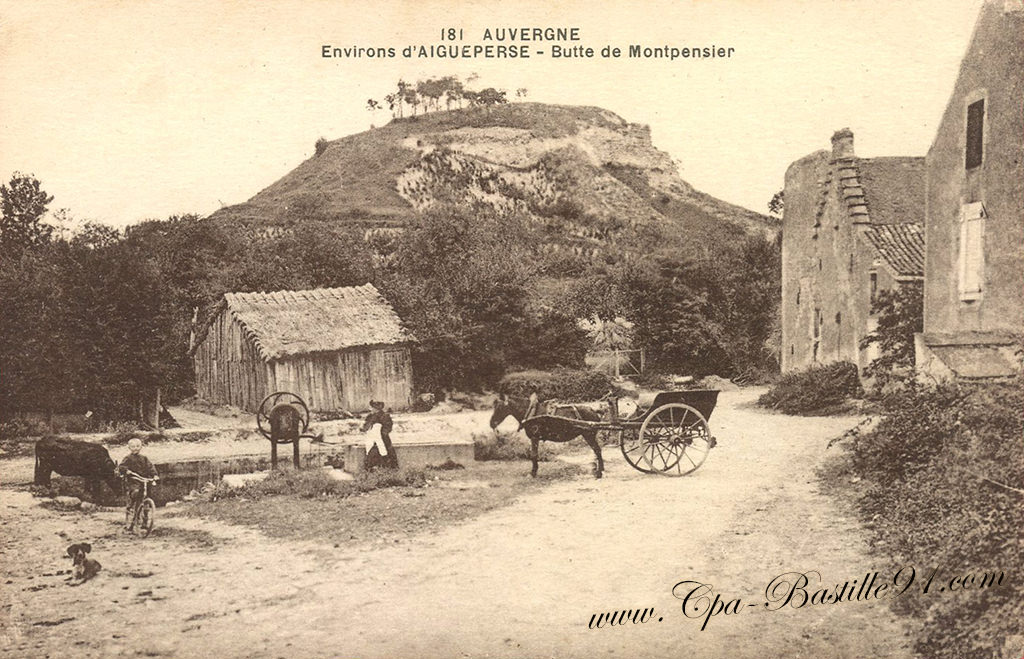Chronologie des temps
Un très très très long voyage qui commence dans la nuit des temps. Intéressant toutefois pour permettre de comprendre le développement du monde, comment tout cela a commencé et s'est développé jusqu'à nos jours.... Bon voyage !
39 - De 1096 (Première croisade) à 1121 (Querelle des universaux)
► 1096 avril Départ d'une "armée de pèlerins", marquant le début de la première croisade. La première croisade eut lieu de 1096 à 1100, sous le pontificat d'Urbain II : prêchée par Pierre l'Ermite, puis par Urbain lui-même, elle eut pour chefs Godefroy de Bouillon (Les Enfances de Godefroy de Bouillon), Eustache et Baudouin, ses frères; Hugues de Vermandois, Robert II, duc de Normandie, Boémond, prince de Tarente, Tancrède, son neveu, et Raymond de Toulouse. Les faits les plus importants de l'expédition sont la bataille de Dorylée (1097), où les Musulmans furent entièrement défaits; la prise de Nicée, d'Édesse (1097), d'Antioche (1098) et celle de Jérusalem (1099). Les Croisés formèrent à Jérusalem un royaume chrétien, dont ils déférèrent la couronne à Godefroy de Bouillon; et dans les villes voisines plusieurs principautés, où régnèrent les autres chefs des croisés.
► 1096 - 15 août Départ des armées régulières pour la Ière Croisade. Une armée bien organisée, avec à sa tête Godefroy de Bouillon, part pour la Terre sainte à l'instigation du pape Urbain II. Ce dernier a assuré : “Et ils deviendront des soldats, ceux qui, jusqu'à ce jour, furent des brigands ; ils combattront légitimement contre les barbares, ceux qui se battaient contre leurs frères et leurs cousins ; et ils mériteront la récompense éternelle, ceux qui se louaient comme mercenaires pour un peu d'argent”. Godefroy de Bouillon, fils d'Ide d'Ardenne, héritière des ducs de Basse-Lorraine et d'Eustache II, comte de Boulogne, au royaume de France, Godefroy de Bouillon est un descendant de Charlemagne et, comme son illustre ancêtre, un personnage de légende.
Godefroy est né fils cadet en 1060. Son oncle Godefroy III le Bossu lui lègue en 1076 son duché de Basse-Lorraine, mais l'empereur d'Allemagne le prive de cet héritage et ne lui concède que le marquisat d'Anvers, où se trouve la terre de Bouillon (1076). Godefroy se range néanmoins aux côtés d'Henri IV du Saint-Empire dans la lutte qui oppose l'empereur germanique et le pape Grégoire VII. Touché par le comportement du jeune homme et pour le récompenser de ses fidèles et loyaux services, l'empereur germanique le reconnaît duc de Basse-Lorraine, ou Lothier, en 1089. L'un des premiers à répondre à l'appel d'Urbain II, en 1095, Godefroy de Bouillon devient aussi l'un des principaux chefs de la première croisade.
En 1096, pour financer son départ, il vend son domaine de Bouillon à Otbert, prince-évêque de Liège. Les armoiries du duché de Bouillon sont visible dans le blason de la Principauté de Liège. Parti de Vézelay avec une suite nombreuse, il passe par Ratisbonne, Vienne, Belgrade et Sofia, arrive à Constantinople, et se heurte aussitôt à Alexis Comnène... Il est au premier rang lors de la prise de Jérusalem en 1099. La couronne de roi de Jérusalem lui est proposée après la prise de la ville mais il la refuse, arguant que seul le Christ est autorisé a porter ce titre. Il est donc fait Avoué du Saint-Sépulcre. Il meurt l'année suivante et son frère Baudouin, qui avait aussi participé à la croisade, devient roi.
► 1096 à 1099 - Première croisade : elle comprit deux expéditions: d'abord Pierre l'Ermite et Gautier Sans-Avoir, pauvre gentilhomme bourguignon, partirent à la tête d'une masse confuse, indisciplinée, ignorante et dénuée de tout: ces bandes à peu près désarmées et affamées, traversèrent péniblement l'Europe, trouvèrent à Constantinople un accueil qui les réconforta sans les rendre plus redoutables et passèrent en Asie où le sultan de Nicée, à la bataille de ce nom, les tailla en pièces.
La deuxième expédition ne comprenait que des gens aguerris et pourvus, en armes et en approvisionnements, de ce qui leur était nécessaire: c'était une véritable armée, qui marcha en bon ordre sous le commandement de Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine. Cette expédition rencontra en Asie de grandes difficultés; néanmoins, après s'être emparée des villes de Nicée, Tarse, Antioche, elle assiégea et prit Jérusalem. Godefroy de Bouillon en fut proclamé roi (1099), et y promulgua, d'accord avec les seigneurs qui l'accompagnaient, les Assises de Jérusalem, qui instauraient en Asie la féodalité européenne. Le nouvel État dura jusqu'en 1187, époque à laquelle il fut détruit par le sultan Saladin.
► 1096 - 21 octobre L'armée "populaire" est anéantie par les Turcs prés de Nicée. “Croisade des pauvres”. Sous la conduite de Pierre l'Ermite et Gautier Sans Avoir, c'est une troupe de gueux qui tente de gagner la Terre sainte, où elle sera mise en pièce. Nicée est une ville d'Anatolie (Turquie)
► 1096 à 1141 - naissance et mort de Hugues de Saint-Victor. Théologien et philosophe français, auteur du 'Didascalicon' et du 'De sacramentis' qui assure le rayonnement de l'abbaye de Saint-Victor de Paris comme école.
► 1097 26 juin Les Croisés s'emparent de Nicée.
► 1097 1er juillet Victoire des Croisés à Dorylée contre les Turcs. La bataille de Dorylee opposa les croisés aux turcs en 1097.
► 1097 21 octobre Début du siège d'Antioche. Antioche est une ville de Turquie proche de la frontière syrienne. Elle est située au bord du fleuve Oronte.
► 1098 21 mars Fondation de l'abbaye de Cîteaux. Robert de Molesme fonde l'abbaye pour y prêcher un retour à la doctrine de Saint Benoît : pauvreté, travaux des champs et uniformité. L'ordre de Cîteaux est né. L'ordre de Cîteaux, également connu sous le nom d'ordre cistercien ou encore de saint ordre de Cîteaux est un ordre monastique catholique réformé, fondé en 1098 à l'abbaye de Cîteaux par Robert de Molesme pour suivre la Règle de Saint Benoît. Le plus célèbre des cisterciens n'est autre que saint-Bernard, à qui l'ordre doit son considérable développement de la première moitié du XIIe siècle.
Les monastères cisterciens se distinguent par la simplicité et la sobriété de l'architecture et des ornements. La robe est blanche avec un capuchon noir. Le symbole de l'ordre est la feuille d'eau (Cîteaux). Des couvents de religieuses cisterciennes ont été établis ; l'un des plus célèbres est celui de Port-Royal. Robert de Molesme (v.1029–1111), moine et réformateur français, considéré comme saint par l'Église catholique romaine. Règle de Cîteaux. Il s'agit de la règle bénédictine appliquée dans toute sa rigueur par les moines de l'abbaye de Cîteaux, fondée par Robert de Molesme en 1098 : retrait du monde, extrême pauvreté, culture de la terre et copie de manuscrits.
► 1098 - 3 juin Les Croisés s'emparent d'Antioche et se retrouvent piégés dans la ville.
► 1098 - 28 juin Victoire de Kerbogha, émir de Mossoul, permettant la libération des troupes assiégées dans Antioche. Kerbogha était l'Atabeg de Mossoul. C'était un chef de guerre qui jouissait d'une grande renommée mais il dut subir une cuisante défaite lors de la première croisade. Mossoul, ville d'Iraq sur les deux rives du Tigre.
► 1098 à 1179 - naissance et mort de Hildegarde von Bingen, Sainte Hildegarde. Sainte allemande, fut l'une des grandes figures du XIIe siècle, voire de tout le Moyen Âge. Hildegard (sainte Hildegard, bien qu'elle ne fut jamais canonisée) écrivit un traité de science et de médecine, qui fait preuve d'un sens de l'objectivité et de l'observation rare dans ces temps-là. Elle écrivait également des poèmes, et de la musique. Sainte Hildegarde de Bingen est confiée aux Bénédictines alors qu'elle n'a que huit ans, en 1105. Elle a des visions qu'elle note méticuleusement dans un petit carnet qui donnera son 'Livre des subtilités et des créatures divines'.
► 1099 Le roi Philippe Ier associe à la couronne son fils Louis, né de Berthe de Hollande en 1081: ce sera dans l'histoire, Louis VI le Gros, surnommé aussi le Batailleur et l'Éveillé. Louis VI de France, dit Louis le Gros, né le 1er décembre 1081 à Herbst, mort le 1er août 1137. Il fut roi de France de 1108 à 1137, cinquième de la dynastie dite des Capétiens directs.
► 1099 - 7 juin Les armées Croisées arrivent devant Jérusalem.
► 1099 - 8 juillet Procession autour de Jérusalem.
► 1099 - 14 juillet Échec du premier assaut contre Jérusalem.
► 1099 - 15 juillet Prise de Jérusalem par les croisés qui vont se livrer au pillage et au massacre de la population. Godefroy de Bouillon prend la ville sainte en ce vendredi, à trois heures de l'après-midi. Son beau-frère Baudouin de Boulogne fonde le royaume latin de Jérusalem. La population musulmane de la ville est massacrée pendant deux jours. Les Juifs sont brûlés vifs dans la synagogue où ils s'étaient réfugiés. Baudouin de Boulogne (v. 1065-2 avril 1118), comte d'Édesse de 1098 à 1100 puis roi de Jérusalem, Baudouin Ier, de 1100 à 1118. Troisième fils d'Eustache II, comte de Boulogne et de Sainte Ide de Boulogne.
► 1099 Godefroy de Bouillon proclamé roi de Jérusalem. Les croisés, après avoir pris Nicée, Antioche, Tarse, ont pris Jérusalem le 15 juillet précédent. Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, et le légat du pape écrivent au pape Urbain II : “Si vous désirez savoir ce qu'on a fait des ennemis trouvés à Jérusalem, sachez que dans le portique de Salomon et dans le temple, les nôtres chevauchaient dans le sang immonde des Sarrasins et que leurs montures en avaient jusqu'aux genoux”.
► 1099 - 12 août Victoire des armées croisées à Ascalon contre les armées égypto-turques. Ascalon site balnéaire en Israël, proche de Gaza, sur la côte méditerranéenne.
► 1100 - 15 juillet Mort de Godefroy de Bouillon, avoué du Saint-Sépulcre à Jérusalem, son frère Baudouin lui succède.
► 1100 Rattachement de Bourges et Dun-le-roi au domaine royal. Eudes Arpin, vicomte de Bourges, partant pour la Croisade, vendit son fief au roi pour 60 000 écus d'or. Depuis cette époque, les pays qui forment le département du Cher demeurèrent directement soumis à l'autorité royale.
► 1100 à 1200 - Écriture gothique. L'écriture gothique ou lettre noire est une déformation de la minuscule caroline. On écrivait alors avec une plume à pointe coupée. Plus étroite que la caroline, donc prenant moins de place sur les parchemins coûteux, l'écriture gothique apparaît au XII° siècle en Allemagne. Ces caractères seront conservés par ce pays jusqu'au milieu du XX°. Dès la fin du XIX° siècle, les copistes florentins jugent les gothiques illisibles. Ils reprennent la caroline et la modifient. Ils créent l'humanistique (dite aussi l'italique) qui devient la base de nos écritures modernes.
► 1100 à 1532 - L'empire Inca (Pérou). L'empire inca s'étendait à son apogée de l'actuelle Colombie jusqu'à l'Argentine et au Chili, par delà l'Équateur, le Pérou, la Bolivie. Les Incas formèrent un des trois grands empires de l'Amérique précolombienne. L'empire inca regroupait de nombreux peuples différents et jusqu'à plus de 700 langues différentes furent parlées sur son territoire ; cependant les Incas imposèrent le quechua comme langue officielle. Ils vécurent du XIe siècle au XVIe siècle. La fin de l'empire inca coïncide avec la mort du dernier empereur lors de la conquête espagnole en 1533.
► 1100 à 1150 - naissance et mort de Marcabru, poète et troubadour. Le troubadour enchanta les cours de France et de Castille. Surtout grâce à un "tube", célèbre dans les années quarante (du XIIe siècle) et intitulé "le chant du lavoir", dont l'air et les paroles sont une exhortation à partir en croisade.
► 1100 vers - La Chanson de Roland. Elle est célèbre dès le Moyen Âge : il en existe plusieurs versions, ainsi que des remaniements datant de diverses époques. Le récit, inspiré par un référent historique, la bataille de Roncevaux (778), est savamment composé en deux fois deux parties : la mort de Roland (la trahison, la bataille) et la vengeance de l'Empereur (le châtiment des païens, le châtiment de Ganelon), encadrées par une exposition et une double conclusion. L'unité de l'ensemble est renforcée par de nombreux parallélismes, contrastes et échos.
Certains passages pourtant très sobres possèdent une grande intensité dramatique et sont restés justement célèbres (la mort de la belle Aude ou celle de Roland). Comme toutes les chansons de geste, la Chanson de Roland comporte une forte charge idéologique, mais c'est également une peinture assez fine des tensions internes de la société féodale (entres vassaux et suzerain, entre l'ambition personnelle et le dévouement), ainsi qu'un drame humain : en dépit du caractère un peu stylisé des personnages, la subtilité des caractères explique et implique le déroulement inéluctable des événements.
La Chanson de Roland est un poème épique et une chanson de geste de la fin du XIe siècle attribué à Turold (Ci falt la geste que Turoldus declinet). Neuf manuscrits du texte nous sont parvenus, dont un (manuscrit d'Oxford) est en anglo-normand. Ce dernier, redécouvert par l'abbé de La Rue en 1834, est considéré par les historiens comme étant l'original. La Chanson de Roland comporte environ 4000 vers en ancien français répartis en laisses, transmis et diffusés par voie orale. Elle relate, trois siècles après, le combat fatal du chevalier Roland (ou Hroudland), marquis des marches de Bretagne et de ses fidèles preux contre une puissante armée maure à la bataille de Roncevaux puis la vengeance de Charlemagne.
► 1100 à 1160 - naissance et mort Pierre Lombard, ou encore Petrus Lombardus, enseignant et religieux. Plus connu sous le nom du Maître des sentences, il est né à la fin du XIe siècle près de Novarre, en Lombardie (d'où son nom). L'Abbé de Cluny le fit admettre à l'école de Reims, puis il se rendit à Paris où il fût d'abord longtemps professeur à l'Université, pour devenir ensuite évêque de Paris. Dans la cadre de son enseignement, il élabora, suite à une originale méthode basée sur les Questions / Discutions, une méthode scolastique aux fins de l'enseignement des Maîtres de l'Université, le "Livre des Sentences" (1152), où pour la première fois, dans l'enseignement universitaire, on faisait la distinction entre l'Écriture et la Théologie ; ce livre, cette Somme, servit de modèle à Thomas d'Aquin.
► 1102 La Croatie intégrée à la Hongrie. Moins de deux siècles après sa proclamation, le Royaume Croate perd sa souveraineté. Rongé de l'intérieur dès la mort de Tomislav par des guerres intestines en vue de la succession, l'État a progressivement perdu sa puissance militaire ainsi que certains territoires. Ainsi après une lourde défaite en 1097, les Croates passent un accord avec la Hongrie : les "Pacta Conventa". Ainsi, le roi de Hongrie Koloman devient-il le roi de Croatie. Toutefois celle-ci conservera un gouverneur et une assemblée autonomes. L'État autonome croate disparaît ainsi pour près de neuf cent ans. Koloman le Bibliophile Arpad, né entre 1065 et 1070, décédé le 3 février 1116, inhumé à Székesfehérvar, fut roi de Hongrie en 1095 et de Croatie en 1105. Il est le fils de Géza Ier et de Synadena Synadène.
► 1104 Abrogation de l'excommunication de Philippe Ier par le pape Pascal II. Pascal II, de son vrai nom Rainier de Bieda, est né à Ravenne vers 1050. Il fut pape du 13 août 1099 au 21 janvier 1118, lutta contre les empereurs Henri IV du Saint-Empire et Henri V du Saint-Empire et créa l'Ordre des Chevaliers teutoniques et l'Ordre des Templiers.
► 1104 Mariage de Louis (futur Louis VI), fils de Philippe Ier avec Lucienne de Rochefort. Lucienne de Rochefort-Monlhéry, appelée aussi Lucianne, est la fille de Guy Ier le Rouge, seigneur de Rochefort et d'Élisabeth de Crécy. La famille des Rochefort étant de plus en plus puissante en Ile-de-France, le roi Philippe Ier compte réduire son influence en s'emparant de leurs seigneuries, mais Bertrade de Montfort, qui compte faire alliance avec les Monlhéry pour placer sur le trône son fils, et ce au détriment de Louis, héritier du trône, propose de marier Louis VI le Gros à Lucienne.
Les fiancailles ont donc lieu en 1104, malgré la réticence de l'époux. Pourtant, une autre famille puissante, les Garlande font valoir à Louis VI les desseins de sa belle-mère, et celui-ci décide de casser l'alliance en faisant appel au Pape Pascal II, lors du concile de Troyes en 1107, prétextant des liens de consanguinité. Ce divorce marque la disgrâce définitive des Rochefort, cependant Lucienne aurait eu une fille avec le futur roi, Isabelle de France (v. 1105-apr. 1175) qui épouse av. 1119, un cousin, un certain Guillaume de Vermandois. Plus tard, Lucienne épouse le seigneur Guichard III († 1137), sire de Beaujeu.
► 1106 - 28 septembre La Normandie retrouve l'Angleterre à Tinchebray. Après la mort de Guillaume le Conquérant, le royaume anglo-normand fut provisoirement partagé, l'Angleterre revenant à Guillaume le Roux et la Normandie à son frère Robert Courteheuse. Mais après la mort douteuse du souverain anglais, victime d'un accident de chasse, c'est le dernier fils de Guillaume le Conquérant, Henri, qui s'empare de la couronne d'Angleterre, la soufflant à un Robert impopulaire.
Cette guerre fratricide se termine lors du combat de Tinchebray, en Normandie. Henri Ier d'Angleterre inflige une sévère défaite à son frère Robert, le fait prisonnier et prend le commandement de la Normandie. Celle-ci est à nouveau rattachée à l'Angleterre. La bataille de Tinchebray a eu lieu le 28 septembre 1106, dans la ville de Tinchebray en Normandie, entre des troupes de l'envahisseur Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre, et celle du duc de Normandie, son frère aîné Robert Courteheuse. Cette bataille s'est soldée par une victoire décisive d'Henri Beauclerc, qui lui permit de rattacher la Normandie à l'Angleterre, ce qui n'était plus le cas depuis la mort de leur père Guillaume le Conquérant en 1087.
La Normandie restera une possession de la couronne d'Angleterre jusqu'en 1204. Henri Ier d'Angleterre (v. 1068 – 1er décembre 1135), appelé Beauclerc à cause de ses intérêts d'études, était le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant. Il régna comme roi d'Angleterre de 1100 à 1135, succédant à son frère, Guillaume le Roux. Il était aussi connu comme Lion de Justice. Son règne est connu pour les limitations des pouvoirs de la couronne, ses améliorations dans les rouages du gouvernement, sa réunification des territoires de son père, et sa décision controversée de choisir sa fille comme héritière.
► 1107 Concile de Troyes annulant le mariage de Louis VI et Lucienne. Lucienne de Rochefort-Monlhéry (dates de vie inconnues), appelée aussi Lucianne, est la fille de Guy Ier le Rouge, seigneur de Rochefort et d'Élisabeth de Crécy.
► 1108 Les communes étaient les villes qui, ayant obtenu de leur suzerain une charte d'autonomie, sanctionnée par le roi, s'administraient et se gardaient elles-mêmes. Leur émancipation ne pouvait que restreindre le pouvoir féodal, aussi fut-elle toujours favorisée par les rois de France, auquel elles étaient reconnaissantes de leur appui moral. A l'émancipation des communes remonte la naissance de la bourgeoisie et la formation du Tiers État. Les premières communes affranchies furent: Le Mans en 1066, Cambrai en 1076; ensuite, parmi les plus importantes, Laon et Amiens en 1111.
► 1108 - 29 juillet Mort de Philippe Ier à Melun, son fils Louis VI le Gros lui succède. Diminué et impotent, le roi Philippe Ier meurt dans son château à Melun. Déjà associé au trône, son fils et successeur Louis VI gouverne seul depuis 1101.
► 1108 LOUIS VI le Gros (1108-1137)
► 1108 Louis VI le Gros l'était effectivement ses parents l'étaient déjà et son appétit fit le reste mais ses autres surnoms montrent les qualités de ce roi qu'on appela aussi - le père des communes - le batailleur - le grand - l'éveillé - le justicier. Louis VI le Gros succède à son père en 1108. Il est couronné à Orléans. Il s'attache tout d'abord à fortifier son autorité dans le domaine royal en luttant contre les seigneurs pillards tels que Hugues du Puiset dont il rasera le château en 1118 et Thomas de Marle seigneur de Coucy qui finira par se soumettre. Il interviendra également en dehors de son domaine, dans les affaires de certains fiefs notamment en Bourbonnais (1109) en Auvergne (1122 - 1126) en Flandres (1128). Certains féodaux ont refusé de lui prêter hommage lors du sacre, notamment les ducs de Normandie (Henri Ier d'Angleterre) et d'Aquitaine (Guillaume IX de Poitiers).
La guerre contre Henri Ier de Beauclerc duc de Normandie et roi d'Angleterre débute dès 1109 et Louis perd devant le roi d'Angleterre. Il s'en suit une succession de luttes autour de Gisors et du Vexin qui conduisent le roi d'Angleterre à s'allier à son gendre l'empereur du Saint-Empire Germanique, Henri V. La menace d'invasion étrangère, suscite un sentiment national français. Louis VI sous l'étendard de Saint Denis à la tête d'une grande armée attend Henri V. Henri V rebrousse chemin et Louis en tire un grand prestige. C'est vers 1112 que Paris prend le pas sur Orléans et devient la capitale du royaume de France.
C'est dans l'abbaye de Saint Denis que Louis VI dépose sa couronne. L'armée française adopte son cri de guerre "Montjoie-Saint-Denis". Le duc de Normandie, préparant sa succession, marie sa fille Mathilde au comte d'Anjou Geoffroy le Bel dit Plantagenêt (Geoffroy V d'Anjou). Il meurt en 1135. La guerre qui s'amorce entre les deux prétendants à sa succession Geoffroy V d'Anjou et Étienne de Blois (neveu du Duc) sert les intérêts de Louis VI. C'est à cette période que le duc d'Aquitaine se soumet également.
La paix régnant, les progrès de l'agriculture: on ferre les chevaux, le collier permet une meilleur exploitation de la force de l'animal, la charrue, l'outillage métallique, les techniques de culture, améliorent les rendements et assurent une certaine prospérité. Louis VI, conseillé par son ami l'abbé Suger excellent administrateur pressentant un mouvement d'évolution, accorde à certains villages de s'organiser autour d'un maire et de sages. Le village bénéficiera d'une assez large autonomie administrative et judiciaire.
En 1110 et les quelques années qui suivent on comptera 82 villages dans le domaine royal à en bénéficier. Paris reçoit sa charte en 1121. La reconstruction de l'abbaye de Saint Denis commandée par l'abbé Suger commence en 1132. Cette date marque le début du style gothique et de la diffusion des vitraux, technique mise au point en Allemagne. Le règne de Louis VI fait apparaître un affermissement du pouvoir des Capétiens Louis VI assure sa succession en faisant couronner son fils Louis (Louis VII) en 1131 (son fils aîné Philippe vient de mourir d'une chute de cheval dans les rues de Paris) et le marie à Aliénor d'Aquitaine ce qui permet d'agrandir le domaine royal jusqu'aux Pyrénées. Louis VI meurt en 1137.
► 1108 - 3 août Sacre de Louis VI le Gros. Surnommé ainsi à cause de son obésité et de sa taille de géant, le fils de Philippe Ier est sacré ce jour à Orléans. C'est un roi dans la force de l'âge, qui exerçait déjà une régence de fait sur son père depuis sept ans, qui monte sur le trône.
► 1108 Avènement de Louis VI. - Ce prince turbulent, mais brave et intelligent, passa son règne à batailler pour agrandir le royaume et affermir la royauté. Tous ses efforts tendirent à réduire, avec l'appui du clergé et des villes, les privilèges des grands vassaux, à faire régner l'ordre dans le royaume, et à établir une administration centralisatrice. Dès son avènement, il partit en guerre contre les seigneurs de Montlhéry et du Puiset qui ravageaient les campagnes à leur portée et détroussaient pèlerins et voyageurs: il s'empara de leurs repaires et les détruisit.
► 1108 à 1124 - Le règne de Louis VI fut marqué surtout par l'activité que prit le mouvement communal, qu'il favorisa et dont il fit profiter la monarchie, mais sans y prendre directement part.
► 1113 Le pape érige en ordre indépendant l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem (hospitaliers) fondé par Gérard Tencre. Ordre hospitalier, l'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, plus communément appelé, suivant les époques, Ordre de l'Hôpital, Ordre hospitalier, Ordre de Rhodes, Religion ou Ordre de Malte, est une organisation catholique souveraine à vocation humanitaire, créée au milieu du XIe siècle par des Latins originaires d'Amalfi (Campanie) du monastère Saint-Jean-l'Aumônier à Jérusalem.
L'origine de l'Ordre est au monastère Sainte-Marie-des-Latins, fondé à Jérusalem au milieu du XIe siècle par des marchands amalfitains. Vers 1080, Gérard Tenque, supérieur du monastère crée un "hôpital" ou hospice, dédié à saint Jean, à côté du monastère. Le rôle de cet hospice est d'accueillir et de soigner les pèlerins chrétiens venus accomplir le "voyage de Terre Sainte". Jérusalem est alors sous domination musulmane.
La première Croisade de 1099 fait passer la ville sous la domination chrétienne, mais renforce l'insécurité dans la région. Les frères hospitaliers, reconnus comme ordre monastique le 15 février 1113 par le pape Pascal II, deviennent vite des chevaliers hospitaliers. C'est le second ordre militaire de Terre Sainte après les Templiers fondés vers 1120. C'est le maître Hospitalier Raymond du Puy (mort vers 1160) qui transforme l'Ordre charitable en ordre militaire. Sur sa demande le pape Innocent II attribue aux Hospitaliers le drapeau à croix blanche en 1130 pour les différencier des Templiers qui portent la croix rouge.
► 1113 Construction du temple d'Angkor Vat. Angkor Vat est le plus grand et le plus harmonieux des temples du complexe monumental d'Angkor, au Cambodge. C'est un des exemples les mieux conservés d'architecture khmère. Angkor Vat fut construit par le roi Suryavarman II dans la première moitié du XIIe siècle.
► 1113 Albertus Magnus dans son 'De vegetalis' différencie les plantes à partir de la structure de la tige. Albertus Magnus, Albert le Grand, ou encore Albrecht von Bollstädt est un savant, philosophe et théologien germanique né à Lauingen en Souabe entre 1193 et 1206 et mort à Cologne en 1280. Il a introduit dans les universités d'Europe les sciences grecques et arabes.
► 1115 Saint Bernard fonde l'abbaye de Clairvaux (fille de Cîteaux), au nord de Dijon, dans l'Aube et en devient le premier abbé. Sous sa direction, l'abbaye se développe considérablement et devient l'abbaye la plus éminente de l'ordre cistercien, essaimant elle-même rapidement en cent soixante monastères. La rumeur selon laquelle il aurait accompli de nombreux miracles et les sermons éloquents de Bernard attirent de nombreux pèlerins.
L'abbaye de Clairvaux a été fondée en 1115 par le moine cistercien Bernard de Clairvaux qui a été sanctifié quelques années après son décès. Le terrain dédié à l'implantation de l'abbaye fut choisi avec précaution : il fallait de l'eau et du bois. Ce terrain offert par un proche parent de Bernard comprenait ces éléments essentiels à l'organisation d'une abbaye cistercienne. En effet, les cisterciens se doivent de respecter la règle de Saint Benoît qui stipule la vie en autarcie et le respect du voeu de stabilité (enfermement).
► 1115 - 3 août Mariage de Louis VI et Adélaïde de Savoie.
► 1118 - Fondation en Palestine, par Hugues de Payens, de l'ordre militaire et religieux des Templiers. L'Ordre du Temple ou Ordre des Templiers était un ordre religieux et militaire qui fut créé lors des Croisades. Fondé en 1118, il disparaît en 1312. En 1118, neuf chevaliers francs, menés par Hugues de Payns offrent à Baudouin II, roi de Jérusalem de créer un ordre militaire qui protégerait les pèlerins, sous le nom de "Pauvres chevaliers du Christ". Le roi leur accorde une résidence dans son palais situé sur le site de l'ancien Temple de Salomon - aujourd'hui recouvert par la Mosquée Al-Aqsa - et leur nom évolue en "chevaliers du Temple" puis en Templiers. L'ordre est officialisé par la bulle pontificale Omne datum optimum le 29 mars 1139.
Ordre des Templiers. Ordre militaire fondé en 1118 par Hugues de Payns et Godefroi de Saint-Amour lors de la première croisade, et qui a apporté son soutien à Philippe IV le Bel lorsqu'il a dû lutter contre le pape Boniface VIII. Mais en ce tout début du XIVe siècle, les caisses de l'État sont vides. Certains des chevaliers font montre avec ostentation de leur puissance financière. On reproche, qui plus est, à ces moines soldats de n'avoir pas su conserver la Terre sainte. Des bruits courent. On soupçonne l'ordre de contraindre ceux qui veulent y entrer à cracher sur un crucifix, à renier la croix.
Le 13 octobre 1307, dans tout le royaume, les Templiers sont arrêtés sur ordre du roi. Leurs biens sont confisqués. L'acte d'accusation qui est lu dans toutes les provinces du royaume, et qui dénonce aussi bien l'hérésie que les plus terribles crimes, est l'oeuvre de Guillaume de Nogaret, chancelier du royaume. Commence alors un long procès. Le grand maître Jacques de Molay, comme les autres chevaliers, est accusé et comparaît devant le tribunal de l'Inquisition entre le 19 et le 24 novembre 1307. Exemple de questions posées : "Comment les frères ont-ils été reçus au Temple ? Les a-t-on dévêtus et baisés en bout de l'échine, sous la ceinture, sur le nombril et en la bouche, puis invités à pratiquer la sodomie ?" Pour obtenir des aveux, les chevaliers sont soumis à toutes les tortures.
L'un d'entre eux confie : "J'avouerais que j'ai tué Dieu si on me le demandait". Le 3 avril 1312, la Bulle pontificale du pape Clément V, Vox Clamantis, dissout l'ordre des Templiers. Lorsqu'il monte sur le bûcher, le grand maître des Templiers lance, le 19 mars 1314 : "Clément, juge inique et cruel bourreau, je t'ajourne à comparaître dans quarante jours, devant le tribunal du souverain juge". Quarante jours plus tard, le pape Clément V meurt, et le 29 novembre 1314, Philippe IV le Bel meurt à son tour. La Mosquée Al-Aqsa fait partie d'un ensemble de bâtiments religieux situé à Jérusalem.
Selon la tradition musulmane, Mahomet est monté au paradis depuis le Mont en 621, raison pour laquelle la mosquée érigée plus tard à cet endroit est considérée comme le troisième lieu saint de l'Islam. Après le Dôme du Rocher (construit vers 690), la première mosquée fut érigée en bois par les Omeyyades et terminée en 710. Certains éléments montrent que la mosquée fut construite sur les ruines du bâtiment annexe (le Chanuyos) de l'ancien Temple. Détruite par des séismes, elle fut reconstruite au moins cinq fois, la dernière reconstruction majeure datant de 1035. La Mosquée Al-Aqsa est la plus grande de Jérusalem.
► 1118 Campagne de Louis VI contre Thomas de Marle, frappé d'anathème pour pillage d'églises par les conciles de Beauvais et de Soissons. Thomas de Marle (1078 - 1130) était sire de Coucy, seigneur de La Fère. Parti en avril 1096 pour la première croisade, Thomas s'y couvrit de gloire et participa à de nombreuses batailles. Rentré au pays, certainement frustré et déçu du peu de profit d'une si longue expédition en Terre Sainte, Thomas de Marle se mit à ravager et dévaster les régions autour de Laon, d'Amiens à Reims.
Il fut même excommunié par les évêques lors d'un concile tenu à Beauvais en 1114. En octobre 1130, il fut griévement blessé par le comte de Vermandois Raoul Ier le Vaillant lors du siège de Coucy ordonné par le roi Louis VI qui voulait en finir avec les exactions de son vassal. Thomas de Marle rendait l'âme le 9 novembre 1130. L'anathème est une excommunication dite "majeure", c'est-à-dire avec plus de force et de cérémonie que les autres types d'excommunication.
► 1119 - 20 août Défaite de Louis VI à Brémule face à Henri Ier d'Angleterre.
► 1119 Louis VI ayant excité Robert Courteheuse (fils de Guillaume le Conquérant) à exiger de Henri Ier d'Angleterre, le duché de Normandie, Henri s'empara par vengeance de la place de Gisors, mais il fut ensuite battu à Brenneville. La paix de Gisors mit fin à cette courte guerre.
► 1120 à 1170 - naissance et mort de Jaufré Rudel. Troubadour occitan, il est le seigneur de Blaye (surnommé le prince de Blaye), mort vers 1170. Il prit part à la deuxième croisade. Troubadour occitan, il écrit des chansons d'amour au cours de la première moitié du XIIe siècle et chante "l'amour lointain", - c'est-à-dire l'amour impossible et sans espoir, – en célébrant peut-être une dame de Tripoli, bien née et inaccessible.
► 1121 Querelle des universaux. Querelle des universaux, opposant les réalistes, menés par Guillaume de Champeaux, aux nominalistes, représentés par Roscelin, et aux conceptualistes (Pierre Abélard). Le terme "universaux" utilisé comme un nom est une notion métaphysique et plus précisément de la scolastique médiévale. Le philosophe Porphyre, dans son introduction à la Logique d'Aristote définit cinq universaux : le genre l'espèce la différence le propre l'accident. Les universaux sont des types, des propriétés ou des relations et caractérisent ce qui est invariable dans le temps et dans l'espace.
Les universaux s'opposent donc aux particuliers, et sont assimilables, en première approche, à des concepts. Ainsi la chevalinité, la circularité,... sont des universaux. À l'inverse, tel cheval, tel cercle sont des particuliers. Au cours du Moyen Âge, les universaux furent l'enjeu d'une querelle demeurée célèbre. Les écoles s'opposaient sur la question de savoir si les universaux sont de pures conceptions de l'esprit, c'est-à-dire de simples concepts, ou, s'ils sont des idées, assimilables à la conception platonicienne des Idées et ont à ce titre une existence propre.
Cette opposition traverse de part en part l'histoire de la philosophie. Platon, idéaliste, et Aristote, réaliste, ont présenté des thèses opposées. Pour Platon, les Idées existent et sont même la seule réalité. Si la thèse platonicienne a longtemps été dominante voire exclusive, elle fût remise en cause par le chanoine de Compiègne Roscelin, qui affirma que les universaux sont avant tout des abstractions, qui n'ont d'existence que dans l'esprit de celui qui les forme et aux moyens des mots ou des noms dont on les désigne ; ce qui a donné son nom à cette thèse : le Nominalisme.
40 - De 1122 (Expédition de Louis VII) à 1159 (Première Guerre de Cent Ans)
► 1122 Expédition de Louis VII contre le comte d'Auvergne. Le comté d'Auvergne est l'une des plus ancienne seigneuries de France, puisqu'elle a déjà été érigée à la fin de la période romaine. Durant l'ère mérovingienne, il devient même momentanément un duché.
► 1122 à 1204 - naissance et mort de Éléonore d'Aquitaine ou Aliénor est la fille et héritière de Guillaume X, dernier duc d'Aquitaine. Elle deviendra duchesse à la mort de son père en 1137, la même année elle épousa à l'âge de 15 ans le futur roi de France Louis VII auquel elle apporta le duché d'Aquitaine (qui resta cependant distinct du domaine royal malgré les attentes des conseillers du roi qui, comme Suger, avaient envisagé une assimilation rapide de cette principauté au royaume).
Elle va accompagner son époux à la deuxième croisade (1147-1149) et fit scandale en raison de son infidélité présumée (avec son propre oncle Raimond de Poitiers, prince d'Antioche), c'est ce qui aurait poussé Louis VII à ne pas mener une expédition contre Édesse (ville du Sud de l'Anatolie en Turquie) qui aurait soulagé la principauté d'Antioche, ce fut lourd de conséquences puisqu'il aurait pu ainsi lever le principal danger qui pesait sur la Terre sainte et qu'il ne le fit pas). Louis demanda le divorce et l'obtint.
Aliénor se remaria avec Henri II d'Angleterre, alors comte d'Anjou et duc de Normandie. (Il deviendra roi d'Angleterre en 1154 sous le nom d'Henri II). Le domaine d'Aquitaine passait donc sous la domination des Plantagenêt, Aliénor, dont il semble qu'elle fut peu attachée à son mari continua d'administrer le duché (elle maintenait une cour brillante à Poitiers). Lorsque leurs fils se soulevèrent contre leur père (tantôt Richard coeur de Lion, tantôt Jean Sans Terre) elle prit parti pour eux. Henri II la fit emprisonner dans divers châteaux anglais, en particulier à Salisbury.
Elle n'en sortit que lorsque Richard devint roi (en 1189), son fils lui confia le gouvernement lorsqu'il partit pour la troisième croisade (1190). Elle joua aussi un rôle prédominant dans l'avènement de Jean Sans Terre en 1199 (malgré les droits éventuels d'Arthur de Bretagne, fils de son fils aîné). Elle dirigea ensuite la résistance royale contre la rébellion des grands feudataires du duché, que soutenait Philippe Auguste. Malgré son âge, elle déploya une remarquable énergie dans les derniers soubresauts de l'indépendance aquitaine, qui disparut peu après sa mort (elle mourut en l'abbaye de Fontevrault où se trouve encore son tombeau), grâce à l'habileté de Philippe Auguste qui exploita les erreurs politiques de Jean Sans Terre.
► 1122 - 23 septembre : Le concordat de Worms, signé entre Henri V et le pape Calixte II, met fin à la Querelle des Investitures entre Église et États au profit de la papauté. L'empereur renonce à l'investiture spirituelle par la crosse et l'anneau et respecte la libre élection des évêques et abbés. Il obtient la présidence de ces élections et de donner ensuite une investiture par le sceptre par laquelle il remet les biens et les fonctions politiques au nouvel évêque, suivie d'un serment de fidélité. Le concordat de Worms est l'accord qui suspendit la Querelle des Investitures en 1122 et marquant ainsi la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel.
L'empereur du Saint-Empire romain Henri V et le Pape Calixte II convinrent des éléments suivants: les évêques seraient élus par leurs chanoines, mais l'empereur aurait le droit d'exercer une influence discrète sur l'élection en y assistant. L'évêque, une fois élu, recevrait l'investiture spirituelle du Pape sous la forme de la crosse et de l'anneau, et l'investiture temporelle de l'empereur sous la forme d'un sceptre. De fait, ce concordat ne satisfit aucune des deux parties et ne suffît pas à effacer les tensions entre elles; plusieurs empereurs furent ainsi excommuniés par la suite.
► 1122 Pierre le Vénérable devint abbé de Cluny. Pierre le Vénérable, Pierre de Montboissier dit Pierre le Vénérable était un abbé de Cluny dès 1122, né en 1092 et mort en 1157. Lors de son séjour en Espagne, il fait traduire le Coran de l'arabe en latin, afin de pouvoir le réfuter par des arguments écrits, et non par la Croisade, qu'il a condamnée. Il réforme l'abbaye de Cluny, en proie à des difficultés financières. Il réforme le domaine seigneurial pour assurer le train de vie des moines (Dispositio rei familiaris). Les inventaires qui sont constitués (Constitutio expense cluniaci) constitue une précieuse source pour les historiens, avec des données sur les rendements, les semences, les techniques agricoles... A noter le rôle essentiel d'Henri de Blois, évêque de Winchester, dans cet ouvrage.
► 1123 Ier concile du Latran. Le Ier concile du Latran se déroule du 18 mars 1123 au 11 avril de la même année, sur une convocation du pape Calixte II, à la basilique Saint-Jean de Latran. Considéré comme le neuvième concile oecuménique par l'Église catholique, c'est le premier concile général tenu en Occident. Pandolphe, dans sa biographie de Calixte II, mentionne 997 participants, chiffre qui paraît nettement exagéré : on estime ce nombre plutôt à 200 ou 300. Concile du Latran, en 1123, le Ier concile du Latran se tient dans la basilique du même nom, à Rome, siège épiscopal jusqu'au départ des papes pour Avignon. Lors de ce concile présidé par Calixte II, le concordat de Worms – qui met fin à la querelle des Investitures –est confirmé et vingt-deux canons, dont l'interdiction de la simonie, sont promulgués.
La simonie est, pour les chrétiens, l'achat et la vente de biens spirituels, tout particulièrement d'une charge ecclésiastique. Elle doit son nom à un personnage des Actes des Apôtres, Simon le Magicien qui voulut acheter à saint Pierre son pouvoir de faire des miracles (Actes, VIII.9-21), ce qui lui valut la condamnation de l'apôtre : "Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent !".
Simonie. Acte désignant la vente ou le trafic des biens ou des charges du clergé. Le mot "simonie" dérive de celui de Simon le Magicien qui tenta de corrompre l'apôtre Pierre. Le Latran est un site de Rome, appartenant aujourd'hui à l'État de la Cité du Vatican. L'Archibasilique Saint-Jean-de-Latran (San Giovanni in Laterano) qui se trouve à Rome sur la place du même nom, est une église cathédrale, siège de l'évêché de Rome, dont l'évêque n'est autre que le pape. Elle est la propriété du Saint-Siège et bénéficie à ce titre du privilège d'exterritorialité. Elle est considérée comme la « mère » de toutes les églises de Rome et du monde.
► 1124 L'empereur d'Allemagne, Henri V du Saint-Empire, poussé par Henri Ier d'Angleterre, envahit la Champagne. Louis VI se met à la tête des milices communales, porteur de l'oriflamme de Saint-Denis et marche à la rencontre des Allemands, qui ne jugent pas prudent de l'attendre. C'est au cours de cette campagne que devint général pour les Français, le cri de guerre: Montjoie-Saint-Denis. Henri V du Saint-Empire, (1081-1125), roi des Romains 1106 à 1111 puis empereur du Saint-Empire romain germanique de 1111 à 1125.
Il épouse en 1114 Mathilde (1103-1167) fille de Henri Ier Beauclerc et de Mathilde d'Écosse. Fils du précédent empereur Henri IV, il contraignit ce dernier à abdiquer en sa faveur, bénéficiant pour ce faire de l'appui du pape Pascal II. Il entra ensuite en conflit avec ce dernier et fit élire contre lui l'antipape Sylvestre IV. Durant son règne, il dut signer le concordat de Worms (1122), mettant fin à la querelle des Investitures, avec le pape Calixte II.
► 1124 - Prise du Vexin par Henri Ier d'Angleterre. Le Vexin est une région du nord-ouest de la France dont l'origine remonte au découpage des premiers temps du royaume de France. En réalité, le Vexin est plus une entité géographique et naturelle que politique et historique.
► 1124 - Février : La flotte vénitienne fait le blocus de Tyr par mer pendant que l'armée franque assiège à nouveau la ville. La ville manque vite d'eau potable. Les Tyriens, n'attendant rien des Égyptiens, leurs protecteurs habituels, se tournent vers Balak d'Alep, alors en train d'assiéger la forteresse de Manbij, où l'un de ses vassaux est entré en rébellion. Tyr est une ville du sud Liban.
► 1124 - 7 juillet : Tyr se rend aux Francs. Sa population est épargnée.
► 1125 à 1180 - naissance et mort de Bernard de Ventadour, grand poète troubadour. Il est l'un des plus célèbres troubadours. Il se démarque d'autres auteurs par l'expression de sentiments plus personnels de façon simple et imagée plutôt que par un travail formel sur la technique poétique ce qui lui valut d'être pleinement reconnu seulement à partir de l'époque romantique.
► 1126 Nouvelle expédition du roi de France contre le comte de Clermont.
► 1126 à 1198 - naissance et mort de Averroès, à la fois un philosophe, un théologien islamique, un juriste, un mathématicien et un médecin berbère du XIIe siècle. Son ouverture d'esprit et sa modernité déplaisent aux autorités musulmanes de l'époque qui l'exilent comme hérétique et ordonnent que ses livres soient brûlés. Il demeura profondément méconnu jusqu'au XIIIe siècle où son importance fut cependant minimisée. Ce n'est qu'actuellement que les historiens de la philosophie reconnaissent son importance.
Averroès est devenu célèbre notamment au travers de sa conception des vérités métaphysiques. Pour lui, elles pouvaient en effet s'exprimer de deux manières différentes et pas forcément contradictoires : par la philosophie (Aristote, néoplatoniciens) et par la religion. Cette façon de présenter deux catégories de vérités fut perçue de manière hostile par les religieux à l'esprit étroit. Son influence posthume en Islam fut quasi nulle, et c'est à des juifs et des chrétiens qu'on doit la conservation et la traduction de ses oeuvres. Son oeuvre majeure est le 'Tahafut Al-Tahafut' (L'Incohérence de l'Incohérence). Ses commentaires des oeuvres d'Aristote figurent parmi les plus fidèles ; ils furent traduits en latin et en hébreu et eurent une grande influence sur la pensée chrétienne et philosophique dans l'Europe médiévale.
► 1129 - 13 janvier Concile de Troyes sur la création de l'ordre des Chevaliers du Temple. Le Concile de Troyes est un concile de l'Église catholique, qui s'est ouvert à Troyes le 13 janvier 1129, afin de reconnaître officiellement l'Ordre du Temple. A l'automne 1127, Hugues de Payns voulut faire connaître son ordre, qui traversait une crise de croissance, et qu'il souhaitait étendre vers l'Occident. Il partit pour Rome avec cinq compagnons (dont Geoffroy de St-Omer) afin de solliciter du pape Honorius II une reconnaissance officielle.
Celui-ci accepta et convoqua un concile à Troyes. Y étaient présents : le cardinal Matthieu d'Albano (représentant du Pape); l' archevêque de Reims et celui de Sens ; dix évêques; huit abbés cisterciens de Vézelay, Cîteaux, Clairvaux (il s'agit de saint Bernard), Pontigny, Troisfontaines et Molesmes ; et quelques laïcs tels que Thibaut II, le comte de Champagne, André de Baudemont, le sénéchal de Champagne, le comte de Nevers et un croisé de 1095.
► 1129 Mariage de Mathilde, fille de Henri Ier d'Angleterre, avec Geoffroy V d'Anjou, comte d'Anjou. Geoffroy V d'Anjou, Geoffroy Plantagenêt dit le Bel ou Plantagenêt (1113 – 7 septembre 1151, Le Mans), fut comte d'Anjou et du Maine (1129-1151), et plus tard comte de Mortain (1141–1151) et duc de Normandie (1144-1150). Il est surnommé Plantagenêt à cause du brin de genêt qu'il avait l'habitude de porter à son chapeau. Il était le fils de Foulque V († 1143), comte d'Anjou et roi de Jérusalem, et d'Erembourge du Maine († 1126), héritière du Maine.
Il devint le fondateur de la dynastie Plantagenêt des rois anglais par son fils Henri II d'Angleterre. Plantagenêt, surnom d'une dynastie princière dont le premier membre fut Geoffroy V, comte d'Anjou et du Maine (1128-1151) et dont les successeurs régnèrent sur le royaume d'Angleterre de 1154 à 1399. Henri II Plantagenêt (Henri II d'Angleterre) (1151-1189) est peut-être le plus important représentant de cette famille. Fils de Geoffroy, il réussit en l'espace d'une dizaine d'années, à concentrer entre ses mains de nombreux territoires : en 1154, il domine le royaume d'Angleterre, le duché de Normandie, le comté d'Anjou, le comté du Maine le comté de Poitou et le duché d'Aquitaine. Quelques historiens appellent l'ensemble "l'empire Plantagenêt".
► 1130 Couronnement à Palerme du premier roi normand de Sicile, Roger II qui régnera jusqu'en 1154. Roger II de Sicile, roi de Sicile de 1113 à 1154. Son père était Roger Ier, comte de Sicile, dernier fils du fameux aventurier normand Tancrède de Hauteville et sa mère Adélaïde de Montferrat. Il conquiert la principauté de Salerne, puis les Pouilles, mais, beau-frère de l'anti-pape Anaclet, il devient l'ennemi du pape Innocent II, qui appelle contre lui l'empereur Lothaire III. Vaincu, il fait la paix avec le Saint-Siège, dont il se reconnaît le vassal. Il s'empare ensuite de Corfou et de la Tunisie, réserve de mercenaires. Il marie sa fille Constance à Henri VI du Saint-Empire, empereur d'Allemagne, dont le fils Frédéric II du Saint-Empire se proclamera roi de Sicile.
► 1131 Mort de Philippe, fils aîné de Louis VI.
► 1131 - 25 octobre Sacre du futur Louis VII à Reims par le pape Innocent II. Louis VII de France, dit Louis le Jeune, né en 1120, mort en 1180 à Paris, roi des Francs de 1137 à 1180, sixième de la dynastie des Capétiens directs.
► 1131 construction de Cathédrale Notre-Dame de Noyon. La cathédrale Notre-Dame de Noyon, construite sur le site d'une église incendiée en 1131, est chronologiquement la première cathédrale construite en France, avant les cathédrales de Laon et Paris. Elle constitue un bel exemple de transition architecturale entre le Roman et le Gothique.
► 1132 Construction de la basilique de Saint-Denis, un des plus anciens monuments de style "gothique" (1132-1144). Pose de la première pierre du chevet de style gothique de la basilique de Saint-Denis par l'abbé de Saint-Denis Suger. Dans la première moitié du XIIe siècle, l'abbé Suger, conseiller de Louis VI le Gros et de Louis VII le Jeune, détruisit l'église carolingienne et fit édifier une église gothique.
Avec lui, l'abbaye devint encore plus importante; elle abrita les regalia (instruments du sacre), devint nécropole royale et plus seulement dynastique. Depuis Hugues Capet, elle est considérée comme la principale nécropole de la monarchie française. La basilique Saint-Denis est une église de style gothique située à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis (93). Elle a le statut de cathédrale depuis 1966. Depuis Hugues Capet, elle abrite les tombeaux des rois de France sauf celui de Philippe Ier (inhumé au monastère de Saint-Benoît-sur-Loire).
► 1135 A la mort de Henri Ier d'Angleterre, Étienne, comte de Blois, petit-fils par sa mère de Guillaume le Conquérant, s'empare de la couronne au détriment de Mathilde, femme de Geoffroy V d'Anjou. Début du règne d'Étienne de Blois, roi d'Angleterre (fin en 1154). Henri Ier d'Angleterre meurt sans laisser de fils. Son neveu Étienne de Blois parvient à se faire couronner. Mais sa faiblesse et les concessions dont il avait payé l'appuis du clergé et des barons multiplie les révoltes, aggravés par les interventions écossaise.
Ses réactions d'une violence excessive permettent à Mathilde, fille d'Henri Ier Beauclerc et épouse de Geoffroy V d'Anjou, spoliée du trône d'Angleterre, d'intervenir et de se faire reconnaître comme reine. Mais un nouveau retour de fortune ramène Étienne sur le trône. Mathilde se maintient en Normandie. Étienne de Blois (1096 - 25 octobre 1154), sire d'Eye, comte de Boulogne et de Mortain, roi d'Angleterre de 1135 à 1154. Il abdiqua peu avant sa mort en faveur de son cousin issu de germain Henri II Plantagenêt.
► 1135 contruction de la Cathédrale Saint-Étienne de Sens. La cathédrale Saint-Étienne de Sens, est considérée comme la première des cathédrales gothiques. Vers 1135, l'archevêque Henri Sanglier décide de remplacer la cathédrale du Xe siècle, par un édifice grandiose et digne de l'importante métropole sénonaise. Au moment où s'élèvent partout des constructions romanes, Henri Sanglier appelle un architecte novateur qui va proposer une conception révolutionnaire du voûtement, la croisée d'ogives. Naît alors une cathédrale ample, d'un volume simple et continu, constituée d'un vaisseau central et de deux collatéraux. Le chantier ne s'achève à la façade occidentale qu'à la fin du XIIe siècle. Entre 1490 et 1517, on entreprend la construction, dans un gothique flamboyant, d'un grand transept dont les travaux sont confiés à un important maître d'oeuvre parisien, Martin Chambiges.
► 1135 à 1183 - naissance et mort de Chrétien de Troyes, écrivain français du Moyen Âge. On connaît très peu de choses sur lui. On suppose qu'il est né à Troyes, qu'il est issu de la bourgeoisie et qu'il a effectué des études classiques, il aurait notamment appris le grec. Il est à peu près certain qu'il a vécu à la cour de Marie de Champagne. Il est considéré comme un des premiers auteurs de romans de chevalerie où mythe et folklore s'unissent admirablement pour former des récits de quête.
Il est l'initiateur de la littérature courtoise en France : 'Érec et Énide', 'Cligès', 'Lancelot ou Le Chevalier de la Charrette', 'Yvain ou le Chevalier au lion', 'Perceval ou Le Conte du Graal'. Arthur, héros de nombreuses légendes médiévales, est le fils adultérin du roi Uter Pendragon et de la reine Ygerne. Chef militaire des Bretons (Britons), il lutta contre l'envahisseurs saxon vers l'an 500. Devenu légendaire, il représente le roi idéal venu rétablir dans leur puissance les Bretons divisés. Chantée par les bardes gallois puis par divers auteurs de chroniques (Nennius, Geoffrey de Monmouth), sa geste fut développée en France par Wace puis par Chrétien de Troyes qui en fit un portrait moins avantageux que celui de la légende.
Le cycle romanesque qui s'achève avec le célèbre roman 'La Mort le roi Artu' (1215/1235) a largement contribué à diffuser l'image traditionnelle du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde. Arthur est le fils du roi Uter Pendragon et de la duchesse Ygerne de Cornouailles. Sa mère avait été mariée une première fois à Gorlois, duc de Cornouailles et vassal d'Uter. Mais un soir, grâce à Merlin, Uter prend l'apparence du duc et partage la couche d'Ygerne. Pendant cette même nuit le duc meurt dans une escarmouche hors de son château. Uter épouse alors Ygerne.
► 1135 Geoffroy de Monmouth, évêque de Saint Asaph au Pays de Galles, écrit son 'Histoire des Bretons' (Historia regum Britanniae) source de la légende arthurienne. Geoffroy de Monmouth (Monmouth, vers 1100 - Saint Asaph, 1155), est un évêque et historien gallois, qui a écrit en langue latine. Familier du monastère de Glastonbury. Il est l'auteur de la 'Vita Merlini', 'des Prophetiae Merlini' et 'de Historia regum Britanniae' (1135) qui est l'un des premiers ouvrags de l'histoire britannique et sera la source de la légende arthurienne.
► 1136 Le célèbre philosophe Pierre Abélard commence à enseigner à l'Université de Paris. Quelques années auparavant (en 1122), ses ouvrages sur la, Trinité avaient été déclarés hérétiques et condamnés par le concile de Soissons.
► 1137 - 25 juillet Mariage de Louis, futur Louis VII, fils aîné de Louis VI avec Aliénor d'Aquitaine, héritière du duché. Par cette union, Louis VII annexe la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, la Marche, l'Angoumois, la Saintonge et le Périgord. Aliénor d'Aquitaine (dite également Éléonore de Guyenne), née en 1122 et morte le 1er avril 1204, à l'abbaye de Fontevraud, près de Saumur, est une femme qui joue un rôle pivot dans l'occident du XIIe siècle : duchesse d'aquitaine, elle épouse successivement le roi de France Louis VII, puis le futur roi d'Angleterre, Henri II d'Angleterre, renversant le rapport des forces en apportant sa dot à l'un puis à l'autre des rois. Elle tient une cour fastueuse dans son domaine aquitain, y jouant un rôle de mécène pour les troubadours.
► 1137 - 1er août Mort de Louis VI à Paris. Son fils Louis VII lui succède.
► 1137 LOUIS VII le Jeune (1137-1180)
► 1137 Louis VII le Jeune. Deuxième fils de Louis VI le Gros, Louis VII a été éduqué par l'abbé Suger. On le marie à Aliénor d'Aquitaine qui apporte en dot notamment la Guyenne, le Poitou, la Gascogne, mais les noces sont écourtées par la mort de Louis VI. Dés le début de son règne Louis est confronté à une grave crise avec le Pape et avec Thibaud de Champagne à propos de la nomination de l'Archevêque de Bourges (1142-1144). Finalement il devra se soumettre par le traité de Vitry.
Pour expier ses fautes et notamment l'incendie de Vitry et de son église dans laquelle périrent de nombreuses victimes, il décide de participer à la seconde croisade en Terre Sainte. Aliénor l'accompagne, Louis va perdre son armée, la croisade est un échec et apparaît un début de mésentente entre les époux. La régence est assurée par Suger. Suger meurt en 1151, et Louis fait annuler son mariage avec Aliénor par le concile de Beaugency en 1152. Aliénor qui reprend sa dot, se remarie avec Henri II de Plantagenêts comte d'Anjou et de Normandie, qui deviendra roi d'Angleterre en 1154 (Henri II d'Angleterre).
Louis s'inquiète de la puissance du roi d'Angleterre qui possède la moitié de la France. C'est le début d'une longue lutte entre Capétiens et Plantagenêts. Il soutient les ennemis des Plantagenêts, Thomas Becket archevêque de Cantorbéry, puis ses fils révoltés mais il ne parviendra pas à entamer la puissance de son voisin. Le traité de Gisors (1180) mettra fin à ces hostilités. Grâce à Suger, Louis a contribué au renforcement de l'autorité du roi sur l'administration. C'est de cette époque que datent les premières ordonnances. Louis VII meurt en 1180
► 1137 Mort de Louis VI et avènement de Louis VII dit le Jeune (fils de Louis VI et d'Alix de Savoie, né en 1119). Tué en quelque sorte par sa gloutonnerie, qui l'a rendu obèse et lui a valu le surnom de “le Gros”, à cinquante-six ans, Louis VI n'en laisse pas moins le royaume pacifié et bien administré. Sur son lit de mort il dit à son fils, qui va devenir Louis VII : “Souvenez-vous, mon fils, que la royauté n'est qu'une charge publique, dont vous rendrez un compte rigoureux à Dieu, qui seul dispose des sceptres et des couronnes”.
► 1137 - 25 décembre Sacre de Louis VII le Jeune à Bourges.
► 1139 Le concile du Latran II met fin au schisme pontifical (Anaclet), condamne l'usure, la simonie et les tournois. Il proclame que "Rome est la tête du monde" et lance un anathème contre les employeurs d'arbalétriers. Le deuxième concile du Latran, tenu du 4 au 11 avril 1139 sous la présidence d'Innocent II, est considéré comme le dixième concile oecuménique par l'Église catholique romaine.
Le concile convoqué au Latran a d'abord pour but de réparer les déchirures crées par le schisme : Innocent II ouvre la réunion en déplorant le trouble causé par Anaclet dans l'Église, et dépose les évêques schismatiques. Ensuite, il s'agit de poursuivre et parachever l'oeuvre du Ier concile du Latran (1129). Dans un même esprit, Innocent II souhaite donner une plus grande solennité aux décrets des synodes qu'il a lui-même tenus auparavant : à Clermont (1130), Reims (1131) et Pise (1135).
► 1139 - 25 juillet Victoire portugaise sur les musulmans. Le comte du Portugal Alphonse Henriques remporte une victoire décisive sur les Maures à Ourique. Fort de cette victoire, il prend le titre d'Alphonse Ier, roi du Portugal et déclare son royaume indépendant de celui de Léon. Le premier souverain du Portugal poursuivra la reconquête chrétienne des terres portugaises vers le Sud. La bataille d'Ourique a eut lieu dans la campagne d'Ourique, actuel Alentejo (au sud du Portugal) le 25 juillet 1139.
Là s'opposèrent les troupes chrétiennes, commandées par Alphonse-Henriques de Portugal et celles de cinq rois Maures qui étaient affaiblis par des dissidences internes. La victoire chrétienne fut telle qu'Alphonse-Henriques s'auto-proclama roi de Portugal sous le nom d'Alphonse Ier de Portugal avec l'appui total de ses troupes. Alphonse Henriques, Alphonse Ier de Portugal, plus connu par son nom de prince Alphonse Henriques, (né en 1109, traditionnellement le 25 juillet, à Guimarães, mort le 6 décembre 1185 à Coimbra) est le fils d'Henri de Bourgogne et de Thérèse de Leon. Il fut le premier roi de Portugal de 1139 à 1185, et le père entre autres de Sanche Ier de Portugal, son successeur au trône.
► 1140 Concile de Sens condamnant les idées d'Abélard. Saint Bernard, (Bernard de Clairvaux, abbé de Clairvaux), qui juge dangereuse l'influence de la pensée d'Abélard, demande au concile de Sens et au pape Innocent II de le condamner pour le scepticisme et le rationalisme de ses écrits et de son enseignement. Le concile de Sens fut tenu en 1140. Il fut l'objet de discussions théologiques sur les positions d'Abélard. Celles-ci furent considérées comme approximatives et condamnées à l'instigation de saint Bernard. Abélard avait déjà été condamné au concile de Soissons en 1121 pour ses vues peu orthodoxes, notamment au sujet de la Trinité.
► 1140 à 1215 - naissance et mort de Bertrand de Born, troubadour périgourdin. Il écrivit des sirventès (genre poétique provençal, traitant de l'actualité, notamment politique, de façon satirique).
► 1140 Décret de Gratien. Le Décret de Gratien, la papauté n'avait jamais compilé les documents élaborés par l'Église en un millénaire. Vers 1140, Gratien, moine et professeur à Bologne entre 1139 et 1148, rassemble tous les documents qu'il peut trouver, les trie et les classe: c'est le Décret de Gratien, dont le vrai titre est Concordance des canons discordants. Cette mise en ordre du passé de l'Église n'est pas une oeuvre de commande. C'est sur ce socle que va se construire tout le droit canon.
► 1142 Louis VII incendie l'église de Vitry-sur-Marne (1300†) en représailles contre le pape et le comte de Champagne (Thibaut II de Champagne) s'opposant à la révocation d'un évêque. Louis VII le Jeune se brouille avec le Saint-Siège au sujet du titulaire de l'archevêché de Bourges. Le protégé du pape s'étant réfugié auprès de Thibaut II de Champagne, Louis envahit la Champagne (incendie de l'église de Vitry) mais l'évacue après l'intervention du pape. Thibaut II de Champagne, Thibaud de Blois ou Thibaut IV le Grand, né en 1093, mort le 10 janvier 1151, comte de Blois, de Chartres, de Meaux, de Châteaudun et de Sancerre, seigneur d'Amboise (1102-1151), comte de Troyes et de Champagne (Thibaut II 1125-1151), fils aîné d'Étienne-Henri, comte de Blois, Chartres, Châteaudun, Sancerre et Meaux, seigneur d'Amboise, et d'Adèle d'Angleterre, fille de Guillaume le Conquérant, il hérite en 1102 des domaines de son père, qui se fait tuer à la Bataille de Rama, en Terre-Sainte. En 1125, son oncle Hugues Ier de Champagne se fait templier et lui lègue, le comté de Troyes, ainsi que le titre de comte de Champagne que ce dernier s'était créé, bien que ne possédant pas la totalité de la province.
► 1142 mort de Pierre Abélard.
► 1144 - 19 janvier : Geoffroy V d'Anjou prend Rouen.
► 1144 - 20 janvier : Geoffroy V d'Anjou, comte d'Anjou et du Maine est intrônisé duc de Normandie à Rouen.
► 1144 - 11 juin : Consécration du chevet et du choeur de la basilique de Saint-Denis devant le roi de France Louis VII et la reine Aliénor : première voûte gothique de vastes dimensions. Début de l'art gothique.
► 1144 à 1450 - Art gothique. L'architecture gothique est née en Île-de-France dans la deuxième moitié du XIIe siècle, elle se répand rapidement au nord de la Loire et s'impose en Europe jusqu'au milieu du XVIe siècle, où se développe l'architecture classique, sous l'influence de la Renaissance italienne. L'architecture gothique est essentiellement religieuse. Son identité très forte est autant philosophique que technique et elle représente probablement de ces deux points de vue, l'un des plus grands achèvements artistiques du Moyen Âge. Ce nouveau style, d'abord appelé art français sera imité dans toute l'Europe.
Au XVIe siècle les Italiens utiliseront le mot "gothique" pour désigner l'architecture imitant cet art français du Moyen Âge. Au XIIe siècle, les architectes découvrent une technique révolutionnaire, la clef de voûte. Elle permet de diviser la poussée et de répartir le poids de la voûte le long des arcs et des piliers. Au lieu de la voûte ronde romane, ces nouvelles églises que l'on appelle gothiques, adoptent la clé de voûte et la voûte brisée en ogive. A l'extérieur de la nef des arcs boutants étaient l'édifice. Il est alors possible d'élever la voûte de plus en plus haut mais aussi de multiplier les fenêtres: les églises deviennent de vrais pièges à lumière. Gothique.
L'art gothique commence au milieu du XIIe siècle et se prolonge jusqu'au milieu du XVIe siècle. L'église gothique est plus grande et plus haute, percée de plus hautes baies. En peinture, le style gothique est caractérisé par l'assouplissement du dessin, d'élégance aristocratique, de vivacité naturaliste. En sculpture, le langage des gestes et des vêtements s'assouplit. Le réel prend le pas sur les canons idéaux. Le Gothique Classique correspond à la phase de maturation et d'équilibre des formes (fin XIIe-1230 environ). On construit alors toutes les plus grandes cathédrales : Reims, Bourges, Amiens,... Le rythme et la décoration se simplifient. En réalité, on privilégie le colossal au détriment du raffinement; l'élan vertical est de plus en plus prononcé.
L'architecture s'uniformise : on abandonne l'idée de principe de piles alternantes très marqué à Sens. Pour cette période, on commence à connaître le nom des architectes, notamment grâce aux labyrinthes (Reims). Le travail se rationalise. La pierre se standardise. Le monument prototype est Chartres, projet ambitieux avec une élévation à trois niveaux qui a pu être possible grâce au perfectionnement dans le contrebutement. La mise au point des arcs-boutants permet de supprimer les tribunes qui jusqu'alors jouaient ce rôle. Les autres pays d'Europe commencent à s'intéresser à cette nouvelle forme architecturale (Canterbury, Salisbury,...).
La cathédrale de Laon qui servit probablement de modèle à d'autres aura 3 niveaux de tribunes. Histoire des cathédrales en France, jusqu'à la fin du XIIe siècle, les cathédrales n'avaient pas les dimensions que nous leur connaissons aujourd'hui ; beaucoup d'églises abbatiales étaient beaucoup plus grandes. Jusqu'à cette époque, le morcellement féodal constituait un obstacle à la constitution civile des populations; l'influence des évêques était limitée par ces grands établissements religieux du XIe siècle. Propriétaires puissants, jouissant de privilèges étendus, seigneurs féodaux protégés par les papes, tenant en main l'éducation de la jeunesse et participant à toutes les décisions politiques, les abbés attiraient tout à eux : richesse et pouvoir, intelligence et activité.
Lorsque les populations urbaines, instruites, enrichies, laissèrent paraître les premiers symptômes d'émancipation, s'érigèrent en communes, il y eut une réaction contre la féodalité monastique et séculière dont les évêques, appuyés par la monarchie, profitèrent avec autant de promptitude que d'intelligence. Ils comprirent que le moment était venu de reconquérir le pouvoir et l'influence que leur consentait l'Église, pouvoir concentré dans les établissements religieux. Ce que les abbayes purent faire pendant le XIe siècle, les évêques n'en auraient pas eu le pouvoir. Mais, au XIIe siècle, l'épiscopat entreprit de reconstruire ses cathédrales ; il trouva dans les populations un concours si énergique qu'il pu vérifier la justesse de ses prévisions, comprendre que son temps était venu, et que l'activité développée par les établissements religieux, dont il avait d'ailleurs profité, allait lui venir en aide.
Il est difficile aujourd'hui de donner une idée de l'empressement avec lequel les populations urbaines se mirent à élever des cathédrales. La foi avait certes son importance, mais il s'y joignait un instinct très juste d'unité et de constitution civile. Où voyons-nous les grandes cathédrales s'élever à la fin du XIIIe siècle ? A Noyon, Soissons, Laon, Reims, Amiens, Saint-Denis, villes qui toutes avaient, les premières, donné le signal de l'affranchissement des communes; dans la ville-capitale de l'Île-de-France, centre du pouvoir monarchique, Paris; à Rouen, centre de la plus belle province conquise par Philippe Auguste; à Liège, capitale de la principauté de Liège. Mais, du point de vue architectural, c'est de celle de Senlis, l'archétype du genre, que toutes s'inspirent.
► 1144 - 24 décembre Prise et massacre d'Édesse par Zengui, Émir de Mossoul. Comté d'Édesse, c'est l'États latins d'Orient le plus avancé dans le monde islamique. Il s'étend de part et d'autre du cours supérieur de l'Euphrate et sur les régions de Marach, Mélitène, du Commagène du Chabakhtan et de l'Osrohène. La capitale est Édesse. Zengui, Imad ed-Din Zengi (également appelé Zangi ou Zengui) (1087-1146) était le fis de Aq Sunqur al-Hajib, Alep sou le Shah Malik I. Il devint l'atabeg de Mossoul en 1127 et d'Alep en 1128, unifiant les deux villes sous son règne personnel. Il fonda la dynastie Zengide.
► 1145 - 1er décembre Bulle "Quantum Predecessores" d'Eugène III appelant à la seconde croisade.
► 1146 - 31 mars Saint Bernard (Bernard de Clairvaux) prêche la deuxième croisade à Vézelay. Assemblée de Vézelay (1146). Au cours de cette assemblée de Pâques, à laquelle assistent le roi Louis VII, Aliénor d'Aquitaine et les grands vassaux du royaume, saint Bernard de Clairvaux prêche la deuxième croisade. Vézelay est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.
► 1147 Le moine Arnaud de Brescia qui avait été le disciple d'Abélard, philosophe et théologien français, ennemi du pouvoir temporel des papes, tente de le renverser et d'établir à Rome le gouvernement républicain. Arnaud de Brescia, réformateur supplicié à Rome, en 1155, à cause de la part qu'il avait prise aux soulèvements du peuple pour se donner un gouvernement indépendant de la papauté.
► 1147 - 16 février Assemblée des grands à Étampes. Lors de cette assemblée, on confie à l'abbé Suger la régence du royaume pour toute la durée de l'absence de Louis VII qui part en croisade. Suger, homme d'église et homme d'état français né en 1081, mort à Saint-Denis en 1151. Fils de serf, il a le privilège d'être l'ami de Louis VI durant leur enfance; ce qui lui permettra de devenir moine à l'abbaye de Saint-Denis, puis abbé de Saint-Denis de 1122 à 1151.
Ayant toute la confiance de Louis VI, il jouera un rôle proche de celui, aujourd'hui, d'un premier ministre. Chargé de missions diplomatiques à l'étranger, conseiller, notamment pour les opérations militaires et même entremetteur puisqu'il sera à l'origine du mariage de Louis VII, fils du roi et futur roi lui-même, avec Aliénor d'Aquitaine (1137). Il sera régent de la France de 1147 à 1149 lors du départ de Louis VII pour la deuxième croisade.
► 1147 Deuxième croisade, prêchée par saint-Bernard à Vézelay. Les troupes partent sous le commandement de Louis VII et de Conrad III de Hohenstaufen, empereur d'Allemagne. L'expédition fut malheureuse. Les croisés assiégèrent inutilement Damas (1148) et la discorde s'étant mise entre les deux princes qui les commandaient, Conrad III regagna ses États. La deuxième croisade, de 1147 à 1149, entreprise sous le pontificat d'Eugène III, et prêchée par Saint Bernard (Bernard de Clairvaux), eut pour chefs Louis VII de France, et Conrad, empereur d'Allemagne (1147).
Ces deux princes n'éprouvèrent que des revers. Ils étaient cependant sur le point de prendre Damas (1148), lorsque la discorde se mit entre les seigneurs de leurs armées, et les contraignit à revenir en Europe. Deuxième croisade (1147-1149). Prêchée par saint Bernard de Clairvaux à l'instigation du pape Eugène III, la deuxième croisade vise à la reconquête d'Édesse. Elle est menée par le roi de France Louis VII et l'empereur Conrad III de Hohenstaufen. Leur mésentente conduit la croisade à l'échec. Le roi rentre en France en 1149. Conrad III de Hohenstaufen, né en 1093, décédé en 1152, empereur romain germanique de 1138 à 1152. Fils de Frédéric Ier de Hohenstaufen, duc de Souabe et d'Agnès de Germanie. Il épouse Gertrude de Soultzbach (?-1146) et eurent deux enfants.
► 1147 - 4 octobre Arrivée des armées croisées françaises à Constantinople.
► 1148 - 6 janvier Défaite des armées croisées françaises à Pisidie. Pisidie, région ancienne de l'Asie Mineure.
► 1149 Louis VII lève le siège de Damas marquant la fin de la seconde croisade. Damas est la capitale de la Syrie.
► 1149 Retour en France, presque sans armée, et sans gloire, de Louis VII. Pendant son absence, le gouvernement avait été exercé par le moine Suger, abbé de Saint-Denis, qui avait été aussi le premier ministre de Louis VI et mérita par sa sagesse d'être appelé par le peuple, le Père de la patrie.
► 1150 à 1220 - naissance et mort de Blondel de Nesles, chevalier ou ménestrel picard, est l'un des premiers trouvères courtois. Il compose une vingtaine de chansons savamment versifiées entre 1175 et 1200-1210.
► 1150 Chanson de Guillaume. L'étrange et superbe Chanson de Guillaume, récit poignant de la grande bataille de Larchamp ou d'Aliscans, est, avec la Chanson de Roland, la plus ancienne chanson de geste. A partir de ce noyau initial, d'autres poèmes ont bientôt chanté les nombreuses aventures de Guillaume d'Orange (Guillaume de Gellone), "le marquis au court nez", ses combats, ses révoltes, ses amours, mais aussi les aventures de ses aïeux, en remontant à son arrière-grand-père Garin de Monglane, celles de ses oncles, celles de son neveu Vivien, celles de son beau-frère, le bon géant Rainouart.
Ainsi s'est formé un ensemble considérable de vingt-quatre chansons de geste, certaines fort longues. Guillaume d'Orange, Guillaume de Gellone, dit Guillaume au Court Nez, aussi connu sous le nom de Guillaume d'Orange (v.742 - †812). Il est le petit-fils de Charles Martel par sa mère, Hadeloge (Aude), et donc cousin de Charlemagne. Son père serait un certain comte Théodoric (Thierry), comte d'Autun et descendant des Mérovingiens. Il eut les titres de comte de Toulouse et marquis de Septimanie.
Ayant retrouvé son ancien ami d'enfance saint Benoît à l'abbaye Saint-Sauveur d'Aniane, il décide de fonder en 804 l'abbaye bénédictine de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert. C'est dans cette abbaye qu'en 806 il s'y retire à la tête d'une migration de moines. Il meurt le 28 mai 812. Il est canonisé en 1066 et devient alors connu sous le nom de Saint Guilhem. Il entre également dans la légende comme le héros d'un cycle épique sous le nom de Guillaume d'Orange.
► 1150 Charroi de Nîmes (chansons de gestes) inspiré d'une chanson de geste de Guillaume d'Orange (Guillaume de Gellone). Le Charroi de Nîmes, comme toute chanson de geste, est un texte épique et légendaire qui sert à édifier dames et damoiselles et à conforter les vertus chevaleresques des seigneurs et chevaliers. Il est aussi un témoignage précieux et une invitation à réfléchir sur toute société et sur tous contextes internationaux qu'ils soient médiévaux ou de notre temps.
► 1150 Traduction latine du Canon d'Avicenne (1150-1180). Avicenne était un philosophe, médecin et mystique Persan et musulman. D'origine iranienne, il naquit en 980 à Afshéna, près de Boukhara, et mourut à Hamadan en 1037.
► 1150 vers - Développement de la tradition de l'amour courtois (fin'amor). La fin'amor - c'est là que s'épanouit son chant lyrique, en partie influencé par l'ambiance cathare - se veut sublimation du désir, inachèvement de la conquête, idéalisation de l'amour charnel. L'amor, c'est l'éros supérieur qui transcende et élève l'âme. Il suppose chasteté. "E d'amor mou castitaz" ("d'amour vient chasteté"), chante le Toulousain Guilhem Montanhagol, auquel la Dame inspire une véritable exaltation mystique. Ce "jeu subtil avec le désir contrarié" (Pierre Bec) s'appuie sur les leys d'amor, lois d'amour parfaitement codifiées qui reposent sur la joie (extase, allégresse, bonheur, jouissance), la cortezia (qui consiste à courtiser, honorer, se montrer gracieux) et la mezura (mesure, longue patience, ce qui purifie le désir).
La courtoisie, c'est d'abord une nouvelle attitude envers les femmes : davantage de respect. Le chevalier courtois accorde une grande place à l'amour, la "fine amor". Cet amour exige du chevalier un dévouement total aux désirs de sa dame: il doit la mériter par son obéissance, sa fidélité et par les prouesses qu'il accomplit pour elle. La courtoisie, c'est est aussi un mode de vie : chevaliers et dames ont du goût pour les riches vêtements (tissus, broderies, fourrures, bijoux...); ils aiment les fêtes où se manifeste la largesse de celui qui les offre. Le chevalier courtois recherche à la fois la gloire personnelle et l'amour de sa dame. Il doit pour cela faire preuve de certaines qualités: le courage : le chevalier doit être "preux" et vaillant. la fidélité à sa parole : il doit être loyal. la générosité, envers son adversaire, envers ceux qui ont besoin de son aide.
(De plus, il doit faire preuve de largesse : il n'a pas à épargner !) la maîtrise de soi : il ne doit pas se laisser conduire par la haine ou la colère. Il doit aussi se montrer courtois au sens moderne du mot, c'est-à-dire qu'il doit respecter des règles de vie en société, de politesse. Il doit chercher l'aventure, ce qui en fait souvent un chevalier errant. S'il a toutes ces qualités, le chevalier est un chevalier parfait... mais les chevaliers ne correspondaient pas tous, loin de là, à cet idéal et les romans nous présentent aussi des chevaliers félons !
► 1150 vers - Débuts de la grammaire (vers la grammaire modiste ou spéculative: une sorte de grammaire générale qui cherche à étudier le langage en général, ses raisons et ses causes, et qui écarte les spécificités de chaque langue dans la catégorie des 'accidents'): analyse des modes de construction et de signification. Grands auteurs: Guillaume de Conches et Pierre Hélie.
► 1150 Le chevalier du XIIème siècle, époque où écrit 'Chrétien de Troyes', vit dans la société féodale. Il est lié par serment à son seigneur: le suzerain doit protéger son vassal et lui donner les moyens de vivre. De son côté, le vassal doit aide -en particulier à la guerre- et conseil à son seigneur. D'où l'importance de la fidélité à la parole donnée : le chevalier félon, celui qui ne respecte pas son serment, trouble l'ordre de la société. Les liens personnels entre le chevalier et son seigneur sont très importants: les chevaliers vont rendre visite à leur suzerain, participer à des fêtes.
Le seigneur s'occupe de l'éducation du fils de son vassal, entre sept et dix-huit ans environ. Le jeune garçon est alors page, puis écuyer (celui qui porte l'écu). Le chevalier est avant tout un homme de guerre. La force physique, le savoir-faire dans la bataille sont de la plus grande importance. Son cheval et ses armes, qui coûtent fort cher, lui sont remis par son seigneur lors de la cérémonie de l'adoubement. Ensuite, la guerre et les tournois pourront être source de profit: il est par exemple courant de demander une rançon pour libérer un chevalier ennemi capturé.
Les loisirs du chevalier sont souvent en rapport avec ses activités guerrières: il aime la chasse - qui prend des formes variées: chasse avec des oiseaux de proie, traque au sanglier... Cette activité, souvent violente et pratiquée en groupe, lui fournit une viande qu'il apprécie, mais lui donne aussi l'occasion de se maintenir en bonne condition physique. Les tournois, qui sont des combats simulés, lui permettent d'établir aux yeux des autres chevaliers, et aussi aux yeux des dames, sa bravoure et sa valeur. Ils développent aussi l'habileté et la force physique nécessaires à la guerre. Dans la grande salle du château, il peut écouter les chansons des jongleurs, les regarder faire des acrobaties, présenter des animaux savants; un lettré, souvent un clerc, lui lit quelques livres. Ces récits - chansons de gestes ou romans- racontent souvent les hauts faits de chevaliers du passé.
► 1152 - 21 mars Louis VII fait casser son mariage avec Aliénor d'Aquitaine par le concile de Beaugency. Annulation du mariage entre Louis VII et Aliénor d'Aquitaine. Le divorce est prononcé par le concile de Beaugency. Il sera la cause des guerres qui éclatent peu après entre la France et l'Angleterre dont Aliénor épouse le roi.
► 1152 Divorce (prononcé par le concile de Beaugency) de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine; celle-ci porta la même année sa main et son immense dot à Henri Plantagenêt (Déjà comte du Maine, de l'Anjou et de Touraine, et duc de Normandie depuis 1149, il devint roi d'Angleterre, sous le nom de Henri II d'Angleterre, en 1154 et possédait en France un territoire égal à 22 de nos actuels départements). Ce divorce fut la deuxième des causes des guerres qui éclatèrent plus tard entre la France et l'Angleterre.
Louis avait déjà indisposé les Anglais en recueillant Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry, adversaire déclaré du roi Henri Ier (et qui mourut peu après, assassiné en Angleterre). Enfin Louis VII avait soutenu certaines prétentions des fils de Henri Ier contre leur père. Il était résulté de ce mécontentement quelques conflits armés entre Anglais et Français; les traités de Montmirail en 1169 et de Montlouis en 1174 les firent cesser.
► 1152 - 18 mai Aliénor d'Aquitaine épouse Henri Plantagenêt (futur Henri II d'Angleterre), duc de Normandie et comte d'Anjou, qui deviendra roi d'Angleterre. Elle apporte, en dot, la province de Guyenne, actuelle Aquitaine, accroissant considérablement les provinces de l'empire des Plantagenêts. Les vues de la monarchie française sur cette province, et le refus du roi d'Angleterre de considérer le roi de France comme son suzerain seront, entre autres, à l'origine de la première guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. Henri II d'Angleterre (5 mars 1133 – 6 juillet 1189), comte d'Anjou et du Maine, duc de Normandie, roi d'Angleterre (1154–1189), dit parfois Henri Court-manteau (Curtmantle) à cause du vêtement court et pratique qu'il affectionnait.
Il est le premier roi de la dynastie des Plantagenêt. La Guyenne est une région aux contours variables selon les époques, située dans le sud-ouest de la France. Son nom provient d'une évolution populaire du mot Aquitaine qui est passé par le stade "Aguiaine" aux XIIe et XIIIe siècles, le "A" initial disparaissant peu à peu. Guyenne est la forme du nom Aquitaine qui fut de loin la plus usitée par les populations locales du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Aquitaine apparaissait comme un terme plus archaïsant et plus cultivé quand Guyenne était le nom courant de la province. Cette ancienne province du sud-ouest de la France avait pour capitale Bordeaux et se confond avec l'Aquitaine en tant que région au nord nord-est de la Gascogne.
► 1155 - 10 juin Trêve de dix ans dans le royaume. Louis VII a déchu, en 1152, son vassal Henri II d'Angleterre de tous ses fiefs français, parce que celui-ci a osé se marier sans en demander l'autorisation au roi. La chose est d'autant plus grave qu'Henri II épouse Aliénor d'Aquitaine que Louis VII a répudiée et qu'elle apporte pour son mariage la dot qu'elle a reprise. Sans moyen pour imposer que sa sentence soit exécutée, Louis VII proclame la paix du roi. Ce geste constitue la première ordonnance capétienne qui renoue avec la période carolingienne. Dès l'année suivante, Henri II fera allégeance au roi de France pour ses fiefs français.
► 1155 à 1210 - naissance et mort de Raimbaut de Vaqueiras, poète provençal. Raimbaut de Vaqueiras est né en 1180 ou 1155, il habitait en Italie où il était un des premiers troubadours. Il aimait chanter à propos de l'amour et dans beaucoup de langues différentes, souvent ses chansons avaient plus d'une langue.
► 1155 à 1220 - naissance et mort de Guiot de Provins, poète lyrique et satirique.
► 1155 Wace écrit Roman de Brut. Robert Wace (ou Robert de Gacé), né vers 1115 sur l'île de Jersey, est considéré comme un poète "français" ou plus précisément normand. Il est également chanoine de Bayeux et meurt vers 1175 en Angleterre.
► 1158 Traité de Gisors entre Henri II d'Angleterre et Louis VII.
► 1159 En juin, Henri II d'Angleterre s'empare de Cahors et Rodez, mais échoue devant Toulouse où s'est enfermé Louis VII, venu au secours du comte Raymond V.
► 1159 Rivalité entre les Capétiens et les Plantagenêt (1159-1299)
► 1159 Première Guerre de Cent Ans. Première Guerre de Cent Ans, en 1159, les armées d'Henri II d'Angleterre entrent dans Périgueux. Le roi d'Angleterre avait décidé d'agrandir encore ses possessions dans le Sud-Ouest en annexant le comté de Toulouse qui comprenait, entre autres, le Quercy. C'est l'origine de la première Guerre de Cent Ans qui se déroula de 1159 à 1299. À partir de 1170, Aliénor d'Aquitaine, pourtant toujours épouse d'Henri II, lui dispute territoires et légitimité au trône en soulevant contre lui ses propres fils. Cette guerre est aussi la lente reconquête capétienne de son royaume. En effet, le pouvoir royal est encore peu étendu sur le tout le territoire de France et la faiblesse de Louis VII n'arrange rien, bien au contraire. Mais par la suite, la France a la chance de connaître trois souverains exceptionnels servis par une non moins exceptionnelle longévité.
► 1159 Jean de Salisbury écrit Polycraticus. Jean de Salisbury (1115-1180) : philosophe scolastique et élève d'Abélard. Il fut évêque de Chartres, secrétaire et ami de Thomas Becket dont il écrivit la vie. Il est aussi l'auteur d'un traité de logique (Metalogicus). Dans son 'Polycraticus' (1159), le corps est l'image métaphorique de la société, dont le roi ou le pape est la tête, et dont artisans et paysans sont les pieds. Jean n'est ni un mystique, ni un théologien; pour lui, le but des études et d'abord l'acquisition d'une sagesse humaine qui doit permettre l'exercice des vertus et la recherche de l'amour de Dieu.
41 - De 1160 à 1180 (Philippe II dit Philippe Auguste)
► 1160 Mort de la reine Constance de Castille. Constance de Castille (v. 1136-4 octobre 1160, à Paris), reine de France, est la fille du roi de Castille Alphonse VIII. Elle est la deuxième épouse de Louis VII, après Aliénor d'Aquitaine. Leur mariage et son sacre eurent lieu à Orléans en 1154. Elle est mère de Marguerite, successivement mariée à Henri le Jeune, fils de Henri II d'Angleterre, puis roi de Hongrie Béla III. Après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, elle meurt à Paris en accouchant d'une fille, Adélaïde, future comtesse de Vexin. Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle est un pèlerinage chrétien, qui mène à la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice (Espagne), où seraient conservées les reliques de Saint Jacques, apôtre du Christ. Avec celui de Rome (via Francigena) et de Jérusalem, c'est l'un des trois grands pèlerinages de la chrétienté.
Traditionnellement, le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle se fait à pied et en partant de chez soi. Cependant pour des raisons pratiques les pèlerins se sont rapidement rassemblés sur des voies précises. Des chemins de pèlerinage partent de la plupart des régions d'Europe, au départ entre autres de Liège, Paris, Vézelay, Le Puy-en-Velay. S'il est parcouru depuis le VIIIe siècle par des chrétiens faisant étape dans des monastères qui jalonnent les chemins de Compostelle, le pèlerinage de Saint-Jacques est également devenu une randonnée célèbre, où les marcheurs croisent les amateurs d'art roman.
► 1160 - 13 novembre Mariage de Louis VII avec Alix de Champagne. Alix de Champagne, Adèle, Alix ou Alice de Champagne (vers 1140 - 4 juin 1206, au Palais de la Cité, à Paris), reine de France, est la fille du comte de Champagne et de Blois Thibaut II le Grand et de Mahaut de Carinthie. Elle est la troisième épouse de Louis VII, veuf de Constance de Castille, le 13 novembre 1160 à Paris et sacrée le jour-même.
Elle en profite pour jouer un grand rôle dans la vie politique du royaume et pour mettre en avant ses frères le comte de Champagne Henri le Libéral, le comte de Blois Thibaut V et l'archevêque de Reims Guillaume aux Blanches Mains - en lui obtenant son premier siège, l'évêché de Chartres. Elle marie les deux premiers aux filles qu'a eues Louis VII d'Aliénor d'Aquitaine. Écartée du pouvoir par Philippe Auguste en 1180, elle est cependant régente du royaume, en 1190, lors de la troisième croisade. Au retour du roi, en 1192, la reine Adèle rentre de nouveau dans l'ombre et participe à la fondation d'abbayes.
► 1160 à 1205 - naissance et mort de Peire Vidal, le troubadour le plus original de cette période. Il accepte et se fait passer lui-même pour un peu fou. C'est un grand voyageur.
► 1162 Henri II s'empare du Vexin.
► 1163 Début de la construction de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, est l'église cathédrale de Paris, d'architecture gothique située sur l'île de la Cité. Elle est située sur la place du parvis Notre-Dame. Elle possède des caractères du gothique primitif (voûtes sexpartites de la nef) et du gothique rayonnant : on remarque particulièrement l'audace des arcs-boutants du choeur. Sa façade occidentale est un chef d'oeuvre d'équilibre architectural. La construction, commencée sous le règne de Louis VII par l'évêque Maurice de Sully, a duré de 1163 à 1345. À cette époque, Paris n'était qu'un évêché, suffragant de l'archevêque de Sens.
Une cathédrale s'entend comme une église dans laquelle est placé le trône de l'évêque du diocèse. Ce sont les "commune" qui, à partir de 1160, vont ériger les cathédrales gothiques, émanations de leur indépendance, de leur foi et de leur communauté : Lille, Beauvais, Amiens, Reims, Arras, Laon, Chartres, Rouen, etc. Et aussi Paris, ville royale depuis Philippe Auguste. Tout à la fois édifice religieux et lieu d'accueil, la cathédrale est, au Moyen Âge, l'espace de sociabilité par excellence. Les fidèles entrent, sortent, bavardent, font de la musique, ce qui ne les empêche pas d'écouter la parole de l'évêque.
► 1163 Concile de Tours où l'on commence à s'inquiéter de l'hérésie cathare. Hérésie. Elle est le fait de chrétiens qui renient un ou plusieurs dogmes de la foi, et proposent leur vision comme seule conception authentique du catholicisme. En ce sens, l'hérésie a toujours paniqué l'Église car elle est naît à l'intérieur de ses rangs, à l'initiative de chrétiens baptisés. La chasse intransigeante aux hérétiques atteint son paroxysme avec l'instauration de l'Inquisition. Inquisition. "Et pourtant, elle tourne !" s'exclame Galilée à l'issue de son procès devant le tribunal de l'Inquisition (1633), qui l'a sommé de renier sa conception héliocentrique de l'univers.
Établie pour lutter contre l'hérésie cathare, l'Inquisition est un organisme judiciaire ecclésiastique qui fonctionne par la dénonciation et l'enquête. Elle fait la chasse aux sorcières et aux hérétiques, les arrête, et les menace du bûcher s'ils n'abjurent pas. Après une mise à la question en rigueur, le degré de culpabilité est établi et la peine prononcée. Les pénitences varient du port d'insignes infamants à la prison. Ceux qui n'abjurent pas sont brûlés vifs. L'Espagnol Torquemada reste sans doute l'inquisiteur le plus tristement célèbre.
►1164 Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury se réfugie en France suite au conflit qui l'oppose à Henri II d'Angleterre. Thomas Becket (21 décembre 1117 - 29 décembre 1170) fut archevêque de Canturbery de 1162 à 1170. Il engagea un conflit avec le roi Henri II sur les droits et privilèges de l'église catholique romaine et fut assassiné par les partisans du roi. Ami, conseiller et chancelier du roi Henri II d'Angleterre, il devient archevêque de Cantorbéry (Canterbury) et chef de l'église d'Angleterre en 1162. Il s'oppose au roi, qui veut diriger l'Église. Menacé, il se réfugie en France pendant sept ans ; à son retour en Angleterre, des soldats du roi l'assassinent dans la cathédrale de Cantorbéry en 1170.
► 1164 Pierre Le Mangeur écrit 'Historia scholastica'. Pierre Le Mangeur ainsi surnommé en raison de son appétit pour la lecture. Théologien français (Troyes vers 1100 - Paris, vers 1179). Chanoine et chancelier de Paris en 1164. Il a laissé un manuel d'histoire religieuse, 'Histoire scolastique', qui connut un grand succès.
► 1165 Gengis Khan premier empereur mongol. Il utilisa son génie politique et militaire pour unifier les tribus turques et mongoles de l'Asie centrale et ainsi fonder son Empire. Il mena pour cela la conquête de la majeure partie de l'Asie, incluant la Chine, la Russie, la Perse, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est. Son petit-fils, Kubilai Khan, fut le premier empereur de la dynastie Yuan en Chine. Gengis Khan, conquérant mongol. Gengis Khan, Khan des Mongols étendit sa puissance sur l'Asie centrale, la Chine septentrionale et le Turkestan russe. Fondateur d'une lignée de dominateurs, il est l'un des personnages les moins bien connus, mais aussi l'un des plus célèbres, de l'histoire des hommes. Après avoir unifié la Mongolie (l'Ulus mongol) sous son autorité, Gengis Khan organise son empire sur lequel il fait régner une discipline sévère.
► 1165 à 1210 - naissance et mort de Jehan Bodel, écrivain et rédigea entre 1197 et 1200 une chanson de geste romanesque: "La chanson des Saines (Saxon)". C'est un des derniers poèmes épiques qui raconte les péripéties de la guerre victorieuse de Charlemagne contre Guitelin. Puis, il écrit une pièce de théâtre de type bouffon: "Le jeu de Saint Nicolas" entre Mars et Octobre 1200. La première représentation de cette pièce eut lieu le 5 Décembre 1200.
►1165 Benoît de Sainte-Maure écrit 'Roman de Troie'. Benoît de Sainte-Maure, qui dédie le 'Roman de Troie' à Éléonor, composera entre 1173 et 1185, une 'Estoire des Ducs de Normandie', commandée par le roi d'Angleterre, s'inspirant des chroniques de Guillaume de Jumièges, Guillaume de Poitiers et Dudon de Saint-Quentin. De ce dernier, il adopte et théorise la tripartition de la société féodale, thème qui sera repris par son proche Étienne de Fougères.
► 1165 Bernard de Ventadour écrit 'Cansos'.
► 1170 29 décembre Assassinat de Thomas Becket. L'archevêque de Cantorbéry Thomas Becket est assassiné au sein même de sa cathédrale par quatre chevaliers anglo-normands fidèles d'Henri II. Bien que ceux-ci agissent sans ordre royal, l'histoire veut qu'ils aient pris cette initiative après qu'Henri II ait prononcé de colère la phrase : "N'y aura-t-il donc personne pour me débarrasser de ce clerc outrecuidant ?".
Nommé par son ancien ami le roi, Thomas Becket s'aliéna ce dernier lorsqu'il commença à opposer une résistance intransigeante aux Constitutions de Clarendon. Celles-ci prévoyaient en fait de réduire le pouvoir de l'Église et de la faire dépendre du pouvoir royal. Après un exil en France et une série d'excommunications contre les prêtres qui ne le soutenaient pas, Thomas Becket avait pu revenir en Angleterre. Cet assassinat provoqua la colère de l'Église et des croyants, forçant Henri II à faire pénitence publiquement. Thomas Becket sera sanctifié trois ans plus tard.
► 1170 Marie de France écrit 'Lais'. Marie de France est une poète médiévale célèbre pour ses lais - sortes de poèmes - rédigés en ancien français. Elle a vécu pendant la seconde moitié du XIIe siècle, en France puis en Angleterre, où on la suppose abbesse d'un monastère, peut-être celui de Reading. Son oeuvre examine l'amour courtois et relève de la matière de Bretagne.
► 1170 Chrétien de Troyes, Romancier médiéval français, écrit 'Lancelot ou le Chevalier à la charrette', 'Érec et Énide'.
► 1170 Composition du 'Tristan et Iseut' de Béroul. Tristan et Iseut, l'histoire de Tristan et Iseut a traversé les siècles pour intégrer la littérature. D'origine celtique, ce sont les poètes normands qui en ont fait les premières rédactions qui nous sont conservées. Issue de la tradition orale, la très populaire histoire de Tristan et Iseut fait son entrée dans la littérature écrite au XIIe siècle. Plusieurs textes différents ont vu le jour, dont les célèbres versions de Béroul et de Thomas d'Angleterre, certains ont été malheureusement perdus comme celui de Chrétien de Troyes, aucun de ceux qui nous sont parvenus ne sont intégraux. Béroul est un jongleur et conteur de métier normand du XIIe siècle. Il a écrit une version de la légende de Tristan et Iseut dans un dialecte normand dont on a conservé un certain nombre de fragments (environ 3000 vers).
► 1171 Début du règne de Saladin (Salah Al-Din Al-Ayyubi) (fin en 1193). Il renverse la dynastie Fatimide à la tête de l'Égypte, restaure la légitimité des Abbassides et le rite sunnite. Il se proclame sultan d'Égypte et fonde la dynastie Ayyoubides. Au même moment, le calife de Bagdad accorde à Nur ad-Din l'investiture de la Syrie et de l'Égypte. Apprenant la fin de la dynastie Fatimide, le chef de la secte des Assassins, Rachideddin Sinan ("le vieux de la montagne") envoie un message à Amaury Ier de Jérusalem pour lui annoncer qu'il est prêt, avec tous ses partisans, à se convertir au christianisme.
Les Assassins possèdent alors plusieurs forteresses et villages en Syrie centrale. Beaucoup d'adeptes de la secte, devenus de paisibles paysans, versent un tribut régulier aux Templiers. En promettant de se convertir, le "vieux" espère exempter ses fidèles du tribut, que seul les non-chrétiens sont tenus de payer. Saladin (1137-1193) fonda la dynastie ayyoubide, d'origine ethnique kurde en Égypte et en Syrie. Il est également connu pour s'être battu contre les croisés et l'honneur avec lequel il traitait les vaincus.
► 1173 - 23 juin Siège de Verneuil. Révoltés contre leur père, Henri II d'Angleterre, Henri le Jeune, Richard et Geoffroy, soutenus par Louis VII de France, mettent le siège devant Verneuil. Révolte de 1173-1174 en Angleterrre et Normandie. Les fils d'Henri II se rebellent contre leur père : Révolte de Richard Coeur de Lion en Aquitaine contre son père Henri II d'Angleterre avec l'appui d'Aliénor d'Aquitaine (fin en 1183). En novembre, Aliénor est capturée par son mari alors que, vêtue d'un habit masculin, elle tentait de se réfugier auprès du roi de France.
La reine est enfermée au château de Chinon (fin en 1189). Révolte des barons en Angleterre et en Normandie (fin en 1174). Guillaume le Lion, roi d'Écosse, fait la guerre à l'Angleterre, mais est capturé et emprisonné à Falaise par Henri II. Il ne sera libéré que contre rançon et reconnaissance de souveraineté. La révolte de 1173-1174 est la rébellion contre Henri II d'Angleterre de trois de ses fils, de son épouse Aliénor d'Aquitaine et de barons qui les soutenaient. Elle dura 18 mois, et fut un échec. Les membres rebelles de sa famille durent se résigner face à sa puissance, et se réconcilièrent avec lui.
► 1174 - 30 septembre Paix de Montlouis. Elle est signée entre Louis VII et Henri II d'Angleterre, roi d'Angleterre. On y réalise le partage des domaines des Plantagenêts entre le roi Henri et ses fils rebelles. Pour sceller la paix, la fille de Louis VII, Adélaïde, doit épouser le fils d'Henri II d'Angleterre, Richard Coeur de Lion. Richard Coeur de Lion, Richard Ier d'Angleterre de 1189 à 1199, duc d'Aquitaine, comte du Maine, comte d'Anjou, né le 8 septembre 1157 au palais de Beaumont à Oxford (Angleterre), mort le 6 avril 1199 lors du siège de Châlus (France). Fils de Henri II d'Angleterre, ou Plantagenêt, et d'Aliénor d'Aquitaine, Richard est élevé en France à la cour de sa mère, dont il devient l'héritier à l'âge de onze ans. Après la mort de son frère aîné, il devient aussi l'héritier de la couronne d'Angleterre, mais aussi de l'Anjou, la Normandie, le Maine.
Pendant son règne, il ne passera que quelques mois dans le royaume d'Angleterre et utilisera toutes ses ressources pour partir en croisade, puis défendre ses territoires français contre le roi de France, Philippe Auguste, auquel il s'était pourtant auparavant allié contre son propre père. Ces territoires, pour lesquels il avait prêté allégeance à Philippe, constituaient la plus grande partie de son héritage Plantagenêt. Avant d'être roi d'Angleterre, Richard fut donc surtout un prince du continent, surtout désireux d'entrer dans la légende par de hauts faits d'armes.
► 1175 Bertrand de Born écrit Cansos. Bertrand de Born (v.1140 - v.1215), seigneur de Hautefort en Limousin, troubadour qui célèbre l'amour et la guerre. Il fut mêlé aux luttes des fils de Henri II d'Angleterre, et prit parti contre Richard Coeur de Lion pour Henri le Jeune. À la mort de celui-ci, il se réconcilia avec Richard, qu'il soutint à son tour contre Philippe Auguste.
► 1175 à 1221 - naissance et mort de Dominique de Guzman, dit Saint Dominique. Religieux catholique, le fondateur de l'ordre des dominicains. Canonisé par l'Église catholique.
► 1176 Chrétien de Troyes compose "Yvain ou le Chevalier au lion". Grand poète de la littérature courtoise, Chrétien de Troyes s'attelle à la rédaction d'un des plus grands ouvrages du genre. Inspiré des mythes bretons du roi Arthur et de la Table ronde, il donne vie à Yvain, un chevalier qui a choisi l'aventure à l'amour. Il ne pourra reconquérir la main de la belle Laudine qu'en accomplissant de grandes prouesses. "Yvain ou le Chevalier au lion" est l'un des trois romans de Chrétien de Troyes - avec "Lancelot ou le Chevalier de la charrette" et "Perceval ou le conte du Graal" - qui traversera les siècles.
► 1177 à 1236 - naissance et mort de Gautier de Coinci. Bénédictin français, Grand prieur à l'abbaye Saint Médard de Soissons en 1236, il fut un dignitaire ecclésiastique important de la région parisienne. On lui doit des discours édifiants, des récits hagiographiques et surtout un recueil de 58 Miracles de Nostre Dame d'environ 30 000 vers, répartis en deux livres, dont il commença la rédaction vers 1218.
► 1179 - 1er novembre Louis VII fait sacrer son fils Philippe (futur Philippe Auguste) à Reims à qui il laisse le pouvoir. Philippe Auguste, Philippe II, dit Philippe Auguste, né le 21 août 1165 à Gonesse Val-d'Oise, mort à Mantes-la-Jolie Yvelines, France le 14 juillet 1223, fut roi de France de 1180 à 1223, septième roi de la dynastie dite des Capétiens directs.
► 1179 - Troisième concile oecuménique du Latran présidé par Alexandre III. Il tente de résorber le schisme. Innocent III, antipape contre Alexandre III, se fait enfermer. Il impose l'élection du pape par la majorité des deux tiers du collège des cardinaux. Le pape oblige tout les Juifs à porter la rouelle jaune. L'hérésie cathare est condamnée. Le concile jette l'anathème sur les mercenaires (routiers). Le pape interdit le commerce avec les musulmans. Le concile menace d'excommunication ceux qui créeront de nouveaux péages ou augmenteront les tarifs des anciens sans autorisation. Le troisème concile du Latran se tient à Rome en mars 1179, suite à la paix de Venise conclue entre l'empereur Frédéric Barberousse et la Ligue lombarde fomentée par le pape Alexandre III. Il est le XIe concile oecuménique.
► 1179 Fondation de la secte des Vaudois à Lyon. Églises vaudoises, elles sont apparues avec Pierre Valdo ou Valdès, en 1179 dans la paroisse Saint-Nizier à Lyon. Pierre Valdès était un riche marchand. on raconte qu'il vendit ses biens pour suivre l'idéal de pauvreté apostolique, c'est-à-dire en imiter la vie des apôtres. Selon la tradition vaudoise, il se serait fait traduire des passages de la Bible du latin en langue vulgaire, et les aurait appris par coeur. Il commença à prêcher dans les rues de Lyon, acte qui était alors interdit par l'Église catholique. Seuls les prêtres et les clercs, en effet, étaient autorisés à le faire. L'Église toléra dans un premier temps la présence de Valdès et de ses disciples à condition qu'ils ne prêchent plus. Mais, ayant bravé cet interdit, ces derniers furent chassés de Lyon. Ils constituèrent dès lors les premiers vaudois, qui se nommaient eux-même "Pauvres de Lyon".
Pierre Valdo (également Pierre Valdès ou Pierre Vaudès selon les sources) dit Pierre de Vaux (1140-1206) est un riche marchand de Lyon. Passant par une crise religieuse, à la suite de laquelle il fit traduire le Nouveau Testament en langue vulgaire, il vendit tous ses biens et devint prédicateur itinérant. D'autres en firent autant. Ce mouvement appelé la fraternité des Pauvres de Lyon rencontra tout de suite de l'hostilité. Ils durent expliquer leur vision de la foi devant un collège de trois ecclésiastiques et notamment des points qui faisaient alors débat au sein de l'Église comme le sacerdoce universel, L'évangile en langue vulgaire, une plus grande pauvreté de l'Institution. Persécutés, chassés de Lyon, Valdo et ses disciples s'installèrent dans les hautes vallées du Piémont, puis, en France, dans le Luberon : l'Église vaudoise est née. Excommuniés par le Concile de Vérone en 1184, sa doctrine fut condamnée par le Concile de Latran en 1215.
► 1180 Au Cambodge, apogée de l'empire d'Angkor. Angkor est l'ancienne capitale de l'Empire khmer qui prospéra du IXe au XVe siècle.
► 1180 invention du gouvernail (Arabie)
► 1180 - 15 Février Édit d'expulsion des juifs.
► 1180 - 28 avril Mariage de Philippe (futur Philippe Auguste), fils de Louis VII avec Isabelle de Hainaut. Isabelle de Hainaut est la nièce de Philippe d'Alsace, comte de Flandre. Elle apporte en dot l'Artois. Philippe d'Alsace, Philippe Ier dit Philippe d'Alsace (° 1143 - † St-Jean d'Acre, 1er juin 1191), fils de Thierry d'Alsace, comte de Flandre, et de Sibylle d'Anjou (†1165). Comte de Flandre 1157 - 1191. Comte de Vermandois par mariage v. 1168 - 1186, à titre viager 1186 - 1191. Son règne correspond à l'apogée et au début du déclin de la puissance féodale flamande. Il lutta avec les visées de Philippe Auguste sur la Flandre, l'Artois et la Picardie. Le problème de sa succession fut au coeur de la politique de la fin de sa vie.
► 1180 - 29 mai Couronnement de Philippe Auguste à Saint-Denis.
► 1180 - 28 juin Traité de Gisors entre Henri II d'Angleterre et Louis VII le Jeune.
► 1180 - 18 septembre Mort de Louis VII à Paris. Au retour d'un pèlerinage, Louis VII prend froid et est terrassé par une hémiplégie. Il meurt paralysé à l'abbaye de Saint-Port. - Avènement de Philippe II (Philippe Auguste) né en 1165, fils de Louis VII et d'Adèle de Champagne, que celui-ci avait épousée après la répudiation d'Aliénor.
► 1180 PHILIPPE II Auguste (1180-1223)
► 1180 Philippe Auguste. Philippe n'a que 15 ans à la mort de son père. Cette même année, avant le décès de son père il épouse Isabelle de Hainaut fille du comte de Flandre. Cela n'empêchera pas celui-ci de comploter avec les comtes de Champagne et de Bourgogne. Malgré sa parenté, Isabelle n'hérite pas de sa tante Isabelle de Vermandois, décédée en 1182. Philippe parvient à faire respecter ses droits et à la suite d'une expédition militaire contre les coalisés (comtes de Champagne et de Bourgogne) obtient par le traité de Boves (1185) le Vermandois, l'Artois et Amiens. Il reprend la lutte contre Henri II d'Angleterre en soutenant Richard Coeur de Lion révolté contre son père (1187-1189).
En 1189 Henri II meurt et Richard lui succède. A la demande du pape, il part pour la troisième croisade avec Richard Coeur de Lion pour délivrer Jérusalem tombée aux mains de Saladin. C'est l'Archevêque Guilaume de Reims qui sera régent en son absence. En 1190, Philippe rencontre des succès devant Saint Jean d'Acre et décide de rentrer. Il quitte la Terre Sainte le 31 juillet 1191. Richard qui n'a pas eu son content de gloire poursuit sa lutte au cours de laquelle il conquiert son surnom, Coeur de Lion. Ayant obtenu de Saladin un accord d'accès aux lieux saints et quelques concessions territoriales Il décide de rentrer en octobre 1192.
A son retour, son bateau est jeté par la tempête sur la côte dalmate (Croatie) il est fait prisonnier par le duc d'Autriche avec lequel il était en hostilité qui le remet aux mains de l'Empereur d'Allemagne. Pendant ce temps le frère de Richard, Jean sans Terre, personnage à demi fou, a pris le pouvoir. Philippe continuant à jouer la division dans le camp anglais le soutient, en retour Jean lui fait des concessions territoriales. Il mène également une action auprès de l'empereur d'Allemagne pour qu'il garde Richard le plus longtemps possible. Au retour de Richard qui récupère son trône la guerre reprend, il fait construire une forteresse sur la Seine, clé de la Normandie (Chateau Gaillard). Elle sera achevée en 1198 et entreprend des expéditions mais il se fait tuer au siège de Chalus en Limousin. Jean lui succède.
Au cours de la bataille de Fréteval remportée par Richard, tous les bagages de Philppe Auguste tomberont aux mains des Anglais. Ceux-ci comprenaient notamment tous les documents constituant l'histoire du royaume et notamment les chartes qui suivaient le roi dans tous ses déplacements. Richard Coeur de Lion meurt le 6 avril 1199. Il avait été blessé au siège de Châlus en Limousin le 26 mars d'un carreau d'arbalète. La succession de Richard qui n'a pas de descendance est revendiquée par le petit-fils de Henry II, Arthur de Bretagne fils de Geoffroi l'ainé et Jean Sans Terre frère cadet de Richard. Jean soutenu par sa mère, Aliénor d'Aquitaine, finit par être couronné Roi d'Angleterre le 27 mai 1199.
Philippe Auguste conformément à sa technique qui consiste à créer des dissensions chez les Anglais, s'empresse de soutenir Arthur. Pour être reconnu comme roi d'Angleterre par Philippe Auguste, Jean Sans Terre conclut le traité du Goulet avec Philippe Auguste lui cèdant le Vexin normand, Évreux et des possessions en Auvergne et en Berry. Malgré cela, Philippe fidèle à sa politique soutient Arthur neveu de Richard contre Jean. Le comte d'Angoulême (vassal de Jean Sans Terre) voulant marier sa fille, Isabelle d'Angoulême, à Hugues de Luzignan (vassal de Philippe Auguste) le Poitou risquait alors de devenir français coupant ainsi la continuité des possessions anglaises en France (Normandie - Aquitaine).
Jean déclare alors qu'il veut épouser la fille en question et le comte son père qui est le vassal de Jean est bien obligé d'accepter (Août 1200). Hugues de Luzignan frustré se plaint au roi de France. Heureux de cela Philippe décide de traduire Jean en Cour de France. Jean ne se présente pas et Philippe lui confisque la Normandie et les autres possessions anglaises en France et les attribue à Arthur de Bretagne. Plus difficile est de faire appliquer ces décisions. Arthur est vaincu par Jean qui le fait prisonnier et le met à mort. Philippe en profite pour juger à nouveau Jean et lui confisque la plupart de ses biens en France.
En 1206 les anglais ne possèdent plus sur le continent que la Guyenne (nom anglais de l'Aquitaine). Jean se coalise avec Othon Ier Empereur Germanique et avec le comte de Flandre contre Philippe. Les troupes françaises prises entre deux feux doivent se scinder en deux l'une menée par le futur Louis VIII, fils de Philippe qui vainc Jean à La Roche aux Moines le 2 juillet 1214 coupant ainsi toute possibilité d'unification des forces coalisées. Louis poursuit les Anglais jusqu'à Londres qu'il occupe sans problème. Philippe commande l'autre armée qui est renforcée par des milices populaires constituées par les villes affranchies qui craignaient une invasion.
Philippe vainc les coalisés à Bouvines contraignant Othon à s'enfuir et à reconnaître les possessions françaises. Le comte de Flandre est fait prisonnier, enfermé au Louvre et ses états rattachés à la couronne. Philippe Auguste fait de Paris sa capitale. Il favorise le commerce. A Paris, il fait construire la tour du Louvre pour protèger la Seine et ses marchands, il fait paver les voies de communication et construire une enceinte autour de la ville. Il favorise l'évolution de la Bougeoisie.
Lorsqu'il part en croisade il confie à 6 bourgeois de Paris la garde du trésor et du sceau royal pendant son absence. Paris bénéficie alors d'un renom internationnal, des étudiants de partout viennent à l'Université française à laquelle Philippe accorde des privilèges. Il fait régner la justice favorisant souvent le petit contre le grand, il est considéré comme le protecteur des villes. L'extension du commerce, la France est maintenant le chemin naturel entre le sud et le nord, entre l'Italie et la Flandre ce qui crée un afflux monétaire, les prix montent et les agriculteurs vendent mieux leurs produits. Grâce à ces revenus supplémentaires ils peuvent acheter leur liberté.
On peut constater un reflux de la féodalité favorisé par le roi. La France est en Europe le pays le plus riche et le plus peuplé. Dans le sud de la France l'hérésie cathare se développe. Le pape Innocent III appelle à la croisade. Les barons du nord viennent en nombre attirés par les terres du midi et la soif de pillage. Ils sont menés par Simon de Montfort (Simon IV le Fort Comte de Montfort). Bientôt ils assiègent Toulouse et vainquent les princes cathares. En 1215 ils font leur entrée dans Toulouse qu'ils pillent.
Les Languedociens se révolteront rapidement, Simon le pillard sera tué, son fils s'enfermera dans Carcassonne et fera appel à Philippe Auguste promettant le rattachement des terres du Midi à la couronne. Philippe refusera ne voulant pas faire la guerre au peuple mais surtout ne voulant pas laisser le royaume sans défense face à l'Anglais. En 1193 Philippe Auguste épouse Ingeburge de Danemark le 15 août dans la cathédrale d'Amiens, le lendemain ils sont couronnés par l'Archevêque de Reims et le surlendemain Philippe annonce sa volonté de se séparer de Ingeburge.
Il la séquestre dans le monastère de Saint-Maur-des-Fossés. Le 5 novembre une assemblée présidée par l'Archevêque de Reims conclut à la nullité du mariage. C'est dans la période de 1194-1196 qu'apparaît dans les écrits la cérémonie de l'adoubement. En 1215 se tient le troisième concil du Latran (palais romain résidence des papes à cette époque) au cours duquel il est décidé la publication des bans afin d'éviter les mariages consanguins. Philippe Auguste meurt en 1223 il laisse le domaine royal quintuplé.
► 1180 Lorsque Philippe II monte sur le trône (1180-1223), des forces nouvelles sont en place, dont il saura diriger l'élan pour consolider définitivement la royauté française. Par une succession d'alliances matrimoniales éminemment politiques, la monarchie a réalisé une synthèse entre les trois dynasties : mérovingienne, carolingienne et capétienne. Les racines de la maison capétienne plongent solidement dans un passé fabuleux. La gloire de Charlemagne et de Roland, toujours chantée par les trouvères dans les manoirs ou sur les places de village, rejaillit sur la maison royale. L'éclatante victoire de Bouvines (27 juillet 1214) sur la coalition anglo-allemande, suivie par quelques grands feudataires du royaume, a suscité une immense liesse populaire.
Auréolé de gloire, Philippe prend le titre d'"Augustus". Il est considéré comme le sauveur du pays contre l'ennemi anglais. Les conquêtes réalisées sur l'empire "angevin" des Plantagenêts semblent définitivement acquises. En moins de trente années, la monarchie a atteint les rivages de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée. Le domaine royal a quadruplé, avec en son centre l'Ile-de-France, la région des plus grasses terres du royaume. Plus qu'aucun de ses grands vassaux, le roi est désormais riche et puissant.
A l'extérieur de ce que l'on commence à appeler la France, la puissance capétienne en Occident est respectée et son prestige reconnu. A l'intérieur du royaume le souverain détient l'autorité suprême. Le pape Innocent III déclare : "De notoriété publique le roi de France ne reconnaît au temporel aucune autorité supérieure à la sienne". Extension du territoire et unification du pays sont les tâches majeures accomplies par Philippe Auguste. Les grands barons, dont nombre se livraient au pillage ou fomentaient des guerre civiles, sont enfin soumis.
Le roi, que la cérémonie du sacre place au-dessus de tous, ne doit l'hommage à personne, mais ses sujets sont obligés de respecter les rites et les obligations de la vassalité. De bas en haut de l'échelle sociale les hommes vivent sous le régime de la féodalité. Seigneurs, hommes libres ou serfs sont assujettis à des lois de subordination créant des droits et des devoirs entre eux. Une stricte hiérarchie existe également entre seigneurs eux-mêmes (ducs, marquis, comtes, châtelains). Par le contrat vassalique, suzerain et vassal s'engagent par "l'hommage" et le "serment de fidélité". Le vassal doit à son seigneur "aide" et "conseil".
L'aide, ou "ost", c'est avant tout le service militaire. C'est aussi une contribution financière, dont la plus courante consiste à réunir la rançon d'un seigneur fait prisonnier. Le conseil oblige le vassal à siéger à la cour seigneuriale ("plaid" de justice). En retour le seigneur doit au vassal "protection" et "entretien", ce qui se traduit par la concession gratuite de terres. Ce fief, concédé à l'origine de manière viagère, est devenu progressivement un bien héréditaire. Si les seigneurs, maîtres en leur domaine, peuvent exercer le pouvoir de commander et de punir, tous, du plus petit au plus grand, doivent rendre un hommage prioritaire au seigneur-lige, c'est à dire au roi.
Dans les structures médiévales la chevalerie est une caste à part. Née au début du XIe siècle en Occident, elle se développe considérablement au XIIe siècle. Qu'il appartienne à la haute aristocratie ou à un lignage de moindre importance, le chevalier doit être suffisamment riche pour acquérir un équipement très coûteux (heaume, haubert, lance, épée, baudrier) et un cheval de combat. Car le chevalier est avant tout un homme de guerre. Dès l'enfance il apprend à manier des armes et à supporter le port de l'armure.
Très tôt la chevalerie prend un caractère sacré que lui confère le rite de l'adoubement, au cours duquel un jeune écuyer est intronisé chevalier. En même temps qu'il jure de sa foi chrétienne, de défendre l'Église, de protéger son seigneur et les pauvres, il reçoit ses armes et des éperons bénis par un prêtre. Faire partie de la chevalerie c'est partager un même idéal (valeur militaire) et respecter un même code moral (loyauté au combat, mépris du profit, idéalisation de l'amour humain). A la suite des différentes croisades, les chevaliers, engagés dans la lutte contre les Infidèles, sont devenu de redoutables "Soldats du Christ", ce qui conduira à la création d'ordres religieux militaires (Templiers).
Constituée à l'origine par des éléments issus de la noblesse, la chevalerie a progressivement ouvert ses rangs à des gentilshommes de plus modeste naissance, petits hobereaux ou seigneurs de village. Une nouvelle classe est née de paysans qui se sont considérablement enrichis, ont acquis des terres, puis, pour les plus entreprenants, une châtellenie. Quelques uns ont ainsi pu accéder à la chevalerie. Les exemples sont encore très rares d'une spectaculaire promotion sociale en ce début du XIIIe siècle. Mais une prospérité générale et un formidable dynamisme dans tous les domaines marquent le règne de Philippe Auguste et la fin du siècle.
Tout d'abord l'expansion démographique fait un bond et se poursuit sans désemparer. Cette montée de la population est un facteur essentiel de la croissance économique. Entre population et ressources du sol, l'équilibre est atteint. On pioche, on laboure, on sème, on multiplie les rendements. On arrache à une nature hostile des terres nourricières au détriment des forêts, des landes, des marécages. Nourrir une population en progression et exploiter ce nouvel espace agricole nécessitent des améliorations décisives. L'outillage se perfectionne (charrue à soc métallique), les bêtes de trait se généralisent (le cheval supplante le boeuf), les labours s'organisent (assolement triennal), des cultures plus lucratives que les céréales s'étendent (vigne, lin, chanvre et plantes tinctoriales), les moulins hydrauliques et les fours à pain couvrent les campagnes.
Dans le même temps les rapports entre seigneurs et paysans se modifient. Le système des corvées, ou “tailles”, dues au maître est progressivement remplacé par le salariat et des manoeuvres agricoles se louent de domaine en domaine. A force de lutte et à renfort de deniers, l'émancipation paysanne se réalise par l'institution de “franchises” passées entre seigneur et paysans et dont les chartes fixent et limitent les exigences seigneuriales. Sur les tenures ou concessions de terre louées aux maîtres, les hommes libres peuvent disposer du fruit de leur travail et s'enrichir ; les serfs s'affranchissent plus progressivement.
Le “vilain” (de “villa”, qui désigne le domaine rural), bénéficie en premier des surplus de l'agriculture. La famille paysanne qui s'accroît mange désormais régulièrement à sa faim et un sensible mieux-être se manifeste dans les conditions d'existence. Dans la maison où le récent usage du verre à vitre apporte de la clarté, on prend le temps de s'asseoir et d'échanger entre voisins des nouvelles autour du tout nouveau foyer de la cheminée ; foyer où règne la femme et dont le rôle au sein de la communauté familiale et rurale s'est fortement affirmé.
Les plus riches demeures paysannes s'équipent en meubles, encore grossièrement façonnés mais plus nombreux, en toutes sortes d'ustensiles de cuisine ; dans les coffres de bois sont enfermés des vêtements taillés dans un drap plus fin et rendus plus pratiques depuis l'invention du bouton ; on montre avec fierté l'acquisition d'un miroir de verre et non plus de métal poli. La paysannerie se regroupe en paroisses rurales, encadrées par le clergé et sous l'autorité d'un maire, où jouent pleinement la solidarité et le travail collectif.
Mais souvent le prix de la liberté à payer au seigneur (le “ cens ”, redevance foncière) était trop cher, comme étaient lourds les impôts dus au clergé (la dîme). Aussi de nombreux paysans ruinés vont rejoindre les bandes de mendiants aux portes des villes, ou verser dans le brigandage sur le chemin des forêts. L'espace forestier, malgré les progrès du défrichement, occupe la majeure partie du royaume. Les grandes voies qui le traversent ne suffisent plus aux échanges commerciaux qui se sont beaucoup développés.
Parallèlement, un réseau nouveau de routes se constitue, qui relie villages, châteaux, bourgs, abbayes, ports et grandes cités. Ponts, digues et embarcadères sur les rivières sont partout construits et facilitent encore le trafic. Des chariots aux roues renforcées par des lames métalliques et tirés par des chevaux ferrés assurent mieux l'acheminement des marchandises. La sécurité des caravanes marchandes qui sillonnent le territoire est assurée par les marchands eux-mêmes, regroupés en "gildes" ou "frairies" et armés contre d'éventuels concurrents pillards ou seigneurs avides.
Les foires sont les lieux privilégiés des rencontres marchandes et les centres de commerce entre le monde nordique et le monde méditerranéen. D'une durée de une à six semaines, les foires se tiennent à proximité immédiate de la ville et se succèdent tout au long de l'année. Champagne et Brie sont les deux pôles de l'activité la plus intense. De tout le royaume, et de l'étranger, on vient commercer à Provins, Troyes, Bar-sur-Aube ou Lagny-sur-Marne où l'on trouve quantité de marchandises : laines, draps de luxe, ustensiles en métal, épices, cuir travaillé, soieries, fourrures, produits tinctoriaux. L'essor de la circulation et des échanges a déterminé la montée spectaculaire des villes.
A aucune autre époque les créations urbaines n'ont été aussi nombreuses qu'alors. Ces “ville-neuves” ou “ville-franches”, qui se sont gonflées du trop plein des campagnes surpeuplées, sont les centres nerveux de la vie régionale. Des bourgades ont grandi et peuvent abriter quelques milliers d'habitants. Au coeur des cités, des maisons à étages se disputent la moindre parcelle d'espace vide. Au delà des enceintes, des faubourgs grossissent démesurément. Les "gens du bourg", d'où vient leur nom de bourgeois, exercent presque tous un "métier" : ce mot est du temps et désigne une activité économique spécialisée, distincte du labeur commun, celui de la terre.
Les gens d'un même métier se regroupent en corporations qui réglementent leur professions et dont le pouvoir va s'étendre fortement au Moyen Âge. Les villes abritent autour de leurs marchands une très grande diversité d'entreprises artisanales. Les industries du vêtement, du cuir, des métaux ou du bois ont chacune leurs nombreux spécialistes. Petites manufactures, ateliers groupés dans une même rue, échoppes et comptoirs marchands occupent une grande partie de la cité. Si la plupart de ces activités sont encore pauvres en moyens et en capitaux, ce n'est pas le cas de la draperie.
Activité de pointe du monde occidental, la "grande draperie" va s'implanter dans les villes de Rouen, Amiens, Beauvais, Châlons-sur-Marne et Reims. Elle va également susciter une quantité d'emplois : fileurs, peigneurs, tisserands, foulons, tendeurs et teinturiers, tous dépendants du marchand drapier qui fournit la matière première et fixe le prix du travail. Riche de ses nombreuses activités, forte d'un négoce et d'un artisanat florissants, la ville va s'émanciper à son tour. Cette liberté, arrachée à prix d'argent à la tutelle des seigneurs locaux par les bourgeois, trouve son expression dans le mouvement "communal".
La commune résulte d'une association jurée entre les habitants d'une ville pour la défense de leurs intérêts collectifs, le droit de s'administrer elle-même et de rendre justice. Plus ou moins suivie selon les régions, l'émancipation urbaine se développe cependant rapidement. De nombreuses villes moyennes et grandes ont acquis le statut de commune. A l'exception de Paris. A Paris, comme dans tout le royaume, Philippe Auguste est maître. Paris est la ville où il est né, dont il a fait sa capitale. Le roi y séjourne désormais quand il ne chasse pas sur les terres de son domaine d'Ile-de-France.
Plus qu'aucune autre, la ville subit le dynamisme général, se transforme et s'embellit. L'expansion est désordonnée, le roi l'organise. Une nouvelle muraille entoure le quartier marchand et cerne celui des écoles. La grosse tour du Louvre est édifiée pour défendre le passage de la Seine. Les rues principales sont pavées, les nouvelles halles fortifiées. Gonflés par l'afflux de nouvelles populations, les faubourgs hier disséminés ne forment plus qu'un bloc. Combien sont-ils ces Parisiens ? Sans doute plus de 50 000, et Paris est sans conteste la ville la plus vaste et la plus peuplée d'Occident.
Autour de la toute neuve cathédrale Notre-Dame (achevée en 1230), et de chaque coté de la Seine, apparaissent paroisses et églises. L'île de la Cité abrite le palais du roi, dont les bâtiments et les écuries prennent place parmi les jardins et les vergers. Dans le palais sans cesse agrandi s'installent à demeure les nouveaux services de la royauté, les clercs et les officiers du roi. Ce centre du pouvoir, enfin fixe, facilite les tâches du gouvernement et de l'administration. Dans ses méthodes et son esprit, l'administration royale s'est totalement transformée. Elle s'est rendue singulièrement efficace par l'institution des "baillis".
Ces baillis ou sénéchaux sont des agents gagés par le roi, fréquemment mutés et révocables. Ils sont issus de la noblesse, mais doivent leur fortune au roi qui les emploie, et dont ils deviennent naturellement les plus ardents défenseurs. Les baillis ont pour mission d'administrer les provinces, de surveiller les vassaux, le clergé et les communes, de faire exécuter les décrets royaux. Ils président aux tribunaux, sont chefs de police, et surtout gestionnaires des finances royales dont ils rendent compte devant la cour plusieurs fois l'an.
Pour remplir leurs multiples fonctions ils ont acquis des rudiments de comptabilité et des connaissances juridiques. Ils sont secondés par un personnel spécialisé et par des clercs, tous conscients de leur valeur et séduits par le pouvoir qu'ils servent. Et tous apportent au roi une arme redoutable : l'écrit. Les actes émanant de l'Administration se comptent maintenant par milliers et constituent de précieuses archives, enfermées au Temple comme l'est également le trésor royal.
La capitale agit comme un aimant sur les grands vassaux qui construisent des hôtels pour y séjourner et profiter des agréments de la ville. La présence de la cour, le passage des barons et des évêques stimulent l'artisanat de luxe et intensifient le commerce. Le système monétaire s'est stabilisé et adapté aux réalités commerciales nouvelles. La forte monnaie royale, "parisis" ou "tournois", se substitue aux "deniers" locaux frappés dans des dizaines d'ateliers seigneuriaux. Sur le Grand Pont, l'activité est intense autour des boutiques de changeurs qui s'y sont installées. Paris est devenu le plus grand centre artisanal du royaume : une centaine d'associations professionnelles réunit près de cinq mille maîtres artisans.
L'aménagement des berges de la Seine et les nombreux débarcadères développent encore les liaisons avec les grandes foires marchandes de Champagne. Bien que très puissant, le prévôt des marchands est contrôlé par le prévôt royal qui gère la ville au nom du roi. Philippe Auguste a cependant associé des riches bourgeois à la gestion de Paris et même appelé certains à faire partie de son Conseil de régence, à l'égal des barons. Capitale royale, centre politique et foyer économique, Paris est aussi le carrefour de la culture.
Ses activités intellectuelles y ont une place essentielle. Paris a ses cercles poétiques, ses écoles, son milieu cultivé, ses tournois philosophiques. L'enseignement se dispense partout, dans des locaux loués par des maîtres (fondations religieuses, cloîtres, églises) mais aussi dans les rues et sur les places. Animés par la passion de la connaissance, les étudiants viennent de l'Europe entière. Issus de toutes origines sociales, Scandinaves, Anglais, Italiens, Espagnols, Allemands se mêlent aux Français venus de toutes les régions du royaume.
Les plus pauvres s'engagent comme serviteurs ou répétiteurs pour gagner quelques deniers dans leurs moments de liberté. Les plus fortunés trouvent à se loger dans le quartier de la Montagne Sainte-Geneviève où s'est déplacé le foyer d'études et où se multiplient les logeurs, les fabricants de livres et d'encre. Maîtres et étudiants combattent ensemble pour établir leurs statuts : définir les disciplines d'études et défendre leurs intérêts. Ils se sont regroupés en une association semblable aux corporations professionnelles des villes et ont formé une "conjuration" qu'on appelle dès 1208 l'Université.
Dans les bagarres, le sang et les grèves prolongées, l'Université a enfin pu naître, gagner sa reconnaissance officielle et son autonomie. Elle s'ordonne autour de quatre facultés : Théologie, Droit, Médecine, Arts (enseignement de la rhétorique, la dialectique, la littérature et avant tout la philosophie). Bientôt l'Université va introduire l'étude révolutionnaire de la logique formelle d'Aristote, de ce qu'on tient alors pour "science" et qui va provoquer une autre façon de vivre et de comprendre le monde.
Grâce au prestige de ses maîtres, Paris est considérée comme le "grand atelier d'Occident" d'où rayonne la culture. Comme la culture est de Paris, l'art en architecture est de l'Ile-de-France. Après avoir assimilé les découvertes artistiques des pays du sud, L'Ile-de-France voit l'éclosion d'un style nouveau : le gothique. L'innovation de l'arc-boutant permet d'ériger des églises et des cathédrales aux voûtes vertigineuses. La nef de Notre-Dame peut ainsi s'élever d'un élan inouï, jusqu'à 32 mètres. De "l'obscurité" romane, l'édifice religieux passe à la "lumière" gothique.
Les architectes s'attachent à percer de fenêtres les façades des églises ou des abbatiales pour laisser couler la lumière qui est le lien parfait entre l'homme et Dieu, "pour éclairer les esprits et les mener par les vraies lumières à la lumière véritable du Christ". L'abbatiale de Saint-Denis est le modèle de cet art gothique nouveau et de toute la lignée des cathédrales qui sortent de terre, comme Noyon, Senlis, Laôn, Chartres. Pour les faire "resplendir d'une merveilleuse lumière ininterrompue" les maîtres verriers font des prodiges. Pour orner l'intérieur de ces murs, peintres et sculpteurs travaillent à un nouveau thème : la nativité.
Pour y louer le Seigneur, la musique polyphonique emplit tout l'espace architectural d'une étonnante floraison. Comme se propage partout dans le royaume l'art gothique, se diffuse une nouvelle littérature à la cour du roi et à celle de fastueux et lettrés seigneurs de province. Les "chansons de geste", ces longs poèmes épiques célébrant les exploits de héros associés à l'histoire de la France royale, sont peu à peu remplacées par un nouveau genre : le roman "courtois". A la Chanson de Roland se substitue le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris ou le Lancelot ou le Perceval de Chrétien de Troyes. Les troubadours y exaltent les valeurs de la "courtoisie": le culte de la femme, la fidélité dans les relations amoureuses, un art nouveau de savoir-vivre, une forme d'élégance morale et l'idéal de la chevalerie qui reflète au plus haut degré la société féodale du XIIIe siècle.
► 1180 à 1189 - Les premières années du règne furent employées par le jeune roi à lutter pour le rabaissement de Henri II d'Angleterre, qui mourut en 1189 et eut pour successeur Richard Ier, Coeur de Lion. A l'intérieur, il fortifia les institutions sur lesquelles reposait la monarchie et amorça les réformes heureuses et les créations qui ont fait de lui un des rois auxquels la France doit le plus.
42 - De 1181 à 1226 (Louis IX)
► 1181 Coalition de la Flandre et de la Champagne contre Philippe Auguste.
► 1181 Intervention de Henri II en faveur de Philippe Auguste.
► 1182 Édit d'expulsion et de confiscation des biens juifs du royaume.
► 1182 Chrétien de Troyes écrit 'Perceval ou le Conte du Graal'.
► 1182 vers - Poète Conon de Béthune se plaint (dans poème Moult me semont Amors que je m'envoise) que la Reine Adèle de Champagne se moque de son parler picard - ses 'mots d'Artois' - alors qu'ils étaient très compréhensibles en français. Conon de Béthune est un trouvère né vers 1150 en Artois, et mort en 1220 à Constantinople. Il est le fils de Robert V de Béthune. Renommé pour ses chansons d'amour et de croisade, il participe à la IIIe et IVe croisade dans lesquelles il tient un rôle politique important. Il écrit aussi une satire attaquant ceux qui s'approprient les fonds rassemblés pour financer ces croisades.
► 1182 à 1226 - naissance et mort de François d'Assise, de son nom véritable Francesco Bernardone, fondateur de l'ordre franciscain (ou ordre des frères mineurs, o.f.m.), considéré comme saint par l'Église catholique romaine. Religieux italien. Personnage majeur du Moyen Âge occidental, François d'Assise a proposé à la chrétienté un modèle de pauvreté, de simplicité évangélique et de contestation de l'ordre social fondé sur les privilèges et l'argent. Fils d'un riche marchand, il rompt avec le monde en 1206 pour se vouer au renoncement total et à la pauvreté.
Il fonde avec ses disciples la fraternité des Pénitents d'Assise vénérant le Christ crucifié. L'ordre des franciscains s'étend alors sur toute l'Italie du Centre et du Nord mais aussi en Allemagne, en France, en Hongrie, en Angleterre, au Maroc. François d'Assise ira jusqu'en Égypte. A la fin de sa vie, il se consacre à la prédication, à la prière et à la vie d'ermite. Déjà malade et presque aveugle, il compose le 'Cantique au soleil', louange joyeuse et sublime de Dieu. Il meurt en 1226, après avoir dicté son testament. Canonisé en 1228. Sa légende revit dans les Fioretti et dans les fresques de Giotto à Assise.
► 1183 mort de Chrétien de Troyes.
► 1183 Marie de France écrit Wace.
► 1184 Les Vaudois sont reconnus comme hérétiques.
► 1185 juillet Traité de Boves avec le comte de Flandre (Philippe d'Alsace) annexant les comtés d'Amiens et de Mondidier au domaine royal. Philippe d'Alsace (° 1143 - † Saint-Jean-d'Acre, 1er août 1191), fils du comte Thierry d'Alsace (dit Thierry III de Lorraine) et de Sibylle d'Anjou (†1165). Comte de Flandre 1157 - 1191. Comte de Vermandois par mariage v. 1168 - 1186, à titre viager 1186 - 1191. Son règne correspond à l'apogée et au début du déclin de la puissance féodale flamande. Il lutta avec les visées de Philippe Auguste sur la Flandre, l'Artois et la Picardie. Le problème de sa succession fut au coeur de la politique de la fin de sa vie.
► 1185 Fondation de l'Ordre du Carmel. Ordre du Carmel ou Carmes, ordre religieux. Les Carmes vivaient cloîtrés, observaient le silence et se livraient au jeûne et à la prière. Ils portaient une robe brune et une chape blanche avec des barres de couleur brune, d'où le nom de Barrés qu'on leur donnait aussi. Les Carmélites sont une congrégation de religieuses qui suivaient la règle des Carmes. Cette congrégation, introduite en France dès 1452; fut réformée par Thérèse d'Avila en 1562 : le cardinal de Bérulle et Madame Acarie firent adopter cette réforme en France.
C'est dans un couvent de Carmélites de Paris (rue d'Enfer) que se retira Mademoiselle de La Vallière. Ordre des Carmélites. L'ordre des Carmes est un ordre religieux mendiant fondé en 1185 par le croisé Berthold de Calabre sur le mont Carmel, où il prône la vie érémitique. Au XVe siècle, la branche féminine dite ordre des Carmélites est créée par le carme Jean Soreth. Dans les années 1560, Thérèse d'Avila et saint Jean de Croix, en quête d'une discipline plus rigoureuse, réforment l'ordre. Ils fondent les carmes déchaussés (port de sandales) fidèles à la règle primitive dominée par la solitude, la pauvreté extrême, la prière et les travaux manuels.
► 1186 Alliance de Philippe Auguste et Geoffroy de Bretagne contre Richard Coeur de Lion. Geoffroy II de Bretagne, (1158 - 1186), le troisième fils d'Henri II d'Angleterre et d'Aliénor d'Aquitaine, fut duc de Bretagne. Fiancé à Constance, fille du duc Conan IV et héritière du duché de Bretagne, il devient duc de Bretagne dès 1175, après la mort de Conan, donc avant même la célébration de son mariage en 1181. Il trouve la mort dans un tournoi et laisse une femme enceinte de celui qui sera Arthur de Bretagne.
► 1187 - 5 juillet Saladin écrase les armées chrétiennes à Hattin.
► 1187 - 2 octobre Prise de Jérusalem par Saladin. Le roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, est vaincu à Tibériade par Saladin qui, magnanime, le libère. Cet épisode est l'un de ceux qui ponctuent le temps des Croisades, entre la première prêchée par Urbain II en 1095 et la dernière au cours de laquelle meurt Louis IX en 1270. Guy de Lusignan (1159 † 1194), roi de Jérusalem (1186-1192), puis roi à Chypre (1192-1194), fils de Hugues VIII le Vieux, seigneur de Lusignan et comte de la Marche, et de Bourgogne de Rançon.
► 1187 Reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre.
► 1188 Traité de paix de Gisors entre Philippe Auguste et Henri II. Au départ de la 3e croisade à Gisors, en Normandie, Philippe Auguste, Henri II d'Angleterre et le comte de Flandre (Philippe d'Alsace) conviennent de distinguer leurs hommes par couleurs. La croix de gueules (rouge) est attribuée aux Français, d'argent (blanc) aux Anglais et de sinople (vert) aux Flamands.
► 1189 - 4 juillet Paix d'Azay-le-Rideau. Par cette paix humiliante, le roi Henri II d'Angleterre désigne son fils Richard Coeur de Lion comme nouveau roi et abandonne à Philippe Auguste l'Auvergne, Issoudun et Châteauroux. Il meurt quelques jours plus tard. Azay-le-Rideau est une commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre.
► 1189 - 6 juillet Mort du premier souverain Plantagenêt d'Angleterre. Après dix ans de conflit de pouvoir avec ses fils Jean Sans Terre et Richard Coeur de Lion, Henri II d'Angleterre s'éteint à Chinon. Il a alors cédé le pouvoir à celui qui va devenir Richard Coeur de Lion lors d'un traité signé à Azay-le-Rideau. En constante lutte avec le roi de France Philippe Auguste lors de la fin de son règne, Henri II donna une place centrale à la Normandie et fut à l'origine de nombreuses réformes qui ont modernisé le royaume anglo-normand.
Il est également connu pour l'assassinat de Thomas Becket. Jean Sans Terre (24 décembre, 1166-18 octobre, 1216), seul roi d'Angleterre ainsi nommé, était le fils le plus jeune du roi Henri II d'Angleterre. Son sobriquet, Jean Sans Terre (en anglais, John Lackland) venait du fait que son père n'avait pas de terres à lui donner jusqu'à la mort de ses frères ainés. Isabelle d'Angoulême était la fiancée de Hugues IX de Lusignan quand Jean Sans Terre la lui ravit.
Hugues IX de Lusignan fit appel au roi de France qui se servit du refus de Jean Sans Terre de paraître devant lui pour prononcer la commise - confiscation - de ses biens continentaux. Veuve de Jean Sans Terre, Isabelle épousera Hugues X de Lusignan, fils de Hugues IX. Jean, contraint et forcé, accorde la Magna Carta en 1215, une charte limitant les pouvoirs royaux. La royauté en Angleterre n'est dorénavant plus absolue. Pour le bonheur des Anglais, ce prince cruel décède après avoir ingurgité une pêche trempée dans de la bière à moins que ce ne soit du vin...
► 1189 Après la mort d'Henri II, le 6 juillet 1189, Aliénor d'Aquitaine est libérée par le nouveau roi, Richard Coeur de Lion, qui est sur le point de partir pour la Troisième croisade.
► 1189 - 18 juillet Philippe Auguste restitue les conquêtes d'Henri II. Pour le remercier, Philippe Auguste redonne à Richard Coeur de Lion, qui monte sur le trône d'Angleterre, les territoires enlevés à son père.
► 1189 - 3 septembre Richard Coeur de Lion est couronné roi d'Angleterre. Roi le 6 juillet 1189 après la mort d'Henri II, Richard Ier Coeur de Lion est couronné à Westminster le 3 septembre. Mais Richard Coeur de Lion est surtout préoccupé par les faits d'armes et décide un an plus tard de partir à la conquête de Chypre. Couronné de succès lors des Croisades notamment à Saint-Jean d'Acre, il subit aussi des revers comme à Jérusalem et se fait emprisonné lors de son retour en Europe par le duc Léopold V d'Autriche.
► 1189 Début de la troisième croisade. La troisième croisade, de 1189 à 1193, fut entreprise sous le pontificat de Clément III, et prêchée par Guillaume, archevêque de Tyr. Il s'agissait de reconquérir Jérusalem, retombée au pouvoir des musulmans en 1187. Trois souverains partirent avec de nombreuses armées pour la Terre-Sainte : Philippe Auguste, roi de France, Richard Coeur de Lion, roi d'Angleterre, et Frédéric-Barberousse, empereur d'Allemagne. Mais le succès ne répondit point à l'espérance générale : l'armée de Frédéric fut presque entièrement détruite en Asie, et lui-même il périt en Cilicie (1190); les deux autres princes s'emparèrent de St-Jean-d'Acre, mais, une fâcheuse rivalité s'étant établie entre eux, Philippe revint bientôt en France (1191), et tout le courage de Richard n'aboutit qu'à obtenir de Saladin une trêve de 3 ans.
► 1189 à 1192 - Troisième croisade. - Le sultan Saladin venait en 1187, en remportant sur Guy de Lusignan la victoire de Tibériade, de détruire le royaume français de Jérusalem et de s'emparer de cette ville. Guillaume, archevêque de Tyr, vint réclamer le secours des princes d'Occident en faveur des chrétientés d'Asie menacées dans leur existence par le triomphe des musulmans. C'est à Gisors, en France, que ce prélat prêcha la croisade ; le départ eut lieu en 1189 : Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion se mirent à sa tête.
De son côté, l'empereur d'Allemagne Frédéric Barberousse, prit la croix et partit pour les rejoindre avec une armée nombreuse. Frédéric s'empara de la ville d'Iconium et quelque temps après se noya en Cilicie. Les croisés français et anglais s'emparèrent de Saint-Jean-d'Acre. Des différents ayant surgi entre les chefs, Philippe rompit avec Richard et rentra en France en 1191, le laissant continuer seul la croisade (jusqu'en 1192).
La troisième croisade, qui débuta en 1189 et s'acheva en 1194, fut menée par les rois de France, d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne, dans le but de reprendre la Terre Sainte à Saladin. Frédéric Barberousse, Frédéric Ier (1122/25-1190), dit Frédéric Barberousse fut élu roi d'Allemagne le 4 mars 1152 en succédant à son oncle Conrad III de Hohenstaufen, et couronné empereur romain germanique en 1155. Prélat, membre du haut clergé investi par le Saint-Siège. Les cardinaux et les archevêques sont des prélats.
► 1190 - 15 mars Mort d'Isabelle de Hainaut, reine de France.
► 1190 - 10 juin Barberousse meurt noyé. L'empereur d'Allemagne Frédéric de Hohenstaufen, dit Barberousse, se noie en voulant se baigner dans un torrent glacé de Cilicie, au sud de l'actuelle Turquie. Il s'en allait rejoindre la troisième croisade avec son armée. Durant son règne, il tenta de consolider la position impériale en Germanie et en Italie. Il deviendra le symbole des espérances populaires et nationales du peuple allemand.
► 1190 - 24 juin Testament de Philippe Auguste. Sur le point de partir avec Richard Coeur de Lion pour la troisième croisade, Philippe Auguste organise par un testament ce que doit être le gouvernement pendant son absence.
► 1190 - 4 juillet La troisième croisade. Symboliquement, c'est sur la colline de Vézelay d'où est partie la première croisade après l'appel du pape Urbain II en 1095, c'est dans cette basilique où Pierre l'Ermite a prêché pour les pauvres en 1096, que se retrouvent Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion avant de partir pour la troisième croisade. Celle-ci est décidée en raison de la prise de Jérusalem par Saladin, le 2 octobre 1187. L'empereur Frédéric Barberousse a déjà pris la route.
► 1190 - Fondation de l'ordre Teutonique. Ordre teutonique, l'ordre de la Maison de sainte Marie des Teutoniques, plus connu sous le nom d'ordre des Chevaliers teutoniques ou maison des chevaliers de l'hôpital de sainte Marie des Teutoniques à Jérusalem, est un Ordre militaire. Il fut fondé à Saint-Jean-d'Acre en 1190, lors de la troisième croisade, après la prise de Jérusalem par Saladin. il fut dénommé ainsi parceque composé pour l'essentiel de chevaliers allemands ou teutons.
A l'origine simple communauté charitable venant en aide aux pélerins chrétiens, il fut réorganisé en ordre militaire vers 1192 et obtint la reconnaissance officielle du pape Innocent III en 1198. Le premier grand-maître Heinrich Walpot fut élu en terre sainte où il fit bâtir une église et un hôpital. Un siècle plus tard, en 1291, la prise d'Acre par les Mamelouks obligea les croisés à quitter la Terre sainte et contraignit l'ordre à reconsidérer sa mission.
► 1190 à 1253 - naissance et mort de Uc de Saint-Circ poète, jongleur troubadour.
► 1190 à 1262 - naissance et mort de Gilles Le Vinier. Trouvère appartenant au puy d'Arras.
► 1190 - Début de la construction du Louvre à Paris. À l'origine du Louvre il y a un château fort, la Grosse tour du Louvre, érigé par le roi Philippe Auguste, en 1190. L'une de ses principales missions est la surveillance de l'aval de la Seine, qui constitue l'une des voies traditionnelles des invasions et razzias depuis l'époque des Vikings.
► 1191 - 8 juin Arrivée de Richard Coeur de Lion, devant Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre est une ville d'israël, située au nord de la baie de Haïfa, sur un promontoire et doté d'un port en eaux profondes.
► 1191 - 13 juillet Prise de Saint-Jean-d'Acre par les croisés. Malgré leur mésentente, les deux rois croisés Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion qui ont entrepris cette troisième croisade pour délivrer Jérusalem des mains des infidèles, combattent au côté l'un de l'autre. Ils reprennent au sultan Saladin Saint-Jean-d'Acre, grâce au courage de Richard. Après cette victoire, le roi de France laisse seul en Terre Sainte le roi d'Angleterre et rentre.
► 1191 Retour de Philippe Auguste en France.
► 1191 De retour en France, Philippe Auguste voulut profiter de l'éloignement de Richard Coeur de Lion et de leur rupture, pour mettre la main sur les provinces que le roi d'Angleterre possédait en France.
► 1192 Ayant conclu la paix avec Saladin, Richard s'achemina vers l'Europe; mais il fut jeté par un naufrage sur la côte de Dalmatie où il fut reconnu pour avoir, pendant la croisade, insulté la bannière d'un seigneur du pays. Retenu prisonnier par le duc d'Autriche (Léopold V d'Autriche) il recouvra la liberté en payant une rançon et vint prendre en France la direction de la résistance contre Philippe Auguste. La Dalmatie est une région de Croatie qui va de l'île de Pag, au nord-ouest, à la baie de Kotor au sud-est, non loin du Monténégro. Elle s'étend sur 350 km sur la côte est de la mer Adriatique sur environ 60 km de large.
► 1192 à 1199 - Philippe Auguste avait été aidé dans ses projets contre Henri II, puis contre Richard Coeur de Lion, par le frère de celui-ci, Jean Sans Terre. En apprenant le retour de Richard; pour se faire pardonner de l'avoir trahi, Jean trahit le roi de France et fit massacrer par des Anglais la garnison d'Évreux. Cependant, la lutte entre les deux souverains restant indécise, un accord intervint entre eux, qui mettait fin pour le moment aux hostilités. Mais Richard voulut avoir raison de quelques seigneurs qui avaient déserté sa cause. Il alla dans ce but assiéger le château de Chalus en Limousin, et fut tué pendant cette opération (1199), laissant pour héritier de la couronne, son neveu Arthur de Bretagne, fils posthume de Geoffroy V d'Anjou.
Le déloyal Jean Sans Terre fit enfermer et plus tard (1203) assassiner dans la Tour de Rouen le prétendant Arthur, afin de monter sur le trône à sa place. Arthur Ier de Bretagne, (30 avril 1187 - 3 avril 1203), le fils posthume de Geoffroy V d'Anjou, fut proclamé duc de Bretagne par les grands en 1196. Il est élevé à la cour de Philippe Auguste, qui le protège des convoitises de Richard Coeur de Lion. Sous Jean Sans Terre, il devient le chef nominal des barons bretons qui tendent vers l'indépendance. Vaincu et pris par Jean Sans Terre à Mirabeau en 1202, il meurt en prison à Rouen, assassiné par son oncle.
► 1192 - 21 août Création du shogunat. Conscient de l'incapacité de l'empereur à prendre le pays en main, le samouraï Minamoto-no-Yoritomo adopte le titre de shogun ("général" en japonais). Sans supprimer le gouvernement impérial, qui reste en place à Kyoto, il édifie à Kamakura (au sud de la ville actuelle de Tokyo) un gouvernement militaire qui exercera le vrai pouvoir. Le shogunat sera le régime officiel du Japon de 1192 à 1867. Minamoto no Yoritomo (9 mai 1147 - 9 février, 1199) est le fondateur et le premier shogun du shogunat de Kamakura au Japon, il a régné de 1192 à 1199. Shogun, signifie "général", c'est la contraction de seiitaishōgun, qui veut dire "le grand général qui triomphe des sauvages".
Néanmoins, après qu'il fut attribué à Minamoto no Yoritomo, il devint un titre héréditaire de la lignée Minamoto, indiquant le dirigeant de facto du Japon (dictateur militaire), alors même que l'empereur restait le dirigeant de jure (en quelque sorte le gardien des traditions). L'équivalent français serait les Cardinaux Mazarin et Richelieu du pouvoir consulaire (potestas) par rapport à l'autorité (auctoritas) royale. Dans la tradition du droit romain, auctoritas est le pouvoir sénatorial des auteurs de la loi, potestas est le pouvoir consulaire des grands commis de l'État et potentas le pouvoir administratif de l'exécution des détails. Samouraï est un mot japonais désignant un membre de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal durant près de 700 ans.
► 1192 Philippe Auguste s'empare de l'Artois et du Vermandois, dot d'Isabelle de Hainaut.
► 1192 - 2 septembre Traité entre Saladin et Richard Coeur de Lion instaurant une trêve.
► 1192 Gautier Map écrit 'Nugiae curalium'. Gautier Map, connu par le tout dernier passage de son livre, 'La Queste del Saint Graal', se dit de Salebieres. les poêtes du Graal: On connaît l'oeuvre de Chrétien de Troyes: elle a été souvent traduite, reprise, mise en scène parfois. Celle de Robert de Boron n'était connue jusque récemment que de ceux qui manient avec une suffisante dextérité le français médiéval pour pouvoir l'aborder dans le texte. Gerbert de Montreuil n'est quant à lui, jamais traduit, sinon pour de courts extraits. Gautier Map est le seul des quatre grands conteurs du Graal à avoir écrit en prose, ce qui ne nuit en rien à la poésie de son récit. Il a souvent été traduit pour les passages qui se rapportent à Galaad, personnage qui n'apparaît pas chez les autres auteurs.
► 1193 février Capture de Richard Coeur de Lion. Sur le chemin de retour de la croisade, le roi Richard Coeur de Lion est pris en otage par le duc Léopold V d'Autriche et livré à l'empereur Henri VI.
► 1193 - 14 août Mariage de Philippe Auguste avec Ingeburge de Danemark. Philippe Auguste épouse Ingeburge, soeur de Knut VI de Danemark, scellant l'alliance anti-anglaise. Il la répudie dès le lendemain du mariage (il n'aurait pas pu la déflorer) et l'accuse de sorcellerie. Ingeburge est mise dans un couvent. Philippe Auguste la reprendra en 1213.
► 11935 novembre Philippe Auguste répudie Ingeburge de Danemark. Ingeburge de Danemark ou encore Ingeborg ou Isambour, reine de France, née vers 1175, est la fille de Waldemar Ier. Philippe Auguste, désireux d'une alliance danoise contre l'Angleterre et veuf d'Isabelle de Hainaut, épouse Ingeburge le 14 août 1193. Les témoins s'accordent de parler de la beauté de la princesse. Néanmoins, à la fin de la nuit de noces, le roi manifeste une vive aversion pour sa jeune femme et s'enfuit. Une assemblée d'évêques et de barons, tenue à Compiègne à la fin de l'année, casse le mariage, ce que n'accepte pas le pape Innocent III, fort heureux de pouvoir se mêler des affaires du royaume.
► 1194 Conquête de la Normandie par Philippe Auguste.
► 1194 mars Libération de Richard Coeur de Lion.
► 1195 Averroès en exil. Le philosophe islamique est contraint à l'exil pour avoir exposé ses conceptions. Grand commentateur d'Aristote, il s'est également appuyé sur le néoplatonisme pour établir que la matière est éternelle. Le monde n'a ni début, ni fin. Dieu agit alors comme celui qui concrétise et donne un souffle aux éléments déjà existants. Au travers de ces considérations, Averroès tend à distinguer la raison de la foi, ce qui lui vaut cet exil. Il sera toutefois gracié peu de temps avant sa mort. On lui attribuera plus tard la théorie de la double vérité (révélée et rationnelle). Ses pensées influenceront fortement l'Occident médiéval et la scolastique chrétienne.
► 1196 Construction de Château-Gaillard (Normandie) par Richard Coeur de Lion. Château-Gaillard est une forteresse médiévale en ruine qui situe au coeur du Vexin normand, à 100 km de Paris sur la commune des Andelys (Eure). Il constitue un morceau d'histoire de France qui domine la vallée de la Seine, mêlant Richard Coeur de Lion et les rois maudits en haut d'une falaise de calcaire. Château-Gaillard a plus de 800 ans. Sa construction a coûté environ 50 000 livres.
Château-gaillard - Image par Thomas Ulrich de Pixabay
► 1196 - 13 mars Le pape Celestin III casse l'annulation du mariage de Philippe Auguste et Ingeburge.
► 1196 - 14 août Mariage de Philippe Auguste avec Agnès de Méranie. Agnès de Méranie ou de Meran (1172--1201), reine de France, est la fille du duc de Méranie Berthold IV. C'est elle qu'épouse Philippe Auguste en juin 1196 après avoir répudié sa deuxième femme Ingeburge de Danemark au terme de la nuit de noces. Le mariage avec Ingeburge ayant été annulé par une assemblée d'évêques complaisants, Innocent III casse la décision des évêques, somme le roi de reprendre Ingeburge et met le royaume en interdit en janvier 1200, ce qui suspend toute vie sacrementelle et liturgique.
La mesure étant de nature à soulever contre le roi ses sujets privés de sacrements et de sépultures, Philippe Auguste feint de céder, envoie Agnès au couvent de Poissy et rend à Ingeburge un rang à la cour, mais sans reprendre avec elle la vie conjugale. En revanche, le roi, inquiet d'une succession mal assurée par le seul fils qu'il a eu de sa première femme, Isabelle de Hainaut, négocie avec le pape la reconnaissance des deux enfants qu'il a d'Agnès, Philippe Hurepel, qui épouse Mathilde de Dammartin, héritière du comté de Boulogne, et Marie, qui épouse Philippe Ier de Namur puis Henri Ier de Brabant.
► 1197 Coalition des comtés de Flandre, Boulogne, Blois et Toulouse avec Richard Coeur de Lion contre Philippe Auguste.
► 1198 Le pape Innocent III lance un Interdit contre le royaume de France et menace Philippe Auguste d'excommunication.
► 1198 Défaite de Philippe Auguste à Gisors contre Richard Coeur de Lion.
► 1198 août Le pape Innocent III appelle à délivrer Jérusalem.
► 1199 janvier Trêve de Vernon entre Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste.
► 1199 - 6 avril Mort de Richard Coeur de Lion. Libéré après le versement d'une rançon qui met l'Angleterre au bord de la faillite, Richard Coeur de Lion n'aura eu l'occasion de retourner dans son pays. Luttant contre le roi de France Philippe Auguste, notamment en Normandie où il construit sa forteresse de Château Gaillard, il est blessé lors du siège de Chalus dans le Limousin. Il meurt alors quelques jours plus tard sur les mêmes terres que son père, dix ans plus tard, à Chinon.
► 1199 - 25 mai Jean Sans Terre est couronné roi d'Angleterre.
► 1199 - 6 décembre Concile de Dijon; interdit contre Philippe Auguste (mariage irrégulier).
► 1199 novembre Thibaud de Champagne, comte de Champagne, prend la tête d'une prochaine croisade. Thibault de Champagne, né le 30 mai 1201, mort le 14 Juillet 1253 fut comte de Champagne de 1201 à 1253 (sous le nom de Thibault IV de Champagne), et roi de Navarre de 1234 à 1253 (sous le nom de Thibault Ier de Navarre).
► 1200 - 15 janvier Innocent III jette l'interdit sur le royaume. Le légat du pape Innocent III lance l'interdit sur le royaume. Philippe Auguste s'incline et reconnaît Ingeburge de Danemark pour épouse.
► 1200 - 22 mai Traité du Goulet entre Philippe Auguste et Jean Sans Terre sur les possessions anglaises. Conclu entre Philippe Auguste et Jean Sans Terre. Philippe garde Évreux et le Berry mais renonce à ses droits sur la Bretagne. Le traité du Goulet date du 22 mai 1200. C'est un traité entre Philippe Auguste et Jean Sans Terre, réconciliés aux dépens d'Arthur de Bretagne, après l'invasion de la Normandie par le roi de France et à la suite de la trêve de Vernon (janvier 1199).
Le Capétien y gagne le comté d'Évreux et le Berry, mais il abandonne au Plantagenêt ses droits sur la Bretagne. Arthur doit renoncer à ses prétentions sur la Normandie, l'Anjou et l'Aquitaine, et fait hommage à son oncle Jean Sans Terre pour le duché de Bretagne. Le roi d'Angleterre renonce à son alliance avec Otton IV du Saint-Empire. Un mariage scelle l'entente : le futur Louis VIII est fiancé à Blanche de Castille, nièce de Jean Sans Terre. Blanche apporte en dot Châteauroux, Issoudun et Graçay.
► 1200 - 23 mai Mariage de Louis, futur Louis VIII, fils de Philippe Auguste et Blanche de Castille. Pour sceller le traité du Goulet qui a été signé la veille, Louis, fils de Philippe Auguste, épouse la nièce de Jean Sans Terre, Blanche de Castille qui apporte Évreux en dot.Louis VIII de France, dit Louis le Lion, né le 5 septembre 1187 à Paris, mort le 8 novembre 1226 à Montpensier (Auvergne), fut roi de France de 1223 à 1226, huitième de la dynastie dite des Capétiens directs. Blanche de Castille, (née le 4 mars 1188 à Palencia, Espagne - morte le 27 novembre 1252 à Melun), reine de France, était la fille d'Alphonse VIII de Castille et d'Aliénor d'Angleterre, elle-même fille d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II d'Angleterre, roi d'Angleterre. Elle fut mariée en 1200 au futur Louis VIII, fils de Philippe Auguste.
► 1200 - 30 août Jean Sans Terre enlève et épouse Isabelle d'Angoulême. Promise à Hugues X de Lusignan, comte de la Marche, la fille unique du comte d'Angoulême est conduite à l'autel le 24 août 1200 par le roi d'Angleterre, Jean Sans Terre, qui la soustrait à son fiancé et l'épouse le 30 août à Chinon. La jeune Isabelle d'Angoulême devient donc reine d'Angleterre à l'âge de 14 ans. A la mort de Jean Sans Terre, en 1216, elle épousera Hugues X de Lusignan, tandis que leur fils aîné deviendra roi d'Angleterre sous le nom d'Henri III.
► 1200 'Prise d'Orange' (chanson de geste). Dès la fin du XIIe siècle, des trouvères ou simplement des copistes eurent l'idée de regrouper dans un même manuscrit des poèmes épiques d'époques et d'auteurs différents, dont l'unité était cependant sauvegardée par un héros principal ou par plusieurs personnages du même lignage. Ainsi apparurent les cycles. C'est à l'un des plus célèbres d'entre eux, le cycle de Guillaume d'Orange (Guillaume de Gellone), qu'appartient 'La Prise d'Orange'.
► 1200 Robert de Boron écrit 'Le Roman de l'histoire du Graal'. Robert de Boron, son oeuvre, s'appuyant sur celle de Chrétien de Troyes et de Robert Wace, marque une évolution du mythe du roi Arthur principalement par sa christianisation. C'est lui qui fait du Graal une relique chrétienne.
► 1200 vers - Essor du fabliau. Le fabliau est la forme picarde du mot français fableau, dérivé de fable. Le fabliau est essentiellement un conte du XIIIe ou du XIVe siècle destiné à faire rire. Parmi les fabliaux, beaucoup ne sont que des récits plaisants, souvent grossiers parfois même à la limite de la pornographie. La satire vise le plus souvent les nobles, les gens de guerre, le clergé, les moines, les femmes, etc. Le comique repose sur des jeux de mots, sur des quiproquos. D'autres fabliaux, cependant, ne sont que des ingénieuses intrigues destinées à satisfaire la curiosité et à émettre un enseignement moral. Il nous est parvenu environ 150 fabliaux.
► 1200 vers - Jean Bodel écrit le Jeu de saint Nicolas, Congés. Jean Bodel (1165-1210) fut un trouvère ayant vécu vers la fin du XIIe siècle à Arras. Ce poète a écrit un certain nombre de chansons de geste en ancien français.
► 1200 Le monde paysan. Le paysan libre et sa famille sont installés sur une terre louée à un seigneur, la tenure. Les menaces de guerre l'obligent régulièrement à se réfugier au château. Durant les mois d'hiver, les paysans restent dans leurs chaumières, faites de pierres et de bois, et recouvertes d'un toit de chaume. En général, elles ne sont constituées que d'une pièce. On se tient la plupart du temps près de la cheminée, source de chaleur et de lumière.
Dans le fond, une grande paillasse fait office de lit unique. Les bêtes sont parquées dans une salle attenante, la chaleur animale s'ajoutant ainsi à celle du foyer. Le pain est la base de l'alimentation. Cuit dans le four du seigneur, il est bis, mêlé de froment et de son - ce qui lui donne une couleur brune, peu appréciée par la noblesse. Quotidiennement une soupe de légumes, souvent de chou, mijote dans la marmite, laissée dans l'âtre. Manger de la viande est rare. Parfois du Lard vient améliorer l'ordinaire.
Le cochon est une véritable richesse. Engraissé de glands à l'automne dans les forêts du seigneur, il sera tué entre la Toussaint et Mardi gras. L'absence de mouches à cette période est la garantie d'un meilleur début de conservation dans le sel. Les travaux des mois. Avec le retour des beaux jours, les paysans peuvent de nouveau s'occuper du jardin potager et préparer les semailles. Le moment est venu de tondre les moutons. Le berger leur fait traverser plusieurs fois la rivière pour bien nettoyer leur toison avant de couper la laine à l'aide de gros ciseaux à ressort, les forces.
En juin ou juillet, l'herbe a bien poussé et les paysans commencent les foins. L'herbe coupée, bien séchée au soleil puis engrangée, nourrira les bêtes durant tout l'hiver. Septembre est le mois des vendanges. C'est un dur travail mais aussi une grande fête. Les raisins sont rassemblés dans une grande cuve en bois. Hommes et femmes, pieds nus, les foulent en dansant pour en extraire le jus qui, quelques mois plus tard, donnera un bon vin. Les champs ne sont pas tous cultivés.
Un sur trois est laissé en jachère. Les blés, coupés à la faucille, sont battus sur l'aire du village, pour faire tomber les grains des épis. Une partie est réservée aux futures semailles, l'autre, portée au moulin du seigneur, donnera de la farine. Mais les menaces de guerre incitent les paysans à ne semer que le minimum et à partir à la première alerte se réfugier en un lieu sûr, fortifié le château, l'abbaye ou la ville. Les récoltes restent médiocres, sensibles aux variations climatiques. A plusieurs reprises des disettes ravagent le pays.
► 1200 Vivre à Paris. La ville s'est beaucoup développée depuis le XIIIe siècle. Elle représente une forte puissance économique et abrite de nombreux intellectuels. De nouvelles fortifications la protègent. La ville s'agrandit. Charles V fait construire autour de Paris une nouvelle enceinte plus grande qui protège les faubourgs. Aux portes de la ville la circulation des hommes et des marchandises est contrôlée. La nuit, les entrées sont closes et de lourdes chaînes sont tendues en travers de la Seine. Certaines portes sont plus célèbres que d'autres. Au nord, celle de Saint-Denis s'ouvre sur la route de l'abbaye du même nom. À l'est, celle de la Bastille est une vraie forteresse.
Elle peut contenir une garnison utile en cas de révolte urbaine, et le roi peut y trouver refuge s'il fuit discrètement vers Vincennes. La rive gauche de la Seine est occupée par les lettrés, c'est le quartier Latin. Les étudiants viennent de loin, bien souvent de l'étranger, pour recevoir l'enseignement de l'université de Paris. Son diplôme est le gage d'un avenir brillant au service de l'Église ou d'un prince. On y professe le droit, la médecine, la théologie, et les sept arts libéraux : la grammaire, la rhétorique ou art de bien parler, la dialectique ou art de la discussion, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Comme les chambres chez l'habitant reviennent très cher, les étudiants les plus modestes s'installent dans des collèges fondés par les ordres religieux. La vie et la discipline y sont très strictes.
La rive droite de Paris appartient aux artisans et aux marchands. Certains sont très puissants. Ils fournissent au roi et à sa cour les produits nécessaires à une vie luxueuse : viandes, épices, vins, draps, tapisseries, pièces d'orfèvrerie... Pour se défendre auprès de l'administration royale, ils élisent un prévôt des marchands. Les membres d'une même profession sont regroupés en "métiers". Ces associations organisent le travail entre maîtres, compagnons et apprentis. Elles assurent une solidarité entre tous. Chaque métier a sa propre juridiction et son saint protecteur : saint Éloi est le patron des orfèvres, saint Luc celui des peintres et des sculpteurs, appelés "les imagiers". L'atelier des artisans fait aussi office de boutique ouverte sur la rue - ce qui facilite les contrôles et garantit un travail honnête.
► 1200 Des divertissements violents. En ces temps mouvementés, les seigneurs restent avant tout des guerriers et aiment les jeux physiques et dangereux. Les codes de la chevalerie régissent les rapports entre joueurs. Les seigneurs cherchent à s'illustrer dans les tournois. Ces jeux militaires contribuent à l'apprentissage puis à l'entraînement à la guerre. Ce sont de grandes fêtes organisées sur deux ou trois jours. Le sol de la lice est constitué de terre et de sable, arrosé d'eau pour limiter la poussière. Les dames sont à l'honneur.
Annoncée par les hérauts, chacune conduit son chevalier, revêtu d'une armure de parade et portant ses couleurs, dans la lice. Dans Le combat à la lance, les adversaires doivent se désarçonner et ensuite s'affronter à pied à l'épée ou à la hache. Les jeux de stratégie font partie de l'éducation du jeune noble. On s'affronte aux dames, au trictrac, à la marelle, mais surtout aux échecs. Les plateaux sont, la plupart du temps, faits de bois de couleur, les pions et les figurines sculptés dans l'os ou l'ivoire. Pour les plus riches, ces jeux peuvent être taillés dans des pierres de couleur ou dans du cristal de roche. Lors d'une partie, chacun doit se comporter noblement, avec modération et galanterie.
Les jeux d'argent et de hasard, comme les dés, n'ont pas bonne réputation, mais suscitent un grand engouement. Sport princier par excellence, les chasses à courre ont lieu dans les vastes forêts royales de Vincennes et de Compiègne. Il y est interdit de braconner. On y trouve des cerfs, des renards, des sangliers et même des loups. L'animal est poursuivi par la meute et les piqueurs, qui guident les chasseurs en sonnant du cor. Le sanglier est particulièrement dangereux, car il peut faire soudain volte-face et attaquer ses poursuivants à coups de boutoir mortels. Le cavalier, muni d'une courte épée, doit le tuer, tout en protégeant son cheval. La chasse au vol a la préférence des dames. Dressés pour s'envoler du poing, les faucons fondent sur des pigeons ou des la pins.
► 1200 Les grands banquets. Le roi et musique, décoration et mets raffinés doivent éblouir les invités. Les grandes dates du calendrier chrétien (Noël, Pâques, la Pentecôte...) ou les événements familiaux (mariage, baptême...) fournissent de nombreuses occasions d'organiser un banquet. Le roi et les princes en profitent pour impressionner leurs invités par un étalage de luxe. Les murs de la salle choisie pour la réception sont parés des plus belles tapisseries. Dans un coin, un dressoir accueille les plus somptueuses pièces d'orfèvrerie du service de la boisson: gourdes, aiguières et bassins. À table!
On dresse la table devant la cheminée, en posant une planche sur des tréteaux, le tout recouvert d'une nappe blanche. Les invités prennent place du même côté. Le plus noble d'entre eux s'assoit dans une chaire surmontée d'un dais orné de ses armoiries. S'il est roi ou prince, une nef de table sera posée devant lui. Cet objet en forme de bateau conserve un couvert personnel à l'abri des poisons. Il s'agit d'un couteau, d'une cuillère et d'un gobelet ou d'un hanap. Il n'y a pas d'assiette. La viande est piquée avec un couteau à lame pointue puis découpée sur un tranchoir que l'on se partage à deux.
Les maîtres queux ont préparé des plats extraordinaires présentés avec art pour éblouir les convives. Les volailles, par exemple, ont le bec et les pattes dorés. Les mets sont accompagnés de sauces relevées par des épices coûteuses rapportées d'Orient comme le poivre, Le gingembre, la cannelle ou encore le safran. L'écuyer tranchant, muni de son bâton, ordonne aux pages d'apporter les plats qui seront tous disposés sur la table. Les invités ne peuvent goûter à tout. Ils ne doivent se servir que dans les plats situés devant eux. Les officiers de bouche coupent la viande avec art, tandis que l'échanson, responsable du service de la boisson, choisit le vin du maître. Il le coupe avec de l'eau et vérifie qu'il n'a pas été empoisonné. Régulièrement des acteurs et des musiciens viendront divertir l'assistance.
► 1200 Une grande piété. La futilité de la mode et des divertissements cache une grande ferveur chrétienne. Le temps est aux épreuves et les hommes se tournent vers Dieu pour trouver du réconfort. La religion fait partie de la vie quotidienne. Dans chaque demeure, un espace est dédié à la prière. Les plus pauvres se recueillent simplement autour d'une image pieuse ou d'une croix, les plus riches dans une chapelle ou un oratoire.
Tableaux, statuettes ou objets d'orfèvrerie à caractère religieux sont eux aussi autant de supports à la prière. Le seigneur comme le bourgeois peut en emporter dans ses déplacements. Le fidèle fortuné se tourne vers Dieu plusieurs fois par jour et trouve dans son livre d'heures une prière adaptée à chaque moment. Cet ouvrage est illustré de scènes de la vie du Christ et des saints. En ces temps de guerre, d'épidémies de peste et de famines, les hommes se tournent vers la religion avec l'espoir que Dieu entendra leurs prières.
L'art religieux met l'accent sur les souffrances et la douleur de son fils Jésus-Christ dans les scènes de la Passion. Elles rappellent le fondement de ta foi : le Christ est Dieu fait homme, descendu sur ta Terre pour racheter les péchés des hommes. Chacun doit se repentir de ses fautes s'il veut entrer au paradis après sa mort. Les reliques, conservées dans des reliquaires, sont tout particulièrement vénérées. Ce sont des parties du corps d'un saint, un objet lui ayant appartenu, ou ayant servi à son supplice. Les fidèles trouvent dans ces reliques une aide à la prière.
Depuis le règne du roi Saint Louis, Paris possède les plus sacrées : la couronne d'épines du Christ et un morceau de la croix sur laquelle il fut crucifié. Elles sont abritées au sein de la Sainte-Chapelle construite dans l'île de la Cité dans ce but. Le pèlerinage est un voyage, à pied ou à cheval, seul ou en groupe, vers un lieu sacré dans lequel sont conservées des reliques. Le pèlerinage n'est pas obligatoire mais permet d'affirmer sa foi.
Les motivations diffèrent d'un individu à l'autre demande de guérison ou d'un pardon à Dieu, remerciement pour un heureux événement... Ces pèlerins partent peu chargés : un manteau, une besace en bandoulière, un bâton et un grand chapeau suffisent. Ils se rendent en France à Saint-Denis, Tours, Vézelay, Conques, Toulouse... Certains vont même à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, à Rome, ou à Jérusalem.
► 1200 invention de la loupe par Robert Grossetête. Robert Grossetête ou Grosseteste est un érudit anglais, franciscain, évêque de Lincoln, né vers 1175 et mort en 1253. Dans son ouvrage De luce, Robert Grossetête présente la lumière (lux) comme à l'origine de toute chose: la lumière visible (lumen), la chaleur, la matière. Il développe la théorie selon laquelle tout le monde physique peut se décrire par de la géométrie. S'appuyant sur les traités d'optique d'Ibn Al-Haytham, il étudie les rayons directs, les rayons réfléchis, les rayons déviés.
Il s'intéresse à la formation de l'arc-en-ciel (De iride) et travaille sur les lentilles et les miroirs. Il découvre ainsi que les lentilles, non seulement ont la propriété de pouvoir mettre le feu, mais aussi peuvent servir plus simplement de loupe. Il étudie la réfraction de la lumière à travers un récipient sphérique rempli d'eau (De natura locorum). Il est à l'origine d'une règle (imparfaite) sur la notion de réfraction : "l'angle de réfraction est égal à la moitié de l'angle d'incidence".
► 1201 Philippe Auguste accepte de se séparer d'Agnès de Méranie, qu'il envoie à Senlis.
► 1201 - 20 juillet Mort d'Agnès de Méranie.
► 1202 Début de la quatrième croisade (Jusqu'en 1204). La quatrième croisade, de 1202 à 1204, prêchée par Foulques de Neuilly sous le pontificat d'Innocent III, fut dirigée par Baudouin IX, comte de Flandre, Villehardouin, sénéchal de Champagne Boniface II, marquis de Montferrat, et Enrico Dandolo, doge de Venise. L'armée des chrétiens n'alla pas plus loin que Constantinople. Elle en chassa d'abord l'usurpateur Alexis l'Ange (1203), et plaça sur le trône Alexis le Jeune; l'année suivante, elle reprit Constantinople sur un nouvel usurpateur, Ducas Murtzuphle, mais cette fois ses chefs se partagèrent l'empire grec : Baudouin eut le titre d'empereur; les Vénitiens s'emparèrent des plus belles stations maritimes.
Chevaliers croisés - Image par Alexander Lesnitsky de Pixabay
► 1202 à 1204 - Quatrième croisade, qui fut prêchée par Foulques de Neuilly, curé de Neuilly-sur-Marne. La couronne n'y prit pas une part active. Elle eut pour chefs Baudouin IX, comte de Flandre, Boniface, marquis de Montferrat et Simon de Montfort. Baudouin comptait sur la marine vénitienne pour le transport de ses troupes, mais le doge Dandolo exigea pour prix de son aide que Baudouin fasse au profit des Vénitiens la conquête de Zara, en Dalmatie.
Une deuxième cause le détourna de sa route. Isaac II Ange, empereur d'Orient, que son frère Alexis III venait de détrôner en 1195, sollicita son appui pour reprendre le trône. La croisade se dirigea donc sur Constantinople dont elle s'empara, et rétablit Isaac (1203). Celui-ci ayant été assassiné quelques mois après, Baudouin fut proclamé par ses troupes, empereur de Constantinople (1204). Ce fut l'empire latin de Constantinople qui dura jusqu'en 1261, époque à laquelle les princes byzantins de la famille des Comnène recouvrèrent le trône; ce nouvel empire durera cinquante-sept ans.
Pendant ce temps, de nombreux seigneurs croisés avaient reçu en fiefs des territoires situés en Grèce, en Bulgarie et en Roumanie, et qui restèrent longtemps dans la famille de certains d'entre eux. Un des croisés, Geoffroi de Villehardouin, s'est immortalisé par le récit qu'il a laissé de la conquête de Constantinople par les croisés, et qui est un des plus anciens monuments de la prose française. Il avait reçu de grands biens en Roumanie. L'empire latin de Constantinople a été instauré suite à la quatrième croisade en 1204 et dure jusqu'en 1261.
► 1202 avril Confiscation de l'Aquitaine à Jean Sans Terre par Philippe Auguste.
► 1202 juin Philippe Auguste envahit la Normandie.
► 1202 juin Arrivée des troupes croisées à Venise.
►1202 Le doge de Venise demande aux Croisés de l'aider à reprendre Zara. Zara, port de l'Adriatique appartenant au roi de Hongrie.
► 1202 - 1er octobre Départ des armées croisées de Venise.
► 1202 - 24 novembre Prise et Pillage de Zara (hongroise) par les Croisés.
► 1202 - Le pape excommunie les Vénitiens pour la prise de Zara.
► 1202 Alexis IV demande de l'aide aux Croisés pour récupérer le trône de Constantinople aux mains d'Alexis III. Alexis IV Ange, né vers 1182, mort en 1204 à Constantinople, empereur byzantin (1203-1204), fils d'Isaac II. Il est enfermé par son oncle Alexis III, qui a détrôné son père. Il réussit à s'évader et conclut une alliance avec les chefs de la quatrième croisade, pour rétablir son père sur le trône.
En échange de l'aide des Croisés, il promet de rétablir l'union religieuse avec Rome et d'aide les Latins dans leur lutte contre les Turcs. Après le siège de Constantinople en 1203 et la prise de la ville, Isaac II est rétabli sur son trône et Alexis IV devient co-empereur. Il heurte l'opposition du peuple byzantin en pratiquant une politique favorable aux Latins. Il est renversé par Alexis V Doukas, gendre d'Alexis III. Emprisonné, il périt étranglé.
► 1202 Fibonacci utilise les chiffres arabes dont le zéro. Fibonacci, Leonardo Pisano (Léonard de Pise) plus connu sous le surnom de Fibonacci (v.1170-v.1250) est né en Italie à Pise mais a été éduqué en Afrique du Nord. Son père gérait les marchés de la république de Pise en Algérie, Tunisie, Maroc,... Il introduit par la suite en Europe le système de notation Arabo-Indien. Ce système est bien plus puissant que la notation romaine et Fibonacci en est pleinement conscient. Cependant, ce système a eu de la peine à s'imposer avant plusieurs siècles.
► 1203 Jean Sans Terre capture Arthur Ier de Bretagne et l'assassine. A la nouvelle de l'assassinat d'Arthur, fils posthume de Geoffroy V d'Anjou, les Bretons, ses sujets, se soulevèrent. Philippe Auguste cita Jean Sans Terre à comparaître devant sa cour pour être jugé.
► 1203 - 16 avril Entrée de Philippe Auguste dans Rouen.
► 1203 - 24 juin Arrivée des armées croisées devant Byzance.
► 1203 - 17 juillet Prise de Byzance par les Croisés.
► 1204 janvier Alexis V rejette l'ultimatum croisé, concernant leur promesse de rétribution. Alexis V Doukas, surnommé Murzuphle est un empereur byzantin mort en 1204. Il épouse Eudoxie Ange, troisième fille d'Alexis III. Il renverse Isaac II et Alexis IV en février 1204. Mais, il ne peut défendre Constantinople contre les croisés de la quatrième croisade, qui s'emparent une deuxième fois de la ville le 12 avril 1204.
Alexis V s'enfuit et rejoint son beau père Alexis III. Après l'avoir bien accueilli, celui-ci lui fait crever les yeux et l'emmène avec lui en Asie Mineure. C'est là qu'en novembre 1204, il est prit par les Latins et amené à Constantinople, ou l'on le précipite du haut de la colonne de Théodose.
► 1204 - 6 mars Philippe Auguste s'empare de Château-Gaillard.
► 1204 - 31 mars Mort d'Aliénor d'Aquitaine. C'est à l'abbaye de Fontevraux, où elle s'est retirée, que meurt la reine de France et d'Angleterre, épouse successive de Louis VII le Jeune et de Henri II d'Angleterre.
► 1204 - 12 avril Début de l'assaut des Croisés contre Constantinople.
► 1204 - 13 avril Prise et pillage de Constantinople par les Croisés marquant la fin de la quatrième croisade. L'empire byzantin est partagé : un quart pour le nouvel empereur, trois quarts pour Venise et les chevaliers. Isaac II Ange à nouveau renversé, les Croisés prennent Constantinople et la mettent à sac. Démembrement de l'Empire : Fondation de l'Empire latin de Constantinople. Baudouin Ier, empereur; La Morée française; Le duché d'Athènes à Othon de la Roche; Le royaume de Thessalonique à Boniface de Montferrat; L'Ionie à Venise; Le despotat d'Épire à Michel-Ange Comnène; L'Empire grec de Trébizonde à Alexis Comnène.
Début du règne de Théodore Lascaris, empereur grec de Nicée (Bithynie, Lydie, Phrygie, Archipel (fin en 1222). Venise fonde un empire maritime en Crète, Messénie, mer Noire et s'empare de l'île de Samothrace. La mer Noire est ouverte au commerce occidental. Constantinople, pillé et brûlée, est désertée par sa population qui ne reviendra qu'en 1261. Isaac II Ange (1155 † 1204) est un empereur byzantin (1185-1195 et 1203-1204), fils d'andronic Ange et d'euphrosyne Kastamonides. C'est un arrière petit-fils d'alexis Ier Comnène.
► 1204 - 18 juin La Normandie redevient française. Philippe Auguste, roi de France, vainc à Rouen le souverain anglais Jean Sans Terre et peut ainsi prendre possession de la Normandie. Dès 1202, Philippe Auguste avait confisqué les terres de Jean, ce qui avait donné naissance à ce sobriquet peu flatteur. Le roi de France avait frappé un grand coup en prenant le célèbre Château Gaillard construit par Richard Coeur de Lion. Philippe Auguste s'emparera ensuite par les armes de l'Anjou et de la Touraine.
► 1205 - La Cour prononça la confiscation des biens de la couronne d'Angleterre en France: Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Poitou, pendant que le pape Innocent III frappait Jean Sans Terre de déchéance et chargeait Philippe d'exécuter sa sentence et de s'emparer de la personne dit criminel. Philippe Auguste faisait ses préparatifs de guerre dans ce but, lorsque Jean Sans Terre fit acte de soumission envers le pape, qui ordonna à Philippe Auguste de s'en tenir là. Mais des troupes anglaises, en France, n'en continuaient pas moins à désoler les campagnes.
► 1205 Conquête de la Touraine et de l'Anjou par Philippe Auguste.
► 1206 Annexion de la Touraine, du Maine et de l'Anjou sur les Plantagenêt.
► 1206 Qûtb ud-Dîn Aibak fonde le sultanat de Dehli. Gouverneur du territoire de Delhi depuis sa conquête par Muhammad Ghûrî, Qûtb ud-Dîn Aibak se proclame le Sultan et fonde la dynastie des esclaves. Ancien esclave passé au service de Ghûrî, il avait connu une ascension fulgurante et son talent de colonel lui avait donné toute la confiance de ce dernier. Le sultanat de Delhi règnera sur l'Inde pendant un peu plus de trois siècles. Qutb ud-Dîn Aibak est un gouverneur de l'Inde musulmane, puis premier sultan de Delhi (1206-1210) et fondateur de la dynastie des Esclaves, également connue sous le nom de dynastie de Muizzî.
► 1207 - Raymond VI, comte de Toulouse est excommunié pour sa passivité à l'égard des Cathares. Raymond VI de Toulouse, né en 1156, il est le descendant Raymond IV, principal acteur de la première Croisade en Terre Sainte, et a été de manière involontaire le personnage central de cette période. Comte de Toulouse, dès 1194, duc de Narbonne, marquis de Provence, suzerain de comté de foix, du vicomté de Bézier et de Carcassonne, c'est avec indépendance qu'il "régna" sur ses états du Midi.
Marié cinq fois, il avait des liens de parenté, non seuleument avec la France, mais aussi avec l'Aragon en Espagne et en Angleterre. Cathare, il ne l'était pas, pas plus que juif ou musulman. A l'image du Languedoc, il cultivait la tolérance, acceptait la diversité, ca qui lui vaudra le reproche de protéger les cathares. Il mourut excommunié en août 1222.
► 1207 Geoffroi de Villehardouin écrit 'Conquête de Constantinople'. Geoffroi de Villehardouin était un historien et chevalier croisé du moyen âge. De 1207 à 1213 il rédige ses Mémoires intitulées 'Histoire de la conquête de Constantinople' ou 'Chronique des empereurs Baudouin et Henri de Constantinople' y décrivant les événements survenus entre 1198 et 1207. Il y expose en français et non en latin, les événements de la croisade dans un style remarquable. Néanmoins, son point de vue est partial car il a pour objectif de faire l'apologie des chefs croisés. Il laisse donc de côté certains détails dont les raisons du détournement des objectifs initiaux de l'expédition.
► 1208 janvier Assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau par un écuyer du comte de Toulouse. Pierre de Castelnau, cistercien français, légat du pape Innocent III en Languedoc, il tenta vainement d'endiguer l'hérésie cathare. Son assassinat, sur l'ordre Raymond V de Toulouse qu'il avait excommunié, fut la cause du début de la Croisade des Albigeois.
► 1208 Le pape ordonne la croisade contre les Albigeois sous la conduite de Simon de Montfort.
► 1208 Robert de Clari écrit Chronique. Robert De Clari, chroniqueur de la conquête de Constantinople.
► 1209 Commencement de la croisade contre les Albigeois (qui ne prendra fin qu'en 1229). Les Albigeois étaient une secte hérétique, fondée aux environs d'Albi et dont les doctrines se propageaient rapidement dans tout le Midi de la France : on les appelait aussi cathares, d'un mot grec qui signifie purifiés. Les Albigeois comptaient parmi leurs plus puissants protecteurs Raymond VI, comte de Toulouse, Roger, vicomte de Béziers et le propre roi d'Aragon, Pierre.
En 1208, quelques-uns de ces hérétiques assassinèrent, sur les terres de Raymond VI, un moine de Cîteaux, légat du pape, nommé Pierre de Castelnau ; chargé d'enquêter sur leurs doctrines qui d'ailleurs étaient jugées hérétiques et dangereuses pour l'État. Le pape Innocent III ordonna une croisade contre eux. Ce fut surtout le Nord qui fournit le personnel volontaire de l'expédition ; l'antipathie des gens de langue d'oil contre ceux de langue d'oc vint renforcer le sentiment religieux des rudes barons du Nord.
La croisade avait à sa tête Simon de Montfort, un des hommes de guerre les plus cruels de son temps, et son fils Amaury. Les croisés s'emparèrent de Béziers dont les habitants furent passés au fil de l'épée, saccagèrent Carcassonne, battirent les Albigeois à Muret (1213) et mirent le siège devant Toulouse; Simon de Montfort y fut tué d'une pierre lancée du haut des remparts par une femme, et qui lui enleva le sommet du crâne. Les femmes en effet contribuèrent vaillamment à la défense, en accablant de pierres les assiégeants (1218).
Son fils Amaury lui succéda et continua la guerre; plus tard, il céda ses droits et ses conquêtes à Louis VIII, fils de Philippe Auguste, qui vit là une occasion de réunir effectivement sous son sceptre des provinces qui jusqu'alors ne tenaient à la couronne que par un lien assez lâche de vassalité. Cette guerre ne se termina que pendant la régence de Blanche de Castille. Cathares, adeptes d'un mouvement religieux dualiste médiéval. Les adeptes de ce mouvement se nommaient eux-mêmes "Bons Hommes", "Bonnes Femmes" ou "Bons Chrétiens", mais étaient appelés "Parfaits" par l'Inquisition, qui désignait ainsi les "parfaits hérétiques", c'est-à-dire ceux qui étaient ordonnés et faisaient la prédication, par opposition aux simples "fidèles" hérétiques.
Principalement concentré dans le Midi de la France, le catharisme subit une violente répression armée à partir de 1209 lors de la croisade contre les Albigeois puis, durant un siècle, la répression judiciaire de l'Inquisition. La théologie cathare n'est qu'un travail de recherche scripturaire, centré sur l'Évangile selon Jean, dont les rapports avec la gnose et le docétisme sont manifestes. Les cathares poussent à l'extrême le sens du message des Écritures. Ils formulent la croyance dans l'existence de deux mondes, l'un bon et l'autre mauvais. Le premier, le monde invisible, attribué aux créatures éternelles, est l'oeuvre de Dieu le Père ; le second, visible et corruptible, est l'oeuvre du diable.
Désirant exempter Dieu du mal constaté dans le monde matériel, les cathares échafaudent leur propre système de croyances, variable selon les périodes et les aires culturelles d'implantation. Catharisme. Doctrine des cathares. Dualiste, elle oppose le Bien (Dieu) et le Mal (la matière). L'homme, soumis à une vie chaste et austère, doit se détacher des biens matériels pour se rapprocher de Dieu. Cette doctrine apparue au XIe siècle dans le Limousin se diffuse bientôt dans le midi de la France. Jugé hérétique au XIIIe siècle, le catharisme est âprement combattu et décimé lors de la "croisade des Albigeois" (1208-1244).
Croisade des Albigeois. Cathares de la région d'Albi – d'où leur nom –, les Albigeois prônent une vie austère détachée des biens matériels, ce qui, au début du XIIIe siècle, tranche avec l'opulence du clergé catholique. En 1208, le pape Innocent III prend prétexte de l'assassinat du légat Pierre de Castelnau par un officier de Raymond VI, comte de Toulouse, pour prêcher la croisade contre les Albigeois. Simon de Montfort en prend la tête. Les massacres se multiplient : sac de Bézier (1209), tuerie de Pujols (1213), bataille de Muret (1213)… Après la mort de Raymond VI à Muret et celle de Simon de Montfort en 1218, leurs fils reprennent le flambeau. Il faudra l'intervention du roi Louis VIII et le traité de Paris en 1226 pour pacifier le Languedoc.
Les terres conquises par Simon de Montfort sont rattachées à la Couronne, tandis que l'hérésie est neutralisée par la prise de Montségur en 1244. Simon de Montfort, né en 1150, Simon IV le Fort, second fils de Simon III, se distingua en 1202 lors de la quatrième Croisade et, à la demande du pape Innocent III, il partit à la croisade contre les Albigeois, croisade dont il devint le chef en 1209. Il reçut du pape les domaines attenants à Carcassone et à Béziers qui appartenaient alors à Raymond Roger, vicomte de Carcassonne et de Béziers.
En 1212, à Castelnaudary, il battit Raymond VI, comte de Toulouse. En 1213, il gagna la célèbre bataille de Muret. Le 30 novembre 1215, le concile de Latran, décida la destitution de Raymond VI à son profit, le déclarant à cette occasion comte de Toulouse. C'est lors du siège de Toulouse que Simon de Montfort mourut en juin 1218 dont le flambeau fut repris par son fils Amaury de Montfort.
► 1209 - 22 juillet Prise de Béziers et de Carcassonne par les croisés. Massacre de Béziers. L'immense armée, conduite par Simon de Montfort pour réduire l'hérésie cathare, est devant la ville depuis la veille. Les croisés ont exigé de l'évêque Renaud de Montpeyroux que 222 bourgeois hérétiques leur soient livrés pour que la ville soit épargnée. La ville refuse ces conditions.
En ce 22 juillet, jour de la Madeleine, quelques soldats catholiques parviennent à forcer une porte. Les chevaliers se précipitent dans la brèche. Le massacre commence dans la ville que, selon un témoin, Pierre des Vaux-de-Cernay “rien ne peut sauver, ni croix ni autel, pas un seul en soit réchappé”. Aux croisés qui s'inquiètent de ne pouvoir distinguer les hérétiques de ceux qui ne le sont pas, Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux, crie : “Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens”. Il y a au soir 7 000 morts dans Béziers.
Cité de Carcassonne - Image par hjrivas de Pixabay
► 1210 Raoul de Houdenc écrit 'Méraugis de Portlesguez'. Raoul de Houdenc, trouvère probablement originaire du village de Houdenc en Bray, près de Beauvais. Disciple et imitateur de Chrétien de Troyes, il est semble-t-il devenu moine après une vie mondaine de jongleur. D'autres sources lui attribuent une vie pauvre et errante après des études de clerc. Connu à son époque comme moraliste, il est l'auteur de 'Méraugis de Portlesguez', roman arthurien qui marque le passage du roman épique au roman allégorique dont il contribua à faire le succès.
► 1210 Fondation de l'Ordre des Franciscains. L'ordre franciscain, ou ordre des frères mineurs (o.f.m. - ordo fratrum minorum), est né en Italie sous l'impulsion de François d'Assise en 1210. Franciscains. Moines de l'ordre mineur de frères laïcs mendiants fondé par saint François d'Assise en 1210, sur les principes rigoureux de l'humilité totale et de la pauvreté extrême. Les franciscains ont une mission de prédication itinérante.
Au XIIIe siècle, l'ordre se divise, malgré les tentatives de conciliation de saint Bonaventure, entre les adeptes de la règle de pauvreté originelle et les spirituels, qui jugent la mission d'enseignement incompatible avec la misère matérielle. Malgré ces dissensions, et les diverses branches qui en découlent, les franciscains poursuivent une lutte active contre les hérésies et se répandent rapidement au travers de la chrétienté.
► 1211 Début du siège de Toulouse par les armées de Simon de Montfort.
► 1211 Coalition des comtes de Flandre, de Boulogne et Jean Sans Terre contre Philippe Auguste.
► 1212 Victoire des armées catholiques contre le comte de Toulouse, Raymond VI, à Castelnaudary. Castelnaudary, commune française, située dans le département de l'Aude et la région Languedoc-Roussillon.
► 1212 Croisade des enfants français et allemands qui précède la cinquième croisade proprement dite. Des milliers de jeunes gens, qui suivent Étienne de Cloyes et le jeune Allemand Nicolas, affluent à Marseille. Ils sont dispersés ou vendus comme esclaves dans les pays musulmans du Maghreb. La Croisade des enfants est une croisade organisée en 1212. Deux croisades des enfants existent, une partie de Cloyes-sur-le-Loir en France sous la direction d'un adolescent d'origine modeste appelé Étienne et l'autre de Cologne sous la direction d'un jeune adolescent de 14 ans nommé Nicolas. La croisade est composée d'adolescents d'origine paysanne qui ont suivi les deux jeunes Étienne et Nicolas qu'ils prenaient pour des prophètes.
► 1213 mai Soumission de Jean Sans Terre au Pape. Abandon du projet d'invasion de l'Angleterre.
► 1213 - 12 septembre Victoire des armées catholiques contre le comte de Toulouse, Raymond VI, et le roi d'Aragon, Pierre II d'Aragon, lors de la bataille du Muret. Bataille de Muret eut lieu dans la plaine à 25 km au sud de Toulouse dans le cadre de la croisade des Albigeois entre les troupes du comte Raymond VI de Toulouse et ses alliés occitans comme Raymond-Roger de Foix avec son beau-frère Pierre II d'Aragon, comte de Barcelone opposés à l'ost des chevaliers du nord de la France sous les ordres de Simon IV de Montfort pour le compte de Philippe Auguste.
L'Aragon était l'un des royaumes chrétiens qui se partagèrent la Péninsule ibérique lors de la Reconquista. La première émanation de l'Aragon, le comté d'Aragon naquit dans les ruines de la Marche d'Espagne carolingienne, sous la dépendance du royaume de Navarre. Il devint au XIe siècle un royaume rassemblant outre l'Aragon proprement dit, les comtés de Sobrarbe et de Ribagorza. Les rois d'Aragon, participant à la Reconquista, développèrent le royaume hors de son réduit pyrénéen pour le porter sur l'Èbre.
Le roi Alphonse Ier le Batailleur conquit Saragosse qui devint la capitale du royaume. L'Aragon atteignit alors ses frontières actuelles, qui sont celles de l'actuelle communauté d'Aragon. Avec le mariage de la reine Pétronille d'Aragon et du comte Raymond Bérenger IV de Barcelone, il devint l'un des royaumes composant la Couronne d'Aragon. Il faut signaler à cet égard que le titre de "roi d'Aragon" désigne souvent non seulement le souverain du royaume d'Aragon, mais aussi et surtout le souverain de la couronne d'Aragon. L'Aragon conserva toutefois son particularisme à l'intérieur de la couronne d'Aragon, grâce à ses cortès (parlement général) et aux pouvoirs étendus de sa noblesse. De plus, l'Aragon était le seul royaume à l'intérieur de la couronne à parler le castillan et non le catalan.
► 1214 Obligé de suspendre ses préparatifs contre Jean sans Terre, Philippe Auguste s'était retourné contre le comte Ferrand de Flandre qui, quoique étant son vassal, s'était déclaré pour le roi d'Angleterre; Philippe arma pour cette campagne les milices communales grâce auxquelles il devait en sortir victorieux. Ferrand était soutenu par les Anglais et par l'empereur d'Allemagne Otton IV. Malgré ces alliés, Philippe remporta sur lui la célèbre victoire de Bouvines. Les Anglais avaient été, la veille même de ce jour, battus à la Roche-aux-Moines par le fils de Philippe Auguste.
Ferrand de Flandre ou Ferdinand de Portugal ou de Bourgogne, dit Ferrand de Flandre (° 1188 - † Noyon, 27 juillet 1233). Comte de Flandre 1215 - 1233 par son mariage avec le comtesse Jeanne de Constantinople. Otton IV du Saint-Empire, Othon IV de Brunswick, né en Normandie en 1174 ou 1182, décédé à Harzburg en Saxe en 1218, empereur romain germanique de 1198 à 1218. Fils d'Henri le Lion duc de Bavière et de Saxe. En 1212, il épouse Béatrice de Hohenstaufen (1198-1212). En 1208, il assassine son rival Philippe de Souabe et se fait couronner par le pape Innocent III. Excommunié par Innocent III (1210), qui soutenait la candidature de Frédéric II du Saint-Empire, il fut défait à Bouvines (27 juillet 1214) par Philippe Auguste et ne conserva que le Brunswick.
► 1214 - 25 avril : naissance de Louis IX dit Saint Louis, futur roi de France. Louis IX de France, plus connu sous le nom de saint Louis, est né le 25 avril 1214 ou 1215 à Poissy Yvelines, et meurt le 25 août 1270 à Tunis. Il fut roi de France de 1226 à 1270, neuvième de la dynastie des Capétiens directs.
► 1214 - 2 juillet Victoire de Philippe Auguste sur Jean Sans Terre à la Roche-aux-Moines. Le prince Louis (futur Louis VIII), fils du roi de France Philippe Auguste pousse le roi d'Angleterre Jean Sans Terre à une retraite précipitée. Quelques jours plus tard, une nouvelle victoire française à Bouvines sonne la fin du conflit entre le roi de France et son vassal anglais. Bataille de la Roche-aux-Moines, en 1214, Jean Sans Terre, alors roi d'Angleterre, allié à l'empereur du Saint-Empire romain germanique Otton IV du Saint-Empire, attaque le royaume de France. Ils ont pour objectif Paris. Pendant que les Anglais attireraient les Français au sud, les impériaux auraient le champ libre et pourraient attaquer la capitale par le nord.
► 1214 - 27 juillet Victoire de Philippe Auguste à Bouvines sur la coalition Boulogne-Flandre-Othon. “Il est interdit d'assaillir son ennemi depuis la neuvième heure du samedi jusqu'à la première heure du lundi”, a décrété le concile d'Elne en 1027. En dépit de cet interdit, en ce dimanche 27 juillet 1214, Otton IV du Saint-Empire, empereur du Saint-Empire romain germanique attaque. Combat violent, acharné, intense. Philippe II de France, qui veut une victoire absolue s'engage lui-même dans la mêlée au risque d'être pris, blessé, tué peut-être. Sa fougue redouble l'ardeur de ses hommes.
En trois heures, tout est joué. La victoire est sans appel. Dans les rangs des chevaliers français, seuls dix sont morts. Le rex christiannissimus, le roi très chrétien Philippe II qui vient de l'emporter à Bouvines prend le titre de Augustus, Philippe Auguste. La bataille de Bouvines eut lieu le dimanche 27 juillet 1214. Elle opposa les troupes royales françaises de Philippe Auguste, renforcées par les milices communales soutenues par Frédéric II de Hohenstaufen, rival d'Othon IV pour la couronne impériale aux troupes coalisées d'Othon IV et les comtes de Flandre, Ferrand - fils cadet du roi de Portugal - et de Boulogne, Renaud de Dammartin et le comte de Frise Guillaume Ier, dit le Velu.
Les coalisés étaient principalement financés par l'Angleterre. Pourtant, le roi d'Angleterre Jean Sans Terre était absent lors la bataille. Il avait été mis en déroute à la bataille de la Roche-aux-Moines près d'Angers le 2 juillet 1214 par le prince Louis, fils du roi de France. Selon Jean Favier, Bouvines est "l'une des batailles décisives et symboliques de l'histoire de France". Pour Philippe Contamine, "la bataille de Bouvines eut à la fois d'importantes conséquences et un grand retentissement". Othon s'enfuit et perd sa couronne ; le Saint Empire romain germanique éclate en morceaux. Ferrand de Portugal passa quinze ans en prison au Louvre. Dépossédé de la Normandie, du Maine, de l'Anjou de la Touraine et de la Bretagne depuis 1206, Jean Sans Terre cesse les hostilités contre la France, et regagne l'Angleterre.
Pour sauver sa couronne, Jean Sans Terre est contraint d'accorder à ses barons la Grande Charte (1215). Du côté français, la dynastie capétienne sort renforcée tandis que les récentes acquisitions de Philippe Auguste sur Jean Sans Terre sont consolidées. Contrairement à Jean Sans Terre, Philippe Auguste est désormais l'arbitre incontesté au-dessus de ses barons. Le retour de Philippe Auguste à Paris est triomphal; ces festivités seront exploitées par la monarchie pour en faire, non sans abus, l'une des premières manifestations de l'unité nationale.
Après Bouvines, la paix dure en France jusqu'en 1337 ; C'est la "grande paix du XIIIe siècle". Frédéric II du Saint-Empire, Frédéric II de Hohenstaufen (26 décembre 1194 à Jesi près d'Ancône - † 13 décembre 1250 à Fiorentino près de San Severo) régna sur le Saint Empire romain germanique de 1220 à 1250. Son règne fut marqué par les conflits avec la papauté et il fut excommunié deux fois. Le pape Grégoire IX alla même jusqu'à l'appeler l'Antéchrist.
► 1214 - 18 septembre Traité de Chinon. Les possessions anglaises du nord passent au domaine royal. Bouvines, où le 27 juillet Philippe Auguste a défait les troupes d'Otton IV du Saint-Empire et du comte Ferrand de Flandre alliées à Jean Sans Terre, permet la signature de cette paix. Le roi d'Angleterre paye 60 000 livres au roi de France et renonce à l'Anjou, au Maine, à la Touraine, au Poitou. Il garde l'Aquitaine. Un chroniqueur déclare : “Jamais depuis ne fut personne qui osa faire la guerre au roi Philippe, mais il vécut depuis en grande paix et toute la Terre fut en grande paix un grand moment”.
Le traité de Chinon est un traité signé entre le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Jean sans Terre le 18 septembre 1214 à Chinon, après la défaite des coalisés le 27 juillet à Bouvines. Lors de cette bataille, Philippe Auguste brisa une terrible coalition (Angleterre, Flandre, Allemagne), et remporta une victoire décisive sur l'Empereur germanique Otton IV du Saint-Empire, allié au roi d'Angleterre Jean Sans Terre, et au comte de Flandre Ferrand. Cette victoire va entraîner l'éclatement de l'empire angevin des Plantagenêts.
Jean Sans Terre dut évacuer le territoire français et fut contraint par le pape Innocent III d'accepter le traité de Chinon qui consacrait la perte de ses possessions au nord de la Loire : le Berry et la Touraine, avec le Maine et l'Anjou retournaient dans le domaine royal, qui couvrait désormais le tiers du territoire de la France actuelle. Il dut en outre payer 60 000 livres au roi de France. Il ne conservait que l'Aquitaine.
► 1214 Annexion du Poitou, la Bretagne passe dans le giron français.
► 1215 Juin : Simon IV de Montfort et Louis le Lion prennent Montpellier, Narbonne et Toulouse. Montfort est institué comte de Toulouse par le concile du Latran IV le 11 novembre. La garde du marquisat de Provence est confiée au pape pour le comte mineur, Raymond VII de Toulouse. Raymond VII de Toulouse, Raymond VII (IX) de Saint-Gilles, (né en juillet 1197 à Beaucaire - mort le 27 septembre 1249 à Millau), comte de Toulouse, duc de Narbonne et marquis de Provence.
► 1215 - 15 juin La Magna Carta. Les barons anglais imposent au roi d'Angleterre Jean Sans Terre un traité appelé Magna Carta ou Grande Charte. Par ce traité, la noblesse anglaise s'assure le respect des coutumes et des droits féodaux. Le roi s'engage notamment à ne pas lever d'impôts extraordinaires sans l'accord du Grand Conseil. La Grande Charte, première limitation imposée au pouvoir monarchique, est à la base de la tradition constitutionnelle anglaise.
Magna Carta, La Grande Charte est une charte de 63 articles arrachée par le baronnage anglais au roi Jean sans Terre le 15 juin 1215 après une courte guerre civile notamment marquée par la prise de Londres, le 17 mai, par les rebelles. Les barons étaient excédés des exigences militaires et financières du roi et de ses échecs répétés en France à Bouvines et à La Roche-aux-Moines. Ce texte limite l'arbitraire royal et établit en droit l'habeas corpus qui empêche, entre autres, l'emprisonnement arbitraire.
Il garantit les droits féodaux, les libertés des villes contre l'arbitraire royal et institue le contrôle de l'impôt par le Grand Conseil du Royaume. L'archevêque de Cantorbéry, Langton défend ardemment les barons, son nom restant le premier à avoir été apposé en qualité de témoin de la Grande Charte.
► 1215 - 1er novembre : Ouverture du concile du Latran IV après 2 ans et demi de préparation. Ce concile du Latran IV organise la cinquième croisade, impose aux chrétiens de se confesser et de communier une fois l'an et impose le port d'un vêtement particulier aux juifs et aux musulmans et leur interdit toutes charges publiques. Il consacre aussi la suzeraineté pontificale sur la Sicile et l'Angleterre et décrète la centralisation de l'administration de la papauté dont le prestige est à son zénith. Le quatrième concile oecuménique du Latran (souvent surnommé Latran IV) est le douzième concile oecuménique de l'Église catholique. Il est tenu à Latran en 1215 sur l'initiative du pape Innocent III.
► 1215 Fondation de l'Ordre des Dominicains. Dominicain, l'Ordre des Prêcheurs, plus connu sous le nom d'Ordre dominicain est né sous l'impulsion de Dominique de Guzman (saint Dominique) en 1215. Cet ordre catholique appartient, comme l'ordre franciscain, à la catégorie des ordres mendiants. Suivant en partie la règle d'Augustin d'Hippone, héritée des Prémontrés, il s'est donné pour mission l'apostolat et la contemplation. Sa devise est Veritas (la vérité). Une autre de ses devises, issue des Actes des Apôtres, et reprise par Thomas d'Aquin, est "annoncer ce que nous avons contemplé".
Les dominicains ne sont pas des moines mais des religieux : ils font voeu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais non de stabilité. Ils vivent dans des couvents et non dans des abbayes. Leur vocation étant de prêcher au monde, leurs couvents sont souvent dans des grandes villes. Dominicains. Frères prêcheurs de l'ordre catholique mendiant fondé par saint Dominique en 1215. Leur mission première est l'apostolat, par la prédication et l'enseignement, et, en ces temps d'hérésie, ils participent à l'Inquisition et à la lutte contre les Cathares. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, frère dominicain, élabore la doctrine de l'ordre. Supprimé par la Révolution, il est rétabli en 1843 par Lacordaire.
► 1216 - 19 octobre Mort de Jean Sans Terre et début du règne de Henri III d'Angleterre (fin en 1272). Le prince héritier du trône de France, Louis (futur Louis VIII), débarque en Angleterre et essuie une défaite à Lincoln. Lincoln est une cité et chef-lieu du comté de Lincolnshire, en Angleterre.
► 1216 Henri III est couronné roi d'Angleterre. Henri III d'Angleterre, Henri III ou Henri III Plantagenêt (1207 - 1272), fils aîné du roi Jean-sans-Terre et d'Isabelle d'Angoulême fut un roi d'Angleterre au règne long, agité et peu glorieux. Il faut cependant rappeler qu'à cette époque, Louis, fils de Philippe Auguste et futur Louis VIII le Lion, avait été appelé en Angleterre par les barons anglais, qui ne reconnaissaient plus l'autorité de Jean Sans Terre. Mais, comme ce dernier mourut, les Anglais se rallièrent au jeune Henri III d'Angleterre. Henri III fut donc couronné à Westminster, en 1216, par les derniers fidèles des Plantagenêt.
► 1216 Guerre de Succession de Champagne. La guerre de succession de Champagne est un conflit qui opposa au XIIIème siècle deux nobles champenois, partagea la noblesse champenoise et déborda sur les duchés frontaliers. En 1190, le comte de Champagne Henri II quitta son comté pour partir en croisade avec ses deux oncles Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion (sa mère est en effet fille de Louis VII de France et d'Aliénor d'Aquitaine, donc soeur de Philippe par son père et de Richard par sa mère). Il fit jurer aux barons de Champagne de rendre hommage à son frère Thibaud au cas où il mourait pendant la croisade.
En Terre Sainte, Henri fut couronné roi de Jérusalem et pour asseoir sa légitimité, épousa la reine Isabelle, veuve de Conrad de Montferrat son second mari, mais son premier mari, duquelle elle avait été contrainte de se séparer, vivait toujours. Henri II mourut en 1197, après avoir eu trois filles, et son frère devint le comte Thibaud III de Champagne. Ce dernier mourut en 1201 sans enfant, laissant sa veuve Blanche de Navarre, enceinte d'un fils posthume, Thibaut IV.
De son côté, un noble champenois vivant en Terre Sainte, Erard de Brienne, seigneur de Ramerupt, cousin de Jean de Brienne, roi de Jérusalem, épousa en 1215 Philippine de Champagne, la troisième fille d'Henri II de Champagne. Il se mit en tête de réclamer le comté de Champagne. Erard et Philippine débarquent en France au début de l'année 1216. De passage au Puy-en-Velay, il est mis en arrestation par les agent du roi de France, mais parvient à s'échapper et se rend en Champagne.
Tout de suite, le duc de Lorraine Thiébaud Ier prit fait et cause pour lui. Blanche de Navarre assiège Noyers en avril 1216, où Erard et ses partisans se sont retranchés. Erard accepte la trêve et s'en remet à l'arbitrage du roi de France. Celui-ci ordonne en octobre d'attendre la majorité de Thibaud IV pour faire valoir ses droits. Mais la guerre reprit peu de temps après, et les barons champenois, tous plus ou moins apparentés aux Brienne, abandonnent Blanche pour se rallier à Erard.
Il fallu l'intervention du roi de France Philippe Auguste, du duc de Bourgogne Eudes III et de l'empereur Frédéric II du Saint-Empire, pour ramener la paix en Champagne. Frédéric II envahit la Lorraine, prend et incendie Nancy en 1218, fait prisonnier le duc de Lorraine, et l'oblige à retirer son soutient envers Erard de Brienne. Erard renonça à la Champagne le 2 novembre 1221 et Philipine en avril 1222. Henri II de Champagne, (° 29 juillet 1166 † 10 septembre 1197), comte de Champagne (Henri II 1181-1197) et roi de Jérusalem (1192-1197), fils d'Henri Ier, comte de Champagne et de Marie de France.
► 1217 Simon de Montfort, devenu comte de Toulouse est chassé de la ville par une révolte.
► 1217 2 - 4 août Défaite de la flotte de Louis (futur Louis VIII). Vaincu et pris par les Anglais lors de la Bataille de Sandwich (encore appelée Bataille de South-Foreland), près de Douvres, au cours de laquelle la flotte anglaise battit la flotte française, Eustache le moine, l'un des plus célèbres pirates du XIIIe siècle, eut la tête tranchée.
► 1217 - 1er septembre Traité de Kingston. Quelques mois plus tôt, Blanche de Castille est intervenue auprès de son beau-père pour lui demander les sommes nécessaires au Dauphin, son mari Louis VIII, auquel des barons anglais en révolte contre Jean Sans Terre ont proposé le trône d'Angleterre. Elle en est presque arrivée au chantage en lui lançant cette menace : “J'ai de beaux enfants, par la Sainte Mère de Dieu ! Je les mettrai en gage, car je trouverai bien quelqu'un qui me prêtera dessus”. Ce à quoi Philippe Auguste a répondu : “Gardez vos enfants et puisez à votre gré dans mon trésor”. Par le traité signé ce jour, Louis (futur Louis VIII), dauphin de France, fils de Philippe Auguste, renonce au trône d'Angleterre contre la somme de 10 000 marcs.
► 1217 - 11 septembre Traité de Lambeth mettant fin aux prétentions de Louis (futur Louis VIII) sur le trône d'Angleterre.
► 1217 à 1221 - Cinquième croisade, à laquelle le roi de France resta étranger. Jean de Brienne, héritier du titre de roi de Jérusalem et André II de Hongrie, menèrent contre les Sarrasins d'Égypte une expédition sans résultat. La cinquième croisade, entreprise sous le pontificat d'Honorius III (1217-1221), eut pour chefs Jean de Brienne, roi titulaire de Jérusalem, et André, roi de Hongrie. André fut rappelé dans ses États par la révolte de ses magnais; Jean de Brienne prit Damiette, qu'il fut bientôt forcé de rendre.
Jean de Brienne, né vers 1148, décédé vers 1237, roi de Jérusalem (1210-1225), empereur latin de Constantinople (1229-1237), fils cadet d'Erard IV, comte de Brienne et d'Agnès de Nevers (fille de Guillaume III de Nevers). André II de Hongrie, roi de Hongrie (né en 1176– mort le 21 octobre 1235), de la dynastie d'Arpad. Il anima la Ve croisade en 1217. Il s'est autoproclammé roi de Galicie-Volhynie. Un de ses enfants est sainte Élisabeth de Hongrie née en 1207.
► 1218 - 25 juin Mort de Simon de Montfort, lors du second siège de Toulouse.
► 1220 Sacre de Frédéric II du Saint-Empire. Frédéric II du Saint-Empire, Frédéric II Hohenstaufen (26 décembre 1194 à Iesi près d'Ancône - † 13 décembre 1250 à Fiorentino près de Lucera) régna sur le Saint Empire romain germanique de 1220 à 1250. Son règne fut marqué par les conflits avec la papauté et il fut excommunié deux fois. Le pape Grégoire IX alla même jusqu'à l'appeler l'Antéchrist. Il fut le dernier empereur de la famille des Hohenstaufen et après sa mort, il devint légendaire, la stupor mundi (l'émerveillement du monde), au point qu'on attendait même son retour après sa mort (son personnage était alors confondu avec celui de son grand-père Frédéric Barberousse).
► 1220 Trouvère inconnu écrit 'Huon de Bordeaux'. Chanson de geste qui fait partie des romans carolingiens. Elle a été composée par un trouvère dont on ne connaît ni le nom ni le pays, à une époque où la veine héroïque commençait à s'épuiser, où les contes bretons s'emparaient de la faveur jusque-là réservée aux oeuvres françaises, et où les poèmes d'aventures allaient remplacer. les poèmes dits historiques ou chansons de geste.
► 1222 à 1282 - naissance et mort de Nichiren, fondateur de la religion bouddhisme japonais, Zennichi-maro dit Nichiren est né le 16 février 1222 dans le village de pêcheurs de Kominato, dans l'actuelle préfecture de Chiba au Japon. Ordonné moine Tendaï à l'âge de 16 ans, il prend le nom de Zesho-bo Renchô. Son voeu d'alors est de devenir la personne la plus sage du Japon. Par ses idées, il est le fondateur du bouddhisme Nichiren appellé aussi parfois école du lotus.
Dans un texte célèbre le Risho Ankuko Ron, il envoie des remontrances au gouvernement, lui demandant de supprimer si besoin par la force les nouvelles sectes bouddhistes amidistes et zen, responsables selon lui de la dégénérescence et des calamités survenus au Japon. La loi s'enseigne selon le temps et les capacités des auditeurs, et Renchô estima en cet période de Mappo (dégénérescence de la loi) qu'il fallait revenir à la vénération du sutra du lotus pour donner un enseignement valable pour les périodes modernes.
Il mit en avant la seule pratique invocatoire du titre du Sutra du lotus le Daimoku sur le modèle de l'amidisme qui repète le nom du Boudha Amida inlassablement, dans le meme temps il fit un objet de vénération le Gohonzon mandala créé sur le modèle de l'ésoterisme. Le Sutra du Lotus ou Sutra sur le Lotus Blanc du Dharma Sublime est l'un des sutras Mahayana les plus populaires et influents en Extrême-Orient ; il est le fondement des écoles bouddhistes Tiantai et Nichiren. Comme tous les textes bouddhiques, il fut écrit plusieurs siècles après la mort du Bouddha. Selon le traducteur Burton Watson, le Sutra du Lotus pourrait avoir été à l'origine écrit dans un dialecte prâkrit avant d'être plus tard traduit en sanskrit pour lui accorder une plus grande respectabilité.
► 1222 Proclamation de la Charte du Manden. La Charte du Manden a été conçue par la confrérie des chasseurs du Mandé (au sud de Bamako). Cette déclaration, solennellement proclamée le jour de l'intronisation de Sundjata Keïta comme empereur du Mali, à la fin de l'année 1222. Elle affirme l'opposition totale de la confrérie des chasseurs à l'esclavage qui était devenu courant en Afrique de l'ouest. L'abolition de l'esclavage fût une oeuvre maîtresse de Soudjata Keïta et de l'Empire du Mali. Cette charte peut être considérée comme la première déclaration des Droits de l'Homme.
► 1223 - 14 juillet Mort de Philippe Auguste à Mantes. Accablé de fièvres tenaces depuis près d'un an, le roi, âgé de quarante-trois ans, prend, parce qu'il se sent mieux, un copieux repas. Le lendemain, il est au plus mal. On lui administre les derniers sacrements. Le roi veux mourir à Paris. Il meurt sur la route, à Mantes. Pour la première fois dans l'histoire de la royauté, de grandes funérailles sont faites au roi qui vient de mourir.
Cet excellent roi avait considérablement fortifié la monarchie; il agrandit le domaine royal de sept provinces: Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Poitou, Valois et Vermandois. Il établit en France, divisée par lui dans ce but en bailliages et prévôtés, l'administration directe par la couronne; il adoucit les moeurs violentes du temps, en instituant la trêve appelée quarantaine-le-roi, en vertu de laquelle on ne pouvait tirer vengeance d'une injure avant quarante jours écoulés; il embellit Paris, dont il bâtit les premiers remparts, bâtit l'Hôtel-Dieu et acheva Notre-Dame. Philippe Auguste fut marié trois fois: 1° avec Isabelle de Hainaut; 2° avec Ingeburge de Danemark qu'il répudia pour épouser; 3° Agnès de Méranie, ce qui le fit excommunier.
► 1223 Louis VIII succède à son père Philippe Auguste qui l'a eu en 1187 d'Isabelle de Hainaut. Il avait guerroyé en Angleterre contre Jean sans Terre, au profit des barons de ce pays, qui l'avaient élu pour leur roi. Mais il fut ensuite défait et rentra en France. Roi de France, il conquit sur les Anglais un certain nombre de places, et prit part à la croisade contre les Albigeois. Il fut surnommé le Lion et mourut en 1226
► 1223 - LOUIS VIII le Lion (1223-1226)
► 1223 Louis VIII le Lion. Avant d'accéder au trône, il participe à la lutte contre les Plantagenêts. Il remporte sur Jean Sans Terre une victoire à La Roche Aux Moines en 1214. Il poursuit celui-ci jusqu'en Angleterre (1216) où il se voit offrir la couronne par les barons révoltés. Vaincu à Lincoln (1217) il renonce à ses prétentions par le traité de Kingston et se retire avec une forte somme. Il succède à son père, Philippe Auguste, en 1223 et poursuit la lutte contre les Plantagenêts auxquels il enlève le Poitou et une partie de la Gascogne. Après la mort de Simon de Montfort (1218) et la renaissance du Catharisme, il reprend la croisade contre les Albigeois, il s'empare d'Avignon mais ne va pas jusqu'à Toulouse. Malade il meurt sur le chemin du retour.
► 1223 - 6 août Louis VIII le Lion est couronné à Reims.
► 1224 - 15 juillet Siège de La Rochelle par Louis VIII. Louis VIII, soutenu par Hugues de Lusignac, répond à la demande du roi Henri III d'Angleterre qui exigeait la restitution des biens Plantagenêts en envahissant le Poitou, en prenant Niort, et en assiégeant La Rochelle qu'il va prendre le 3 août.
►1224 Louis VIII conquiert le Poitou et le Saintonge.
► 1225 à 1274 - naissance et mort de Saint Thomas d'Aquin. Théologien italien est le plus connu des philosophes de l'époque médiévale. Alors qu'à la suite des croisades, l'Occident retrouve les oeuvres perdues d'Aristote qu'avaient conservées la civilisation arabe, le chrétien Thomas d'Aquin va tenter de faire la synthèse de la philosophie d'Aristote et du christianisme. Il influencera profondément la scolastique, doctrine qui dominera la philosophie occidentale jusqu'au XVII° siècle, époque où le système s'effondrera avec la naissance des sciences expérimentales.
Considéré comme l'un des principaux maîtres de la scolastique et de la théologie catholique, il a été proclamé docteur de l'Église en 1568. Il est aussi appelé "Docteur Angélique" par le clergé. Après saint Augustin (354-430) - et en filiale continuité avec la pensée de l'évêque d'Hippone - Thomas d'Aquin a réalisé au XIIIe siècle la grande synthèse de la raison et de la foi, tentant de concilier la philosophie d'Aristote et la pensée chrétienne. Pour concilier les contradictions entre la philosophie aristotélicienne et la doctrine chrétienne, il sépare les vérités de la raison de celles de la foi, définie comme une adhésion inconditionnelle à la parole de Dieu.
La philosophie doit cependant demeurer la servante de la théologie. De son nom dérivent thomisme et thomiste, qualifiant, entre autres, sa philosophie. Le thomisme est devenu la doctrine officielle de l'Église. Le thomisme est un courant philosophique faisant référence à Saint Thomas d'Aquin. Thèses philosophiques défendues par les thomistes : Dieu est acte pur ; l'homme peut saisir l'existence de Dieu à partir des choses visibles ; En philosophie de matière et de forme ; une seule forme substantielle actualise chaque corps physique ; l'individualisation d'un corps est réalisée par une matière déterminée ; les substances séparées sont dépourvues de tout principe d'individuation ; chaque créature est divisée en existence et essence ; Conception de l'homme : distinction dans les substances crées entre nature essentielle et activités de l'étant ; l'âme rationnelle est l'unique forme substantielle de l'être humain individuel. Ces thèses forment un réalisme métaphysique qui s'oppose nettement à l'idéalisme et au positivisme.
► 1226 - 9 septembre Louis VIII prend Avignon, et conquit le Languedoc. Avignon, assiégée depuis trois mois par les troupes du roi de France Louis VIII capitule. Le roi reçoit la soumission du Languedoc.
► 1226 - 8 novembre Mort de Louis VIII à Montpensier (Auvergne), son fils Louis IX (12 ans) lui succède. C'est une dysenterie aiguë qui emporte le roi en ce jour à Montpensier. Il rentre de la troisième croisade des albigeois. Les médecins, convaincus qu'une trop longue continence sexuelle est la cause du mal du roi, resté fidèle à la reine Blanche de Castille, mettent dans son lit une jeune fille. Lorsqu'au réveil il la découvre, il lui dit : “Non, ma fille, j'aime mieux mourir que de sauver ma vie par un péché mortel”. Louis IX est son successeur.
43 - De 1226 (Louis IX - Saint Louis) à 1270 (mort de Saint Louis)
► 1226 LOUIS IX (Saint Louis) (1226-1270)
► 1226 Saint Louis. Louis IX accède au trône à la mort de son père Louis VIII à l'âge de 12 ans. C'est sa mère Blanche de Castille qui assure sa tutelle. Souhaitant mettre fin à la guerre contre les Albigeois elle signe le traité de Paris en 1229 avec le comte de Toulouse. Elle prépare la réunion à la couronne du comté de Toulouse en mariant son fils Alphonse à la fille du comte, Jeanne, fille de Raymond VII de Toulouse. En 1234 la majorité de Louis est déclarée, Blanche, toujours guidée par l'intérêt du royaume, le marie à Marguerite de Provence jeune fille intelligente et d'une grande beauté dont le roi est très amoureux.
Elle en devient très jalouse. En 1241 Louis IX doit faire face à la révolte de Hugues de Luzignan soutenu par Henri III d'Angleterre qui débarque sur le continent en 1242. Louis IX le bat à Taillebourg et à Saintes. Une trêve est conclue l'année suivante qui débouchera sur le traité de Paris en 1258 par lequel chacun fera des concessions territoriales. Le roi d'Angleterre renonce aux terres conquises par Philippe Auguste et Louis renonce au Limousin, au Quercy et au Périgord. Il en fera de même avec Jacques Ier d'Aragon la même année à Corbeil, Louis IX renonce aux comtés de Barcelone et du Roussillon et Jacques à tout ce qui est au dessus des Pyrénées (excepté Montpellier dont il était seigneur par son mariage avec la fille de Guilhem VIII).
A la suite d'une grave maladie Louis IX fait la promesse de se croiser. La septième croisade est provoquée par la perte de Jérusalem et la défaite des Latins en 1245. Blanche assurera la régence. Marguerite accompagne Louis et embarque à Aiguemorte enceinte, elle refuse de retarder le départ. Après plusieurs mois de préparation à Chypre en vue de l'action sur l'Égypte, les Croisés prennent Damiette en juin 1249 puis ils marchent sur Le Caire ils battent les Musulmans à Mansourah en février 1250 mais son armée est ravagée par la peste. Louis IX couvrant la retraite est fait prisonnier. Il faudra verser une forte somme pour sa libération et restituer Damiette ou son fils Jean Tristan est né.
Louis IX et Marguerite se rendront en Palestine et y resteront plusieurs années pendant lesquelles Louis IX fortifiera les villes franques. Une fille, Blanche, naîtra à Jaffa en 1252. Louis IX retourne en France fatigué et malade en 1254. Tout le long du trajet français, de Hyères à Paris il est acclamé par la foule. Louis repart en Croisade, la huitième, en 1270, pour la Tunisie. On ne sait pas réellement l'objectif de Saint Louis, on suppose qu'il voulait convertir le Sultan de Tunis et ainsi se ménager une base arrière pour retourner en Égypte. A peine débarquée son armée est décimée par la peste (ou le typhus?). Louis IX laissera sa vie sous les murs de Tunis ainsi que son fils Jean de Damiette et 3 autres membres de la famille royale.
Sur le plan intérieur, Louis IX organisa la justice royale en créant le "Parlement" corps de légistes et les grands "Bailliages" qui avaient le droit d'appel sur la justice seigneuriale et qui relevaient eux même du parlement. Il crée un embryon de "Cour des comptes". Il place un fonctionnaire royal à la tête de Paris (Étienne Boileau). Paris devient un très grand centre marchand. Il fait édifier la Sainte Chapelle, dentelle de pierres, pour abriter la couronne d'épines du Christ qu'il a achetée en 1239.
La chapelle sera terminée en 1248. Il crée l'hôpital des Quinze-Vingts (façon de compter à l'époque, l'hôpital était construit pour accueillir 15x20 = 300 malades) pour accueillir les aveugles fait construire l'Abbaye de Royaumont, aménage le Louvre qui était alors une austère forteresse. C'est le sommet de la civilisation française du moyen âge Louis IX favorise l'éducation, la Sorbonne reçoit sa charte de fondation en 1257 et de toute l'Europe les étudiants affluent vers l'université de Paris.
► 1226 Avènement de Louis IX (Saint Louis), fils de Louis VIII et de Blanche de Castille, âgé seulement de 11 ans (né en 1214). La reine Blanche de Castille prend la régence (qu'elle exercera avec fermeté et habileté). Les principaux faits de la régence se rapportent à la lutte que la régente eut à soutenir (et dont elle sortit victorieuse) contre les grands vassaux désireux de profiter de la minorité de Louis IX pour recouvrer des privilèges et acquérir des avantages matériels. Blanche de Castille détache de leur parti le plus puissant, Thibaut, comte de Champagne, dont la défection amène la soumission du duc de Bretagne et la cessation de l'hostilité des autres vassaux.
► 1226 - 29 novembre Louis IX est sacré à Reims. Le jeune roi n'est âgé que de onze ans lorsque sa mère, Blanche de Castille, en raison d'une révolte des vassaux qui menace la couronne, précipite le sacre de son fils. La cathédrale est en chantier et le siège épiscopal de Reims est vacant. C'est à l'évêque de Soissons qu'il est fait appel. Seul Thibaud IV de Champagne apporte son soutien à la régente pour l'organisation de ce sacre, auquel elle a voulu qu'assistent tous les vassaux qui remettent en cause la puissance du pouvoir royal. Régence de Blanche de Castille (jusqu'en 1236).
Louis IX n'a que douze ans. Son père, Louis VIII, est au plus mal. Blanche de Castille devient régente du royaume. Une tâche difficile pour la reine : la rébellion couve. Les grands seigneurs, vassaux du roi de France, sont certains qu'une femme ne peut leur tenir tête et qu'ils vont pouvoir reprendre tout ce qu'ils ont dû céder à la couronne.
► 1226 Coalition des barons avec l'aide de Henri III d'Angleterre contre Blanche de Castille.
► 1226 Révision du texte latin de la vulgate à l'Université de Paris.
► 1227 - 16 mars Traité de Vendôme mettant fin à la révolte des barons. Révolte des grands vassaux contre Blanche de Castille (fin en 1234) : Le trouvère Thibaud IV de Champagne, Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, Philippe Hurepel, comte de Boulogne, Enguerrand III, sire de Coucy. Ils tentent d'enlever le jeune roi qui est sauvé par l'énergie de la régente, appuyée par l'église et les villes. Les comtes de Bretagne et de la Marche se soumettent lors du traité de Vendôme.
► 1227 - 18 août La mort de Gengis Khan. Le chef des Mongols, Gengis Khan (du chinois Chêng-Sze "guerrier précieux" et du turc Khan "seigneur"), meurt à environ 60 ans, au soir de sa victoire contre le royaume des Tangoutes (au nord-ouest de la Chine). A la tête d'une armée de nomades, il a conquis un immense empire allant des confins orientaux de la Chine à la mer Caspienne. L'Empire mongol sera divisé entre ses trois fils.
► 1228 à 1229 - sixième croisade sans la participation des Français: elle était conduite par Frédéric II, empereur d'Allemagne, héritier de Jean de Brienne, roi nominal de Jérusalem, qui, ayant réussi à se faire livrer sans combat Jérusalem par le sultan d'Égypte, s'en fit proclamer roi, mais comme il était excommunié, des légats du pape défendirent aux chrétiens de lui obéir. La sixième croisade commençée en 1228 et terminée en 1229, fut lancée par l'empereur romain germanique Frédéric II du Saint-Empire pour conquérir le royaume de Jérusalem. Elle fut victorieuse sans aval du pape et sans soutien militaire, créant un précédent qui influencera les prochaines croisades.
► 1229 - 26 février Traité de Paris. Celui-ci met un terme aux troubles religieux du Languedoc par l'annexion au domaine royal des terres de Nîmes, Beaucaire, Béziers et Carcassonne. Le mariage d'Alphonse de Poitiers, frère du roi Louis IX, avec Jeanne, fille de Raymond VII de Toulouse, est décidé. Le traité de Paris de 1229 met fin au conflit albigeois opposant le Royaume de France au comté de Toulouse. Il scelle aussi le sort de l'autonomie occitane vis à vis du Royaume de France.
Alphonse de Poitiers (11 novembre 1220-21 août 1271), frère du roi Louis IX de France dit Saint Louis, comte de Poitiers de 1241 à 1271, de Toulouse de 1249 à 1271. Fils du roi Louis VIII et de Blanche de Castille, il reçu en 1225, par testament de son père, le comté de Poitou et une partie de l'Auvergne en apanage. Conformément au traité de Paris en 1229, il épouse Jeanne, fille de Raymond VII de Toulouse, comte de Toulouse. À la mort de ce dernier, en 1249, il hérite du comté de Toulouse. Jeanne de Toulouse, née en 1220, morte le 25 août 1271, était la fille et l'héritière de Raymond VII de Toulouse, comte de Toulouse et de Jeanne d'Angleterre. Elle fut comtesse de Toulouse de 1249 à 1271.
► 1229 - 12 avril Traité de Meaux (dit aussi Traité de Paris) qui met fin à la croisade ou guerre contre les Albigeois. Beaucaire, Nîmes et Carcassonne sont rattachés au royaume. Le traité de Paris de 1229 met fin au conflit albigeois opposant le Royaume de France au comté de Toulouse. Il scelle aussi le sort de l'autonomie occitane vis à vis du Royaume de France. Appelé aussi Traité de Meaux-Paris, il fut ratifié le 12 avril 1229 par Blanche de Castille, alors régente du Royaume de France pour son fils Louis IX et par Raymond VII de Toulouse.
Ce dernier, dans une situation politique très incomfortable (il est en effet excommunié et dépossédé des terres dont il est l'héritier légitime par la croisade royale), n'a d'autre choix que d'accepter ce traité. Pour ce faire, il se rend à Paris en pélerin, va chercher l'absolution en pénitent sur les marches de Notre-Dame de Paris où il sera flagellé après sa déclaration publique de repentir et enfin il signera le traité. Ceci lui permet de voir sa situation régularisée auprès de l'Église et du Royaume de France, au prix d'un traité dont les conditions sont très dures.
Raymond VII de Toulouse, comte de Toulouse se voit contraint de prêter allégeance au roi de France Louis IX. De plus, il doit céder près de la moitié de son territoire, principalement les anciennes vicomtés de Trencavel. Les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne seront données au Royaume de France et le marquisat de Provence (connu plus tard sous le nom de Comtat Venaissin) sera cédé au Saint-Siège. Le comté de Toulouse perd ainsi les territoires actuels du Gard, de l'Hérault, de la Drôme, du Vaucluse et de l'Aude.
Il conserve l'Agenais, le Rouergue, le nord de l'Albigeois et le bas Quercy (ce qui représente actuellement la Haute-Garonne, l'Aveyron, le Tarn et le Tarn-et-Garonne). Ce traité prévoit également le mariage de Jeanne de Toulouse (fille et seule héritière de Raymond VII de Toulouse) avec l'un des frères du roi, Alphonse de Poitiers, ce qui permet à plus ou moins brève échéance de rattacher les territoires restants du comté de Toulouse au royaume de France.
► 1229 Annexion du Languedoc.
► 1230 à 1286 - naissance et mort de Adam de La Halle est un poète et un musicien remarquable. Il a composé de nombreuses pièces courtes (chansons, jeux-partis, rondets de carole, motets, rondeaux polyphoniques), un dit, un congé, et surtout une importante oeuvre théâtrale, qui marque l'éclosion des premiers textes du théâtre profane français. Un motet est une composition musicale apparue au XIIIe siècle, à une ou plusieurs voix, avec ou sans accompagnement musical, généralement religieuse, courte, et écrite sur un texte en latin. Motet.
Oeuvre polyphonique (le plus souvent sacrée) sur des textes latins, chantée par le choeur. La tradition du motet s'étend de 1200 à 1750. A l'origine, le motet est composé à l'occasion d'une fête, souvent religieuse. Le motet médiéval est issu du développement de la "clausule", forme empruntant en partie ses textes et sa musique au chant grégorien. Il existe un continuum d'une forme à l'autre. La clausule monodique (une seule ligne mélodique) devient polyphonique, et les rythmes libres du grégorien sont remplacés par des rythmes définis et notés, fondés sur les "modes rythmiques" en vigueur à l'époque.
Ceux-ci sont au nombre de six, ils sont à trois temps et ont présidé à la fondation de la clausule comme du motet du XIIIe siècle. L'âge d'or du motet exclusivement polyphonique est le XVIe siècle. Il devient une forme à part entière, d'une polyphonie luxuriante, à quatre voix et souvent plus. Josquin des Prés en est l'un des plus brillants représentants. La dernière époque du motet est le "Chapelle Royale" de la cour de Versailles connaît une brillante floraison d'oeuvres intimes ("petits motets") et grandioses ("grands motets"), genres que structure l'omniprésent Lully – que reprennent tous les compositeurs jusqu'à la Révolution.
Le dit est un poème narratif à la première personne, destiné à être récité. Il peut cependant contenir des poèmes lyriques en musique, comme 'Le Remède' de Fortune de Guillaume de Machaut, qui intègre sept chansons. Le congé est un genre poétique médiéval né au tout début du XIIIe siècle. Façon poétique de se séparer d'une femme ou bien du monde en général, ces oeuvres lyriques sont souvent rédigées à la première personne, conférant aux vers un aspect autobiographique (avec lequel il faut savoir distance garder cependant).
► 1230 apparition de 'La Mort le Roi Artu', auteur inconnu. Le cycle romanes-que s'achève avec le célèbre roman La Mort le roi Artu a largement contribué à diffuser l'image traditionnelle du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde.
► 1230 Auteur inconnu écrit Aucassin et Nicolette. Aucassin et Nicolette, roman d'amour que Roquefort fait remonter au XIIe siècle, et qui est une des plus charmantes productions du moyen âge. Ce roman, d'un auteur inconnu, est plein de naïveté, de pureté et de grâce. Il est écrit alternativement en prose et en vers de 7 ou 8 syllabes. Les couplets sont monorimes; ils étaient chantés, comme l'indiquent, sur le manuscrit, des notes de musique sur des portées de quatre lignes; chaque portée est précédée d'un signe qui ressemble à la clé d'ut.
► 1230 apparition de 'Le Roman de Renart'. 'Le Roman de Renart' est un recueil de récits médiévaux français des XIIe et XIIIe siècles ayant pour héros des animaux agissant comme des humains.
► 1230 Barthélemy L'Anglais écrit Liber de proprietatibus rerum. Barthélemy l'Anglais fut, avec Thomas de Cantimpré et Vincent de Beauvais, l'un des trois encyclopédistes majeurs du XIIIe siècle, véritable âge d'or de l'encyclopédisme médiéval selon Jacques Le Goff. La vie de ce franciscain anglais, qui enseigna à Paris et à Magdebourg, nous est fort mal connue. Sa notoriété lui vient de l'écriture d'une célèbre encyclopédie sur la nature, en 19 livres, intitulée De proprietatibus rerum ou Livre des propriétés des choses, authentique best-seller de la fin du Moyen Âge et des premiers temps de l'imprimerie.
► 1230 Gerbert de Montreuil et Manessier écrit Continuation du Conte du Graal.
► 1231 Organisation par Grégoire IX de l'Inquisition, chargée de poursuivre les erreurs contre la foi catholique. Grégoire IX, né vers 1145, prénommé Ugolino, il appartient à la famille des comtes de Segni. En 1198, il fut fait cardinal par son oncle, le pape Innocent III. En 1206 il fut nommé cardinal-évêque d'Ostie avant d'être élu pape en 1227 sous le nom de Grégoire IX. Ami de Saint-François d'Assise, il joua un rôle, avant son pontificat, dans la création de l'Ordre des Frères mineurs ou Franciscains. Le faisant nommer cardinal protecteur de l'ordre, il l'entraîna alors vers un idéal qui n'était pas le sien, le mettant ainsi au service de l'Église romaine pour l'aider dans ses tâches.
Mais l'oeuvre principale de Grégoire IX, troublé par l'hérésie en Albigeois, fut l'organisation de l'Inquisition. Il publia en effet en 1231 la contitution Excommunicamus qui plaçait la poursuite des hérétiques sous la direction papale et établissait l'Inquisition. En 1234 il ordonna le rassemblement des Décrétales qui constituèrent alors une étape dans la codification du droit canon. L'Inquisition était une juridiction spéciale de l'Église catholique romaine chargée de lutter contre l'hérésie. Elle fut fondée en 1231 par Grégoire IX. L'Inquisition eut pour but de pallier les déficiences des tribunaux épiscopaux. C'était une juridiction spéciale et permanente. Elle était affranchie de l'autorité des évêques. Son seul but était la défense de la foi catholique. Créée pour lutter contre les Vaudois et les Cathares, elle s'étendit ensuite aux autres hérésies, puis à la sorcellerie en tant que survivance du paganisme et au blasphème.
► 1231 L'abbé de Saint-Denis Eudes Clément poursuit les travaux de reconstruction de la basilique entrepris par Suger en 1140. Apogée de l'art gothique et début du gothique rayonnant. Le gothique rayonnant, encore une fois, ce style est né à Saint-Denis avec la réfection du choeur de l'abbatiale en 1231. Le rayonnant va se développer peu à peu jusqu'en 1350 environ. Les églises deviennent de plus en plus hautes, dépassant parfois les limites comme à Beauvais, construction trop ambitieuse : en 1272 une partie des voûtes du choeur de la cathédrale s'effondrèrent; les voûtes étaient trop hautes et les piliers trop espacés.
Les principales caractéristiques de cette architecture sont la virtuosité des remplages, la verticalité toujours plus importante, des piliers fasciculés, et les surfaces vitrées qui deviennent de plus en plus grandes (Cathédrale Saint-Étienne de Metz avec 6496 m²) ; les églises deviennent de véritables squelettes de pierre, le reste étant de verre, laissant pénétrer une lumière abondante. Le gothique rayonnant s'impose réellement à partir des années 1240.
Les édifices alors en chantier prennent immédiatement en compte cette nouvelle "mode" et changent partiellement leur plan. C'est à cette époque que la rose devient vraiment un élément incontournable du décor, même si elle était déjà très utilisée avant (Notre-Dame de Paris, transept). La multiplication des chapelles latérales permet aussi d'agrandir l'espace de la cathédrale. L'abbatiale Saint-Ouen de Rouen est un excellent exemple d'édifice rayonnant.
► 1234 - 27 mai Mariage de Louis IX avec Marguerite de Provence (née en 1221 et qui mourut en 1295).
► 1235 Trêve de cinq ans entre Louis IX et Henri III d'Angleterre.
► 1235 à 1315 - naissance et mort de Raymond Lulle, est considéré comme l'un des plus grands philosophes, théologiens et mystiques de son époque. Raymond Lulle, bien que marié, mène une vie dissipée jusqu'à l'âge de trente ans où il se convertit et prêche le christianisme aux infidèles. Surnommé le "Docteur illuminé", il fonde un monastère à Miramar, où les moines étudient les langues orientales à des fins missionnaires, puis il parcourt les pays méditerranéens et africains, écrit, étudie, enseigne à Montpellier, Naples et Paris. Lapidé dans le port africain de Bougie, il meurt des suites de ses blessures en 1316 à Majorque.
► 1237 Guillaume de Lorris écrit 'Roman de la Rose'. Le Roman de la Rose est un travail de 22000 vers octosyllabiques sous la forme d'un rêve allégorique. Il a été écrit en deux temps: Guillaume de Lorris écrivit la première partie (4058 vers) en 1237, puis l'ouvrage fut complété par Jean de Meung (18000 vers) entre 1275 et 1280. Une traduction en vers et en français contemporain en a été effectuée par Bordas. Celle-ci est introuvable aujourd'hui, mais on peut en lire un extrait dans l'Anthologie de la poésie française de Pierre Seghers. Le texte d'époque, quant à lui, est à peu près illisible aujourd'hui par un non spécialiste, hormis quelques mots identifiables de ci, de là.
► 1238 - 9 octobre : Jacques Ier d'Aragon reprend Valence aux Maures. Les musulmans ne tiennent plus que le royaume Nasride de Grenade (fin en 1492). Muhammad Al-Ghalib Billah, fondateur de la dynastie nasride, choisit Grenade comme siège du gouvernement. Il commence la construction du palais de l'Alhambra. L'Alhambra de Grenade est un des monuments majeurs de l'architecture islamique.
C'est avec la Grande mosquée de Cordoue le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne du VIIIe au XVe siècle. Leurs caractères sont d'ailleurs opposés : à la sobriété grandiose du monument religieux représentatif de la première architecture islamique, s'oppose l'exubérance de la dernière manière hispano-mauresque : celle-ci s'exprime en effet dans les palais des derniers souverains nasrides, alors en pleine décadence, et qui disparaîtront bientôt lors derniers assauts de la Reconquista.
► 1239 Saint Louis achète le comté de Mâcon.
► 1239 11 août : Le roi Saint Louis accueille à Villeneuve-l'Archevêque la Couronne d'épines du Christ, pour la conservation de laquelle il a entrepris la construction de la Sainte-Chapelle.
► 1241 - Soulèvement des barons Poitevins avec l'appui de Henri III d'Angleterre contre Louis IX. Révolte contre le roi de France Louis IX du comte de la Marche, Hugues de Lusignan, du comte de Toulouse, Raymond VII de Toulouse, avec le soutien du roi d'Angleterre, Henri III. Hugues X de Lusignan († le 5 juin 1249 devant Damiette), dit Le Brun, sire de Lusignan, comte de la Marche et d'Angoulême, fils d'Hugues IX de Lusignan et de Mahaut d'Angoulême.
► 1241 - 11 avril Écrasante victoire Mongole en Hongrie. Les Mongols conduits par le petit-fils de Gengis Khan, Batû Khan, écrasent les troupes hongroises du roi Bela IV à Mohi. Depuis 1237 la "Horde d'Or" mongole a entrepris de s'emparer de l'Europe. Avant la Hongrie, elle a ravagé l'Ukraine, la Pologne et une partie de la Russie. L'Europe occidentale échappera à la terrible invasion mongole. La bataille de Mohi (également appelée bataille de la rivière Sajo) le 11 avril 1241 est la principale bataille entre les Mongols (menés par Batû-Khan, petit-fils de Gengis Khan) et le Royaume de Hongrie pendant l'invasion mongole de l'europe.
► 1242 A la majorité de Louis IX, un des grands vassaux, le comte de La Marche, Hugues de Lusignan, avait formé, avec l'aide de Henri III d'Angleterre, une nouvelle ligue contre lui. Le roi de France marcha contre ces ennemis et battit le roi d'Angleterre (Plantagenêt et leur allié poitevin) à Taillebourg et à Saintes. Ces victoires marquent la fin de la lutte des grands vassaux contre la Couronne.
Louis IX fait accepter le principe que les seigneurs possédant des fiefs en France et en Angleterre devront désormais choisir celui des deux suzerains auquel ils entendent s'attacher; il rend à Henri III certains territoires en France, à condition qu'il renonce à ses prétentions sur toutes autres provinces qui lui auraient été précédemment enlevées.
Bataille de Taillebourg, opposa, en 1242, les troupes capétiennes du roi de France Saint Louis et de son frère le comte de Poitiers Alphonse à celles de leurs vassaux révoltés, Henri III d'Angleterre et Hugues X de Lusignan. Le départ de ce dernier épisode de la première guerre de Cent Ans entre Français et Anglais se trouve dans la révolte d'un baron poitevin, Hugues X, seigneur de Lusignan.
► 1243 janvier Traité de Lorris entre Louis IX et Raymond VII de Toulouse, comte de Toulouse. La paix de Lorris est signée par le roi de France et Raymond VII, comte de Toulouse. Elle confirme globalement le traité de Paris de 1229 qui prépare l'annexion du comté de Toulouse au domaine royal.
► 1243 - 7 avril Trêve de cinq ans entre Saint Louis et Henri III d'Angleterre. Henri III d'Angleterre, en guerre avec la France depuis de nombreuses années, conclut avec Louis IX une trêve de cinq ans. Mais il faudra attendre 1258, soit quinze ans plus tard, pour que le traité de Paris mette fin à la guerre et que le roi d'Angleterre reconnaisse être le vassal du roi de France pour ses possessions françaises que sont l'Anjou, la Normandie, la Touraine, le Maine et le Poitou.
► 1244 - 20 mars Capitulation de la forteresse cathare de Montségur. Le 1er mars 1244, Pierre-Roger de Mirepoix se voit contraint de négocier la reddition de la place forte. Les termes en seront les suivants : la vie des soldats et des laïcs sera épargnée, les parfaits qui renient leur foi seront sauvés, une trêve de 15 jours est accordée pour les cathares qui veulent se préparer et recevoir les derniers sacrements. 16 mars, la forteresse s'ouvre à nouveau.
Tous les cathares qui n'avaient pas abjurés leur foi périrent sur le bûcher qui engloutit ainsi un peu plus de 200 suppliciés (le nombre varie légèrement suivant les sources) dont la femme, la fille et la belle-mère de Raymond de Péreille. La tradition veut que le bûcher soit monté à 200 m du castrum dans le "Prat dels Cremats" (le champs des brûlés) où une stèle fut érigée par la contemporaine Société du souvenir et des études cathares. Sur cette dernière figure l'inscription : "Als cathars, als martirs del pur amor crestian. 16 mars 1244".
► 1244 mort de Jeanne de Constantinople, début de Guerre de Succession de Flandre et du Hainaut. Guerre de Succession de Flandre et du Hainaut, une série de conflits qui opposèrent les enfants de Marguerite de Flandre au milieu de XIIIe siècle. Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut était parti à la quatrième croisade en laissant ses comtés à sa fille aîné Jeanne Celle-ci mourut en 1244, sans héritier malgré deux mariages, et sa soeur Marguerite lui succéda. Elle avait épousé en premières noces, un chevalier de modeste condition Bouchard d'Avesnes (1182 †1244), et dont elle dut se séparer en 1221 par ordre de sa soeur et parce que Bouchard avait été excommunié.
Elle avait eu trois fils, dont Jean d'Avesnes. En 1223, elle s'était remariée avec Guillaume (†1231), seigneur de Dampierre, et avait eu trois enfants, dont Guillaume et Guy. Un premier conflit éclata en 1244 entre Jean d'Avesnes et Guillaume de Dampierre pour savoir qui hériterait des comtés. Les demi-frères se combattirent, jusqu'à ce que Saint Louis intervienne et décide que le Hainaut reviendrait à Jean d'Avesnes et la Flandre à Guillaume de Dampierre.
Fort de ce jugement, Marguerite laissa le gouvernement de la Flandre à Guillaume de Dampierre dès 1247, mais ne manifesta pas l'intention d'en faire autant avec le Hainaut. Lorsque Guillaume meurt en 1251, elle laisse la Flandre à Guy de Dampierre, qui devient à son tour comte de Flandre. Le second conflit : en 1250, Saint-Louis est parti en Croisade, et y restera quatre ans. Jean d'Avesnes ne tarde pas à comprendre que sa mère n'a pas l'intention de lui laisse le Hainaut, et attaque Guy et Marguerite.
Différent combats opposent les demi-frères, jusqu'à la bataille de West-Capelle, le 4 juillet 1253, où les Avesnes remportent une éclatante victoire contre les Dampierre, et les obligent à respecter l'arbitrage de Saint-Louis et à renoncer définitivement au Hainaut. Le troisième conflit : Marguerite de Flandre ne s'avoue pas vaincu, et ne voulant toujours pas laisser le comté de Hainaut à Jean d'Avesnes, le donne à Charles d'Anjou, frère de Saint Louis, qui est revenu de la Croisade avant son frère. Charles entreprend de conquérir le comté, mais échoue à prendre Valenciennes, et manque d'être tué au cours d'une escarmouche. Enfin Saint Louis revient de Terre Sainte et oblige son frère à renoncer au Hainaut. Jean d'Avesnes pourra enfin recevoir son héritage.
► 1244 vers - Rédaction de l'encyclopédie 'Speculum majus' par Vincent de Beauvais (av. 1244-1258). Vincent de Beauvais (vers 1190-1267) fut un dominicain célèbre pour avoir écrit une encyclopédie. On pense qu'il fait partie des Dominicains de Paris entre 1215 et 1220, et à Beauvais, lorsqu'un monastère dominicain y est fondé par Louis IX. Il est plus certain qu'il occupe le poste de lecteur à l'abbaye de Royaumont dans l'Oise, fondée également par Louis IX entre 1228 et 1235.
Le roi, comme la reine Margaret, son fils Philip et son beau-frère Theobald V de Champagne et Navarre, lui commandent la réalisation de nombreuses oeuvres. La grande oeuvre de Vincent est son 'Speculum Majus', grande compilation de la connaissance du Moyen Âge. Elle est constituée de trois parties : Speculum Naturale, le Speculum Doctrinale et le Speculum Historiale. Ces ouvrages seront abondamment réédités jusqu'à la Renaissance.
► 1248 - 12 juin Départ de Saint Louis pour la septième croisade. A Aigues-Mortes, Louis IX embarque pour respecter le voeu fait lors d'une maladie qui l'a presque amené à mourir, en 1244. 25 000 soldats montent à bord de navires génois. Sa femme, Marguerite de Provence, l'accompagne.
► 1248 - 28 août Saint Louis quitte Aigues-Mortes pour Chypre.
► 1248 Construction de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle fut édifiée sur l'île de la Cité, à Paris, à la demande de Saint Louis afin d'abriter la Sainte Couronne, un morceau de la Sainte-Croix ainsi que diverses autres reliques qu'il avait acquises. Ce bâtiment est un petit chef d'oeuvre de l'art gothique, certains auteurs considérant qu'il marque l'apogée de cet art. Conçue comme une chasse précieuse devant mettre en valeur les reliques y étant conservées, elle devait également servir de chapelle royale, étant construite dans le palais royal de l'île de la Cité.
Elle superpose deux chapelles, l'inférieure pour les gens du commun, la supérieure pour l'entourage du roi, selon un usage courant dans la construction des palais royaux du Moyen Âge. Dans les premiers temps, la chapelle haute n'était d'ailleurs accessible que par les galeries supérieures du Palais, Saint Louis n'ayant pas fait construire d'escalier public.
► 1248 apparition du Psautier de Saint Louis. Réalisé pour le roi de France Louis IX (1214-1270) entre 1253 et 1270, ce psautier de grand luxe, dit Psautier de Saint Louis était destiné à l'usage des chanoines de la Sainte-Chapelle, construite à Paris en 1248 pour abriter les reliques de la Passion. Un psautier comporte traditionnellement trois parties: un calendrier qui signale les fêtes liturgiques particulières à l'église à laquelle il est destiné, ainsi que les fêtes de certains défunts; une histoire sainte en images; le texte latin des cent cinquante psaumes, tirés de la Bible.
► 1249 à 1254 - Septième croisade. Louis IX, au cours d'une grave maladie, avait fait voeu d'entreprendre une croisade, s'il en guérissait. Il était prévenu d'ailleurs que les musulmans avaient repris la Palestine, et menaçaient l'Empire latin de Constantinople, qui était en pleine décadence. Il réunit donc des troupes et s'embarqua pour la Terre Sainte à Aigues-Mortes, emmenant sa femme Marguerite. Il débarqua en 1249 à Damiette et s'empara de cette ville après avoir livré bataille.
La septième croisade fut dirigée contre l'Égypte : le roi de France prit Damiette, et remporta même un avantage à la Massoure (1250); mais, la peste s'étant mise dans son armée, il fut contraint de reculer devant l'ennemi, et fut lui-même fait prisonnier. Il racheta chèrement sa liberté, passa 4 ans en Palestine, occupé à fortifier quelques places, et revint en France en 1254, après la mort de la reine Blanche, sa mère, qu'il avait instituée régente.
► 1249 - 5 juin Débarquement des armées de Saint Louis devant Damiette. Damiette est un port du Dimyat, en Égypte, dans le delta du Nil, à environ 200 kilomètres au Nord-Est du Caire.
► 1249 - 6 juin Les armées de Saint Louis entrent dans Damiette que les armées du sultan ont évacués dans la nuit. En ce jour, Louis IX, qui vient de débarquer en Égypte où commence la septième croisade, prend cette ville de Damiette qui, sur la rive droite du Nil, est censée ouvrir la route de Jérusalem que les croisés se sont promis de reprendre aux infidèles.
► 1249 - 27 septembre Mort de Raymond VII de Toulouse, le frère de Louis IX, Alphonse de Poitiers récupère le titre. Alphonse de Poitiers (11 novembre 1220-21 août 1271), frère du roi Louis IX de France dit Saint Louis, comte de Poitiers de 1241 à 1271, de Toulouse de 1249 à 1271. Fils du roi Louis VIII et de Blanche de Castille, il reçu en 1225, par testament de son père, le comté de Poitou et une partie de l'Auvergne en apanage. Conformément au traité de Paris en 1229, il épouse Jeanne, fille de Raymond VII de Toulouse, comte de Toulouse. À la mort de ce dernier, en 1249, il hérite du comté de Toulouse.
► 1250 - 8 février Défaite de La Mansourah, Saint Louis échappe de justesse aux Mamelouks, et son frère (Robert Ier d'Artois) meurt au combat. Gênés par les crues du Nil, les croisés ont livré bataille à Mansourah dans de mauvaises conditions. Robert Ier d'Artois, frère préféré du roi, est tué. Louis IX tombe lui-même aux mains des mamelouks. Mansourah est une ville du nord-est de l'Égypte dans l'est du Delta du Nil, à 120 Km du Caire, chef-lieu du gouvernorat de Dakhalieh, sur le bras oriental (Damiette) du Nil.
Robert Ier d'Artois, né en 1216, mort à Mansourah en 1250, est comte d'Artois (1237-1250), fils de Louis VIII et de Blanche de Castille et frère de Saint Louis. Conformément à la volonté de son père, il reçut en 1237 le comté d'Artois. En 1240, il refusa de prétendre à l'empire, comme le souhaitait le pape Grégoire IX. Il prit part à la septième croisade de Saint Louis et trouva la mort dans un assaut inconsidéré contre Mansourah en 1250. Les mamelouks sont les membres d'une milice formée d'esclaves (affranchis), au service des califes musulmans et de l'Empire ottoman, qui à de nombreuses reprises, a occupé le pouvoir par elle-même.
En Égypte, ils sont issus de la garde servile du sultan ayyoubide qu'ils renversèrent à l'occasion de la IXe croisade (Mansura, dans le Delta égyptien, en 1249). L'histoire de cette dynastie non héréditaire se divise en deux lignées, les Bahrites (1250-1382) et les Burjites (1382-1517)Ils régnèrent sur l'Égypte, la Syrie et le Hedjaz, vainquirent les Mongols à Aïn Jalut (1260), devinrent les protecteurs des Abbassides rescapés, dont ils recueillirent un descendant à qui ils donnèrent le titre de calife. Ils conquirent les dernières possessions des Francs au Levant. Les Ottomans mirent fin à cette dynastie en 1517.
► 1250 - 6 avril Saint Louis et son armée sont capturés et fait prisonniers. Louis IX, qui a été défait à Mansourah où son frère préféré Robert Ier d'Artois a été tué, est fait prisonnier par le sultan qui, par les égards qu'il a pour lui, témoigne du respect qu'il porte à celui qu'il appelle le “sultan juste”. Traité avec égards par les musulmans, il put se racheter moyennant l'abandon de Damiette, et racheter ses compagnons en payant une rançon de 400 000 besants, monnaie byzantine, (d'autres auteurs disent un million de besants).
Cependant, les maladies et la famine décimaient ses troupes; d'autre part, il apprit la mort de sa mère qui exerçait de nouveau la régence en son absence; il se rembarqua donc avec son armée et rentra en France en 1254. Il avait mis à profit son séjour en Palestine, après sa libération, pour parcourir ce pays, et fortifier les dernières places qu'y possédaient encore les chrétiens. Il laissait parmi les musulmans la réputation d'un prince brave, généreux et vertueux.
► 1250 - 2 mai Le sultan est reversé par les Mamelouks, une rançon est exigé pour la libération de Saint Louis. Le roi, prisonnier des musulmans depuis le 6 avril, signe une convention avec le sultan qui le libère ainsi que ses compagnons contre une somme de 400 000 besants et la restitution de la ville de Damiette conquise par les croisés, l'année précédente.
► 1250 - 6 mai Saint Louis et les survivants de son armée rejoignent Saint-Jean d'Âcre.
► 1250 Vincent de Beauvais écrit 'le Speculus Majus’
► 1250 vers - Langue française commence à concurrencer le latin: elle acquiert un véritable prestige en France comme à l'étranger avec de nouveaux domaines de compétence (savoir, droit, etc.) Développement du pouvoir royal sur le territoire (administration apporte le français); multiplication des actes en français, rôle des notaires; ce français est peu marqué régionalement.
► 1250 vers - Le français (anglo-normand) perd du terrain en Angleterre; la noblesse est généralement bilingue.
► 1251 Sous prétexte d'aller libérer Saint Louis des bandes de paysans pillards se constituent, c'est la croisade des Pastoureaux. La croisade des Pastoureaux fait partie des croisades populaires initiées sans l'appui des puissants et même souvent contre eux. L'appel solennel aurait eu lieu pour Pâques. Des milliers de bergers et de paysans prennent la croix, et marchent vers Paris, armés de haches, de couteaux et de bâtons. Ils sont 50 000 à Paris, où Blanche de Castille les reçoit. Dans un premier temps elle donne son appui, le mouvement est trop dangereux sur le plan social et religieux pour être accepté par les puissants: il accuse abbés et prélats de cupidité et d'orgueil, et s'en prend même à la Chevalerie, accusée de mépriser les pauvres et de tirer profit de la croisade.
Des conflits s'ensuivent avec le clergé dans plusieurs villes. Lorsque les villes ne veulent pas les nourrir, des pillages ont lieu en France, par exemple à Bordeaux, où Simon de Montfort réprime les Pastouraux. Le mouvement s'étend en Rhénanie et dans le nord de l'Italie. La répression est de plus en plus féroce et seuls quelques rescapés parviennent jusqu'à Marseille et s'embarquent pour Saint Jean d'Acre, où ils rejoignent les croisés. Croisade des Pastoureaux. En avril 1250, Louis IX est fait prisonnier à Mansourah lors de la septième croisade. Des bandes de paysans, que l'on nomme les Pastoureaux, se forment pour aller délivrer le roi. Bientôt, des éléments subversifs se mêlent à l'équipée qui dégénère en une bande de pillards. En 1251, la reine Blanche de Castille met fin à la croisade des Pastoureaux.
► 1252 à 1270 - Cette période fut consacrée par Louis IX à l'organisation de ses États. Il fit régner en France l'ordre et la sécurité; d'excellentes institutions fortifièrent la monarchie (enquêteurs qui visitaient les provinces pour réprimer les abus, confirmation et extension de la Quarantaine-le-Roi, abolition du duel judiciaire, établissement d'une sorte de Cour royale de Justice, formation d'un corps de Légistes, mesures propres à établir en France l'unité monétaire, garanties assurées au Clergé par la Pragmatique Sanction de 1269, etc.). Louis IX bâtit la Sainte-Chapelle pour y placer la Couronne d'épines rapportée de Terre Sainte, fonda la Sorbonne, centre d'études universitaires, et les Quinze-Vingts, destinés à hospitaliser les chevaliers revenus aveugles ou blessés de Palestine. Il se montra un souverain éclairé et passionné pour le bien public.
► 1252 - 27 novembre Mort de Blanche de Castille, mère de Saint Louis qui assurait la régence. La mère du roi s'éteint, épuisée par les épreuves successives : la mort de son fils Robert Ier d'Artois, la défaite de Mansourah et la captivité de Louis IX.
► 1254 - 25 avril Saint Louis quitte Saint Jean d'Acre pour la France. Après avoir consolidé des forteresses, apaisé des conflits, versé une rançon pour ses chevaliers et rendu Damiette au sultan, Louis IX s'embarque pour la France. C'est la fin de la septième et avant-dernière croisade.
► 1254 - 17 juillet Saint Louis débarque en Provence.
► 1254 juillet Saint Louis édicte les premières ordonnances de réforme administrative. "Grande ordonnance" pour la réforme du royaume (1254-1270). Louis IX de France (Saint Louis) codifie le rôle des baillis pour améliorer l'administration. Les baillis se voient attribuer une circonscription bailliagère fixe où il jugent en appel, encaissent les recettes royales, lèvent l'ost et transmettent les ordres du roi. Les sénéchaux installés dans le midi et dans l'ouest du royaume ont des attributions semblables.
Le bailli était dans l'Ancien Régime français le représentant de l'autorité du roi ou du prince, chargé de faire appliquer la justice et de contrôler l'administration en son nom. Il était à l'origine porté par des commissaires royaux qui rendaient la justice, percevaient les impôts et recevaient, au nom de la couronne, les plaintes du peuple contre les seigneurs. Leur juridiction, régularisée avec les Capétiens fut d'abord très étendue ; mais l'abus qu'ils firent de leur puissance obligea les rois à la réduire, et vers le XVIe siècle, ils n'étaient plus que des officiers de justice.
► 1257 Fondation du collège de la Sorbonne à Paris. La Sorbonne est une des plus anciennes universités d'Europe fondée par Robert de Sorbon à Paris en 1257. On y enseignait principalement la théologie aux étudiants pauvres et elle s'est développée rapidement. Paris devint un grand centre culturel et scientifique en Europe dès le XIIIe siècle avec plus de 20 000 étudiants. Robert de Sorbon (9 octobre 1201 à Sorbon - 15 août 1274 à Paris) est un théologien français. Chapelain et confesseur du roi Saint Louis IX, il créa le Collège de Sorbonne à Paris pour "seize pauvres maîtres ès arts, aspirants au doctorat en théologie" en 1257. Le Collège devint par la suite la maison la plus célèbre de l'Université de Paris.
► 1258 - 11 mai Traité de Corbeil entre Louis IX et Jacques Ier d'Aragon où ils renoncent mutuellement à leur prétention sur la Catalogne et le Languedoc. Jacques Ier dit le Conquérant, né le 2 février 1208 à Montpellier, mort le 27 juillet 1276 à Valence (Espagne), roi d'Aragon, comte de Barcelone et seigneur de Montpellier à partir de 1213, roi de royaume de Majorque à partir de 1229 et de Valence à partir de 1232. Traité de Corbeil, traité passé en 1258 à Corbeil (Essonne) entre les représentants du roi Jacques Ier d'Aragon (dont Guillaume de Roquefeuil) et du roi de France Louis IX, dans lequel le roi de France cède ses droits sur la Catalogne et le roi d'Aragon cède ses droits sur le Languedoc (sauf Montpellier).
Ce traité fixe la frontière du royaume de France au sud des Corbières gardée, côté français par les forteresses de Termes, Aguilar, Quéribus, Peyrepertuse et Puylaurens. Les chevaliers Olivier de Termes et Raimond Gaucelm de Lunel sont sans doute les principaux artisans de ce traité. Traité de Corbeil. Saint Louis renonce, par ce traité signé en 1258, à ses prétentions sur la Cerdagne et le Roussillon au profit du roi d'Aragon ; il rend au roi d'Angleterre les terres au sud de la Charente, mais s'assure de la possession de la Touraine et de la Normandie.
► 1258 - 10 février : Les Mongols de Houlagou Khan mettent Bagdad à sac (la ville compte un million d'habitants) et mettent fin au califat abbasside. Les combattants musulmans, malgré l'intervention du calife, sont exterminés dès qu'ils ont déposé les armes. La ville est pillée, ses monuments détruits, ses quartiers incendiés, sa population massacrée (près de 80 000 personnes). Seule la communauté chrétienne de la cité est épargnée grâce à l'intercession de la femme du khan.
► 1258 - 28 mai : Le roi de France Saint Louis signe le traité de Paris avec Henri III d'Angleterre qui renonce à l'Anjou, la Normandie, la Touraine, le Maine et le Poitou en échange de domaines dans les diocèses de Limoges, Cahors et Périgueux.
► 1259 La Guyenne passe sous le giron français. La Guyenne est une ancienne province du sud-ouest de la France. Elle avait pour capitale Bordeaux et correspondait approximativement à l'actuelle Aquitaine. C'était une province royale représentée et administrée, dans un premier temps, par un Lieutenant général pour le roi, puis par un gouverneur, détenant l'autorité militaire, politique et administrative. Le nom de duché de Guyenne fut donné à l'ancien duché d'Aquitaine amoindri par les conquêtes des souverains français.
Il succéda à celui d'Aquitaine au moment du Traité de Paris conclu le 12 avril 1229 entre Saint Louis et Raymond VII comte de Toulouse, qui cédait la plus grande partie du Languedoc à la France et mettait fin au conflit albigeois. Possession des rois d'Angleterre de 1188 à 1453, la Guyenne est réunie au domaine du roi de France après la bataille de Castillon, qui mit fin à la guerre de Cent Ans. Donné en apanage à son frère Charles de Valois, par Louis XI en 1469, le duché revint définitivement à la couronne à la mort de celui-ci en 1472. C'est en 1561 que la province est érigée en gouvernement de Guyenne avec pour siège Bordeaux.
► 1259 - 4 décembre Traité de Paris sur la restitution d'une partie des possessions anglaises par Saint Louis, Henri III d'Angleterre devient vassal du roi de France. Traité de Paris, le 4 décembre 1259, le roi d'Angleterre Henri III Plantagenêt signe avec Louis IX, le futur Saint Louis, le traité de Paris (aussi appelé traité d'Abbeville). Louis IX rétrocède à Henri III, le Limousin, le Périgord, la Guyenne, le Quercy, l'Agenais et la Saintonge. Mais le roi d'Angleterre s'engage, pour ces possessions, à rendre au roi de France l'hommage féodal dû au suzerain.
Le roi de France conserve par ailleurs la Normandie et les pays de Loire (Touraine, Anjou, Poitou et Maine). Ces riches provinces ont été confisquées par son aïeul Philippe Auguste au père de Henri III, le roi Jean sans Terre. Par ce traité équitable, tissé de concessions réciproques et appuyé par les victoires des armées françaises à Saintes et Taillebourg, le roi de France devient le monarque le plus puissant d'Occident. Le traité de Paris met fin à ce que l'on appelle parfois la première Guerre de Cent Ans. Ce conflit entre la France et l'Angleterre avait débuté au siècle précédent avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du futur roi d'Angleterre Henri II d'Angleterre.
► 1260 Rutebeuf écrit 'Poèmes de l'infortune'. Rutebeuf (v.1230 - v.1285), probablement du surnom "boeuf vigoureux", serait originaire de Champagne (il a décrit les conflits à Troyes en 1249) mais a vécu adulte à Paris. On ne sait quasiment rien de sa vie sauf qu'il était probablement un jongleur avec une formation de clerc (il connaissait le latin). Son oeuvre, très diversifiée, qui rompit avec la tradition de la poésie courtoise des trouvères, comprend des hagiographies, du théâtre, des poèmes polémiques et des poèmes satiriques.
► 1260 vers - Brunetto Latini, florentin, compose à Paris son 'Livres dou trésor' (en français): 'Et se aucuns demandoit pour quoi cis livres est escris en roumanç, selonc le raison de France, puis ke nous somes italien, je diroie que c'est pour ii raisons, l'une ke nous somes en France, l'autre por çou que la parleure est plus delitable et plus commune à tous langages (gens)'.
► 1261 - 13 mars : traité de Nymphaeon. Gênes et Byzance font alliance. Michel VIII Paléologue octroie à Gênes des privilèges commerciaux important à Smyrne et à Constantinople (Pera et Galata) au détriment de Venise, qui perd le monopole du commerce avec la mer Noire. Michel VIII Paléologue (1224 † 1282) est un empereur byzantin du XIIIe siècle qui régna entre 1261 et 1282.
► 1261 - 25 juillet : le basileus Michel VIII Paléologue, aidé par Gênes, vainc Guillaume de Villehardouin et le despote d'Épire et entre triomphalement dans sa capitale, Constantinople (le général Alexios Stratigopoulos reprend la ville presque sans combats en l'absence de la flotte vénitienne). Michel VIII Paléologue prend Constantinople aux croisés.
Alors capitale de l'Empire latin de Constantinople fondé par les croisés, Constantinople ne résiste pas à l'armée de Michel VIII Paléologue. Après avoir subi des années de ravages et de pillages en tout genre, la cité n'est plus qu'un amas de ruines presque sans valeur. Difficile, dans ce cas, de faire retrouver à l'ancienne capitale byzantine son rayonnement et sa puissance d'autrefois. Michel VIII sera proclamé empereur et fondera la dynastie des Paléologues mais ne pourra enrayer le déclin de la ville.
► 1261 - 15 août : l'empereur byzantin Michel VIII Paléologue refonde l'Empire byzantin. Fin de l'Empire latin de Constantinople. Il renverse, emprisonne et aveugle Jean IV Lascaris, l'héritier légitime mineur et fonde la dynastie Paléologue. Les Paléologue sont une famille noble de Byzance datant du XIIe siècle qui régna sur l'Empire Byzantin et originaire de Macédoine. Jean IV Lascaris, Jean IV Doukas Lascaris fut empereur byzantin de Nicée de 1258 à 1261, né en 1250, mort en 1305, fils de Théodore II, empereur de Nicée, et d'Hélène de Bulgarie.
► 1261 - 29 août Élection du pape Urbain IV. Urbain IV, Jacques Pantaléon, devient pape sous le nom d'Urbain IV. Évêque de Verdun en 1253, puis patriarche de Jérusalem en 1255. Il est élu pape le 29 août 1261. Il est le premier pape français depuis Sylvestre II - le savant Gerbert - et Urbain II. Empêché de gagner Rome par les gibelins de Manfred, il prend délibérément le parti guelfe et offre la Couronne de Sicile à Saint Louis, qui refuse, puis à Charles d'Anjou, en faveur duquel il prêche la Croisade contre Manfred.
Manfred Ier de Sicile (vers 1232-1266), roi de Sicile en 1258, souvent désigné sous le nom de Manfred de Hohenstaufen, était le fils illégitime de l'empereur Frédéric II du Saint-Empire (empereur) et de Bianca Lancia, ou Lanzia, qui semble avoir été mariée à l'empereur juste avant sa mort. Les Guelfes tirent leur nom de l'allemand Welf, désignant la dynastie rivale des Hohenstaufen. Plus tard, lorsqu'eut lieu l'opposition entre Papauté et Empire, les partisans du pape se nommèrent naturellement "guelfes", par référence aux opposants aux Hohenstaufen en Allemagne. Le conflit fut particulièrement violent dans la ville de Florence, en Toscane, où il avait pour base la querelle entre deux familles, les Buondelmonte et les Arrighi, qui s'identifièrent vite respectivement aux Gibelins et aux Guelfes.
► 1261 Jacques de Voragine écrit Légende dorée. Jacques de Voragine, frère prêcheur, archevêque de Gênes (1298) Originaire de Varase en Italie, d'où son nom, dans la région de Savone, il entra dans l'Ordre de saint Dominique dont il devint le provincial pendant 19 ans. Devenu évêque de Gênes, il écrivit une compilation des "Légendes dorées des saints", riche d'enseignement moral mais aussi accompagnée souvent de récits étranges et légendaires. Il a été béatifié en 1816.
► 1262 - 28 mai Mariage de Philippe (futur Philippe III de France), fils de Louis IX avec Isabelle d'Aragon. Philippe III de France, dit Philippe le Hardi, né le 30 avril 1245 à Poissy, mort le 5 octobre 1285 à Perpignan, fut roi de France de 1270 à 1285, le dixième de la dynastie dite des Capétiens directs. Isabelle d'Aragon, née en 1247, morte de 28 janvier 1271 à Cosenza (Calabre), infante d'Aragon, fut, par mariage, reine de France (1270-1271).
Elle était la fille de Jacques Ier d'Aragon "le Conquérant" (v. 1207-1276), roi d'Aragon, de Valence et de Majorque, et de sa deuxième femme Yolande de Hongrie (v. 1215-1251), dite Yolande Arpad. Le 28 mai 1262 à Clermont-Ferrand, elle épousa le futur Philippe III (1245-1285), fils du roi de France Louis IX dit Saint Louis (1214-1270) et de Marguerite de Provence (1221-1295).
► 1265 Le pape Clément IV propose la couronne de Sicile à Charles d'Anjou, frère du roi de France. Charles d'Anjou, Charles Ier de Sicile, couramment appelé Charles Ier d'Anjou (mars 1227 - 7 janvier 1285) Il est le fils de Louis VIII le Lion et Blanche de Castille.
► 1265 - 5 mars Prise de Césarée par les Mamelouks. Le sultan mamelouk Baïbars qui avait pris le pouvoir en Égypte s'empare de Césarée tenue par les croisés, ce qui décide Louis IX à partir à nouveau pour une huitième croisade. Celui-ci quitte Aigues-Mortes le 2 juillet 1270. Césarée de Palestine, la ville de Césarée en Israël est située sur la côte méditerranéenne, au sud de la ville de Dor (20 km).
► 1265 à 1321 - naissance et mort de Dante à Florence dans la famille guelfe d'Alighiero, d'où son nom: Dante di Alighiero ou Dante Alighieri (Divine comédie). Poète italien. A la naissance de Dante Alighieri, Florence est sur le point de devenir la cité la plus puissante d'Italie, bien qu'elle soit rongée par des luttes intestines concernant la légitimité du pouvoir temporel du Pape. Après des études de philosophie et de théologie, Dante est élu à la charge de prieur.
Il fait partie des six hauts magistrats dirigeant la ville en 1300. Mais les partisans de l'extension du pouvoir papal l'évincent de ses fonctions et le condamnent à l'exil. S'ensuit une longue errance, à Ravenne, puis à Venise en tant qu'ambassadeur. Marié depuis l'âge de vingt ans, c'est néanmoins d'une autre femme - Béatrice - dont il est amoureux. En dépit de sa mort prématurée qui le laisse fou de douleur, elle demeure la source d'inspiration de sa poésie, et notamment de 'La divine comédie', chef-d'oeuvre qui le place aujourd'hui au rang de fondateur de la poésie italienne du Moyen Age.
► 1266 - Prise de la forteresse des Templiers à Safed par les Mamelouks. Safed, située dans le nord d'Israël à une altitude de 900 mètres au dessus du niveau de la mer.
► 1266 Brunetto Latini écrit Trésor. Brunetto Latini (Brunet Latin), naissance: Florence, 1210 - Décès: 1294. notaire et rhétoricien de Florence, rédigera le Livre du Trésor - témoignage de la tradition scientifique médiévale héritée du savoir antique (Galien, Pline l'Ancien, Aristote...) - en français. Ce poème encyclopédique fera de son auteur le premier encyclopédiste en prose de la littérature. Membre du parti guelfe, il trouvera refuge à Paris. Dante sera son élève, comme en témoigne le chant XII de l'Enfer.
► 1267 - 24 et 27 juillet : Traités de Viterbe : Charles Ier d'Anjou est reconnu par l'empereur titulaire de Constantinople pour suzerain de la Morée et du tiers des territoires à reconquérir sur Michel VIII Paléologue. Il obtient la vassalité de Guillaume de Villehardouin. La principauté de Morée passe sous la suzeraineté des Angevins de Naples. Elle recule au cours du XIVe siècle devant la reconquête byzantine partie de Mistra.
► 1267 à 1337 - naissance et mort de Giotto. Ce peintre et architecte toscan de la fin du Moyen Âge, auteur de fresques de la vie de saint François à Assise, sera l'un des précurseurs de la Renaissance. Peintre, sculpteur et architecte italien du Trecento, dont les oeuvres sont à l'origine du renouveau de la peinture occidentale. C'est l'influence de sa peinture qui va provoquer le vaste mouvement de la Renaissance à partir du siècle suivant. Giotto se rattache au courant artistique de la Pré-Renaissance, dont il est l'un des maîtres, qui se manifeste en Italie, au début du XIVe siècle.
En cette fin du Moyen Âge, Giotto est le premier artiste dont la pensée et la nouvelle vision du monde aidèrent à construire ce mouvement, l'humanisme, qui place l'homme à la place centrale de l'univers et le rend maître de son propre destin. Les fresques que Giotto a peintes à Florence (église Santa Croce de Florence), à Assise (basilique Saint-François d'Assise) et à Padoue (chapelle des Scrovegni ou chapelle Santa Maria dell'Arena dans l'église de l'Arena de Padoue) figurent parmi les sommets de l'art chrétien.
► 1268 Prise de Jaffa et Antioche par les Mamelouks. Jaffa ou Yaffo est une ville située en Israël, dont l'existence est attestée au moins depuis 3 500 ans (elle fut prise par les Égyptiens vers -1465) et qui a fusionné en 1950 avec Tel-Aviv. Antioche est une ville de Turquie proche de la frontière syrienne. Elle est située au bord du fleuve Oronte.
► 1268 Roger Bacon: opus majus; favorable à l'apprentissage des langues contre le monopole du latin et les risques de la traduction : promotion de la grammaire. Roger Bacon (1214 - 1294), surnommé le doctor mirabilis (docteur admirable) en raison de sa science prodigieuse, philosophe et alchimiste anglais, considéré comme le père de la méthode scientifique. Roger Bacon est né à Ilchester, dans le Somerset en Angleterre, en 1214. Il entra chez les Franciscains en 1240. Ayant étudié à Oxford et à Paris, il se fixa à Oxford, enseignant en particulier Aristote.
Il se livra avec ardeur à l'étude de toutes les sciences connues de son temps, surtout de la physique et acquit bientôt une instruction fort supérieure à son siècle. Quelques-uns de ses confrères, jaloux de son mérite et irrités de ce qu'il avait censuré leurs moeurs dissolues, l'accusèrent de sorcellerie : quoiqu'il eût écrit lui-même contre la magie, il fut condamné et passa dans les cachots la plus grande partie de sa longue vie. À l'avènement du pape Clément IV, qui l'avait en grande estime, il retrouva la liberté en 1265, mais après la mort de ce pape éclairé, il resta en butte à de nouvelles persécutions et fut enfermé à Paris, pendant dix ans, dans le couvent des Franciscains.
Il ne sortit de prison que peu d'années avant sa mort. On lui doit d'ingénieuses observations sur l'optique (il eût l'idée de la trichromie) et la réfraction de la lumière; une réflexion sur l'arc-en-ciel - dont il mesure l'ouverture angulaire : 42° et recense les variantes : rosée, fontaines, prismes - qui prend position pour la vision de Robert Grossetête plutôt que celle d'Ibn Al-Haytham, ainsi qu'une description de la chambre noire.
On lui a parfois attribué l'invention de la poudre à canon, celle des verres grossissants, du télescope, de la pompe à air et d'une substance combustible analogue au phosphore ; on trouve en tout cas dans ses écrits des passages où ces diverses inventions sont assez exactement décrites. Il proposa dès 1267 la réforme du calendrier, sans avoir eu connaissance des travaux antérieurs d'Omar Khayyam. Son plus grand mérite enfin est d'avoir renoncé à la méthode purement spéculative et d'avoir conseillé et pratiqué lui-même l'expérience. Cependant, il ne fut pas exempt des erreurs de son temps, et crut à l'alchimie et à l'astrologie, ou du moins le laissa-t-il penser.
► 1269 La dynastie des Mérinides. Le peuple berbère des Mérinides s'empare du pouvoir et établit sa capitale à Fès, en édifiant Fès Djedid (1276). L'empire, déjà morcelé par la reprise de l'indépendance des Hafsides de Tunisie, sera affaibli par la progression de la Reconquête espagnole. Les Mérinides se replieront finalement au Maroc et ne pourront empêcher les Portugais et les Espagnols d'envahir le littoral.
Les Mérinides ou Marinides ou Banû Marin ou Bénî Marin (1258-1465) dynastie de berbères appartenant au groupe des Zénètes (nomades originaires du bassin de la haute Moulouya), qui régna pendant deux siècles sur les diverses régions du Maroc et qui imposa temporairement son pouvoir à l'ensemble du Maghreb. À l'origine ce sont des nomades du nord Sahara. La désertification progressive de la région et l'avancée des tribus berbères Hafsides en Libye et en Tunisie les repoussèrent vers le Maroc.
► 1270 Huitième croisade. - A l'instigation de Charles d'Anjou, son frère, Louis IX prépara une nouvelle croisade (ce fut la dernière de ces expéditions). Cette fois, il allait attaquer les musulmans sur les rivages de l'Afrique, peut-être pour attirer leurs forces de ce côté, et ainsi soulager les dernières villes chrétiennes de Palestine qu'ils ne cessaient d'attaquer. Louis IX porta donc son armée près de Tunis, sur l'emplacement de l'ancienne Carthage. Il remporta d'abord quelques succès, mais la peste se mit dans son armée, lui-même fut frappé du fléau et y succomba devant Tunis (1270).
Le reste de l'armée se distingua encore par quelques faits d'armes et Philippe III qui succédait à Saint Louis la ramena en France. La huitième croisade (1270), Saint Louis était accompagné de ses 3 fils et du prince Édouard d'Angleterre; il se dirigea sur Tunis, espérant, disent quelques historiens, convertir le maître de cette ville, Mohammed Mostanser; mais, à peine arrivé sous les murs de Tunis, il fut enlevé par une maladie contagieuse. Charles d'Anjou, son frère, qui était venu le rejoindre, se mit à la tête des troupes, remporta quelques avantages et revint en France après avoir forcé Mohammed à payer les frais de la guerre.
Huitième croisade. 2 juillet 1270 : Louis IX quitte Aigues-Mortes pour la croisade. Le sultan mamelouk Baïbars qui avait pris le pouvoir en Égypte s'est emparé de Césarée, tenue par les croisés en mars 1265, ce qui décide Louis IX à partir à nouveau pour une huitième croisade. 18 juillet 1270 : Débarquement à Tunis de la huitième croisade. "Grand péché firent ceux qui lui conseillèrent la croisade, vu la grande faiblesse de son corps". C'est de Louis IX (épuisé par une dysenterie qui ne cesse pas) que parle Joinville, Louis IX qui, le 14 mars, s'est croisé à Saint-Denis. En ce jour, ce roi qui ne peut même plus tenir à cheval, débarque dans la plaine à côté de la ville de Tunis.
Mais là, au-delà du scorbut qui a déjà commencé d'atteindre ses hommes depuis leur départ d'Aigues-Mortes, c'est la peste qui est le premier ennemi du roi. 25 août 1270 : Mort de Louis IX à Tunis. "O Jérusalem ! Jérusalem ! Beau sera, Dieu, que tu aies merci de ce peuple qui ici demeure ! Qu'il ne tombe en la main de ses ennemis et ne sois pas contraint de renier ton saint nom". C'est à Tunis que Louis IX, qui va mourir, en ce 25 août, alors qu'il vient d'entamer la huitième croisade, prononce ces mots. Il murmure encore : "Mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains". Philippe III le Hardi, son fils, rapporte en France les os de son père pour les inhumer à Saint-Denis. La chair, le coeur et les entrailles du roi sont déposés par Charles d'Anjou, son frère, à l'abbaye de Monreale en Sicile.
► 1270 - 16 mars Départ de Saint Louis pour la huitième croisade.
► 1270 - 1er juillet Saint Louis quitte Aigues-Mortes en direction de Tunis. Aigues-Mortes est une commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.
► 1270 - 18 juillet Débarquement à Tunis de la huitième croisade. “Grand péché firent ceux qui lui conseillèrent la croisade, vu la grande faiblesse de son corps”. C'est de Louis IX épuisé par une dysenterie qui ne cesse pas, que parle Joinville, Louis IX qui, le 14 mars, s'est croisé à Saint-Denis. En ce jour, ce roi qui ne peut même plus tenir à cheval, débarque dans la plaine à côté de la ville de Tunis. Mais là, au-delà du scorbut qui a déjà commencé d'atteindre ses hommes depuis leur départ d'Aigues-Mortes, c'est la peste qui est le premier ennemi du roi.
► 1270 - 3 août Mort de Jean Tristan comte de Nevers, fils du roi Saint Louis, de la dysenterie, à Tunis. Jean Tristan, né à Damiette le 8 avril 1250, mort à Tunis le 3 août 1270, comte consort de Nevers (1265-1270) et de comte de Valois (1268-1270), fils de Saint Louis, roi de France et de Marguerite de Provence.
► 1270 - 25 août Mort de Saint Louis à Tunis son fils Philippe III le Hardi lui succède. “O Jérusalem ! Jérusalem ! Beau sera, Dieu, que tu aies merci de ce peuple qui ici demeure ! Qu'il ne tombe en la main de ses ennemis et ne sois pas contraint de renier ton saint nom”. C'est à Tunis que Louis IX, qui va mourir, en ce 25 août, alors qu'il vient d'entamer la huitième croisade, prononce ces mots. Il murmure encore : “Mon Dieu, je remets mon esprit entre tes mains”. Philippe III le Hardi, son fils, rapporte en France les os de son père pour les inhumer à Saint-Denis. La chair, le coeur et les entrailles du roi sont déposés par Charles d'anjou, son frère, à l'abbaye de Monreale en Sicile.
44 - De 1270 (Philippe III le Hardi) à 1300 (population mondiale 360 millions)
► 1270 PHILIPPE III le Hardi (1270-1285)
► 1270 Philippe III le Hardi. Fils de Louis IX il avait accompagné son père à la croisade où Louis IX mourut du typhus. Il est proclamé roi sous les murs de Tunis en 1270. Son frère Jean Tristan meurt également et il est lui même ainsi que son épouse Isabelle atteint. C'est son oncle Charles d'Anjou qui prend le commandement. Il conclut une trève de 10 ans avec le Calife Al-Mostancer qui fait libérer les prisonniers, assure la sécurité pour les voyageurs et les commerçants francs, permet aux missionnaires de célébrer leur culte et de prêcher ce qui ouvre la voie à une politique de rapprochement entre l'Orient et l'Occident.
De retour en Sicile, Charles d'Anjou était roi de Naples et de Sicile, Philippe voit mourir son beau frère Thibaud roi de Navarre et sur le chemin du retour, en Italie c'est Isabelle qui décède ainsi que son oncle Alphonse de Poitiers. Charles d'Anjou qui avait été fait roi de Sicile par le pape Clément IV en 1265 à la suite d'une croisade prêchée par Urbain IV contre Manfred qui s'était fait roi et qui était en hostilité avec le pape. Manfred fut tué et certains de ses partisans trouvèrent refuge auprès du roi d'Aragon, Pierre III qui avait épousé la fille de Manfred. Charles d'Anjou n'était pas populaire, il avait restreint les libertés et pressurait le peuple pour payer ses ambitions méditerranéennes.
Pierre III d'Aragon soutenait la résistance à la domination française, la révolte éclata en Sicile le 30 mars 1282 à l'heure des Vèpres, les Français furent égorgés (cette révolte prendra le nom de Vèpres Siciliennes) les Angevins durent abandonner la Sicile et Pierre III y pris le pouvoir. Le pape excommunia Pierre III et donna son royaume à Charles de Valois, fils de Philippe le Hardi. Ce dernier engagea donc la guerre contre l'Aragon mais échoua, l'armée de Philippe vaincue fait retraite à Perpignan où il mourra du paludisme le 5 octobre 1285. Pierre III d'Aragon le suivra en Novembre. Philippe III hérita de son oncle Alphonse de Poitiers du comté de Toulouse, le Poitou et l'Auvergne qu'il incorpore au domaine royal ainsi que le Perche et le comté d'Alençon hérités de son frère Pierre (1283) et les comtés de Nemours et de Chartres achetés. Par contre il cèda au pape le comtat Venaissin (région au nord est d'Avignon).
► 1270 Avènement de Philippe III le Hardi, fils de Louis IX et de Marguerite de Provence, né en 1245, proclamé roi devant Tunis. En 1271, il hérita de son oncle Alphonse de Poitiers, recueillant ainsi le Poitou, l'Auvergne et le Comté de Toulouse, qui furent incorporés au domaine royal.
► 1270 - 4 septembre Victoire des Croisés contre les armées musulmanes.
► 1270 - 20 octobre Victoire des Croisés contre les armées musulmanes.
► 1270 - 5 novembre Traité de paix avec les Hafsides mettant fin à la hui-tième croisade. Les Hafsides sont une dynastie berbère qui a commencé par être l'alliée des Almohades. Elle s'en est séparé pour devenir la dynastie régnante en Tunisie de 1230 à 1574.
► 1270 Raymond Lulle écrit 'Libro del gentile e e dei tre savi'.
► 1271 Marco Polo quitte Venise pour accomplir son extraordinaire voyage en Chine. Marco Polo était un voyageur et explorateur italien. Il est né en 1254 à Venise et est mort en 1324, également à Venise. Il est surtout connu pour son voyage en Chine, entrepris quand il avait 17 ans en compagnie de son père et de son oncle qui étaient marchands. Il y entra au service de Kubilai Khan. Il y est resté 12 ans et fut l'un des premiers occidentaux à se rendre en Extrême-Orient et à emprunter la Route de la soie. Rentré à Venise 24 ans après en être parti, il participe ensuite à la guerre avec Gênes, où il est fait prisonnier.
Les récits qu'il a fait à Rusticello de Pise, un compagnon de détention, permirent à celui-ci de rédiger le Livre des merveilles du monde, écrit en français, un ouvrage qui a par la suite inspiré notamment Christophe Colomb. Kubilai Khan, (1215–1294), mongol Xubilaï, khan mongol puis empereur de Chine, fondateur de la dynastie Yuan. Petit-fils de Gengis Khan, il est né en 1215, durant l'année de la prise de Pékin par Gengis Khan, qui la détruira complètement ; il succède à Möngke, son frère, comme grand khan des Mongols en 1260.
Il achève la conquête de la Chine en renversant les derniers empereurs de la dynastie Song en 1279. En 1280, il se proclame empereur de Chine, fondant ainsi la dynastie Yuan. Il échoue pourtant à conquérir le Japon et le Viêt Nam. En Chine, c'est un souverain éclairé. Il rénove et étend le réseau de routes, fait rebâtir les édifices publics et creuser le Grand canal. Il introduit la monnaie papier, protège les arts et se montre tolérant à l'égard des différentes religions, accueillant des prêtres nestoriens et des lamas tibétains – en revanche, il fait preuve de méfiance à l'égard du taoïsme. À sa cour, Marco Polo est un fonctionnaire important.
► 1271 - 28 janvier Mort de la reine Isabelle d'Aragon.
► 1271 mai Arrivée à Paris de Philippe III de retour de la huitième croisade.
► 1271 - 15 août Sacre de Philippe III le Hardi à Reims.
► 1271 Annexion du Comté de Toulouse. Raymond VII de Toulouse choisit alors de transiger : le bas Languedoc est annexé au domaine royal et Raymond VII de Toulouse garde le Toulousain - de même que son marquisat de Provence - mais il doit donner sa fille Jeanne en mariage à un frère de Saint Louis, Alphonse de Poitiers, le comté de Toulouse revenant au domaine royal si Jeanne meurt sans enfant. C'est ce qui se produit en 1271. Entre-temps, Alphonse aura réorganisé l'administration du comté et assaini la situation financière de villes souvent touchées par les troubles sociaux.
► 1274 - 7 mars Mort de Saint Thomas d'Aquin.
► 1274 - 21 août Mariage de Philippe III avec Marie de Brabant. Marie de Brabant, née à Louvain le 13 mai 1254, morte le 10 janvier 1321, près de Meulan, reine de France, fille du duc de Brabant Henri III le Débonnaire et de Adélaïde de Bourgogne. Ellle devint, à vingt ans, la deuxième épouse de Philippe III le Hardi, de neuf ans son aîné, le 21 août 1274, à Vincennes. Elle fut couronnée le 24 juin 1275 à la Sainte-Chapelle. Le Duché de Brabant est un ancien duché situé à cheval sur les Pays-Bas et la Belgique actuels. Son étendue couvrait l'actuelle province néerlandaise du Brabant septentrional, les actuelles provinces belges d'Anvers, du Brabant wallon, du Brabant flamand, ainsi que la région de Bruxelles.
► 1274 Première rédaction en français des 'Grandes Chroniques' de Primat de Saint-Denis. Primat de Saint-Denis, auteur, compilateur de la première version des 'Grandes Chroniques de France'. 'Les Grandes Chroniques de France', est une compilation d'oeuvres historiques élaborées remarquablement enluminé, d'après des modèles latins, entre les XIIIe et XIVe siècles. Elles retracent l'histoire des rois de France depuis leur origine jusqu'en 1461. Il s'agit d'une chronique commandée par Saint Louis, qui fait remonter l'origine des rois de France aux Troyens de l'Antiquité.
► 1275 Guerre de la vache (Wallonie) (1275-1278). La Guerre de la vache est le nom donné à une guerre qui mit à feu et à sang une soixantaine de villages du Condroz de 1275 à 1278 faisant environ 15 000 morts. Les Liégeois, Namurois, Brabançons et Luxembourgeois y étaient engagés, soutenant soit le comte de Namur, soit le prince-évêque de Liège, tous deux en dispute à cause d'une vache volée à Ciney (alors Pays de Liège) et retrouvée sur une foire à Andenne (dépendant du comté de Namur). Cet incident futile n'est en fait qu'un prétexte à vider une querelle qui met aux prises le duc de Brabant et les comtes de Namur et de Luxembourg, contre l'évêque de Liège, de qui la cité cinacienne dépend depuis l'an 1000.
► 1275 Rédaction de la suite du 'Roman de la rose' de Guillaume de Lorris par Jean de Meung. Jean de Meung, Jean de Meun ou Jean Chopinel, Jean Clopinel (v.1240 à Meung - v.1305 à Paris) est un poète français du XIIIe siècle. Il est surtout connu comme auteur de la seconde partie du 'Roman de la rose', continuation du travail de Guillaume de Lorris tout en lui donnant un ton plus proche du débat d'idées. Comme beaucoup de poète de la fin du XIIIe siècle, il écrit sur ton satirique démontrant une bonne connaissance des faiblesses de son époque. Ce ton sarcastique, devenant parfois excessif, provoque une célèbre polémique, à propos de ses positions antiféministes, lancé par Christine de Pisan dans ce qui est considéré comme une des premières querelles féministes.
► 1275 Guillaume de Moerbeke traduit en latin le corpus des commentaires d'Aristote (1275-1300). Guillaume de Moerbeke, savant dominicain, né à Moërbeka (Flandre) au XIIIe siècle, mort archevêque de Corinthe à un âge avancé. Il fut missionnaire en Orient. Il a laissé un Traité de la géomancie (Divination), qui est demeuré inédit, une traduction d'une partie des oeuvres d'Aristote et les traductions partielles de Galien et d'Hippocrate, ainsi que de plusieurs ouvrages de Proclus.
► 1276 Adam de la Halle écrit 'Le jeu de la feuillée' (1276-1277).
► 1277 Étienne Tempier condamne l'aristotélisme averroïsant. La connaissan-ce des ouvrages d'Aristote provoque une crise, dans la mesure où deux aspects de son oeuvre, la question de l'éternité du monde et le problème de l'immortalité de l'âme, sont contradictoire avec l'enseignement de l'Église. La première réaction est l'interdiction de l'enseignement de la Physique et de la Métaphysique d'Aristote (1210, 1215, 1228). Mais dès 1229 l'université de Toulouse signale que ces oeuvres seront enseignées. Les interdictions restent lettre morte, les oeuvres interdites figurent dans les programmes.
La construction thomiste semble avoir réglé le problème, mais la crise avérroïste va tout remettre en question. Dès 1270, Étienne Tempier, évêque de Paris, condamne les averroïstes, en interdisant l'enseignement de 13 propositions d'Averroès. En 1273, un statut de l'université de Paris interdit l'étude de textes théologiques dans le cadre de la faculté des arts. Enfin, en 1277, à la demande de Jean XXI, Étienne Tempier condamne 219 propositions, qui sont plutôt un amalgame de diverses "déviations".
► 1278 Exécution de Pierre de la Brosse, conseiller du roi. Marie de Brabant fut accusée par le conseiller et ministre royal Pierre de la Brosse d'avoir empoisonné Louis le fils aîné d'Isabelle d'Aragon (Louis de France). On invoqua le célèbre jugement de Dieu et un chevalier fut envoyé par le frère de Marie pour défendre la vie et l'honneur de la reine. Ce chevalier étant maître en armes, il innocenta la reine et Pierre de la Brosse fut pendu au gibet.
► 1278 Les Habsbourg prennent la tête de l'Autriche. Habsbourg, la Dynastie des Habsbourg ne régne plus sur aucun pays depuis 1918. Elle régna sur plusieurs pays d'Europe : dirigeants de l'Autriche, comme ducs 1282-1453 puis archiducs 1453-1806, souverains des Espagnes (1516-1700), du Saint-Empire romain germanique pour plusieurs siècles jusqu'en 1806, ils devinrent Empereur d'Autriche 1806-1918, roi de Hongrie et de Bohême jusqu'en 1918. Le nom Habsbourg dérive d'un lieu suisse Habichtsburg (Château des autours, bâti vers 1020 dans le canton d'Argovie), siège de la famille aux XIIe et XIIIe siècles. Depuis le sud-ouest de l'Allemagne, la famille étendit son influence vers l'est, contrôlant le Saint Empire romain germanique dès 1273, l'étendant jusqu'à l'actuelle Autriche (1278-1382).
► 1278 Rodolphe Ier du Saint-Empire cède à Nicolas III l'exarchat, la Marche d'Ancône et le duché de Spolète qui forment les contours définitifs de l'État pontifical. Rodolphe Ier du Saint-Empire, il fut roi des Romains de 1273 à sa mort. Il est le fils de Albert IV (-1240) comte de Habsbourg et de Heilwige de Kybourg (-1260). Durant son règne, il agrandit ses terres avec l'Autriche, la Styrie et la Carniole au détriment d'Ottokar II de Bohême. C'est grâce à Rodolphe Ier que les Habsbourg ont pu fonder leur puissance.
Nicolas III, de son vrai nom Giovanni Gaetano Orsini est né à Rome entre 1210 et 1220 et mort à Soriano près de Viterbe le 22 août 1280, probablement d'une attaque d'apoplexie. Il fut pape de 1277 à 1280. "Rosa composita" dans la prophétie de Saint Malachie. Il était membre de la célèbre famille Orsini. Il fut le premier pape à vivre régulièrement à Rome, où il établit la résidence pontificale. Les États pontificaux sont les États qui étaient sous l'autorité temporelle du pape. On parle aussi de patrimoine de saint Pierre. Les États pontificaux n'existent plus de facto en 1870, et sont formellement abolis par les accords de Latran en 1929.
► 1279 - 23 mai Traité d'Amiens entre Philippe III et Édouard Ier d'Angleterre. Édouard Ier d'Angleterre (17 juin 1239 – 7 juillet 1307), fut roi d'Angleterre de 1272 à 1307. Il est connu comme le conquérant du Pays de Galles et de l'Écosse.
► 1279 Début du règne de la dynastie Yuan en Chine, instituée par Koubilaï Khan (Qubilai Khan) (jusqu'en 1368). Kubilai conserve les institutions et tente de rallier les fonctionnaires chinois. La Chine entre dans une période de paix et de tolérance religieuse. En quelques décennies, l'aristocratie mongole établie en Chine assimile la civilisation chinoise. La dynastie Yuan a régné sur la Chine de 1271 à 1368. Elle fut fondée par Kubilai Khan et succède à la dynastie Song qui a régné sur la Chine entre 960 et 1279.
► 1279 Gilles de Rome (1243-1316) dédie son 'De regimine principum' à Philippe le Bel. Gilles de Rome écrit pour son élève le futur Philippe IV le Bel, petit-fils de Saint Louis, un De Regimine principum ("Du gouvernement des Princes"), où il propose le modèle d'un roi-clerc omniscient qui maîtrise une culture encyclopédique bâtie sur les arts libéraux, la théologie, la métaphysique et les sciences morales. Cet ouvrage, marqué par l'influence aristotélicienne, reflète la volonté de former une intelligentsia royale.
Il connaîtra un succès extraordinaire : copié, adapté, traduit dans plusieurs langues, il sera ensuite imprimé et réimprimé jusqu'en 1617. Gilles de Rome, surnommé doctor fundatissimus et theologorum princeps (né à Rome en 1247, mort en 1316). Disciple de Thomas d'Aquin, il enseigna avec éclat dans l'université de Paris, devint général des Augustins et archevêque de Bourges en 1295. Il fut chargé en 1278 de l'éducation de Philippe le Bel, et composa pour ce prince le traité 'De regimine principum'.
► 1280 Le philosophe juif espagnol Rashba (Rabbi Shlomo ben Adret) tranche la "question de Maïmonide" qui divise la communauté juive : les jeunes juifs doivent pratiquer le Talmud et ses commentaires autorisés de la tradition tosafiste (ceux "qui ajoutent" des commentaires au Talmud), puis après l'âge de vingt ans, sous la surveillance d'un maître, ils peuvent lire Maïmonide, voire Aristote et Averroès. En réaction avec la diffusion des idées rationalistes de Maïmonide, les Cabalistes, suivis par le petit peuple juif, propagent une doctrine mystique en faveur de la foi, de la vie intérieure, de l'adhésion de l'âme et non de l'intelligence à la croyance divine (Josef ha-Cohen de Soria, Josef Gikatila d'Aragon, Todros de Tolède, Abraham Abulafia de Tudela).
Le livre le plus célèbre est le Zohar ("Le Livre des Splendeurs") écrit en araméen tardif, anonyme, se référant à Simon bar Yohaï, maître de Méron en Haute-Galilée au début de l'ère talmudique, l'un des premiers prédicateurs de l'extase et de l'adhésion mystique. Le Zohar serait en fait l'oeuvre du castillan Mossé de León (vers 1280-1300). La Kabbale est une tradition mystique, philosophique.
Elle est présentée comme la Loi orale secrète, donnée par YHWH à Moïse sur le Mont Sinaï en même temps que la Torah (ou Loi écrite). Ashlag connu sous le nom de Baal HaSoulam, kabbaliste, et commentateur du Zohar, en donne la définition suivante : "Cette sagesse n'est ni plus ni moins que l'ordre des racines, descendant à la manière d'une cause et de sa conséquence, selon des règles fixes et déterminées, s'unissant au nom d'un but unique et exalté, décrit par le nom "révélation de Sa Divinité à Ses Créatures en ce monde" ".
Selon ses adhérents, la compréhension intime et la maîtrise de la Kabbale rapproche spirituellement l'homme de Dieu, ce qui confère à l'homme un plus grand discernement sur l'oeuvre de la Création par Dieu. Zohar, Le Sefer Ha Zohar ("Livre de la Splendeur"), aussi appelé Zohar, est un des ouvrages majeurs de la Kabbale. Rédigé en araméen par Moïse de Leon entre 1270 et 1280, il s'agit d'une exégèse ésotérique et mystique de la Torah ou Pentateuque (principalement de la Genèse) attribuée à un rabbin du IIe siècle, Shimon Bar Yochaï. L'importance de ce maître livre justifie la tendance que l'on a souvent à confondre la doctrine entière avec cette oeuvre particulière. Moïse de Leon (1240 -1305) est le nom d'un rabbin espagnol que l'on évoque souvent comme étant l'auteur ou le compilateur du Sefer HaZohar, l'ouvrage le plus important de la mystique kabbaliste juive.
► 1280 invention du canon (Chine)
► 1280 Cimabue peint 'La vierge et l'enfant'. Cimabue est un peintre italien de la pré-Renaissance. Il assure le renouvellement de la peinture byzantine en introduisant des éléments de l'art gothique, tels que le réalisme des expressions des personnages. Giotto fut son élève.
► 1280 vers - Développement de la langue juridique, particulièrement à l'écrit, est un vecteur d'unification et de standardisation de la langue française dans une scripta (diminution des traits dialectologiques indentifiables comme tels).
► 1280 vers - invention des lunettes correctrices. Les "lunettes à nez" ou "lunettes d'yeux" ont été inventées en Toscane, entre 1280 et 1285. Suite à des expériences sur la réfraction de la lumière le physicien florentin Salvino Degli Armati (1245-1317) mit au point en 1280 deux verres qui, à un certain degré de courbure grossissaient les objets. On peut logiquement lui attribuer l'invention des lunettes. (L'invention de la loupe arrive au XIe siècle).
► 1281 En 1281, une ordonnance royale permet le développement de bureaux d'écriture juridique et laïque, dont le personnel est en relation avec la cour et avec les bureaux parisiens, et est amené à éliminer les traits dialectaux des écrits. Fin XIIIème, début XIVème, le français se développe de plus en plus (par rapport au latin) dans tous les actes juridiques, comme les plaidoiries ou les jugements. A cette époque, le français de Paris est incontestablement diffusé dans l'ensemble des provinces.
Le français de Paris, c'est-à-dire celui de la cour et des parlements (au XVIIème, on considérera que c'est le seul bon). On notera qu'au XIVème siècle débute la guerre de Cent ans (1346, Crécy), entre deux rois de langue française, pour la conquête du Royaume de France. En Angleterre, le français recule, on commence à l'apprendre comme une langue étrangère. Avec Jeanne d'Arc (. 1431), la guerre prend un caractère national, et les destinées des deux pays se séparent définitivement, le règne du français se termine en Angleterre.
► 1282 Charles d'Anjou (le même qui avait provoqué la huitième croisade), régnait sur la Sicile, où ses hommes d'armes passaient pour terroriser et dépouiller la population. A l'instigation de Pierre III d'Aragon, à Palerme et dans quelques autres villes, elle se souleva en masse, le lundi de Pâques, au moment où les cloches appelaient aux vêpres, et massacra traîtreusement tous les Français qui purent être atteints: il en périt huit mille et deux seulement s'échappèrent. C'est à cette journée que l'on a donné le nom de Vêpres siciliennes. Un médecin nommé Jean de Procida avait été le principal agent de Pierre d'Aragon dans cette affaire. Pierre III d'Aragon, Pierre III le Grand (1239 - 11 novembre 1285), fut roi d'Aragon (Pierre III) et de Valence (Pierre Ier), et comte de Barcelone (Pierre II) de 1276 à 1285.
► 1282 - 30-31 mars "Vêpres Siciliennes"; révolte contre les Français en Sicile. En ce lundi de Pâques, à Palerme comme dans quelques autres villes de Sicile, les cloches sonnent pour les vêpres. Elles donnent le signal du massacre. Les 8 000 Français qui occupent l'île pour y soutenir les prétentions de Charles Ier d'Anjou (oncle du roi de France Philippe III le Hardi) au trône de Sicile sont passés au fil de l'épée par les Siciliens soutenus par Pierre III d'Aragon. Deux parviennent à s'échapper... Les Vêpres siciliennes sont un soulèvement populaire de l'île de Sicile contre la tutelle du roi français Charles d'Anjou. À la suite de ce soulèvement, le roi d'Aragon Pierre III met la main sur l'île.
► 1282 - 8 mai Charles de Valois nommé roi d'Aragon. Le pape Martin IV, qui a excommunié le roi Pierre III d'Aragon pour avoir soutenu les Siciliens, lors du massacre des Vêpres siciliennes du 30 mars 1282, lui confisque son royaume. Il donne ce dernier à Charles de Valois, fils de Philippe III le Hardi. Charles de Valois (1270 - 16 décembre 1325), fils du roi Philippe le Hardi et Isabelle d'Aragon.
Moyennement intelligent, démesurément ambitieux et passablement avide, Charles de Valois collectionne les principautés. Il eut en apanage les comtés de Valois et d'Alençon (1285). Il devint en 1290 comte d'Anjou, du Maine et du Perche, par son mariage avec Marguerite, fille aînée de Charles II d'Anjou, roi nominal de Sicile ; par un deuxième mariage, contracté avec l'héritière de Baudouin II de Courtenay, dernier roi latin de Constantinople, il avait aussi des prétentions sur ce trône. Mais il est fils, frère, beau-frère et gendre de rois ou de reines (de France, de Navarre, d'Angleterre et de Naples), en attendant d'être de surcroît, après sa mort, père de roi (Philippe VI).
► 1283 Philippe de Beaumanoir écrit Coutumes de Beauvaisis. Philippe de Beaumanoir fut comme son père bailli et écrivain, mais son oeuvre est d'une toute autre nature. Il est l'auteur d'un ouvrage juridique très célèbre écrit en 1283. "Les Coutumes de Clermont en Beauvaisis" est parmi les écrits juridiques de l'époque, le plus complet, le mieux rédigé et le plus personnel. Il est composé de 70 chapitres qui représentent plus de 1000 pages d'impression !
►1284 - 16 août Mariage du futur Philippe IV avec Jeanne de Navarre. Philippe IV de France, dit Philippe le Bel, né en 1268, mort le 29 novembre 1314 à Fontainebleau, fut roi de France de 1285 à 1314, le onzième de la dynastie dite des Capétiens directs. Jeanne de Navarre, Jeanne Ière de Navarre (née le 17 Avril 1271 à Bar-sur-Seine, Aube - morte le 4 avril 1305 à Vincennes, France), princesse de la maison de Champagne, fut reine de Navarre de 1274 à 1305 et reine de France de 1285 à 1305. Jeanne Ière était la fille du roi Henri Ier de Navarre et de Blanche d'Artois de lignée capétienne. Elle épousa, en 1284, l'héritier de la couronne de France, Philippe, qui devint le roi de Navarre Philippe Ier (1284-1305) et le roi Philippe IV le Bel (1285-1314).
► 1284 Philippe III intervient en Aragon.
► 1284 - 28 novembre Effondrement de la voûte du coeur de la cathédrale de Beauvais. La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais est un chef-d'oeuvre de l'architecture gothique. Elle est renommée pour ne pas avoir de nef -seule la première travée a été construite- et posséder le plus haut choeur gothique au monde (47 mètres). C'est après un incendie dans la "Basse Oeuvre" qu'a commencé, en 1247, la construction de la cathédrale. En 1284, les voûtes du choeur s'effondrent. À l'intérieur, les dégâts sont considérables, mais le chevet ne semble pas avoir été touché.
On décide donc de reconstruire en doublant les piliers avec d'autres, intermédiaires, moins larges. Les réparations se terminent aux alentours de 1347. La guerre de Cent Ans passe et marque une période de pause dans la construction de la cathédrale. C'est seulement 150 ans après l'édification du choeur que le transept va être construit sous la direction de Martin Chambiges. Celui-ci ne connaitra pas la fin des travaux : il meurt en 1532 le 29 août. Une fois le transept érigé (entre 1500 et 1548), on décide de construire la flèche la plus haute de toute la chrétienté.
"Nous construirons une flèche si haute, qu'une fois terminée, ceux qui la verront penseront que nous étions fous". Les travaux commencent en avril 1563 et se terminent en 1569, elle atteint alors 150m de hauteur. Le 30 avril 1573 est un jour noir dans l'histoire de la cathédrale, alors que les fidèles sortent de la célébration de l'Ascension, la flèche et les trois étages du clocher s'effondrent. La reconstuction prive la cathédrale des fonds nécessaires pour édifier la nef. La cathédrale reste depuis inachevée.
► 1284 à 1344 - naissance et mort de Simone Martini. Cet artiste peindra de nombreuses fresques. Il introduira cette discipline au sein de l'école de Sienne dont il sera l'un des maîtres. 'Sa Maesta', réalisée en 1315 pour le palais public de Sienne, constitue la plus ancienne de ces oeuvres connues à ce jour.
► 1285 Philippe le Hardi soutint la politique sicilienne de son oncle Charles d'Anjou, après les massacres des Vêpres Siciliennes en 1282, le pape excommunia Pierre III d'Aragon considéré comme l'instigateur du massacre et donna son royaume à Charles de Valois, fils de Philippe le Hardi. Philippe III engagea la croisade d'Aragon, attaqua sans succès la Catalogne (siège de Gérone du 26 juin au 7 septembre 1285), il mourut à Perpignan suite à une retraite désastreuse, causée par les épidémies et le manque de ravitaillement.
► 1285 Échec de l'opération de Philippe III en Aragon.
► 1285 - 5 octobre Mort de Philippe III à Perpignan. C'est sur la route des croisades que la malaria atteint l'armée de 20 000 cavaliers et 80 000 fantassins que le roi Philippe III le Hardi commande. Lui-même, âgé de quarante ans, trouve la mort à Perpignan. Son fils, Philippe IV le Bel, lui succède.
► 1285 PHILIPPE IV le Bel (1285-1314)
► 1285 Philippe IV le Bel monte sur le trône en 1285 et met fin à la croisade contre l'Aragon par le traité de Tarascon en 1291 donnant le royaume de Naples à la maison d'Anjou et la Sicile à l'Aragon. Le palais de la citée à Paris subit de grandes réfections. Le parlement qui avait été créé par son grand-père Saint Louis et la chambre des comptes se réuniront à Vincennes. Il s'entoure de légistes, Pierre Flote, Enguerran de Marigny, Guillaume de Nogaret. Le rôle du parlement est précisé. Philippe réunit fréquemment les trois ordres (préfiguration des états généraux) pour faire approuver sa politique. Pour Philippe le roi est le maître dans l'ordre temporel et ne peut accepter de limitations à son pouvoir et notamment il ne peut admettre la suprématie pontificale dans son domaine.
La guerre avec l'Angleterre reprend en 1293. En 1294 l'armée anglaise prend Blaye et Bayonne. Philippe joue l'atout maritime fait construire des navires et fait le blocus de l'Angleterre. L'armée du roi conquière la Guyenne, possession anglaise en 1296. La guerre se termine par le traité de Montreuil en 1299 prévoyant notamment le mariage de la soeur du roi (Marguerite de France) avec Édouard Ier d'Angleterre (le roi d'Angleterre) et celui de sa fille (Isabelle de France) avec l'héritier du trône d'Angleterre (Édouard II d'Angleterre). Cependant, la Flandre, dont le comte Guy de Dampierre est vassal du roi de France, qui commerçait principalement avec l'Angleterre était entrée dans le conflit alliée aux Anglais.
Le roi organise une expédition punitive contre le félon, les Français occupent la Flandre en 1300 mais le 18 mai 1302 une révolte les chasse de Bruges et Philippe subit une défaite écrasante à Courtrai en juillet 1302 il prendra sa revanche en 1304 à Mons-en-Pévèle et imposera la paix à la Flandre. Le traité de Paris (1303) conclu entre Édouard Ier et Philippe le Bel restitue les terres confisquées par le roi de France aux Anglais. Philippe le Bel qui entend que le pape ne lui impose pas ses vues en politique et qui veut une église de France à ses ordres (gallicanisme) entre en conflit avec le pape Boniface VIII d'autant plus que, ayant besoin d'argent il impose une taxe au clergé.
Une lutte s'ouvre le roi réunit les états généraux pour faire approuver sa politique. Il envoie de partout des messagers expliquer en quoi le pape se rend coupable. Il envoie une délégation en Italie qui, rencontrant également des ennemis du pape, arrêtent le pape à Agnani où il est gardé à résidence dans son palais. Il sera rapidement délivré mais il ne survivra pas au choc moral subit. Philippe le Bel fera élire un pape Français : Clément V, élu en 1305, est couronné à Lyon. La population de Rome étant très agitée, il s'installe à Avignon et convoque un concile à Vienne sur le Rhône en 1312.
Après ces événements, les autres papes n'interviendront plus dans les affaires intérieures des royaumes. En 1367 Urbain V quittera Avignon pour Rome, mais les troubles subsistant, il devra revenir en Avignon en 1370. Son successeur Grégoire XI effectuera un retour définitif en 1378. Les régimes d'imposition sont très anarchiques, à chaque fois que le roi à besoin d'argent, il lève un impôt plus ou moins bien organisé, souvent peu réfléchi, injuste quelques fois, ces impôts sont mal acceptés, des révoltes ont lieu, or l'organisation de l'état qui s'étoffe et les guerres, grêvent lourdement le budget royal.
Philippe à dévalué la monnaie en faisant incorporer moins d'or dans les pièces de monnaie, mais c'est une arme à double tranchant qui fait perdre la confiance des marchands et nuit au commerce. Philippe décide de prendre l'argent où il est, c'est à dire d'abord chez les marchands Juifs et les Lombards, qui alors ont tendance à quitter la France, ce qui aggrave les problèmes. Alors il décide de s'attaquer aux Templiers qui sont très riches et qui, depuis leur repli de Palestine, sont de véritables banquiers.
Ils sont accusés d'hérésie en 1312, l'ordre est supprimé par Clément V et en 1314 condamné pour hérésie. De nombreux Templiers mourront sur le bûcher dont le grand maître Jacques de Molay le 19 mars 1314. Le roi contracte la typhoïde à Fontainebleau et meurt le 29 novembre 1314. Son conseiller Guillaume de Nogaret l'avait précédé d'une année (1313) et Enguerran de Marigny le suivra l'année suivante (1315).
► 1285 Avènement de Philippe IV le Bel, fils de Philippe III de France et d'Isabelle d'Aragon, né en 1288. C'est une des personnalités les plus curieuses de la monarchie française et un des rois qui ont fait le plus pour la France, bien qu'en usant souvent de moyens critiquables. En 1284, Philippe avait épousé Jeanne de Navarre, qui lui apporta la Champagne et la Navarre, et pris le titre de roi de Navarre. La Champagne rentra de ce fait dans le domaine royal.
► 1285 - 10 novembre Mort de Pierre III d'Aragon, roi d'Aragon.
► 1285 Philippe le Bel acquiert la Champagne. Comté depuis le début du XIIe siècle, la Champagne fut réunie à la couronne de France grâce à un mariage : celui de Jeanne de Champagne avec Philippe de France, qui devint roi en 1285 sous le nom de Philippe IV le Bel. Cependant la Champagne garda son autonomie jusqu'à sa mort en 1314 et c'est son fils Louis X le Hutin qui la rattacha définitivement à la France.
► 1286 - 6 janvier Sacre de Philippe IV le Bel. Philippe est sacré à Reims avec la reine Jeanne. Bien qu'il n'ait que dix-sept ans à la mort de son père Philippe III le Hardi, il sait aussitôt s'imposer.
►1286 Guillaume Durand écrit 'Rationale divinorum officiorum'. Guillaume Durand, il fut évêque de Mende. Ce fut également un juriste, canoniste et liturgiste très renommé. Ses écrits ont servi de guide à l'application de la liturgie dans toute la chrétienté.
► 1289 - 4 octobre Naissance de Louis (futur Louis X), fils de Philippe IV. Louis X de France, dit Louis le Hutin (c'est-à-dire le Querelleur), né le 4 octobre 1289 à Paris, mort le 5 juin 1316 à Vincennes, fut roi de Navarre de 1305 à 1316 (sous le nom de Louis Ier) et roi de France de 1314 à 1316 (sous le nom de Louis X), douzième de la dynastie dite des Capétiens directs.
► 1291 Traité de Tarascon, qui met fin à la guerre entreprise par Philippe III contre l'Espagne. En vertu de ce traité, le royaume de Naples reste à la maison d'Anjou et la Sicile est attribuée à l'Aragon. Le traité de Tarascon, fut signé le 19 février 1291. Philippe IV le Bel et le pape Nicolas IV désirant empêcher la domination de l'Aragon-Catalogne sur la Sicile, mais dans l'incapacité de battre par les armes la résistance de Jacques II, roi de Sicile, entamèrent des négociations avec son frère Alphonse III d'Aragon-Catalogne qui aboutirent à la signature du traité de Tarascon entre le roi d'Aragon-Catalogne, d'une part, et Charles de Salerne et le Pape, de l'autre.
► 1291 - 18 mai Entrée des armées musulmanes à Saint-Jean-d'Acre.
► 1291 - 28 mai Chute de Saint-Jean-d'Acre
.
► 1291 - 1er août Serment du Grütli. Walter Fürst, Arnold de Melchtal et Werner Stauffacher, les représentants des trois cantons alpins, concluent un pacte de défense mutuelle contre les Habsbourg. Ce serment est considéré comme l'acte de naissance de la Confédération helvétique (Suisse). En 1315, la victoire sur Léopold Ier d'Autriche à Morgaten, renforcera la cohésion des cantons. Le Serment du Grütli est un mythe fondateur suisse.
Il se déroule sur la prairie du Grütli dominant le lac des Quatre-Cantons, et rassemble les hommes libres des vallées d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald. Cet accord entre trois communautés situées dans ce qui forme de nos jours la Suisse centrale, a été considéré jusqu'au XIXe siècle comme l'acte fondateur de la Confédération suisse. Léopold Ier du Saint-Empire (né à Vienne en 1640 - Décédé à Vienne en 1705), roi de Hongrie-Croatie, et roi de Bohême (1656), puis archiduc d'Autriche et empereur germanique (1658). Fils de Ferdinand III de Habsbourg (1608-1657) et de Marie Anne d'Espagne (1606-1646).
► 1291 Fin des royaumes croisés en Terre Sainte.
► 1292 Rixe à Bayonne entre matelots français et anglais, origine de la guerre qui éclatera peu après entre la France (alliée à l'Écosse) et l'Angleterre (alliée à la Flandre).
► 1292 Philippe IV ordonne la saisie des biens Lombards.
► 1292 Dante écrit 'La Vita Nova'.
► 1293 Au Japon, un séisme tue 30 000 personnes.
► 1293 Naissance de Philippe (futur Philippe V), second fils de Philippe IV. Philippe V de France, dit Philippe le Long, né vers 1293, mort le 3 janvier 1322 à Longchamp (Paris), fut roi de France de 1316 à 1322, le quatorzième de la dynastie dite des Capétiens directs. Il fut aussi roi de Navarre sous le nom de Philippe II.
► 1293 Naissance de Philippe (futur Philippe VI). Philippe VI de France, dit Philippe de Valois ou le "roi trouvé", (né en 1293 - mort le 22 août 1350 à Nogent-le-Roi, Eure-et-Loir), fut roi de France de 1328 à 1350, premier de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne. Il était le fils de Charles de Valois, frère cadet de Philippe IV dit Philippe le Bel, et donc cousin des trois fils de ce dernier qui se succédèrent sur le trône de France. À la mort de son cousin germain Charles IV dit Charles le Bel, en 1328, et en l'absence d'héritier mâle survivant, il fut reconnu roi de France. Cette succession, contestée par le roi d'Angleterre Édouard III d'Angleterre, lui-même petit-fils de Philippe IV le Bel par sa mère Isabelle, fut la principale cause de la guerre de Cent Ans.
► 1294 - 19 mai Début de la guerre franco-anglaise pour la Guyenne (jusqu'en 1297). Philippe le Bel prend la Gascogne (1294-1303).
► 1294 Arrivée en Chine du missionnaire franciscain Jean de Montecorvino. Parti d'Europe en 1289, il meurt à Pékin en 1330. Il reste pendant de longues années sans nouvelle de Rome à qui il réussit à faire parvenir deux lettres par des marchands occidentaux. Jean de Montecorvino (ou de Montecorvin), né en 1246 à Montecorvino dans le sud de l'Italie et mort à Beijing (Pékin) en 1328 est un Franciscain fondateur de la mission catholique de Chine.
Des "nestoriens" étaient disséminés dans toute l'Asie et en particulier en Chine. Ils n'étaient pas forcémment des disciples de Nestorius, mais des chrétiens descendants de l'Église de Perse et complètement coupés de Rome depuis des siècle. On trouvait plus particulièrement de nestoriens chez les öngüt, une ethnie turque bien représentée à la cour de Kubilaï. Pour répondre aux demandes de Kubilaï, le pape Nicolas IV envoya en mission d'abord deux dominicains qui ne dépassèrent pas l'Arménie, puis Jean de Montecorvino qui quitta Rome en 1289.
Il était accompagné de deux compagnons, le Dominicain Nicolas de Pistoia et le marchand Pierre de Lucalongo. Il navigua du Golfe Persique jusqu'en Inde où il débarqua en 1291, y prêcha pendant 13 mois et y baptisa une centaine de personnes. Il s'embarqua pour la Chine à Meliapur, sans Nicolas de Pistoia qui était mort. C'est en 1294 qu'il arrive en Chine, au port de Zaïton (Tsiuan-Tchéou) dans le Fo-kien. De là, il gagne Khanbaliq où on lui dit que Kubilaï vient de mourir. Chengzong, son fils, qui lui succède, ne fait aucun obstacle à l'apostolat missionnaire.
► 1295 Début des altérations monétaires de Philippe IV le Bel.
► 1295 Naissance de Charles (futur Charles IV), troisième fils de Philippe IV. Charles IV de France, dit Charles le Bel, né vers 1295, mort le 1er février 1328 à Vincennes, fut, de 1322 à 1328, roi de France, le quinzième et dernier de la dynastie dite des Capétiens directs, et roi de Navarre (sous le nom de Charles Ier).
► 1296 Création de la décime (taxe perçue par le roi sur les revenus du clergé).
► 1296 Bulle "Clericis Laicos" interdisant le paiement du décime sans accord du Saint-Siège.
► 1296 Formation d'une coalition autour de Édouard Ier d'Angleterre contre Philippe IV.
► 1297 à 1305 - premières hostilités de la guerre France-Angleterre, dont les faits principaux sont : les victoires remportées par les Français sur les Anglais à Furnes (1297) et à Comines (1299). Ces succès et l'intervention du pape Boniface VIII amènent les Anglais à signer la paix (traité de Montreuil, 1299). La fille de Philippe IV, Isabelle de France, fut mariée en vertu de cet arrangement au fils du roi d'Angleterre. Cependant la guerre, un moment interrompue avec la Flandre, se ralluma par suite du massacre, à Bruges, de 3 000 Français par les Flamands outrés de la déloyauté de Philippe qui, ayant attiré à Paris le comte de Flandre, Guy de Dampierre, l'y retenait prisonnier (il mourut de cette captivité en 1305).
En 1302, les Flamands infligent une sanglante défaite aux Français commandés par Robert II d'Artois (cousin de Philippe IV) à Courtrai; mais en 1304 les Français battent les Flamands à Mons-en-Pévèle. Cette guerre se termine en 1305: la Flandre française reste à la France. Robert II d'Artois, fils posthume de Robert Ier et de Mathilde de Brabant, devient comte d'Artois en 1250. Il prit part à la croisade de Tunis en 1270, et se montra un farouche combattant, voulant venger son père qui avait été tué à la précédente croisade. Sa soeur Blanche d'Artois, épouse d'Henri Ier de Navarre, mort en 1274 en laissant une fille de trois ans, se réfugia en France afin d'échapper aux luttes pour le pouvoir et la régence.
Philippe III le Hardi confia à son cousin Robert d'Artois le soin de rétablir la paix. Il assiégea et prit Pampelune et rétablit l'autorité de la reine. A la suite des Vêpres Siciliennes (1282), il se rendit en Italie pour secourir son oncle Charles Ier d'Anjou. A la mort de ce dernier, il fut nommé régent du royaume de Naples, Charles II étant prisonnier du roi d'Aragon. Mais Charles II, redevenu libre, conclut un arrangement avec le rois d'Aragon et Robert, courroucé, quitta l'Italie en 1287. Philippe IV le Bel l'envoya combattre les Anglais en Guyenne (1296), puis en Flandre. Robert battit les Flamands à Furnes en 1297, mais son fils Philippe qui combattait à ses côtés y fut gravement blessé et mourut un an après.
Robert fut tué à la bataille de Courtrai le 11 juillet 1302. La Flandre était autrefois un comté, créé en 866. Plus vaste que la Flandre belge actuelle, il était situé géographiquement plus à l'ouest (le Brabant et le Limbourg n'en faisaient pas partie). La Flandre historique s'étend sur : deux des cinq provinces flamandes de la Belgique : la Flandre occidentale (Bruges) et la Flandre orientale (Gand), plus le pays de Waes (partie de la province d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut), et quelques communes aujourd'hui rattachées à la province de Hainaut; la partie nord-ouest du département français du Nord où l'on distingue la Flandre maritime (Dunkerque), la Flandre intérieure ou Coeur de Flandre (Hazebrouck, Armentières) et la Flandre méridionale (Lille, Douai) ; aux Pays-Bas, la Flandre zélandaise, en néerlandais Zeeuws-Vlaanderen, une petite zone coincée entre l'Escaut et la Belgique, dans le sud de la province de Zélande. L'Artois, au sud, en fut détaché en 1237.
À la mort du dernier comte de Flandre, Louis de Male à Saint-Omer en 1384, le comté de Flandre cessa d'être un fief direct de la couronne de France et fut intégré aux Pays-Bas bourguignons suite au mariage de Marguerite de Male avec le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, fils cadet du roi de France Jean II le Bon. Pendant les siècles suivants, des liens de plus en plus importants se sont tissées entre les populations du comté de Flandre et des territoires néerlandophones du duché de Brabant et de la principauté de Liège. Cette évolution s'est accélérée au sein des Pays-Bas espagnols, suite à la scission des Provinces-Unies, et plus tard, après l'indépendance de la Belgique.
C'est ainsi que les provinces néerlandophones ou "flamandes" de la Belgique font aujourd'hui partie de l'entité politique et culturelle "Flandre". Parallèlement, la partie sud de l'ancien comté a été annexée par la France après le siège de Lille par Louis XIV. Elle forme aujourd'hui la partie nord-ouest du département du Nord, à laquelle il faut ajouter le reste de la Flandre française, anciennement de culture flamande, au nord de la Lys. On distinguait ainsi en France la Flandre gallicane parlant le français, et Flandre flamingante (ancienne Flandre néerlandophone), parlant le flamand.
► 1297 - 7 février Le pape Boniface VIII accorde à Philippe IV le droit d'imposer le clergé en cas de nécessité. Par cette bulle pontificale, le roi se voit conférer par le pape même le droit de lever des subsides sur le clergé sans son autorisation, en cas de nécessité urgente.
► 1297 juin Les troupes de Philippe IV le Bel entrent en Flandre.
► 1297 - 9 août Canonisation de Saint Louis par Boniface VIII qui cherche à se réconcilier avec le roi. Pour apaiser le conflit qui l'oppose au roi de France Philippe IV le Bel, le pape Boniface VIII autorise le clergé à verser le décime au roi de France, et canonise Louis IX, qui devient saint Louis. La canonisation est un rituel suivi par l'Église catholique et les Églises orthodoxes, permettant d'ajouter une personne au nombre des saints.
Canonisation. Acte par lequel un homme dont la vie fut irréprochable aux yeux de la religion chrétienne, généralement un martyr, acquiert après sa mort le statut de saint. A partir de 1170, seul le Saint-Siège a le pouvoir de canoniser un défunt. Une enquête est menée pour s'assurer de la réelle sainteté du personnage durant sa vie, qui aboutit au procès en canonisation, où des contemporains viennent témoigner de la droiture du candidat.
► 1297 - 13 août Victoire de Philippe IV à Furnes contre les troupes allemandes et flamandes. La bataille de Furnes opposa les troupes françaises aux troupes flamandes le 20 août 1297. Les Français, conduits par Robert II d'Artois, en ressortirent victorieux.
► 1298 Marco Polo dicte à Rusticien de Pise le récit de ses voyages en français.
► 1299 - 19 juin Accord de Montreuil-sur-mer entre Philippe IV le Bel et Édouard Ier d'Angleterre. Par ce traité, Philippe IV le Bel rend au roi d'Angleterre Édouard Ier la Guyenne mais conserve la ville de Bordeaux. Pour sceller leur accord, il lui offre d'épouser sa soeur Marguerite et promet le mariage de sa fille Isabelle de France avec celui qui sera le roi Édouard II d'Angleterre.
► 1300 La population mondiale atteint 360 millions.
45 - De 1300 (Formation des grands états d'Europe) à 1337
1300 - La formation des grands États d'Europe. Au Moyen Âge tardif au XIVe - XVe siècles, le développement du commerce européen se développe. Indice de vitalité économique, la monnaie pénètre toutes les activités économiques, les techniques commerciales se répandent et se complexifient. Le commerce international s'organise d'abord à partir de deux pôles: les Pays-Bas et les villes italiennes.
La guerre de Cent ans (1328-1453) a lieu entre l'Angleterre et la France. L'Italie favorise un renouveau artistique, l'art se transforme il est moins marqué par la religion. Après deux siècles d'expansion vont succéder aux XIVe et XVe siècles de crise profonde, famines, la peste, des guerres et le pillage des campagnes. C'est également la naissance des États moderne en France, au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal en Germanie et en Suisse.
► 1300 janvier Reprise des hostilités, et occupation de la Flandre par les troupes françaises.
► 1300 Le pape Boniface VIII commande à Giotto des oeuvres, aujourd'hui disparues, pour célébrer le premier jubilé. Un jubilé est une fête qui célèbre le n-ième anniversaire d'un événement qui dure dans le temps (règne, mariage, etc.). Dans l'Église catholique romaine, un jubilé est, depuis l'année 1300, une fête ayant lieu tous les 25 ans, consacrée à la pénitence. On appelle aussi ces jubilés des "années saintes". Le premier jubilé formellement organisé fut celui décrété en 1300 par le pape Boniface VIII. À cette époque, des rumeurs couraient selon lesquelles une indulgence générale était accordée tous les cent ans.
Le mot de "jubilé" était déjà dans l'air du temps. Le dominicain Humbert de Romans, dans un sermon de 1367, déclarait ainsi : "Voici maintenant le jubilé, non pas celui des Juifs mais des chrétiens, tellement meilleur". De même, dans la Chronique d'Albéric des Trois-Fontaines, le mot fut utilisé pour désigner la croisade d'Innocent III contre les Albigeois.
Le 22 février 1300, fête de la chaire de saint Pierre, Boniface VIII promulgua la bulle d'indiction Antiquorum fida relatio. Il y institua l'année sainte et précisa les conditions de l'indulgence : être en état de pénitence (après confession et absolution), avoir visité les basiliques de Rome. Les chiffres donnés par les chroniqueurs médiévaux sont extravagants : ils s'échelonnent de 200 000 personnes à deux millions. Dante nota néanmoins que la densité de la foule obligea à aménager un sens unique sur le pont Saint-Ange, près du Vatican.
► 1300 Le parti guelfe à Florence se sépare en deux factions rivales, Noirs (ultras) et Blancs (modérés). Les Blancs sont menés par la famille de Cerchi, désireuse de répondre aux aspirations du popolo, et les Noirs, alliés du pape, dirigés par Corso Donati, refusant tout compromis avec le peuple. Afin de préserver la paix dans la cité, le Conseil décide d'exiler les dirigeants des deux partis. Mais, par l'entremise du pape Boniface VIII, les chefs des Noirs peuvent regagner Florence à la fin de 1301, et s'emparer du pouvoir. Guelfes et gibelins, au Moyen Âge, les guelfes et les gibelins sont des factions qui soutenaient la papauté ou le Saint Empire romain germanique et qui s'affrontèrent en Italie aux XIIe et XIIIe siècles.
À la fin du XIIIe siècle, le parti guelfe se divise en deux factions : les blancs et les noirs. À l'origine de cette division est encore une querelle de clans, celle qui oppose les Vieri dei Cerchi (blancs) aux Donati (noirs). Cette division est également sociale, les Cerchi étant proches du peuple et les Donati de l'élite florentine. Ces derniers entendent s'opposer aux Ordonnances de Justice émises par Giano della Bella. En 1300, sur la Place de la Sainte Trinité à Florence, éclate une bataille qui marquera un clivage définitif entre les deux partis. Les Guelfes noirs, très proches de Boniface VIII vont prévaloir sur les blancs incapables de se défendre convenablement, et Charles de Valois, venu de France en appui du pape, investira Florence sans rencontrer aucune résistance. Dès janvier 1302, on commence à exiler les blancs, dont Dante Alighieri. C'est le comte de Gabrieli de Gubbio qui règne alors sur la ville.
► 1300 à 1377 - naissance et mort de Guillaume de Machaut. Célébré comme un maître et un chef de file par tous les poètes des XIVe et XVe siècles, il compose environ 400 pièces lyriques d'inspiration courtoise. Il reprend des formes anciennes, les raffine, en explore les possibles, en définit les règles, et fait leur succès. Son 'Remède de Fortune' (v. 1340), un dit narratif, contient ainsi neuf pièces lyriques qui sont considérées comme des modèles de chacun des genres. A la fin de sa vie il rédige un Prologue à ses oeuvres qui, sous la forme d'une fiction allégorique, constitue un véritable art poétique. Il écrit aussi une dizaine de dits narratifs en octosyllabes avec insertions lyriques, souvent consacrés à des débats de casuistique amoureuse où le narrateur est soit témoin soit confident soit partie.
► 1301 mai Visite de Philippe IV le Bel et Jeanne de Navarre en Flandre.
►1301 - 12 Juillet L'évêque Bernard Saisset accuse Philippe IV d'être un faux-monnayeur. Bernard Saisset est un prélat français, mort en 1314. Évêque de Pamiers, il est célèbre par ses démêlés avec Philippe le Bel. Bernard Saisset conteste haut et fort la légitimité du roi de France. Il suggère au comte de Foix et au comte de Comminges de se libérer de la tutelle capétienne. Philippe le Bel ouvre une enquête et met les biens de l'évêque sous sequestre. Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1301, Bernard Saisset est arrêté.
► 1301 - 24 octobre Arrestation de Bernard Saisset, évêque de Senlis.
► 1301 - 15 décembre Bulle Ausculta fili exigeant la libération de Bernard Saisset.
► 1301 Traité de Bruges: abandon par Albert de Habsbourg du Barrois à Philippe IV le Bel. Albert Ier de Habsbourg, né en juillet 1255, mort le 1er mai 1308, fut, duc d'Autriche et de Styrie, d'abord conjointement avec son frère Rodolphe II, de 1282 à 1283, puis seul, de 1283 à sa mort. Le Barrois fait partie de la Haute Lorraine.
► 1301 Début du différend entre Philippe IV et le pape Boniface VIII.
► 1302 Pour satisfaire aux grands besoins d'argent du Trésor, Philippe altérait les monnaies et, de plus, avait fait saisir les revenus des églises. Un évêque de Pamiers, Bernard Saisset, refusant d'obéir aux injonctions royales, Philippe le fit arrêter et prétendit le faire juger par une cour laïque. Le pape s'interposa, réclamant l'évêque comme n'étant justiciable que de lui seul. Une première bulle, lancée contre le roi, demeura sans effet; Philippe fit même emprisonner le légat du pape.
Ce dernier adressa au monarque un nouvel avertissement, la bulle Ausculta filii. Philippe voulut faire la nation entière juge du différend et pour la première fois convoqua les États généraux (trois ordres), afin de leur soumettre la bulle (dont il avait d'ailleurs eu la précaution de dénaturer le texte). Les États réunis à Paris donnèrent raison à Philippe le Bel contre Boniface VIII.
► 1302 - 12 mars Discours de Guillaume de Nogaret contre Boniface VIII devant le Conseil Royal. Guillaume de Nogaret (né vers 1260 à Saint-Félix de Lauragais - mort le 27 avril 1314) était un juriste français, originaire du Languedoc, qui devint conseiller du roi de France Philippe IV le Bel, son Garde du Sceau, et fut à partir de 1306 le véritable maître d'oeuvre de la politique royale. La part la plus importante de son action politique est peut-être l'oeuvre quotidienne pour la défense, la préservation, la définition, voire l'extension des droits du roi à l'intérieur de son propre royaume.
C'est là qu'il est, entre autres, le "légiste" du roi. Il s'y montra intransigeant et efficace, mais n'y conquit guère la popularité. On connaît davantage son rôle dans la lutte contre Boniface VIII et dans l'affaire des Templiers. Contre le pape, il infléchit la ligne politique de Flote, qui défendait contre le Saint-Siège le droit du roi à être maître dans son royaume, donc maître de son clergé ; pour Nogaret, il s'agit surtout de défendre l'Église et le royaume contre un pape indigne ; venu à la curie pour notifier à Boniface VIII un appel devant le futur concile - qui annulait toute sentence que pourrait rendre le pape contre le roi - et placer la personne du pape sous l'autorité de l'appelant, Nogaret se trouva mêlé au tumulte déclenché par une faction romaine (Anagni, 7 sept. 1303) et, par là, compromis avec les fauteurs de violence.
Le pape mort, il entretint une lutte de plus en plus vaine contre la mémoire de celui-là ; il multiplia les écrits pour se justifier, ce qui contribua à associer son nom au souvenir de l'attentat d'Anagni. Il fut implicitement inclus dans l'absolution négociée en 1311. L'affaire du Temple lui avait également servi de moyen de pression sur la papauté. Nogaret fut le premier homme d'État français qui fit appel à l'opinion publique, convoqua systématiquement des assemblées, fit répandre des pamphlets et lança une campagne de pétitions. L'offensive de 1303 contre Boniface est un modèle du genre.
Mais Nogaret demeura souvent à l'arrière-plan, faisant parler ses hommes de confiance, parmi lesquels Guillaume de Plaisians. C'est ce dernier qui harangua la foule dans les jardins du palais et qui prit part à l'interrogatoire des Templiers. Nogaret mourut alors que la prépondérance dans la gestion de la politique royale était déjà passée au très réaliste Enguerrand de Marigny.
► 1302 - 17-18 mai "Matines brugeoises" contre les troupes du gouverneur français en Flandre. Outrés par la déloyauté de Philippe le Bel qui retient prisonnier le comte de Flandre, Guy de Dampierre, les Flamands massacrent dans Bruges quelque trois mille Français. L'armée, envoyée en renfort par le roi de France, est défaite à Courtrai. Matines brugeoises, au petit matin du 18 mai 1302, à Bruges, en Flandre, des insurgés en armes pénètrent dans les maisons et abordent les occupants en leur demandant de répéter après eux : "Schild en vriend !" (Bouclier et ami !). Il est impossible à qui n'est pas natif des Flandres de prononcer correctement cette expression. C'est ainsi que les soldats de la garnison française sont démasqués les uns après les autres et assassinés au pied de leur lit.
On compte un millier de morts. Cette journée a été appelée "Matines de Bruges" (on dit aussi "Matines brugeoises") par analogie avec les "Vêpres siciliennes" qui chassèrent 20 ans plus tôt les Français de Sicile. Elle réduit à néant le rêve des rois capétiens d'annexer les Flandres. Guy de Dampierre, ou Gui, né vers 1226, mort à Compiègne le 7 mars 1305, fut proclamé Comte de Flandre en 1253 par sa mère et devint comte effectif à la mort de cette dernière en 1279 jusqu'en 1305. Il fut également comte de Namur de 1264 à 1305. Il était le second fils de Guillaume II de Dampierre et de Marguerite de Constantinople.
► 1302 - 18 mai Début de la révolte en Flandre contre l'occupation française.
► 1302 - 10 avril Les États Généraux confirme l'indépendance du roi face au pape. Philippe IV le Bel, qui est en conflit avec le pape, a fait arrêter l'évêque de Pamiers qui l'avait critiqué et l'accuse d'intelligence avec les Anglais, ses ennemis. Pour obtenir sa libération, le pape convoque un concile. Le roi de France réagit en réunissant à Notre-Dame de Paris des États généraux qui reconnaissent sa supériorité dans le domaine temporel. La France signifie ainsi au pape qu'elle ne peut admettre que le pouvoir spirituel qui est le sien empiète sur la conduite des affaires politiques.
États généraux, créés en 1302 et réunis vingt-deux fois en 487 ans, les États généraux étaient une assemblée d'exception convoquée par le roi de France soit pour connaître l'opinion de ses sujets, soit pour consolider une décision, en particulier en matière d'impôts. Elle réunissait les représentants des trois États ou Ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état. Les membres étaient élus par leurs pairs à Paris et dans les provinces. Chaque Ordre disposait d'une seule voix aux États généraux, ce qui donnait au clergé et à la noblesse - représentant à peine 2% à 4% de la population - une influence considérable : comparé à leur nombre réel, la représentativité du clergé et de la noblesse était multipliée par 30, tandis que celle du Tiers État était divisée par 3.
Les requêtes du peuple et des autorités locales et provinciales étaient exprimées sous forme de doléances inscrites dans les carnets de doléances. Tiers État, sous l'Ancien Régime, la population de la France était divisée en trois ordres : le clergé, la noblesse et le Tiers État. Le "Tiers" tire son nom de la tenue des États, assemblée représentative convoquée par le prince à partir du début du XIVe siècle en France.
Cette division en trois ordres, héritée du Moyen Âge, est supprimée lors de la Révolution française par le principe de l'Égalité. États généraux. Assemblée politique de la monarchie, réunie par le roi dans les moments critiques, notamment pour obtenir la levée d'impôts exceptionnels. Des représentants des trois ordres (noblesse, clergé, tiers état) siègent aux États généraux. Les premiers sont convoqués par Philippe le Bel en 1302, les derniers par Louis XVI en 1789.
► 1302 - 14 juin Accusations de Guillaume de Plaisians contre le pape.
► 1302 - Excommunication de Philippe IV par Boniface VIII.
► 1302 - 11 juillet : Bataille de Courtrai dite aussi bataille des Éperons d'Or : défaite de la chevalerie française devant les fantassins des communes flamandes révoltées. Défaite de la chevalerie française contre les Flamands révoltés à Courtrai. Philippe le Bel, en guerre avec la Flandre, assiste impuissant au massacre de ses chevaliers, parmi lesquels il y a Pierre Flotte, Raoul de Nesle et Robert II d'Artois, qui se sont enlisés dans les marais des environs de la ville de Courtrai. Ils sont taillés en pièces par les milices flamandes.
Une chronique artésienne rapporte : “Là, on put voir toute la noblesse de France gésir en de profonds fossés, la gueule bée et les grands destriers, les pieds amont et les chevaliers dessous”. Philippe IV le Bel n'oubliera pas cette humiliation. Deux ans plus tard, il prendra sa revanche en particulier lors de la bataille de Mons-en-Pévèle. La bataille de Courtrai opposa le roi de France aux milices communales flamandes le 11 juillet 1302, près de Courtrai, appelée également bataille des éperons d'or. L'industrie textile faisait la prospérité de la Flandre, province du nord du royaume de France. Elle utilisait la laine, essentiellement importée de Grande-Bretagne.
Les artisans tisserands et commerçants estimaient que les taxes levées par le roi Philippe le Bel pour gêner l'Angleterre étaient trop élevées. Guy de Dampierre, Comte de Flandre, qui avait pris le parti de ses tisserands, foulons et autres drapiers, a été attiré et emprisonné à Paris. Après les "Matines de Bruges" les rebelles tenaient le pays sauf deux places fortes importantes, Cassel et Courtrai.
► 1302 - 18 novembre Bulle "Unam Sanctam" du pape rappelant sa supériorité.
► 1302 États Généraux de Paris affirmant l'indépendance du roi face au pape.
► 1302 Dante Alighieri est condamné à mort par les autorités de Florence. Dante finit ses jours en exil. En 1302, alors qu'il est en mission diplomatique auprès du pape, Dante, en tant que guelfe blanc, est condamné à un exil de deux ans et à une forte amende. Comme il est dans l'impossibilité de payer celle-ci, il est condamné à mort s'il rentre à Florence, ce qui équivaut à un exil définitif.
► 1303 - 18 mars Premières Ordonnances de réforme du royaume.
► 1303 - 20 mai Traité de Paris restituant la Guyenne à l'Angleterre. Traité de Paris, entre Philippe IV le Bel et Édouard Ier d'Angleterre. La France restitue l'Aquitaine (la Guyenne), à condition que le roi d'Angleterre rende hommage pour ses possessions continentales. Le traité de Paris de 1303 est conclu entre le roi de France Philippe IV le Bel et le roi d'Angleterre Édouard Ier d'Angleterre. Il est signé à Paris le 20 mai 1303, et met un terme définitif à la guerre avec l'Angleterre, déclenchée en 1292, à la suite d'une rixe entre des marins français et anglais à Bayonne. Il confirme les dispositions arrêtées dans le traité de Montreuil, signé le 19 juin 1299, qui instaurait une trêve entre les belligérants.
► 1303 - 14 juin Les États Généraux chargent Guillaume de Nogaret d'organi-ser un concile pour juger le pape.
► 1303 Des envoyés de Philippe IV, Nogaret et Sciarra Colonna, chargés de notifier à Boniface VIII le résultat de la tenue des États généraux, insultent gravement à Anagni le souverain pontife, d'où résulte une rupture entre la France et le Saint-Siège.
► 1303 - 7 septembre Attentat d'Anagni de Guillaume de Nogaret contre Boniface VIII.
► 1303 - 9 septembre Les habitants d'Agnani libère le pape captif des Français.
► 1303 - 11 octobre Mort du pape Boniface VIII.
► 1304 - 10-11 août Victoire navale de Philippe IV contre les Flamands.
►1304 - 14-16 août Échec des négociations entre Philippe IV et les Flamands.
► 1304 - 18 août Victoire de Mons-en-Pévèle de Philippe IV contre les Flamands. En Flandre, Philippe IV le Bel est venu venger la défaite de Courtrai dont il a été humilié. Il remporte sur les Flamands la victoire de Mons-en-Pévèle.
► 1304 septembre Prise de Lille par les armées du roi de France.
► 1304 à 1374 - naissance et mort de Pétrarque. Poète et humaniste italien, Francesco Petrarqua est né à Arezzo en 1304 et mort à Arqua, près de Padoue, en 1374. Ce sont ses démêlées avec la faction des Guelfes qui pousse la famille de Pétrarque à fuir Florence pour la Provence. Elle arrive à Avignon en 1311, mais les problèmes de logement sont tels à l'époque où la présence du Pape attire une énorme population, qu'elle ne peut s'y installer et part à Carpentras.
Pétrarque effectue des études de Droit à Montpellier et à Bologne, il s'impreigne alors des textes des auteurs antiques et des poètes contemporains. En 1325, il retourne à Avignon, attiré par la cour papale, abandonne le Droit et entre dans les ordres mineurs. Il cotoya alors des personnages éminents auprès desquels sa culture faisait impression, car bien qu'il reprochait aux papes d'avoir quitté Rome, la cour l'attirait. Il rencontra aussi Laure de Noves, en 1327, qui inspira dans le coeur du poète, une passion folle et impossible, symbole de la perfection divine.
Il entra au service du Cardinal Giovanni Colonna, voyagea en Europe, écrivit, ('De viris illustribus' notamment) et lut beaucoup. Il se retire alors une première fois à Vaucluse loin des agitations et des fastes des grandes villes, pour méditer. En 1341, il est couronné poète des poètes au Capitole, à Rome -Il est à noter que Paris lui avait offert la même distinction, remerciant ainsi celui qui permettait la renaissance des lettres, la redécouverte les textes anciens oubliés et ouvrait la voie aux humanistes-. Pétrarque songe alors à se fixer en Italie mais l'agitation politique le fait retourner à Avignon. C'est à ce moment qu'il écrit le Canzoniere, plus de 300 poèmes, pour la plupart des sonnets, regroupés en Rimes et Triomphes où l'on retrouve l'amour idéal, platonique inspiré par Laure.
En 1347, Cola di Rienzo, qui avait été en exil dans la cité des Papes se fait élire Tribun. Pétrarque, partisan des gouvernements populaires et de celui de di Rienzo depuis longtemps, quitte le cardinal Colonna et part pour Rome, le soutenir. La mort de di Rienzo dans une émeute interrompt son voyage, en 1354. Pétrarque s'établit à Milan jusqu'à ce que la peste l'oblige à fuir. Il ira successivement à Venise, Padoue puis, finalement, Arqua, où il mourra en 1374.
► 1304 Dante écrit 'La divine comédie'. Les deux premières parties intitulées 'L'enfer' et 'Le purgatoire' furent divulguées de son vivant. En 1321, à peine quelques heures après avoir terminé la troisième partie, Le paradis, Dante succombe à l'âge de 56 ans des suites de la malaria à Ravenne. 'Le paradis' sera publié après sa mort.
► 1304 Le latin classique est appelé grammatica par Dante (mais aussi en vieux français: 'gramaire')
► 1305 Bertrand de Got, évêque de Bordeaux, est élu pape sous le nom de Clément V en remplacement de Boniface VIII, grâce au concours de Philippe le Bel. Clément V, Bertrand de Got naquit vers 1264 près de Villandraut en Gironde, et décéda le 20 avril 1314, à Roquemaure (Gard). Son tombeau se trouve dans l'église collégiale (qu'il avait fait bâtir) à Uzeste, en Gironde. Il fut évêque de Saint-Bertrand-de-Comminges puis archevêque de Bordeaux avant de devenir pape sous le nom de Clément V.
► 1305 - 2 avril Mort de la reine Jeanne de Navarre à Vincennes.
► 1305 - 23 juin Traité d'Athis-sur-Orge entre Philippe le Bel et Guy de Dampierre, comte de Flandre. Par le traité d'Athis-sur-Orge qu'il conclut avec le comte de Flandre (Guy de Dampierre), Philippe le Bel obtient les châtellenies de Lille, Douai et Orchies. Le traité d'Athis-sur-Orge, actuellement Athis-Mons, a été signe entre la France et la Flandre le 23 juin 1305 après la bataille de Mons-en-Pévèle. La 'paix' permettra au roi d'annexer Lille, Douai et Béthune.
► 1305 - 23 août Exécution de William Wallace. Le nationaliste écossais William Wallace est écartelé à Londres pour s'être opposé au roi d'Angleterre Édouard Ier d'Angleterre. Celui-ci annexé l'Écosse en 1296, après la mort d'Alexandre III d'Écosse sans héritier. qui avait annexé l'Écosse en 1296. La victoire du roi écossais Robert Ier d'Écosse sur les Anglais à la bataille de Bannockburn le 24 juin 1314, assurera l'indépendance de l'Écosse.
Sir William Wallace (v. 1270-1305) fut un patriote écossais qui emmena son pays contre l'invasion de l'Écosse par les Anglais (Normands) et contre le roi Édouard Ier d'Angleterre, plus connu sous le nom de Edward Longshanks ou Édouard le Sec, pendant une partie des guerres d'indépendance de l'Écosse. Il est aussi connu sous son surnom de Bruce Braveheart Wallace. Son histoire a eu des similitudes avec celle de Jeanne d'Arc ou encore de Spartacus.
► 1305 - 23 septembre Mariage du futur Louis X avec Marguerite de Bourgogne. Marguerite de Bourgogne, née en 1290, morte en 1315 est une princesse de la première branche bourguignonne de la dynastie capétienne. Elle était la fille de Robert II (1248-1306), duc de Bourgogne (1272-1306), et d'Agnès de France (1260-1325), fille du roi Louis IX.
► 1305 Giotto peint 'Lamentation sur le corps du Christ’
► 1306 - 22 juillet Expulsion des juifs du royaume, et confiscation de leurs biens.
► 1307 - 14 septembre Philippe IV décide l'arrestation des Templiers. Les caisses de l'état sont vides et les chevaliers des Templiers font montre d'une richesse ostentatoire. Il n'en faut pas plus pour que le roi Philippe le Bel mette la main sur ce “trésor”. Sous prétexte d'hérésie, il donne l'ordre en ce jour d'arrêter tous les Templiers du royaume. Leurs biens sont confisqués et l'acte d'accusation, oeuvre de Guillaume de Nogaret, est affiché sur tous les murs.
► 1307 - 13 octobre Arrestation des Templiers en France.
► 1308 24 mars États Généraux de Tours. Pour la première fois dans l'histoire de la monarchie, un roi de France convoque une assemblée formée de représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie des villes. Philippe IV le Bel veut ainsi obtenir un soutien plus large que celui que peut lui accorder un conseil. Cette assemblée annonce ce que deviendront les États généraux. États généraux de 1308, réunion des états généraux du royaume de France, convoqués par Philippe IV le Bel, à Tours. L'assemblée fut convoquée au sujet de l'abolition des Templiers.
► 1308 - 12 août Le pape Clément V accepte le principe d'un procès contre son prédécesseur.
► 1308 Édouard II d'Angleterre épouse Isabelle de France, fille de Philippe le Bel. Édouard II d'Angleterre (25 avril 1284, château de Caernarfon, Pays de Galles – 21 septembre 1327), fut roi d'Angleterre de 1307 à 1327. Il était le fils du roi Édouard Ier d'Angleterre et d'Aliénor de Castille. Isabelle de France (vers 1292 à Paris - 1358), reine d'Angleterre, était la fille du roi de France Philippe IV le Bel et de la reine Jeanne Ière de Navarre et surnommée la Louve de France pour son tempérament particulièrement violent.
► 1309 Le nouveau pape Clément V, afin de témoigner sa gratitude au roi de France (qui l'a fait élire) transporte le siège de la papauté en France, à Avignon (où il demeurera jusqu'en 1378).
► 1309 Les papes à Avignon (1309-1417). Papauté d'Avignon, l'histoire de la papauté d'Avignon débute lorsqu'après un long conclave d'un an, le français Bertrand de Got est élu pape le 20 avril 1314 sous le nom de Clément V à Pérouse. L'usage voulait à l'époque que le conclave ait lieu dans la ville où était mort le précédent pape. Le prédécesseur de Clément V, Benoît XI, était mort en exil à Pérouse.
La guerre civile à Rome empêche Clément V d'y retourner. Il doit se faire couronner à Lyon, puis s'installe à Poitiers et finalement dans la campagne autour d'Avignon qui appartenait aux États pontificaux. C'est ainsi que la papauté s'installe durablement à Avignon. Dès lors, la plupart des cardinaux nommés par le pape et ses successeurs seront français ou espagnols. Les successeurs immédiats de Clément V restent à Avignon et sont tous français.
Ce sont Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V et Grégoire XI. Urbain V prendra la décision de retourner à Rome mais la situation chaotique qu'il y trouve l'empêche de s'y maintenir. Il doit retourner en France pour arbitrer un conflit entre les Français et les Anglais et, de fait, il se réinstalle à Avignon. Il meurt très peu de temps après. Son successeur Grégoire XI décide à son tour de rentrer à Rome, ce qui met fin à la première période de la papauté d'Avignon.
Siège de la papauté en Avignon (1309-1376). En 1309, Clément V, pape français, décide d'installer le siège de la papauté en Avignon. Débute alors pour la cité une période de prospérité sans précédent. La cour pontificale accueille les poètes, les princes, les savants et les artistes européens. Après le retour du Saint-Siège à Rome (1377), deux antipapes maintiennent successivement leur fonction en Avignon. Conclave. Étymologiquement "chambre fermée à clef", le conclave est le lieu où se réunissent les cardinaux pour élire un nouveau pape.
Il a été institué en 1271 par saint Bonaventure pour mettre fin à une vacance de trois ans du Saint-Siège après le décès de Clément IV, mort en 1268. Il est stipulé que le conclave doit se réunir le 10ème jour après la mort du pape dans une pièce fermée. Chaque jour passé, les portions de repas diminuent afin d'inciter les cardinaux à faire un choix rapide.
► 1309 Jean de Joinville écrit Vie et miracles de Saint Louis. Jean de Joinville (1224 - 24 décembre 1317), noble champenois et biographe de Saint Louis.
► 1310 Procès des Templiers (1310-1314)
► 1310 - 12 mai Premières exécutions des Templiers. La chute de Saint-Jean-d'Acre avait ramené en France 2 000 templiers. Leur ordre s'avère très riche et le roi qui n'admet pas que cet ordre du Temple, fondé en 1119 par Hugues de Payns et Godefroi de Saint-Amour, puisse ne dépendre que du pape, fait arrêter un premier groupe de cinquante-quatre templiers qu'il fait supplicier et mettre à mort, après avoir obtenu des aveux invraisemblables.
Leur ordre sera supprimé par ordre du pape Clément V et leur chef, Jacques de Molay, brûlé, le 19 mars 1314. Jacques de Molay, né en 1243, fut le 23e et dernier maître de l'ordre des Templiers. Le dernier maître des Templiers s'est distingué par sa valeur au combat en Terre Sainte. Mais, en France, il se montrera piètre politique face à Philippe IV le Bel et à Enguerrand de Marigny, et il ne pourra empêcher la chute de son Ordre. Arrêté le 13 octobre 1307, en même temps que la plupart des templiers de France, il est brûlé vif sur l'île de la Cité à Paris le 11 ou 18 mars 1314 en compagnie de Geoffroy de Charnay, qui portait le titre de "précepteur de Normandie".
►1310 - 17 juin Les Templiers sont reconnus innocents à Ravenne. Ravenne est une ville d'Italie, capitale de province en Émilie-Romagne. Ravenne était un port important sous l'Empire romain et au début du Moyen Âge.
► 1310 - 1er juillet Les Templiers sont reconnus innocents à Mayence. Mayence, ville d'Allemagne, capitale et plus grande ville du Land de Rhénanie-Palatinat. Entourée de vignoble, elle est sur la rive gauche du Rhin, en face de l'embouchure du Main. C'est une ancienne cité romaine.
► 1310 - 21 octobre Les Templiers sont reconnus innocents à Salamanque. Salamanque est une ville, capitale de la Province de Salamanque en Espagne. Elle est célèbre pour son activité estudiantine. En effet, une grande université forme quelques milliers d'étudiants chaque année.
► 1311 - 16 octobre Ouverture du concile de Vienne sur les Templiers en présence de Clément V et Philippe IV le Bel.
► 1311 Apparition des premiers portulans, cartes marines donnant le tracé des côtes. Un portulan était une sorte de carte nautique servant essentiellement à repérer les ports et connaître les dangers qui pouvaient les entourer : courants, bas-fonds... Les portulans étaient grossièrement dessinés, les détails ne s'attachant qu'à ce qui avait de l'importance pour la navigation.
► 1312 Concile de Vienne, dans lequel Clément V prononce l'abolition de l'ordre des Templiers. Philippe le Bel ne réussissant toujours pas à équilibrer les finances du royaume par des expédients, songeait depuis longtemps à s'emparer des immenses richesses que les Templiers possédaient en France. Cet ordre était accusé par la rumeur publique de pratiquer, sous le couvert du catholicisme, une hérésie rapportée d'Asie, le manichéisme ; on les accusait aussi de se livrer entre eux à la sodomie.
Philippe prit acte de ces bruits pour réunir de nouveau, en 1308, les États généraux, afin de faire déclarer par eux que les Templiers, par leurs crimes, avaient mérité la mort. Armé de cette décision, Philippe ordonna la confiscation de leurs biens et exigea de Clément V (qui ne pouvait rien lui refuser) l'abolition de l'ordre, contre lequel d'autre part était ouverte une instruction qui ne pouvait pas ne pas donner les résultats que le roi en attendait. Reconnus donc coupables à tort ou à raison, un grand nombre de Templiers furent emprisonnés.
En 1310, 54 d'entre eux périrent sur le bûcher. En 1314, leur grand-maître, Jacques Molay, et les trois derniers dignitaires de l'ordre, montèrent à leur tour sur le bûcher. Le concile de Vienne, convoqué par le pape Clément V, se réunit entre octobre 1311 et mai 1312 pour discuter de l'avenir de l'Ordre du Temple. Tout commence le 13 octobre 1307 lorsque le roi de France Philippe le Bel fait arrêter lors d'un vaste coup de filet tous les Templiers du royaume.
Lors des premiers interrogatoires, ils avouent sous la torture tout ce qu'on veut leur faire avouer : reniement du Christ, crachat sur la croix, idolâtrie, sodomie. Tout cela se fait sans en référer au pape de qui ils dépendent. Clément V, surpris par les arrestations mais ébranlé par les aveux, décrète la bulle Pastoralis praeminentiae qui ordonne l'arrestation de tous les Templiers de la Chrétienté.
Seul le pape a le pouvoir de décider de leur sort. Par la bulle Faciens misericordiam du 12 août 1308, il crée des commissions diocésaines, chargées d'enquêter sur les agissements des Templiers, et des commissions pontificales, chargées de juger l'Ordre du Temple comme tel. Ces dernières livreront leurs rapports lors d'un concile oecuménique convoqué à Vienne en 1310, qui discutera de son sort.
► 13 - 3 avril Bulle pontificale Vox Clamantis mettant fin à l'ordre des Templiers.
► 1312 - 12 avril Lyon est rattaché au domaine royal. A la fin du Xe siècle, l'archevêque de Lyon s'empara du pouvoir temporel. Cette autorité, contestée par les bourgeois de Lyon en 1274, entraîna le rattachement de la ville à la France en 1312 avec création d'un consulat par Philippe le Bel.
► 1313 à 1375 - naissance et mort de Jean Boccace. Écrivain italien. Célèbre auteur du 'Décaméron' composé entre 1350 et 1353. Né en 1313 à Certaldo ou à Florence, mort le 21 décembre 1375 à Certaldo. Fils illégitime d'un marchand et d'une Française, il fit ses études de droit canon à Naples où il fut largement intégré à la cour du roi de Naples. Il y vécut une passion pour une dame qu'il surnomma Fiammetta. A la fin de l'année 1340, il rentre à Florence où il se lie d'amitié avec Pétrarque.
En 1362, il subit une profonde crise religieuse pendant laquelle il voulut même détruire tous ses manuscrits. Pétrarque l'en dissuada. Retiré à Certaldo, il vécut la fin de sa vie dans la misère. Enfin, en 1373-1374, il fut invité par la ville de Florence à faire la lecture publique de la "divine comédie" de Dante dans l'église San Stefano di Badia, ce qu'il fit jusqu'à sa mort. Si Dante est considéré comme le fondateur de la poésie italienne, Boccace est généralement admis comme le créateur de la prose italienne.
► 1314 Robert Ier d'Écosse, roi d'Écosse défait les Anglais à Bannockburn. Robert Ier d'Écosse, Robert Bruce, Robert De Brus (en normand), Roibert a Briuis (en Écossais méd.), Robert the Bruce ou Robert Bruce (en anglais moderne), né le 11 juillet 1274 et mort le 7 juin 1329), est un roi d'Écosse de 1306 à 1329, de la dynastie Bruce, fils de Robert Bruce VIIcomte de Carrick. La bataille de Bannockburn fut une écrasante victoire de l'armée écossaise menée par Robert Bruce sur les troupes anglaises menées par Édouard II d'Angleterre. Cette victoire, due à la stratégie de génie de Robert Bruce, paracheva l'indépendance du pays. Il restera indépendant jusqu'en 1603, quand Jacques VI d'Écosse, descendant de Bruce, devint à la fois roi d'Angleterre et d'Écosse sous le nom de Jacques Ier d'Angleterre.
► 1314 - 18 mars Exécution de Jacques de Molay et Hugues de Pairaud.
► 1314 On dit que Jacques Molay, en montant sur le bûcher, avait prédit à Philippe le Bel et à Clément V qu'ils ne tarderaient pas à comparaître eux-mêmes devant le Souverain Juge. Cette prédiction se réalisa la même année : les deux persécuteurs de l'ordre du Temple moururent en effet en 1314. Philippe le Bel laissait le souvenir d'un prince habile mais fourbe ; mais il a créé des institutions qui ont été heureuses pour la France ; on lui doit la réorganisation du Parlement, qu'il divisa en trois sections : le Parlement proprement dit qui était une Cour de justice, le Grand-Conseil qui était chargé de préparer les lois, et la Chambre des Comptes qui avait à s'occuper des finances du royaume.
Il établit les premières douanes et permit aux serfs, du moins dans le Midi, d'acheter leur libération à prix d'argent. Par contre, afin de remplir les coffres de l'État, il expulsa les juifs de France après avoir confisqué leurs biens, et il pressura toutes les classes de la société afin de tirer d'elles de l'argent, avec le concours des légistes (hommes de loi dont les décisions étaient censées justifier ses exactions).
Ceux-ci s'étant attiré, par leur servilité à l'égard du roi et l'iniquité de leurs sentences, l'animadversion de la population, une révolte éclata contre eux: le plus puissant, Enguerrand de Marigny, surintendant des finances, qui était peut-être le moins coupable, fut pendu en 1315 au gibet de Montfaucon. Enfin, Philippe le Bel avait agrandi par son mariage le domaine royal, et il lutta pendant tout son règne pour la consolidation des droits de la couronne (c'est-à-dire alors de l'État) à l'encontre de la noblesse et de la papauté. Philippe le Bel laissait trois fils qui lui succédèrent à tour de rôle.
► 1314 avril Adultère des belles-filles de Philippe le Bel à la tour de Nesle : leurs amants sont châtrés, écorchés vifs. Les princesses coupables sont enfermées à Château-Gaillard. Marguerite de Bourgogne est répudiée. Louis X la fera étrangler (1315). Jeanne de Bourgogne sera reprise par son mari Philippe le Long. En avril 1314, année même de la mort de Philippe le Bel, un grand scandale éclate : Marguerite de Bourgogne, épouse de Louis X déjà roi de Navarre (par sa mère, Jeanne de Champagne et de Navarre) et Blanche de Bourgogne, femme de Charles (futur Charles IV le Bel, sont dénoncées par Isabelle, fille de Philippe le Bel et reine d'Angleterre.
Elles auraient trompé leur mari sans honte avec deux frères : Philippe et Gautier d'Aunai, tous deux chevaliers de l'hôtel royal. Les deux amants sont jugés et condamnés pour crime de lèse majesté, ils sont exécutés sur le champ en place publique à Pontoise : dépecés vivants, leur sexe tranché et jeté aux chiens, ils sont finalement décapités, leurs corps traînés puis pendus par les aisselles au gibet. Une telle cruauté s'explique par l'affront fait à la famille royale, mais aussi une atteinte aux institutions du royaume : cet acte met en péril la dynastie capétienne. Les implications politiques sont si graves que le châtiment se doit d'être exemplaire. Marguerite de Bourgogne est condamnée à être tondue et est conduite dans un chariot couvert de draps noirs à Château-Gaillard.
Occupant une cellule ouverte à tous vents au sommet du donjon, elle y mourra en 1315 (certains disent qu'elle fut étranglée, ses conditions d'incarcération ne mettent pas en doute une mort d'usure...). Blanche de Bourgogne est aussi tondue mais bénéficie d'un "traitement de faveur" : elle est emprisonnée sous terre pendant sept ans, puis obtiendra l'autorisation de prendre l'habit de religieuse. Femme du cadet, et non pas du futur roi de France (du moins c'est ce que l'on croit, puisque son époux deviendra roi en 1322), Blanche a donc un traitement moins cruel que sa soeur. Quant à la troisième, Jeanne de Bourgogne, femme du futur Philippe V, elle est enfermée à Dourdan pour avoir gardé ce secret. Soutenue par sa mère Mahaut d'Artois, elle se réconciliera avec Philippe le Long. Mahaut d'Artois, née vers 1270 et morte en 1329, était une princesse de la maison capétienne d'Artois, comtesse d'Artois et paire de France.
► 1314 Louis X répudie sa femme, Marguerite de Bourgogne pour adultère, la fait emprisonner Chàteau-Gaillard.
► 1314 - 20 avril Mort du pape Clément V. Il faudra au conclave vingt-sept mois de délibération pour choisir un nouveau pape en la personne de Jean XXII, candidat du roi de France. Jamais la vacance du siège pontifical n'aura été aussi longue.
► 1314 - 29 novembre Mort de Philippe IV le Bel son fils Louis X le Hutin lui succède. Lorsqu'il monte sur le bûcher, Jacques de Molay, grand maître des Templiers, ordre dissous par Philippe le Bel lance : “Clément, juge inique et cruel bourreau, je t'ajourne à comparaître dans quarante jours, devant le tribunal du souverain juge”. Quarante jours plus tard, le pape Clément V meurt, et le 29 novembre, c'est le roi qui disparaît.
► 1314 LOUIS X le Hutin (1314-1316)
► 1314 Louis X le Hutin. Il succède à son père Philippe le Bel en 1314, il doit faire face à une puissante réaction féodale dont le chef de file est son oncle Charles de Valois. C'est une opposition à la politique de Philippe le Bel et particulièrement contre ses légistes. Un procès est intenté contre Enguérrand de Marigny, qui, abadonné de tous finira au gibet de Montfaucon. Cependant, Charles est pris de remords, il se repend et le réhabilite publiquement. Louis le Hutin (ce qui signifie le bagareur) réussit alors qu'il n'est pas encore roi, en 1312, par la négociation, le rattachement de la ville de Lyon au royaume.
Dés le printemps 1315, les hostilités qui étaient apparues contre son père renaissent, Louis réussira à calmer le jeu pacifiquement en accordant des chartes. Mais le comte de Flandre (Robert III de Flandre) refuse de prêter hommage au roi qui doit lancer une campagne contre l'opposant, il réunit les états généraux à Bourges en 1316. Des pluies dilluviennes s'abattent sur la Flandre et des torrents de boues font cesser les hostilités. Jeanne de Navarre, sa mére, est morte en 1305, Philippe le Bel, ce qui est très rare, ne s'est pas remarié, mais elle n'est plus là pour veiller à ce que la cour se comporte correctement et notamment les femmes de ses 3 fils qui font de la cour un lieu de plaisir.
Convaincu d'adultère, les trois jeunes femmes seront arrêtées elles ne subiront pas toutes le même sort, Louis X répudie Maguerite de Bourgogne en 1314, elle meurt en 1315. Remarié à Clémence de Hongrie celle-ci est enceinte lorsque le roi meurt subitement de problèmes respiratoires. C'est son frère Philippe V, le Long qui assure la régence, le fils de Louis X le Hutin, Jean Ier, nait roi le 14 novembre 1316 mais ne vit que 5 jours, son règne aura été de courte durée. Pour la première fois depuis Hugues Capet il n'y a pas d'héritier mâle direct c'est le frère de Louis, Philippe V le Long, qui sera désigné roi. Jeanne, fille de Marguerite qui sera écartée du trône en vertue de la loi salique conservera la Navarre qui avait été amenée à la couronne par sa grand mère Jeanne de Navarre épouse de Philippe le Bel.
► 1314 Avènement de Louis X le Hutin, né en 1289, fils aîné de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre. Ce surnom lui fut donné à cause de son caractère querelleur. Son court règne fut marqué par le triomphe de la réaction de la bourgeoisie contre les agissements de la noblesse, réaction dont fut victime Enguerrand de Marigny (1315). Toujours à court d'argent, comme son père dont il imita les procédés, Louis X affranchit les serfs de ses domaines moyennant finance. Une expédition militaire qu'il entreprit contre les Flamands n'eut pas de résultat. Louis X avait épousé Marguerite de Bourgogne, qu'il fit étrangler en 1315, à cause des scandales de sa conduite. II mourut en 1316.
► 1315 Création de la gabelle (impôt sur le sel). La gabelle, bien qu'il y ait localement des gabelles sur d'autres produits (comme le vin), la gabelle sert essentiellement à qualifier l'impôt sur le sel organisé au XIVe siècle. Après les guerres de religion, une compagnie unique obtient la ferme des greniers à sel de 11 généralités. Par la suite, le bail des gabelles est incorporé dans la ferme générale. Le Trésor royal prélève donc un droit fiscal et contrôle strictement, amis sans les prendre en charge, l'exploitation et la vente du sel. Gabelle. Impôt indirect sur le sel, en usage en France jusqu'en 1790.
► 1315 - 19 mars La Charte aux Normands. Suite aux différentes révoltes nées des pressions fiscales, Louis X le Hutin est contraint d'octroyer la Charte aux Normands. Cette exception rappelle la puissance de la Normandie dans les siècles qui ont précédé et sera par la suite perçue comme l'expression du particularisme normand dans l'histoire de France. Elle confère une plus grande indépendance au duché concernant ces lois et garantit l'absence d'impôts extraordinaires.
Charte aux Normands est un texte octroyé le 19 mars 1315, par le roi de France Louis le Hutin, qui fait écho à la Grande Charte des Anglais. Pour apaiser les révoltes périodiques des Normands, le roi a dû reconnaître la spécificité de la Normandie, et cette charte, ainsi que la seconde de 1339, sera considérée jusqu'en 1789 comme le symbole du particularisme normand.
► 1315 - 30 avril : Le grand argentier de Philippe le Bel, Enguerrand de Marigny, est pendu au gibet de Montfaucon sous la pression des nobles. Enguerrand de Marigny (né vers 1260 - mort le 30 avril 1315) était chambellan et ministre du roi Philippe IV le Bel. Né à Lyons-la-Forêt en Normandie, d'une vieille famille de petit baronnage appelé "Le Portier". La famille n'avait pris le nom de Marigny que vers 1200, lors du mariage d'Hugues Le Portier avec Mahaut de Marigny. La mort de Philippe le Bel, le 29 novembre 1314, fut le signal de la réaction contre sa politique. Le parti féodal, dont le roi avait essayé de limiter le pouvoir, se retourna contre ses ministres et surtout contre son chambellan. Enguerrand fut arrêté sur l'ordre de Louis X, répondant à la demande de Charles de Valois ; on porta sur lui vingt-huit articles d'accusation y compris celle d'avoir reçu des pots-de-vin.
► 1315 - 11 juillet Affranchissement des serfs du domaine royal. Comme son père Philippe IV le Bel, Louis X le Hutin ne cesse pas d'être à court d'argent. Pour remplir ses caisses, il affranchit ses serfs… moyennant finances.
► 1315 - 14 août Assassinat sur les ordres de Louis X de Marguerite de Bourgogne à Château-Gaillard. Au début de l'année 1314, Philippe IV le Bel, alors roi de France, fit arrêter ses trois belles-filles Marguerite de Bourgogne, Jeanne de Bourgogne et Blanche de Bourgogne, sur dénonciation de sa fille Isabelle d'Angleterre, selon un chroniqueur, parce qu'elles auraient été prises en flagrant délit d'adultère avec deux jeunes chevaliers, Philippe et Gautier d'Aunay.
Sous la torture, ceux-ci auraient avoué leurs relations avec les princesses, qui duraient depuis trois ans, avant d'être, à Pontoise, écorchés vifs, écartelés, châtrés, décapités, puis suspendus à un gibet. Marguerite, enfermée dans la forteresse de Château-Gaillard aurait reconnu son adultère et fut tenue au secret dans sa prison. Elle devint reine de France à la mort de son beau-père Philippe IV le Bel, survenue le 29 novembre 1314. Le 15 août 1315, elle fut retrouvée étranglée ou étouffée à l'aide de ses cheveux.
► 1315 - 19 août Louis X épouse Clémence de Hongrie. Clémence de Hongrie, (née en 1293 - morte le 12 octobre 1328 à Paris), reine de France et de Navarre, fut la fille de Charles-Martel d'Anjou, roi titulaire de Hongrie et de Clémence de Habsbourg, fille de l'empereur Rodolphe Ier.
► 1315 - 24 août Couronnement de Louis X le Hutin.
► 1315 - 15 novembre La bataille de Morgarten. Se sentant menacé par la Confédération suisse, Léopold Ier de Habsbourg tente de réaffirmer son autorité, accompagné d'une importante armée. Les confédérés n'ont cependant aucun mal à remporter la victoire à Morgarten. Cet événement consolidera le pacte signé en 1291 et permettra d'enrichir l'union avec l'adhésion des cantons de Zurich, Lucerne, Glaris, Zoug et Berne. Multipliant les défaites, les Habsbourgs finiront par reconnaître l'indépendance de la Confédération et établiront un traité de paix en 1389.
La bataille de Morgarten eut lieu le 15 novembre 1315, au sud de Zurich où quelque 1500 montagnards suisses (avec des troupes de la vallée de Dompierre-Ducry) repoussèrent les troupes (entre 3000 et 5000 soldats professionnels) du duc Léopold Ier d'Autriche, seigneur de Habsbourg. C'est l'une des rares occasions, au Moyen Âge, où des communautés paysannes réussirent à s'émanciper de leur suzerain féodal. Confirmée quelques années après le célèbre serment du Grütli (Rütli en allemand), la victoire de Morgarten renforca la cohésion des cantons alpins. Elle leur rallia les cantons environnants et surtout les villes de Zurich, Bâle et Berne.
► 1315 mort de Raymond Lulle.
► 1316 - 5 juin Mort de Louis X. Régence de Philippe V le Long frère de Louis X. Louis X le Hutin a vingt-sept ans, lorsqu'il rend son dernier soupir. Son épouse, Clémence de Hongrie, est enceinte de cinq mois. Elle accouchera le 15 novembre de la même année d'un fils, Jean Ier qui meurt quatre jours plus tard. Le frère cadet du roi défunt, Philippe de Poitiers, monte sur le trône et devient Philippe V le Long.
► 1316 - 15 novembre Naissance de Jean, fils posthume de Louis X.
► 1316 Jean Ier.
► 1316 - 20 novembre Mort de Jean Ier (4j), le régent, Philippe V le Long, devient roi.
► 1316 Jean Ier (fils de Louis X) ne règne pas (mort en bas âge). Avènement de Philippe V le Long (deuxième fils de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre) né en 1294. Louis X laissait deux enfants: Jean (Jean Ier) et Jeanne, tous deux en bas âge. Philippe V prit la régence et sur ces entrefaites, Jean mourut; Philippe V se fit reconnaître pour roi. La couronne fut réclamée au nom de Jeanne. Philippe réunit les États généraux (1317) en leur demandant de se prononcer sur l'application dans ce cas de la loi salique. (Cette loi établie par les Francs Saliens et qui se rapportait aux diverses circonstances de leur vie sociale, contenait une clause en vertu de laquelle, chez eux, les femmes étaient exclues du partage de la terre conquise.
Étant donné l'origine de la monarchie française, on pouvait regarder la loi salique comme l'un de ses fondements.) Les États généraux interprétèrent la vieille loi franque dans le sens des prétentions de Philippe, et déclarèrent les femmes incapables de succéder au trône de France. Philippe V eut à réprimer un soulèvement des pastoureaux du Midi qui, fanatisés par quelques meneurs, se croyaient appelés à entreprendre une nouvelle croisade; il persécuta les juifs, prit des mesures contre la libre circulation des lépreux qui constituaient un danger public, et amorça l'unification dans le royaume des poids et mesures. Il organisa une Cour des Comptes. Il épousa Jeanne de Bourgogne qui lui survécut de trois ans. II mourut en 1322.
► 1316 PHILIPPE V le Long (1316-1322)
► 1316 Philippe V le Long. Désigné régent à la mort de son frère Louis X, il attend la naissance de l'enfant que porte Clémence de Hongrie, ce sera un garçon mais qui ne vivra que 5 jours. Il se rend à Lyon où se tient le conclave des cardinaux qui cherchent depuis 2 ans un successeur à Clément V mort en 1314. Il fait fermer les portes du couvent des dominicains dans lequel ils sont réunis et menace de faire enlever le toit. Efficace un nouveau pape Français est élu Jean XXII. Philippe est marié à Jeanne d'Artois en 1307, ils ont cinq enfants lorsqu'éclate le scandale de l'adultère de Marguerite de Bourgogne et de Blanche d'Artois, les femmes de ses deux frères.
Jeanne est soupçonnées, enfermée à Dourdan mais réussira à faire reconnaitre son innocence qui sera proclamée par le Parlement de Paris. Sa seule faute était de ne pas avoir dénoncé sa soeur. Il se fait nommer roi et tuteur de sa nièce Jeanne de Navarre (fille de Louis X) ce qui le fait également roi de Navarre. Pour officialiser cela il réunit les états généraux en 1317 pour leur faire déclarer "Femme ne succède pas à la couronne de France" (loi salique) cette loi se retournera contre ses propres filles. Il met fin à la guerre contre la Flandre en 1320 et son règne ne sera plus troublé que par la révolte des pastouraux du midi.
Les pastoureaux étaient des bandes de paysans et de vagabonds qui avaient été créées sous Louis IX pour aller le délivrer alors prisonnier en Égypte (vers 1250) et qui dégénéra en jacquerie. Disparu on le voit réaparaitre dans la région de la Garonne et du Languedoc pour s'attaquer aux juifs. Il se consacre au renforcement de l'administration intérieure, réorganisation du conseil du roi (1318) et statut définitif de la Chambre des comptes (1320). Il développe les milices urbaines et place à leur tête des officiers royaux, règle la fabrication des monnaies et amorce l'unification des poids et mesures. Il déclare inaliénable le domaine de la couronne. Il prend des mesures sévères contre les juifs, restreint la circulation des lèpreux qu'on accusait d'empoisonner les fontaines et favorise l'inquisition dans le midi. Il meurt en 1322 sans descendant mâle, c'est son frère Charles, troisième fils de Philippe le Bel qui prendra sa succession.
► 1316 Jean Maillart écrit 'Roman du comte d'Anjou'. Ce roman du XIVe siècle se présente comme une des premières versions de Peau d'Âne. Une jeune fille y est poursuivie par le désir incestueux de son père, s'enfuit, subit calomnies et infortunes, jusqu'au châtiment des coupables et au bonheur de l'innocente. Il s'agit d'un roman de formation, où une adolescente devient adulte à travers de cruelles épreuves, y compris une condamnation à mort. Le récit a, certes, un caractère fabuleux et mythique. Mais il a aussi le dessein de servir d'exemple : l'héroïne se conforme à un modèle religieux, figure de la Vierge Marie. Elle est environnée de pauvres, qui forment un contrepoint à la richesse. Le monde courtois cache des réalités moins brillantes : la société médiévale est en pleine mutation. Un des premiers romans réalistes incarne ici ce tournant historique.
► 1317 - 9 janvier Sacre de Philippe V le Long à Reims.
► 1317 - Les Grands du royaume, confirment le principe de loi salique.
► 1319 Naissance de Jean, futur Jean II de France. Jean II de France, dit Jean le Bon, (né le 16 avril 1319 à Château de Gué-Maulin - mort à Londres le 8 avril 1364), fut roi de France de 1350 à 1364, le deuxième de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne.
► 1320 Fin de la guerre de Flandre. Bon stratège, Philippe le Long arrive à vaincre les oppositions grâce à son esprit de décision, ce qui lui permet de résoudre les problèmes flamands par la diplomatie (paix du 2 juin 1320).
► 1320 à 1391 - naissance et mort du poète persan Hafiz. Né à Shiraz aux environs de 1320, Khodja Shams-eddine Muhammad, plus connu sous le pseudonyme de Hafiz (celui qui connaît le Coran par coeur), est, avec Saadi, Firdousi et Khayyâm, un des quatre poètes unanimement reconnus en Iran. Le père de Hafiz aurait émigré d'Ispahan à Shiraz où il serait mort durant la petite enfance du poète, laissant sa famille dans la plus grande gêne. Dans un centre de civilisation islamique aussi florissant que le Shiraz de cette époque, d'humbles débuts n'étaient qu'un désavantage relatif et il est plausible qu'Hafiz ait reçu une éducation classique achevée. Ses vers portent témoignage de sa connaissance de l'arabe, des sciences islamiques et de la littérature persane.
► 1320 à 1382 - naissance et mort de Nicolas Oresme, fut évêque de Lisieux de 1377 à 1382. Ce philosophe, écrivain et érudit exerça une influence considérable sur le futur Charles V. Il fut son précepteur et conseiller. A sa demande, il traduisit Aristote. Il étudia aussi la physique et l'astronomie, préfigurant les intuitions ou démonstrations relatives à la loi de la chute des corps ou au mouvement de la terre autour du soleil.
Les idées d'Oresme en matière de politique économique ont inspiré la pensée et l'action du Dauphin, qui assura la régence pendant l'emprisonnement de Jean II le Bon, puis du roi. Le retour d'une relative stabilité monétaire sous le règne de Charles V est à mettre au crédit d'un de ceux dont le roi reconnut : "Nous avons, pour donner des conseils à la majesté royale, des hommes illustres et super-illustres, lettrés, sages et savants dont les pensées et les actions sont l'honneur du monde".
► 1321 Traité "Ars Nova" de Philippe de Vitry. Le compositeur et théoricien de la musique Philippe de Vitry écrit son traité "Ars Nova". Par l'importance des innovations qu'elle présente au XIVe siècle, cette oeuvre voit désormais son nom désigner une époque musicale. Ces innovations concernent avant tout la notation. Ars nova est une période dans la musique médiévale occidentale. Philippe de Vitry, Philippe de Vitry, évêque de Meaux, considéré par ses contemporains comme un esprit brillant, loué pour ses connaissances en mathématiques, philosophie, poésie, rhétorique et musique, fut une figure emblématique du Moyen Âge.
Bien que ses compositions musicales – hormis quelques motets – aient disparu, ses traités de musique ont pu nous parvenir. Vers 1320, il publia son fameux traité Ars Nova, dans lequel il proposait une notation musicale novatrice, utilisant des signes inconnus. Il encouragea l'emploi de nouvelles règles de composition, notamment des arrangements rythmiques novateurs, ce qui permit l'émergence d'un style polyphonique plus harmonieux et moins dépendant des contraintes de l'art liturgique, l'Ars antiqua.
► 1321 mort de Dante.
► 1322 - 3 janvier Mort de Philippe V, son frère Charles IV le Bel lui succède. Atteint de dysenterie, Philippe V succombe après cinq mois de lutte acharnée contre le mal. Sans enfant, il laisse le royaume à son frère, Charles IV le Bel.
► 1322 CHARLES IV le Bel (1322-1328)
► 1322 Charles IV le Bel. Troisième fils de Philippe le Bel, il succède à son frère Philippe V, mort sans héritier mâle. Il sera confronté à la suspicion d'adultère de Blanche (1314) mais à un degré moindre que Marguerite femme de Louis X son frère aîné, plus jeune elle aurait été entraînée. Répudiée, elle sera enfermée pendant 8 années dans Château Gaillard. Le mariage sera annulé par le pape Jean XXII (pour parenté au 4ème degré, pour adultère l'église aurait prôné le pardon) après quoi elle sera autorisée à prendre le voile, elle meurt en 1326.
Il se remarie avec Marie de Luxembourg qui n'a que 17 ans deux ans après elle meurt en mettant au monde un garçon qui ne vivra pas. Il se marie à nouveau en 1326 Jeanne d'Évreux qui lui donnera 3 filles mais lui mourra en 1328 sans héritier mâle. Charles devra faire face à nouveau à une révolte de la Flandre en 1323 qui se terminera par la paix d'Arques en 1326. Les tensions avec l'Angleterre reprennent, Charles prononce à nouveau la confiscation de la Guyenne, son oncle, Charles de Valois (frère de Philippe le Bel) commande les troupes qui la conquièrent en 1324. Un arrangement sera trouvé entre les deux rois Charles IV de France et Édouard II d'Angleterre.
Édouard II cède son titre de duc de Guyenne à son fils Édouard III d'Angleterre. En 1326 sa soeur Isabelle d'Angleterre vient se réfugier accompagnée de son fils Édouard III d'Angleterre auprès de son frère Charles IV le Bel fuyant son mari Édouard II qui préfère les hommes. Elle recontrera un autre réfugié Anglais Mortimer qui deviendra son favori et avec lequel elle parviendra à faire prononcer la déchéance de son époux (1327) qui sera assassiné peu de temps après dans son cachot de la Tour de Londres.
Son fils Édouard succèdera au roi déchu sous le nom de Édouard III. Charles étant mort sans héritier mâle, il y a trois prétendants au trône de France : le fils de Charles de Valois mort en 1325, Philippe (futur Philippe VI) qui est cousin germain des trois derniers rois de France, Philippe d'Évreux lui aussi petit fils de Philippe III le Hardi mais par les femmes et Édouard III (roi d'Angleterre) neveu de Charles IV. C'est Philippe (futur Philippe VI) qui sera choisi. La branche des Capétiens directs s'éteint et s'ouvre une nouvelle branche les Capétiens Valois. Suite à ce choix, les hostilités avec l'Angleterre qui étaient fréquentes vont redoubler de gravité, ici va commencer la guerre de cent ans.
► 1322 Avènement de Charles IV le Bel, troisième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre, né en 1294. Le seul fait vraiment intéressant de ce règne de six ans fut l'érection en duché-pairie de la baronnie de Bourbon, en faveur de Louis Ier de Bourbon, comte de Clermont, fils de Robert de France, petit-fils de Louis IX le Saint (qui devait être l'origine de la maison royale de Bourbon). Charles IV fut le dernier des Capétiens directs. Il mourut en 1328.
► 1322 - 11 février Sacre de Charles IV le Bel.
► 1322 - 21 septembre Mariage de Charles IV avec Marie de Luxembourg. Marie de Luxembourg, née vers 1305, morte le 21 mars 1324 à Issoudun, fille de l'empereur Henri VII de Luxembourg et de Marguerite de Brabant. Le mariage du roi de France Charles IV le Bel et de Blanche de Bourgogne ayant été annulé, le 19 mai 1322 par le pape Jean XXII, le roi épousa, en secondes noces, Marie de Luxembourg.
Le mariage fut célébré à Provins, le 21 septembre 1322. Marie mit au monde un premier enfant, une fille. Alors qu'elle était de nouveau enceinte, elle fut grièvement blessée dans un accident de voiture. Elle accoucha prématurément d'un fils qui mourrut quelques heures plus tard. Marie ne survécut pas à cet accident et succomba à son tour le 21 mars 1324 à l'âge de 19 ans. Elle fut inhumée à Montargis, dans l'église des dominicaines.
► 1323 Révolte des Karls en Flandre maritime (fin en 1328). Ce soulèvement, mené par les riches paysans, gagne les villes de Bruges et d'Ypres. La révolte des Karls s'explique par les récoltes médiocres de 1323, une soudure difficile, le refus de payer la dîme et l'impôt comtal, la haine envers la noblesse et l'autorité, mais surtout par l'action des paysans qui possèdent une belle exploitation et poussent à la révolte leurs chefs (Jacques Peyte, Nicholas Zannekin). Des membres de la petite noblesse les rejoignent, comme le chef de la révolte, Guillaume de Deken.
► 1323 Création de la Compagnie du Gai Savoir (future Académie des Jeux Floraux) à Toulouse: née pour défendre la tradition poétique des troubadours et la langue d'oc, elle deviendra au XVIIe siècle un agent de propagation de la langue française.
► 1324 - 21 mars Mort de Marie de Luxembourg et de son fils.
► 1324 - 1er juillet Charles IV envahit la Guyenne. Prétextant du fait qu'Édouard II n'ait pas encore rendu l'hommage pour la Guyenne, Charles IV de France décide la confiscation du duché. Les troupes royales, menées par Charles de Valois, occupent le terrain sans trop de résistance.
► 1325 - 13 juillet Mariage de Charles IV avec Jeanne d'Évreux. Jeanne d'Évreux, née vers 1307, décédée le 4 mars 1371 à Brie-Comte-Robert, reine de France, fille de Louis d'Évreux et de Marguerite d'Artois, petite-fille du roi Philippe III et de Marie de Brabant. Étant la cousine germaine du roi, elle bénéficie de la complaisance du pape français Jean XXII, qui délivre la dispense nécessaire à Charles IV, pour qu'elle puisse devenir, le 13 juillet 1325, sa troisième épouse. Elle est sacrée reine le 11 mai 1326 à la Sainte-Chapelle.
► 1325 Ibn Battuta part de Tanger pour son pèlerinage à La Mecque. Ibn Battuta, né le 24 février 1304 à Tanger (Maroc) et décédé entre 1368 et 1377 (ses dernières années restant obscures), était un voyageur marocain. Il termina sa vie au Maroc comme juge appartenant à l'école malikite. C'est le "Marco Polo" (Venise 1254-Venise 1324) de l'islam. Ibn Battuta parcourut 120 000 km en 28 ans de voyages. Ses récits sont plus précis et moins fabulateurs que ceux de Marco Polo.
► 1326 - 19 avril Traité d'Arques mettant fin à la révolte en Flandre.
► 1326 - 11 mai Couronnement de Jeanne d'Évreux.
► 1327 Le Bourbonnais est érigé en duché. Louis Ier de Bourbon (1279-1342) devient le premier duc de Bourbon. Le Bourbonnais est une province historique du centre de la France, qui correspond à l'actuel département de l'Allier, ainsi qu'à une partie du département du Cher (vers Saint-Amand-Montrond). Duché de Bourbon, province historique du centre de la France, le Bourbonnais correspondait à l'actuel département de l'Allier, ainsi qu'à une partie du département du Cher. Les Bourbon avaient conclu une alliance avec le pouvoir royal.
Ils avaient mis leurs forces au service du roi, profitant ainsi de la position géographique du Bourbonnais situé entre le domaine royal et les duchés d'Aquitaine et d'Auvergne. Cette alliance, ainsi que le mariage de Béatrix de Bourgogne et Robert de France, facilitèrent l'essor et la prospérité du Bourbonnais. En 1327, il fut d'ailleurs érigé en duché-pairie par le roi Charles le Bel.
Louis Ier de Bourbon, dit le Grand ou le Boiteux (v. 1280-1342) était un prince de sang royal français, fils aîné de Robert, comte de Clermont-en-Beauvaisis (ancêtre par les mâles du roi Henri IV) et de Béatrice de Bourgogne, dame de Bourbon. Il était donc un petit-fils de saint Louis. Louis de Bourbon fut Sire de Bourbon, comte de Clermont-en-Beauvaisis (1310), grand chambrier de France (1312), comte de la Marche et de Castres (1322), premier duc de Bourbon et pair de France (1327).
► 1327 Pétrarque (Francesco Petrarca), aperçoit une belle femme, mariée, dans l'église de Santa Clara à Avignon. Au cours de sa vie, il lui écrit 366 poèmes, l'appelant Laura pour protéger son identité. Dans l'église Sainte-Claire d'Avignon, Francesco Petrarca fait la connaissance de celle qui inspirera toute son oeuvre poétique : Laure de Noves. L'amour platonique que lui inspire la jeune femme inspirera de très nombreux poèmes dont le Canzoniere (le Chansonnier), publié en 1470.
► 1328 - 1er février Mort de Charles IV. Fin des Capétiens directs. Philippe VI petit-fils de Philippe III lui succède. Charles a trente-quatre ans lors de sa mort. Il laisse une femme sur le point d'accoucher mais c'est à une fille qu'elle donnera naissance. La dynastie des Capétiens s'éteint.
► 1328 LES VALOIS - DIRECTS.
► 1328 La maison de Valois est la branche de la dynastie Capétienne qui régna sur la France de 1328 à 1589. Elle succède aux Capétiens directs et précède les Bourbons. Elle tire son nom de l'apanage donné à Charles, fils de Philippe III le Hardi et père du roi Philippe VI. La branche aînée s'est éteinte en 1498, mais elle compte plusieurs rameaux cadets : celui des ducs d'Alençon, éteint en 1549, issus de Charles II, second fils de Charles de Valois ; celui des ducs d'Anjou, éteint en 1481, issu de Louis, second fils de Jean II le bon ; celui des ducs de Berry, éteint en 1416, issu de Jean, troisième fils de Jean II le bon ; celui des ducs de Bourgogne, éteint en 1477, issu de Philippe le hardi, quatrième fils de Jean II le bon.
Ce rameau eut lui-même deux autres sous-rameaux : les ducs de Brabant, éteint en 1430, et issu d'Antoine, fils de Philippe le Hardi ; les comtes de Nevers, éteint en 1491, et issu de Philippe, fils de Philippe le Hardi ; celui des ducs d'Orléans, éteint en 1515 après avoir accédé au trône et issu de Louis, second fils de Charles V. Ce rameau eut lui-même un autre sous-rameau : les comtes d'Angoulême, éteint en 1589 après avoir accédé au trône et issu de Jean, second fils de Louis.
Les Valois directs : Charles, comte de Valois et frère de Philippe IV le Bel. Il est le fondateur de la branche, mais n'a pas régné ; Philippe VI de Valois, son fils aîné, comte de Valois, puis roi de France (1328-1350) ; Jean II le Bon son fils (1350-1364) ; Charles V le Sage fils aîné du précédent (1364-1380) ; Charles VI le Fou fils du précédent (1380-1422) ; Charles VII le Victorieux fils du précédent (1422-1461) ; Louix XI le Prudent fils du précédent (1461-1483) ; Charles VIII l'Affable fils du précédent (1483-1498).
► 1328 PHILIPPE VI (1328-1350)
► 1328 Philippe VI de Valois. Charles IV le Bel étant mort sans héritier mâle, il y a trois prétendants au trône de France le fils de Philippe III de France, Charles de Valois mort en 1325, Philippe (futur Philippe VI) qui est cousin germain des trois derniers rois de France, Philippe d'Évreux lui aussi petit fils de Philippe III le Hardi mais par les femmes et Édouard III d'Angleterre neveu de Charles IV. C'est Philippe VI qui sera choisi. La branche des Capétiens directs s'éteint et s'ouvre une nouvelle branche les Capétiens Valois.
Suite à ce choix, les hostilités avec l'Angleterre qui étaient fréquentes vont redoubler de gravité, ici va commencer la guerre de cent ans. Depuis fort longtemps, la Flandre est spécialisée dans le filage de la laine et cette laine vient principalement d'Angleterre. C'est pour cette raison que la Flandre est souvent plus liée à l'Angleterre qu'à la France. Lorsque Édouard III décide d'arrêter les exportations de laine vers la France il sait qu'il va provoquer une nouvelle révolte de celle-ci contre le roi de France.
Philippe VI vainc les Flamands à Cassel en 1328. En 1337 il décide à nouveau la confiscation de la Guyenne. Édouard III d'Angleterre envahit la Flandre et se proclame roi de France en 1340. La flotte française subit la même année une grave défaite. Édouard débarque avec ses troupes dans le Cotentin et ravage la Normandie jusqu'à Poissy en passant par Caen. Philippe répugne au combat mais il s'y voit contraint notamment par sa chevalerie qui rêve de gloire, et de combat. Il prend donc la route mais le commandement est déplorable.
Les troupes arrivent épuisées devant l'ennemi, en forêt de Crécy, les cordes des arbalètes sont mouillées ce qui les rend inutilisables. En face, en infériorité numérique, les Anglais rompant avec les règles de la chevalerie de l'époque, gardent les chevaliers en réserve et place l'infanterie et les archers en première ligne derrière des retranchements de fortune. Lorsque les chevaliers français chargent beaucoup sont tués, c'est la débacle. La guerre de 100 ans est commencée, mal commencée.
La fine fleur de la chevalerie française, 1500 noms y laissent la vie. C'était le 26 août 1346. L'année suivante les Anglais s'emparent de Calais après un siège de 11 mois pendant lequel le roi de France ne sera pas intervenu son prestige s'en ressentira gravement. Édouard exigera que les clefs de la ville lui soient remises par 6 bourgeois en costume de pénitent. Ils obtiendront sa grace. Une terrible épidémie de peste noire s'abat sur l'Europe occidentale.
Elle arrive en France par Marseille sur une population affaiblie, depuis plusieurs années le temps est froid et humide et les récoltes mauvaises. L'emploi de mercenaires dans les armées crée une insécurité grave, mal payés ou irrégulièrement ils vivent sur l'habitant, des bandes désorganisent la production agricole, les paysans se réfugient dans les villes. La famine fait son apparition en 1315-1317, l'hygiène est inexistante la peste tue 40% de la population.
L'Angleterre n'est pas épargnée une trève est conclue en 1348. Le roi Philippe VI de Valois meurt en 1350. Malgré les vissicitudes, Philippe laisse un domaine de la couronne agrandi, d'une part, par ses propres terres, les comtés de Valois, de Chartres, d'Anjou et du Maine d'autre part par transaction avec Jeanne de Navarre et Philippe d'Évreux, la Champagne et la Brie et avec le roi de Majorque Jacques II, la seigneurerie de Montpellier.
► 1328 Règne de Philippe VI (1328-1350), cousin germain de Charles IV, début de la dynastie capétienne des Valois (1328-1589). En ce 1er avril, Jeanne d'Évreux, la femme de Charles IV qui vient de mourir le 1er février à l'âge de trente-trois ans, accouche. On espère un fils. Une fille naît. La succession au trône de France se trouve ouverte. Des trois prétendants, Philippe, comte d'Évreux, Édouard III d'Angleterre et Philippe de Valois, c'est ce dernier, l'actuel régent, qui est proclamé roi le 8 avril. Il est désormais Philippe VI.
► 1328 Avènement de Philippe VI de Valois ou le Hardi. - Charles IV ne laissait pas d'héritiers du trône. A sa mort, la couronne fut revendiquée par trois prétendants : Philippe de Valois, fils de Charles de Valois (frère de Philippe IV) et de Marguerite de Sicile (né en 1293) ; Édouard III d'Angleterre, qui était fils d'Isabelle, fille de Philippe IV ; et Philippe d'Évreux, gendre de Louis X le Hutin. Les États généraux (réduits à la réunion des pairs et des barons) furent convoqués pour se prononcer entre eux, et écartèrent Édouard III d'Angleterre et Philippe d'Évreux par application de la loi salique (ces deux prétendants ne postulant la couronne qu'en vertu du droit que pouvaient y avoir leurs femmes, nièce et petite-fille de Philippe IV).
Dès le début de son règne, Philippe VI prit fait et cause pour Louis Ier de Flandre dans le différend qui mettait celui-ci aux prises avec ses sujets, Flamands révoltés, et vainquit ces derniers à Cassel. Louis Ier de Flandre, Louis de Dampierre dit Louis de Nevers ou Louis de Crécy, (°Nevers, vers 1304 - † Crécy, 26 août 1346), comte de Flandre (Louis Ier, de 1322 à 1346), de Nevers et de de Rethel (Louis II, de 1322 à 1346), fils de Louis Ier de Dampierre, comte de Nevers, et de Jeanne, comtesse de Rethel.
► 1328 - 29 mai Sacre de Philippe VI à Reims.
► 1328 - 24 août Victoire de Cassel sur les Flamands. A l'appel du comte de Nevers, Philippe VI apporte son concours pour écraser les Flamands qui se sont révoltés contre leur suzerain. La ville prise, toute la population est passée au fil de l'épée. Les chevaliers français reviennent enrichis du butin qu'ils se sont partagé et que la vengeance du désastre de Courtrai justifie.
Bataille de Cassel s'est déroulée le 23 août 1328 à proximité de la ville de Cassel dans le nord de la France entre l'armée du roi de France Philippe VI de Valois et les milices flamandes menées par Nicolaas Zannekin, petit propriétaire foncier de Lampernisse dans la châtellenie de Furnes (Belgique actuelle). Le roi de France, Philippe VI de Valois, après son sacre à Reims, dans le but de tenter de consolider son autorité, décide de partir en guerre contre les Flamands révoltés (bourgeois de Bruges, artisans et paysans du Franc de Bruges, artisans et ouvriers de Courtrai), insurgés contre leur seigneur, le comte de Flandre Louis Ier de Flandre.
► 1328 Première rédaction des 'Leys d'amor'. 'Leys d'Amor', nom d'un des premiers ouvrages qui présentait, au début du XIVe siècle, la somme la plus complète des connaissances touchant la grammaire, la rhétorique et la poétique de la langue d'oc. Les "Leys d'Amor" faisaient déjà préssentir une sorte d'Humanisme tout de bon sens et de logique.
► 1329 à 1337 - La victoire de Cassel donnait à Philippe VI un prestige qu'il jugea suffisant pour exiger d'Édouard III d'Angleterre que celui-ci vînt lui rendre hommage comme son vassal pour la Guyenne et la Gascogne. Lié par la loi féodale, Édouard se soumit à cette exigence, en venant faire hommage à son suzerain, à Amiens; mais il prédit qu'il se vengerait de cette humiliation. En effet, il s'assura le concours du comte de Hainaut, Guillaume Ier de Hainaut, de l'empereur Louis de Bavière, du duc de Brabant et de Jacques van Artevelde, échevin de Gand et des communes de Flandre.
Puis, à l'instigation de Robert II d'Artois (beau-frère de Philippe), il réclama de nouveau le trône de France. Prévenu de la naissance de cette coalition, Philippe crut bon de prendre les devants en faisant saisir quelques places en Guyenne et en Flandre. Ce furent les premiers faits de guerre de la longue période qui devait être appelée guerre de Cent ans (1337-1453). Rappelons que les causes lointaines de ce long conflit furent: la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant; le divorce de Louis VII avec Aliénor d'Aquitaine (ou de Guyenne) qui épousa ensuite Henri Plantagenêt (futur roi d'Angleterre Henri II d'Angleterre) et lui apporta en dot une grande partie de la France; enfin, en tout dernier lieu, les prétentions d'Édouard III d'Angleterre à la couronne de France.
La province de Hainaut, couramment appelée le Hainaut, est une province du sud-ouest de la Belgique qui a pour chef-lieu Mons. Elle se situe en Wallonie dont elle en constitue la partie la plus importante en population. Louis IV de Bavière (v.1286-1347), empereur allemand de 1314 à 1347. Fils de Louis II le Sévère, duc de Bavière et de Mathilde de Habsbourg. Le Duché de Brabant est un ancien duché situé à cheval sur les Pays-Bas et la Belgique actuels. Son étendue couvrait l'actuelle province néerlandaise du Brabant septentrional, les actuelles provinces belges d'Anvers, du Brabant wallon, du Brabant flamand, ainsi que la région de Bruxelles.
Un échevin, en Belgique, est un élu adjoint au bourgmestre. Les tâches des échevins varient en fonction des communes. Une commune aura ainsi par exemple un échevin des travaux publics, un échevin de l'enseignement, etc. Ils sont élus par le conseil communal en son sein. leur nombre varie en fonction de la population de la commune (entre 2 et 10). Robert III d'Artois, né en 1287, seigneur de Domfront, reçoit en 1310 le comté de Beaumont-le-Roger en dédommagement du comté d'Artois auquel il prétendait.
Il est le fils du Capétien Philippe d'Artois, seigneur de Conches-en-Ouche et de la Capétienne Blanche, fille du duc Jean II de Bretagne. La mort prématurée de son père Philippe d'Artois va écarter Robert III de la succession du comté d'Artois. À la mort de Robert II, le grand-père de Robert III, c'est sa fille Mahaut d'Artois qui prend possession de l'héritage, et le jeune Robert III ne peut songer à faire valoir une représentation des droits de son père qu'ignore la coutume d'Artois. La rancoeur et les intrigues entre Mahaut d'Artois (appelée parfois Mathilde) et Robert vont émailler toute la période et finir par mettre le feu aux poudres entre la France et l'Angleterre et déboucher sur la guerre de Cent Ans.
► 1329 - 6 juin Édouard III d'Angleterre rend hommage à Philippe VI pour la Guyenne.
► 1332 - 28 juillet Mariage du futur Jean II avec Bonne de Luxembourg. Bonne de Luxembourg, née le 20 mai 1315, morte le 11 septembre 1349 à l'abbaye de Maubuisson, fut l'épouse de Jean II dit le Bon. Fille de Jean Ier l'Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Bohême, et d'Élisabeth de Bohême, elle épouse le dauphin Jean le 28 juillet 1332 à Melun.
► 1333 Simone Martini écrit Portement de la croix.
► 1335 Construction du premier palais pontifical d'Avignon, le palais des papes, par Benoît XII. Benoît XII, Jacques de Novelles, dit Fournier (vers 1285-1342), issu d'une famille modeste du comté de Foix devient pape sous le nom de Benoît XII. Élu pape le 20 décembre 1334 à la mort de Jean XXII, il entreprend de vastes réformes. Il assainit le système de collation des bénéfices et sa conséquence, la fiscalité pontificale. Il rétablit dans plusieurs ordres religieux les bases de la discipline ecclésiastique et favorise les universités (Toulouse, 1337; Grenoble, 1339).
Image par Hans Braxmeier de Pixabay
En vue d'une éventuelle croisade, il oeuvre pour la paix entre les royaumes chrétiens, notamment entre la France et l'Angleterre, et tente une reconciliation avec l'empereur excommunié Louis de Bavière. Tenté de gagner Rome en 1335, il s'accommode en définitive de demeurer à Avignon et construit le premier palais pontifical, dont l'austérité architecturale est un bon reflet de sa personnalité.
Il ne refuse cependant pas un certain décor, et c'est lui qui fait appel au peintre siennois Simone Martini. Le Palais des papes, à Avignon en France, est la plus grande des constructions gothiques du Moyen Âge du monde. Avignon devient la résidence des papes en 1309, et le palais est construit entre 1335 et 1352 sur une protubérance rocheuse au nord de la ville, surplombant le Rhône, sous les pontificats de Benoît XII et Clément VI.
► 1337 - 24 mai Philippe VI confisque le duché de Guyenne à Édouard III d'Angleterre. La Guyenne est une possession anglaise. La victoire remportée à Cassel confère à Philippe VI un prestige qui lui permet d'exiger d'Édouard III d'Angleterre qu'il devienne son vassal. L'anglais se soumet. Humilié, il se venge en formant une coalition. Il est condamné par défaut et son fief est saisi. Cette saisie provoque la guerre de Cent Ans.
► 1337 - 7 octobre Édouard III d'Angleterre revendique le trône de France.
► 1337 - 1er novembre Lettre de défi d'Édouard III d'Angleterre.
46 - De 1337 (début de la guerre de Cent ans) à 1359
► 1337 - 1er novembre Lettre de défi d'Édouard III d'Angleterre.
► 1337 Début de la guerre de Cent Ans.
► 1337 à 1453 - Guerre de Cent ans. La guerre de Cent ans n'a pas con-sisté en une suite ininterrompue de batailles; elle a été une longue série d'actes hostiles de part et d'autre, entre lesquels s'écoulent des pauses plus ou moins longues de paix armée. On la divise en quatre périodes: la première est malheureuse pour la France (Philippe VI et Jean le Bon); la deuxième est marquée par les succès des Français (Charles V); la troisième voit revenir, pour les Français, les revers de toute sorte: la France est à moitié conquise par les Anglais (Charles VI); la quatrième et dernière est la période de revanche glorieuse dont Jeanne d'Arc est le plus éclatant personnage (Charles VII).
La guerre de Cent ans, en réalité de cent seize ans, se termine par les victoires françaises de Formigny en 1450 et de Castillon en 1453, par lesquelles les Anglais sont définitivement expulsés de France. La guerre de Cent Ans décrit la période de 116 ans (1337 à 1453) pendant laquelle s'affrontent la France et l'Angleterre lors de nombreux conflits, entrecoupés de trêves plus ou moins longues. La guerre commence lorsque Édouard III d'Angleterre envoie un défi (déclaration de guerre) au roi de France Philippe VI de Valois.
Le traité de paix définitif qui en marque la fin est signé le 29 août 1475 à Picquigny, en Picardie. Il a débouché sur la constitution de deux nations européennes indépendantes : la France et l'Angleterre qui, jusqu'alors, étaient imbriquées légalement et culturellement et étaient en lutte pour le contrôle territorial de l'Ouest de la France. Pour le contrôle de ce territoire, les Plantagenêts (dynastie royale anglaise) et les Capétiens avaient déjà lutté près de 140 ans, entre 1160 et 1299. Cette première période avait vu évoluer les deux royaumes d'une organisation féodale très morcelée à une structure d'État centralisé.
Le problème posé par le duché de Guyenne n'ayant pas été résolu, (le roi d'Angleterre étant théoriquement vassal du roi de France en tant que duc d'Aquitaine) à la fin du dernier conflit, est largement à l'origine du déclenchement des hostilités. Guerre de Cent Ans (1337-1453). En 1337, Philippe VI prononce la saisie de la Guyenne (Aquitaine). Cette dernière est une possession anglaise. La victoire remportée à Cassel lui confère un prestige qui lui permet d'exiger d'Édouard III d'Angleterre qu'il devienne son vassal. L'Anglais se soumet. Humilié, il se venge en formant une coalition. Il est condamné par défaut et son fief est saisi.
Cette saisie provoque la guerre de Cent Ans. La France, en mauvaise posture au début, perd plusieurs batailles (L'Écluse, Crécy) et les villes de Calais (1347) et de Poitiers (1356). Cependant, un regain intervient sous Charles V où elle récupère la plupart des possessions anglaises, hormis Calais, Bordeaux et Cherbourg. L'affaiblissement intérieur et militaire des deux pays provoque une trêve jusqu'au début du XVe siècle. En 1415, Henri V d'Angleterre allié à Jean sans Peur remporte la bataille d'Azincourt et contraint ses rivaux à le reconnaître par le traité de Troyes (1420) roi de France et d'Angleterre.
C'est à ce moment qu'intervient Jeanne d'Arc. Grâce à ses victoires sur les Anglais, elle fait renaître l'espoir des troupes françaises et parvient à faire couronner Charles VII à Reims. La France souveraine à nouveau, malgré la mort sur le bûcher de la "pucelle d'Orléans" (1431), regagne patiemment du terrain sur les Anglais, qui ne possèdent plus, en 1453, que la ville de Calais. Le traité de paix entre Louis XI et Édouard IV d'Angleterre sera signé en 1475 à Picquigny.
► 1338 décembre Les Flamands reconnaissent Édouard III d'Angleterre roi de France.
► 1338 naissance de Charles, futur Charles V. Charles V de France, dit Charles le Sage (né à Vincennes, le 31 janvier 1338 - mort à Beauté-sur-Marne, le 16 septembre 1380) fut Roi de France de 1364 à 1380. Il est le fils de Jean II le Bon et de Bonne de Luxembourg. Il est le troisième roi de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne. Il est le premier héritier à utiliser le titre dauphin, après que son grand-père Philippe VI acquit la province du Dauphiné.
Dauphin est un titre de noblesse français, assez rare. Dauphin était d'abord le surnom, puis le titre des seigneurs du Dauphiné, comtes de Viennois, qui s'intitulaient "dauphins de Viennois et comtes d'Albon". En imitation des dauphins de Viennois, une branche des comtes d'Auvergne prit le titre de "dauphin d'Auvergne", qui subsista jusqu'à la Révolution. Les héritiers du trône de France portaient le titre de dauphin, depuis que, en 1349, Humbert II avait vendu sa seigneurie du Dauphiné au roi de France Philippe VI, à la condition que l'héritier portât le titre de dauphin.
Pour avoir le titre de dauphin, il fallait non seulement être l'héritier du trône, mais aussi descendre du roi régnant. Ainsi François Ier, cousin de son prédécesseur Louis XII ne fut jamais titré "dauphin". Jusqu'au règne de Louis XIV, on parlait de "dauphin de Viennois", après lui de "dauphin de France". Le premier prince français surnommé le Dauphin fut Jean II, qui succéda à Philippe VI. Le dernier fut le duc d'Angoulême (Louis Antoine d'Artois, duc d'Angoulême, devenu Louis Antoine de France, dauphin de France, puis Louis de France), fils de Charles X, qui renonça au titre en 1830.
► 1339 - 20 septembre Édouard III d'Angleterre entre dans le Cambraisis avec son armée.
► 1339 - 9 octobre Édouard III d'Angleterre entre en France avec son armée.
► 1339 - 24 octobre Édouard III d'Angleterre se retire avec son armée.
► 1339 Apparition des 'Miracles de Notre-Dame' (1339-1382). Les formes théâtrales se développent considérablement au XIVe et au XVe siècles. les miracles par personnages, sont l'occasion de mettre en scène des personnages et des situations variées (le motif de la femme injustement accusée revient souvent). Composés d'une succession de tirades en octosyllabes dont la fin est signalée par un quadrisyllabe, entre lesquelles sont parfois insérés des rondeaux chantés signalant par exemple les apparitions de la Vierge, ce sont souvent des commandes des confréries, religieuses ou non, à l'occasion de la fête de leur saint patron.
On a ainsi conservé une collection de quarante 'Miracles de Notre-Dame' par personnages représentés presque chaque année entre 1339 et 1382 lors de la réunion annuelle de la confrérie Saint-Éloi des orfèvres de Paris. Le miracle est une petite narration (500 à 3000 vers) relatant une action humaine où l'élément divin apparaît dans le dénouement. Le plus souvent, c'est une intervention de la Vierge, parfois des Saints. Les miracles se jouent au XIIIe et XIVe siècles. Le plus célèbre recueil de miracles est celui de Gautier de Coinci, mort en 1236, et qui comprend 30 000 vers.
► 1340 Les hostilités, commencées par Philippe VI par la saisie de villes en Guyenne et en Flandre, eurent pour second acte la bataille navale de l'Écluse, dans laquelle la flotte française fut anéantie par les flottes conjuguées de l'Angleterre et de Flandre.
► 1340 - 24 juin Destruction de la flotte française lors de la bataille de l'Écluse (près de Bruges). Parce que Jacques Van Artevelde a reconnu Édouard III d'Angleterre comme roi de France légitime, Philippe VI, qui a à sa disposition une puissante flotte, veut engager une bataille navale contre les Zélandais. Ses amiraux sont ancrés dans le port de l'Écluse près de Bruges. Les bateaux sont pris à l'abordage par les archers anglais.
La flotte française est presque totalement détruite. Bataille de l'Écluse, le 24 juin 1340, lors de la bataille navale de l'Écluse (ou de Sluys), le roi anglais Édouard III, prétendant à la couronne de France, anéantit la flotte de son rival, le roi de France Philippe VI de Valois, devant l'estuaire du Zwin, ce bras de mer (de nos jours ensablé) qui mène à Bruges.
C'est la première bataille d'importance de la guerre de Cent Ans. Jacques Van Artevelde, ou Jacob Van Artevelde, né à Gand vers 1287, est un membre de la haute bourgeoisie gantoise qui a fait fortune dans l'industrie drapière au début du XIVème siècle. Ses différents contacts avec le pouvoir comtal en ont fait l'un des porte-paroles de sa ville d'abord, des communes flamandes ensuite, dans les diverses négociations avec le comte de Flandre Louis de Nevers.
► 1340 - 23 septembre Trêve d'Esplechin-sur-Escaut entre Français et Anglais. La trêve d'Esplechin-sur-Escaut fut signée le 25 septembre 1340 malgré la bataille de l'Écluse remportée par Édouard III d'Angleterre le 24 juin 1340 sur l'armée royale conduite par Philippe VI de France. En effet le roi d'Angleterre se trouvait dans une situation très incommode. Le souverain anglais faisait le siège devant Tournai, tandis que Robert III d'Artois assiégeait Saint-Omer.
En outre, les troupes anglaises connaissaient de sérieux revers en Guyenne et les Écossais en l'absence d'Édouard III d'Angleterre s'étaient révoltés. Cette situation obligea le roi d'Angleterre à négocier avec la France. Le monarque anglais et Philippe VI de Valois se rencontrèrent à Esplechin-sur-Escaut où fut signée une trêve d'un an. Grâce à cette dernière le roi de France put sauver Tournai et Saint-Omer assiégées.
► 1340 Guillaume de Machaut écrit 'Remède de Fortune'.
► 1341 Mort de Jean III de Bretagne. Jean III de Bretagne, dit le Bon, né le 8 mars 1286, mort le 30 avril 1341, duc de Bretagne de 1312 à 1341, fils de Arthur II de Bretagne, duc de Bretagne, et de Marie, vicomtesse de Limoges, sa première épouse. Dès son avènement, il essaya de contester la légitimité du mariage entre son père et Yolande de Montfort. En 1315, il participa à une campagne de Louis X le hutin contre la Frandre. Il fut fidèles aux rois de France et combattit au côté de Philippe VI de Valois à la bataille de Cassel (1328), où il fut blessé.
Édouard III d'Angleterre lui confisqua le comté de Richemont en raison de son alliance avec la France. Il tenta de léguer à sa mort le duché de Bretagne à la France, mais ses sujets s'y opposèrent, et il maria alors sa nièce Jeanne de Penthièvre avec Charles de Blois, neveu de Philippe VI. En 1338, il envoya sa flotte à l'Écluse en soutien de celle du roi de France, mais celles ci furent détruite par les anglais. Il mourut à Caen en 1341 en revenant de Flandre. Sa succession provoqua la guerre de succession de Bretagne.
► 1341 à 1385 - Guerre des Deux Jeanne ou de Bretagne. - Jeanne de Penthièvre (femme de Charles de Blois) et son oncle Jean de Montfort (mari de Jeanne de Flandre) se disputent le duché de Bretagne dont le dernier duc leur oncle, vient de mourir sans héritier direct. Philippe VI prend le parti de Jeanne de Penthièvre, Édouard III d'Angleterre celui de Jean de Montfort (Jeanne de Flandre). Tous les deux en appellent aux armes: cette guerre de quatorze ans a pris le nom des femmes des prétendants à cause du rôle actif qu'elles y jouèrent; elle se termina par le traité de Guérande, en vertu duquel la Bretagne restait à la maison de Montfort, la maison de Penthièvre recevant en compensation la vicomté de Limoges.
La guerre de Succession de Bretagne (1341-1364) – ou guerre des deux Jeanne – est l'une des guerres secondaires qui eurent lieu au cours de la guerre de Cent Ans. Le 30 avril 1341, meurt le duc Jean III de Bretagne. Malgré trois mariages, avec Isabelle de Valois, Isabelle de Castille et Jeanne de Savoie, Jean III n'a pas eu le moindre enfant. Et il n'est jamais parvenu à se décider à désigner l'un des deux candidats à sa succession. Il y a d'une part Jeanne de Penthièvre, fille de son frère Guy de Penthièvre, mariée depuis 1377 à Charles de Blois, parent du roi, d'autre part son demi-frère Jean de Montfort, comte de Montfort-l'Amaury, fils du second mariage d'Arthur II de Bretagne avec Yolande de Dreux, comtesse de Montfort-l'Amaury.
Par sa naissance, Charles de Blois est le neveu du nouveau roi, Philippe VI de Valois, choisi pour roi aux dépends des prétentions d'Édouard III d'Angleterre, en vertu de la loi salique. Charles de Blois a en outre hérité des prétentions de la maison de Penthièvre sur le duché de Bretagne. En réaction, Édouard III se rappproche du Montfort qui sait avoir peu à attendre du roi. Cette alliance est assortie du comté de Richemont, fief anglais entré dans le patrimoine des ducs de Bretagne. Jeanne de Penthièvre, elle est duchesse de Bretagne, Dame d'Avaugour, l'Aigle et Châtel-Audren, Comtesse de Penthièvre et Goëllo, Vicomtesse de Limoges.
Nièce de Jean III, duc de Bretagne, et femme de Charles de Blois. Elle fit valoir par les armes ses droits à la succession de Bretagne contre Jean IV de Bretagne, son oncle, époux de Jeanne de Flandre ; mais en 1365, elle dut y renoncer par le traité de Guérande. Charles de Blois, aussi appelé Charles Ier de Bretagne, est né en 1319 à Blois. Il a été canonisé comme Charles de Blois (bienheureux). Il est Baron de Mayenne, comte de Penthièvre, seigneur de Guise, et duc de Bretagne. Il est devenu duc de Bretagne en 1341, ayant épousé Jeanne de Penthièvre (dite la Boiteuse), nièce du duc Jean III de Bretagne et petite-file d'Arthur III de Bretagne le 4 juin 1337 à Paris, ce qui a déclenché la guerre de Succession de Bretagne lorsque par l'arrêt de Conflans, le roi Philippe VI de France le reconnaît Charles de Blois duc de Bretagne.
Jean de Montfort ou Jean de Bretagne, comte de Montfort-l'Amaury, né vers 1294 à Hennebont, mort le 26 septembre 1345 à Hennebont, fils d'Arthur II, duc de Bretagne et de Yolande de Dreux, comtesse de Montfort l'Amaury. Son demi-frère Jean III de Bretagne, duc de Bretagne, avait désigné sa nièce Jeanne de Penthièvre pour lui succéder, l'écartant. Cependant, à la mort de Jean III, il se trouvait à Nantes et se fit proclamer duc de Bretagne, s'emparant du trésor ducal. Charles de Blois en appela à la Cour des Pairs, qui trancha en sa faveur.
Un certain nombre de barons bretons se rallièrent à Charles de Blois, le mari de Jeanne de Penthièvre. Une guerre s'ensuivit durant vingt ans, appelée guerre de Succession de Bretagne ou guerre des deux Jeanne, du nom des deux duchesses en compétition. Jean de Montfort était soutenu par le roi d'Angleterre, et Charles par le roi de France. Jeanne de Flandre, duchesse de Bretagne, épouse de Jean IV de Bretagne. Elle disputa le duché de Bretagne à Jeanne de Penthièvre, ce qui fit donner le nom de guerre des Deux Jeannes à la guerre de succession de Bretagne.
► 1342 juin Intervention d'Édouard III d'Angleterre en Bretagne.
► 1342 - 18 août Arrivée de renforts anglais à Brest, Charles de Blois lève le siège.
► 1342 - 30 septembre Défaite des armées de Charles de Blois contre les Anglais devant Morlaix.
► 1343 - 19 janvier Seconde trêve dans la Guerre de Cent Ans. Celle-ci est conclue à Malestroit grâce à l'intervention du Pape. Trêve de Malestroit signée en 1343 entre Édouard III d'Angleterre et Philippe VI de France. Après la signature de cette trêve le souverain anglais et ses troupes quittèrent la Bretagne pour l'Angleterre. Malestroit est une commune du département du Morbihan, dans la région Bretagne,
► 1343 août Ouverture des États Généraux pour la levée de nouveaux impôts.
► 1344 Le Dauphiné échoit aux héritiers du trône de France. Le Dauphiné est une ancienne province française, qui correspond approximativement aux départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes.
► 1345 - 26 septembre Mort de Jean de Montfort, son fils Jean IV de Bretagne, hérite du duché de Bretagne. Jean IV de Bretagne, né en 1339, mort le 9 novembre 1399 à Nantes, duc de Bretagne de 1364 à 1399, comte de Montfort (1345-1399) et duc de Bretagne (1364-1399), fils de Jean de Montfort et de Jeanne de Flandre. Son père mourut en pleine lutte contre Charles de Blois pour la succession de Bretagne et alors qu'il n'avait que six ans. Ce fut sa mère qui poursuivit la guerre, remportant des succès. Il commença à prendre parts aux opérations militaires en 1357.
► 1346 février Les États Généraux votent des aides (impôts exceptionnels).
► 1346 - 7 juin Édouard III d'Angleterre débarque en Normandie.
► 1346 Édouard III d'Angleterre, conseillé et dirigé par le traître Geoffroy d'Harcourt, seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicomte, envahit la France. Philippe VI marcha à sa rencontre et lui livra bataille à Crécy, où les Anglais firent, pour la première fois en Europe, usage de la poudre et des canons; les Français y furent complètement défaits. C'est à cette bataille que fit ses premières armes le fils aîné d'Édouard III qu'on surnomma le Prince Noir, à cause de la couleur de son armure.
Geoffroy d'Harcourt, dit "le Boîteux", baron de Saint-Sauveur-le-Vicomte, mort à Coutances en novembre 1356, fut l'instigateur de la première invasion anglaise de la Normandie lors de la guerre de Cent Ans. Il était l'un des plus puissants seigneurs de Normandie. Le Prince Noir, Édouard de Woodstock, dit le Prince Noir, prince de Galles et duc de Cornouailles (Woodstock, 1330 - Westminster, 1376), était le fils aîné d'Édouard III d'Angleterre et de Philippa de Hainaut. Il a été choyé par son père, ne négligeant ni son éducation ni son instruction de prince. Son père l'appelait "The Boy"
.
► 1346 - 21 juillet Prise de Caen.
► 1346 - 26 août Défaite des armées françaises à Crécy face aux Anglais. Débarqué quelque temps plus tôt à Saint-Vaast-la-Hougue, dans le Cotentin, Édouard III d'Angleterre ravage la Normandie puis remonte vers la Flandre. Ses troupes se composent de 10 000 hommes à pied et de seulement 4 000 chevaliers. Qui plus est, il a à sa disposition trois bouches à feu (canons). De leur côté, les Français ne doutent pas de leur puissance.
Pressés, les chevaliers veulent aussitôt en découdre. Selon le chroniqueur Froissart les “arbalétriers génois crièrent pour faire peur à l'Anglais”. Indifférence anglaise. Si les cordes mouillées des Génois les empêchent de tirer, en revanche les Anglais “firent voler leurs flèches : elles descendirent et entrèrent si uniment dans les Génois qu'il semblait que ce fut neige”. Le roi de France, outré que ses mercenaires génois refluent, lance à ses chevaliers : “Tuez la piétaille !”
Il reste aux Anglais à tirer à nouveau sur ces chevaliers qui déciment les Génois et à lancer dans la mêlée des soldats qui coupent au couteau les jarrets des chevaux. C’est la débandade. Quelque 5 000 chevaliers français meurent. Philippe VI, qui a fui au cours des combats, ignore le lendemain encore l'ampleur du désastre. Pour leur part, les Anglais n'ont perdu qu'une centaine d'hommes.
► 1346 États Généraux conjointement à Paris et Toulouse.
► 1347 juin Charles de Blois prétendant au duché de Bretagne est capturé à la Roche-Derrien par les Anglais.
► 1347 En 1346 et 1347, Édouard III d'Angleterre fit le siège de Calais, dont la population lui résista pendant onze mois. Exaspéré par cette résistance, il jura de la passer au fil de l'épée; la famine ayant obligé les habitants à capituler, il eût mis sa menace à exécution, sans les instances de sa femme, Philippa de Hainaut, qui obtint non seulement la grâce des Calaisiens, mais encore celle de cinq notables qui, conduits par Eustache de Saint-Pierre, venaient se livrer à lui, ayant offert leur vie pour sauver celle de leurs concitoyens. La ville de Calais devait rester deux cent dix ans aux mains des Anglais, auxquels elle ne fut reprise qu'en 1558 par le duc de Guise.
► 1347 - 4 août Prise de Calais par Édouard III d'Angleterre. Calais se rend à Édouard III d'Angleterre. Après un siège de onze mois qui a excité la colère du roi d'Angleterre, Édouard III d'Angleterre, la ville a signifié qu'elle est prête à se rendre. Le roi a songé à un massacre, mais il s'est ravisé et a fait savoir sa volonté : “Six des bourgeois les plus notables, nu-pieds et nu chef, en chemise et la hart (corde) au col, apporteront les clefs de la ville et du château, et de ceux-ci je ferai ma volonté”.
En ce 4 août, les bourgeois attendus sont aux pieds du roi. Ils lui déclarent : “Noble sire et noble roi, nous voici tous les six… Veuillez donc avoir de nous pitié et merci dans votre très haute magnanimité”. Édouard III, selon Froissart qui le rapporte dans ses chroniques, grâce à l'intervention de la reine Philippine de Hainaut, “durement enceinte”, qui lui demande “de bien vouloir prendre ces six hommes en pitié”, accorde leur grâce. Le roi lui déclare : “Tenez, je vous les donne : faites-en ce qu'il vous plaira”.
► 1347 - 28 septembre Trêve (Jusqu'en sept 1355). Trêve générale entre Philippe VI et Édouard III d'Angleterre. La France est épuisée après la perte de Calais, le 4 août, et la défaite de Crécy, un mois plus tôt, à la suite de laquelle le roi a dû frapper à la porte du château de Broye et répondre à celui qui s'inquiétait de savoir qui pouvait “heurter” à une pareille heure : “Ouvrez, châtelain, c'est l'infortuné roi de France”.
Le pays accepte sur les instances du pape Clément VI la trêve proposée, qui va durer jusqu'en 1355. Pendant la durée de celle-ci une autre fatalité accable l'europe : la peste noire. Un chroniqueur rapporte : “Le nombre des personnes ensevelies est plus grand que le nombre même des vivants. Les villes sont dépeuplées : mille maisons sont fermées à clef, mille ont leur porte ouverte et sont vides d'habitants et remplies de pourriture”. La peste noire est une pandémie de peste bubonique qui a affecté toute l'Europe entre 1346 et 1350.
Ce n'est ni la première ni la dernière épidémie de ce type, mais c'est la seule à porter ce nom. Par contre c'est la première épidémie de l'histoire à être bien décrite par les chroniqueurs contemporains. On estime que la peste noire a provoqué la mort d'au moins un tiers de la population européenne, soit autour de 25 millions de victimes, et probablement le même nombre en Asie. La peste noire eut des conséquences durables sur la civilisation européenne, d'autant qu'après cette première vague, la maladie refait ensuite régulièrement son apparition dans les différents pays touchés (par exemple entre 1353 et 1355 en France, en 1360 et 1369 en Angleterre, etc.)
► 1347 novembre Nouvelle réunion des États Généraux à Paris.
► 1348 - 9 juin Le pape Clément VI achète Avignon à la reine de Naples.
► 1348 Édouard III d'Angleterre fonde l'ordre de la Jarretière. L'Ordre très Noble de la Jarretière (The Most Noble Order of the Garter) est un ordre de chevalerie anglais, fondé par Édouard III d'Angleterre en 1348. Selon la légende, la comtesse de Salibury, maîtresse d'Édouard III, laissera tomber sa jarretière lors d'un bal de la cour. Le roi la ramassera vivement et la rendra à la comtesse. Devant les plaisanteries des courtisans, il s'écriera : "Honni soit qui mal y pense".
Il promettra à sa favorite de faire de ce ruban bleu un insigne si prestigieux que les courtisans les plus fiers s'estimeraient trop heureux de le porter. Les premiers membres seront Édouard III d'Angleterre lui même, le prince de Galles (Édouard, le Prince Noir), ainsi que 24 compagnons. Ces "chevaliers fondateurs" étaient des hommes d'armes, dont certains n'avaient pas plus de vingt ans. L'ordre de la Jarretière est le plus important ordre de chevalerie britannique, et l'un des plus prestigieux au monde.
L'admission en son sein donne à ses membres le droit au titre de "Sir". Les bannières et armoiries des compagnons chevaliers sont suspendus dans la chapelle la chapelle Saint-George à Windsor. Chaque stalle est dotée d'une plaque indiquant le nom et les armes de l'occupant. Les bannières et armoiries, suspendues en permanence au dessus de la stalle du chevalier, ne sont retirées qu'à sa mort.
► 1349 Philippe VI acquiert de Humbert II, le Dauphiné, à la condition que dans l'avenir, le fils aîné du roi de France portera le titre de dauphin; par la suite, le titre passa aux fils aînés des dauphins, lorsque ceux-ci mouraient sans avoir régné.
► 1349 Mort de Jeanne II de Navarre, reine de Navarre, fille de Louis le Hutin. Son fils, Charles le Mauvais, lui succède. La Navarre, ancien État des basques, a été indépendante jusqu'en 1512, année de sa conquête militaire par le Duc de Alba. Jeanne II de Navarre, reine de Navarre, née en 1311, morte en 1349, était la fille du roi de France et de Navarre Louis X dit le Hutin et de Marguerite de Bourgogne. Elle fut reine de Navarre de 1328 à 1349. Charles le Mauvais, Charles II de Navarre, dit Charles le Mauvais (1332 - 1387) fut roi de Navarre de 1349 à 1387 et comte d'Évreux de 1343 à 1378.
Il est le fils de Philippe III et Jeanne II. En plus de ses titres officiels, et grâce aux tractations de sa mère, il détient également des droits en Champagne, le comté de Mortain, une partie du Cotentin, et dans le Vexin : Pontoise, Beaumont-sur-Oise et Asnières-sur-Oise. Il espéra longtemps une hypothétique restauration de ses droits éventuels à la couronne de France (à laquelle sa mère avait pourtant renoncé en 1328, avant sa naissance) et intrigua beaucoup dans ce but, allant jusqu'à épouser Jeanne de France, fille de Jean le Bon.
► 1349 - 30 mars Le Dauphiné est rattaché au royaume. Humbert II du Viennois, en mauvaise posture financière et politique, cède le Dauphiné au roi de France au traité de Romans. Le prince héritier du trône de France, Charles, petit-fils du roi, prend le titre de dauphin. Humbert II du Viennois, Humbert II de la Tour-du-Pin, né en 1312, mort en 1355, fut un dauphin du Viennois de 1333 à 1349. Le dernier Dauphin a été sévèrement jugé par ses contemporains comme un incapable et un dépensier : il n'avait pas l'ardeur guerrière de son frère et se rangeait plutôt dans le camp des pacifiques.
Il avait passé sa jeunesse à la cour de Naples où il avait pris goût pour le faste et les plaisirs du "quattrocento" italien. Il entretenait une cour fastueuse à Beauvoir-en-Royans qui est mal perçue par ses frustes contemporains. A la différence de ses prédécesseurs, Humbert ne mène plus cette vie itinérante d'un château delphinal à l'autre et préfère rester à Beauvoir. Il avait vidé les caisses de son Trésor pour organiser une vaine Croisade en Terre Sainte, quarante ans après le départ des derniers chrétiens de Saint Jean d'Acre.
Après la perte de son fils unique André, Humbert abandonne vite l'espoir d'avoir une descendance et projette dès 1337 de céder son héritage. Les difficultés financières s'accumulant, Humbert fait procéder à l'inventaire de ses biens en 1339 dans le but de vendre sa principauté au pape Benoît XII. La transaction avec le Pape ayant échoué, c'est finalement au roi de France Philippe VI de Valois que le Dauphiné est cédé en 1349. Pour sauver les apparences, la cession est appelée Transport.
Le traité de Romans a été signé le 30 mars 1349 entre le Dauphin Humbert II et le royaume de France. Le Dauphin vendait sa principauté à la France, qui faisait alors un grand bond territorial à l'est du Rhône. Le traité prévoit également : que le Dauphiné serait le fief du fils aîné du roi de France, qui porte désormais le titre de Dauphin ; que le Dauphiné bénéficierait d'un statut fiscal particulier, le statut delphinal. Le Dauphiné de Viennois est une ancienne province française, qui correspond approximativement aux départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes.
► 1349 avril Philippe VI achète Montpellier au roi de Majorque (Pierre IV d'Aragon). Pierre IV d'Aragon (1319-1387), roi d'Aragon (1336-1387), le Cérémonieux ou el del punyalet (celui avec une petite dague). Il déposa Jacques III de Majorque et joignit les Iles baléares et le Roussillon sous la couronne d'Aragon. Il a écrit les Chroniques de son nom.
► 1349 - 11 septembre Mort de Bonne de Luxembourg, épouse de Jean II. Bonne de Luxembourg, née le 20 mai 1315, morte le 11 septembre 1349, fut l'épouse du futur roi de France, Jean II dit le Bon. Fille de Jean Ier l'Aveugle, comte de Luxembourg et roi de Bohême, et d'Élisabeth de Bohême, elle épouse le dauphin Jean le 28 juillet 1332. De cette union naquirent 9 enfants dont les futurs Charles V et Philippe le Hardi, ainsi que Jean Ier de Berry, Jeanne de France, Marie, Agnès de France, Marguerite de France, Isabelle de France et Louis Ier d'Anjou. La réapparition de la peste en Occident entraîna son décès.
► 1349 Première implantation chinoise à Singapour. La République de Singapour est un pays d'Asie situé à 137 km au nord de l'équateur.
► 1350 - 11 janvier Mariage de Philippe VI avec Blanche de Navarre. Blanche de Navarre (1333-1398). Elle est la fille de Philippe III de Navarre et de Jeanne de France. D'abord destinée à une alliance avec la Castille, Blanche est ensuite promise au futur Jean II, mais c'est le père de celui-ci, Philippe VI de Valois - veuf de Jeanne de Bourgogne - qui l'épouse le 29 janvier 1349.
► 1350 - 19 février Jean II le Bon se remarie avec Jeanne d'Auvergne (1326-1361) fille de Guillaume comte d'Auvergne. Jeanne d'Auvergne, comtesse d'Auvergne et reine de France, est la fille et héritière de Guillaume XII d'Auvergne et de Marguerite d'Evreux. Mariée une première fois à Philippe de Bourgogne, fils du duc Eudes, elle est la mère du dernier duc capétien de Bourgogne, Philippe de Rouvre. Elle épouse en secondes noces le roi Jean le Bon, veuf de Bonne de Luxembourg ; elle en a trois enfants, qui ne vécurent pas.
► 1350 - 8 avril Mariage du futur Charles V avec Jeanne de Bourbon. Jeanne de Bourbon, née le 3 février 1337 à Vincennes, morte le 6 février 1378 à Paris. Elle était fille du duc de Bourbon Pierre Ier de Bourbon, mort à la bataille de Poitiers en 1356, et d'Isabelle de Valois (1313-1383). Par son mariage (8 avril 1350 à Tain-l'Hermitage) avec le futur Charles V (1337-1380), roi de France (1364-1380), elle devint reine de France de 1364 à 1378.
► 1350 - 22 août Mort de Philippe VI à Nogent-le-Roi, son fils Jean II le Bon lui succède.
► 1350 Mort de Philippe VI. - Il avait épousé en premières noces Jeanne de Bourgogne, fille du duc Robert II; en secondes noces, Blanche, fille de Philippe d'Évreux, roi de Navarre. Tant par ses mariages que par son accession au trône et ses négociations, il ajouta au domaine royal, outre le Dauphiné, la seigneurie de Montpellier, les duchés de Valois, d'Anjou et du Maine. Philippe VI laissait le souvenir d'un souverain incapable et d'un prince hautain: il imita à plusieurs reprises Philippe le Bel en altérant les monnaies et institua sur le sel l'impôt dit de la Gabelle.
► 1350 JEAN II le Bon (1350-1364)
► 1350 Jean II le Bon fut un bon chevalier mais un piètre roi. Mal conseillé, il dilapide le trésor royal et entre en conflit avec Charles le Mauvais roi de Navarre qui prétend secrètement au trône de France. Ce dernier était le fils de Philippe d'Évreux un des trois prétendants au trône lors de la succession de Charles IV. Il aurait donc pu prétendre au trône de France au cas ou Jean le Bon mourrait sans descendance aussi il ne cessa de fomenter des troubles dans le royaume.
Malgré son mariage avec Jeanne, fille de Jean le Bon en 1352, il persévère dans ses actions de sape et est emprisonné en 1356. Profitant des troubles le roi d'Angleterre Édouard III attaque la France. Son fils, le Prince Noir à la tête des troupes chevauche en Gascogne et en Languedoc. Le duc de Lancastre (Henry de Grosmont) débarque en Normandie. Jean le bon tente d'arrêter le prince Noir qui remonte vers la Normandie. Alors qu'il aurait pu vaincre, des erreurs tactiques vont lui faire perdre la bataille et sa liberté.
Les Anglais en mauvaise posture se réfugient dans des vignes empêchant les chevaliers de charger, ceux-ci doivent mettre pied à terre mais leurs lourdes armures les rendent vulnérables. La bataille fait rage, Jean met à l'abri deux de ses fils mais en garde un près de lui et c'est le fameux "père gardez-vous à droite, père gardez-vous à gauche". Jean perd la bataille, il est fait prisonnier avec son fils et emmené en Angleterre. C'était près de Poitiers le 19 septembre 1356.
C'est son fils Charles futur Charles V qui assure la régence. Il devra faire face à une situation très dégradée. C'est la plus grave crise qu'ait connu la monarchie française. Les états généraux tentent d'imposer au régent une réforme profonde du système de gouvernement avec un contrôle de leur part, c'est la grande ordonnance de 1357. Accéder à leurs demandes reviendrait à instaurer une monarchie parlementaire. Les campagnes se révoltent (jacqueries). Charles le Mauvais qui s'est évadé traite avec Édouard III d'Angleterre pour se partager la France.
Des bandes à la solde de Charles le Mauvais ravagent le royaume, et de connivence avec Étienne Marcel (prévôt des marchands de Paris) ils organisent des manifestations. Étienne Marcel sera tué par le peuple de Paris accusé de vouloir livrer Paris à l'Anglais. Charles parviendra à surmonter toutes ces difficultés. Deux traités de Londres 1358 et 1359 permettent à Jean le Bon de revenir en France mais les conditions sont exorbitantes.
Abandon de toute la façade atlantique du royaume à l'Angleterre et une forte rançon, plusieurs millions d'écus d'or. Deux fils du roi son pris en otage en attendant le paiement de la rançon. Les états généraux refusent les conditions. La guerre reprend. En 1363 l'un des otages, Louis duc d'Anjou (futur Louis Ier de Naples, fils de Jean le Bon), s'évade. Le roi n'écoutant que les lois de l'honneur retourne en Angleterre. Il y mourra quelques mois plus tard.
► 1350 à 1355 - Avènement en 1350 de Jean II le Bon (fils de Philippe VI de France). il régnait depuis peu de temps lorsqu'il fit exécuter sans jugement le connétable Raoul, comte d'Eu, parce qu'il le soupçonnait d'intelligences avec la cour d'Angleterre : il donna la charge devenue ainsi vacante à son favori Lacerda que, peu après, Charles le Mauvais fit assassiner. Par représailles, Jean profita de l'occasion d'un banquet à Rouen pour faire saisir Charles le Mauvais qui fut emprisonné, et un certain nombre de ses compagnons que l'on décapita séance tenante.
Le mécontentement que cet événement causa aux Anglais, dont Charles était l'allié, s'aggrava de l'échec subi dans le Combat des Trente par les champions anglais. On a donné ce nom à un combat que livrèrent en 1351, près de Ploërmel, trente chevaliers français, tenants de Charles de Blois, commandés par Beaumanoir de Josselin, à trente chevaliers anglais commandés par Richard Benborough, qui furent vaincus. La reprise de la guerre avec l'Angleterre devenait inévitable. En 1355, Jean le Bon convoqua les États généraux pour leur demander des subsides pour la soutenir. Le Prince Noir débarqua à Bordeaux à la tête d'une armée.
► 1350 - 26 septembre Sacre de Jean II le Bon à Reims.
► 1350 vers - Épanouissement de la ballade et du rondeau, avec Guillaume de Machaut et Eustache Deschamps, genres portés à leur perfection au XVe siècle par Christine de Pisan, Charles d'Orléans et François Villon.
►1350 Gothique flamboyant (Rouen, Paris, Lisieux). Le gothique flamboyant, appelé aussi gothique tardif, il naît dans les années 1350 et se développe jusqu'à la fin du XVe siècle, et parfois même dans certaines régions, telle la Lorraine, durant la première partie du XVIe siècle telle la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port. Durant cette période, les innovations sont rares. La structure des édifices reste la même, mais leur décor évolue vers un ornement exubérant, "flamboyant", qui forme des sortes de flammes que l'on peut remarquer dans les remplages des baies ou sur les gâbles par exemple.
L'élévation se simplifie quelque peu avec souvent une élévation à deux niveaux (Saint-Germain l'Auxerrois), ou bien avec une élévation à trois niveaux mais avec un triforium aveugle. La voûte d'ogive se fait plus complexe, devenant dans certains édifices, décorative ; c'est le cas à la cathédrale Saint-Guy de Prague. La clef pendante ou cul-de-lampe, véritable prouesse technique, se fait plus fréquente (Saint-Ouen de Rouen, portail des Marmousets). Exemples d'édifices flamboyants : l'église Saint-Maclou et le Parlement de Rouen, la basilique Saint-Urbain de Troyes, l'église de Louviers, l'église de Brou, près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain.
► 1350 vers - Le français perd progressivement le statut de langue dominante en Europe. En Angleterre, où le français est de moins en moins maternelle et où elle doit être soutenue par un enseignement spécifique, cela se traduit notamment par l'augmentation du nombre de traités didactiques (et souvent juridiques ou épistolaires, le français devenant une langue spécialisée) visant à professer le français (qui sera nécessaire pour les postes importants jusque tard: XVIe siècle grosso modo: les lois sont en français ou en anglais jusque 1487 et imprègnera longtemps le domaine juridique: 'law french')
► 1351 Nouvelle convocation des États Généraux pour la levée d'impôts.
► 1351 Création de l'ordre de l'Étoile par Jean II. Sur le modèle anglais, le roi de France Jean II le Bon, crée le premier ordre de chevalerie français. La célébration de l'instauration de l'ordre de l'Étoile se déroule à Saint-Ouen. L'ordre de l'Étoile est un ordre de chevalerie fondé le 6 novembre 1351 par Jean le Bon, roi de France. La cérémonie inaugurale a lieu à Saint-Ouen le 6 janvier 1352. Il le crée pour s'attirer une nouvelle fidélité auprès des chevaliers français, et afin de les discipliner, pour éviter de renouveler le désastre de Crécy.
Pour y être admis, seuls les mérites personnels sur le champ de bataille comptaient ; la valeur lors des tournois n'était pas prise en compte. Une solde était versée aux chevaliers membres. Ses statuts prévoyaient que ses membres ne devaient jamais tourner le dos à l'ennemi. Lors de la bataille de Poitiers, cette disposition provoqua la mort ou la capture de plusieurs membres, dont le grand-maître, le roi en personne. L'ordre tomba ainsi rapidement en désuétude. Ordre de l'Étoile. Ordre français de chevalerie – l'un des tous premiers – créé par Jean le Bon en 1351. Sa devise "les astres montrent la voie aux rois" est symbolisée par une étoile blanche sur fond rouge.
► 1351 - 25 mars Combat de chevaliers français et anglais à Ploermël. Trente chevaliers français “tenants” de Charles de Blois et commandés par Beaumanoir de Josselin se battent contre trente chevaliers anglais commandés par Richard Benborough et les défont. La reprise de la guerre avec l'Angleterre, alors que Jean II le Bon règne depuis 1350, est inévitable. Combat des Trente, pendant la guerre de Succession de Bretagne, Josselin était aux mains de Jean de Beaumanoir, partisan de Charles de Blois.
Ploërmel, en revanche, était tenu par l'Anglais Richard de Brandenburg (ou Bembro) partisan des ducs de Bretagne de la maison de Montfort. Les deux garnisons s'affrontant continuellement, Beaumanoir proposa à Brandenburg un duel entre soldats pour régler l'attribution du territoire. Le 26 mars 1351 le combat épique se déroula près du "chêne de Mi-Voie", entre Ploërmel et Josselin. Les trente Bretons de Jean de Beaumanoir s'immortalisèrent en luttant contre les trente Anglais commandés par Brandenburg.
Huit Anglais furent tués et les autres se rendirent. On raconte que, dans l'ardeur du combat, le chef des Bretons, épuisé de chaleur et de fatigue, demanda à boire; l'un de ses compagnons lui répondit "Bois ton sang, Beaumanoir, la soif te passera". Malheureusement l'issue du combat ne règla rien et les garnisons anglaises continuèrent à traiter la région en pays conquis, l'exploitant et la rançonnant durement.
► 1354 - 8 janvier : Assassinat du connétable de France, Charles de la Cerda par des hommes de Charles II dit le Mauvais, roi de Navarre et comte d'Évreux. Charles de la Cerda, favori du roi Jean II le Bon, s'était vu offrir le comté d'Anjou que le roi avait promis à Charles de Navarre. Celui-ci, par vengeance, fait assassiner le favori, revendique son crime devant les plus hautes autorités, y compris le pape, et ses droits sont reconnus. Charles de la Cerda était le favori de Jean II le Bon. Il fut assassiné le 8 janvier 1354 à l'auberge de la "Truie-qui-File" par les hommes de main de Charles le Mauvais, roi de Navarre. Il est aussi connu sous le titre de comte Charles d'Angoulême ou Charles de la Cerda d'Angoulême.
► 1354 - 22 février Traité de Mantes entre Jean II le Bon et Charles II de Navarre, à l'avantage de ce dernier. Traité de Mantes, ce traité fut signé le 22 février 1354 à Mantes par Jean II de France et Charles II de Navarre. Par ce traité, Charles II le Mauvais, roi de Navarre accepta de perdre Asnières, Pontoise et Beaumont. En contrepartie il reçut le comté de Beaumont-le-Roger, les châteaux de Breteuil, Conches et de Pont-Audemer, le clos du Cotentin avec la ville de Cherbourg, les vicomtés de Carentan, Coutances et Valognes en Normandie.
Ce traité lui donnait également la permission de tenir chaque année un échiquier, prérogative ducale. De plus ce traité lui donna l'assurance de percevoir rapidement la dot de son épouse Jeanne de France (1343-1373), dot qui s'élevait à 60 000 deniers or. Lorsque l'on étudie ce traité, on se rend compte que le roi de Navarre fut largement gagnant, malgré la perte des châtellenies du Vexin et de l'Île-de-France, ce traité fut pour Charles II de Navarre très avantageux.
► 1354 Les Turcs ottomans acquièrent Gallipoli, sur la rive des Dardanelles, leur première possession en Europe. Gallipoli, ou Gelibolu est une ville turque située près du détroit des Dardanelles.
► 1355 - 10 septembre Traité de Valogne avec Charles le Mauvais. Par ce traité, Charles de Navarre, qui vient d'assassiner le connétable Charles d'Espagne, obtient du roi Jean II le Bon une totale amnistie pour son crime. Le traité de Valognes fut signé après moult plaintes du roi de Navarre auprès du pape. En effet Charles II de Navarre se plaignait des mauvais traitements que lui infligeait Jean II de France.
Le roi de Navarre réussit à apitoyer le pape Innocent VI et le Conseil royal, ceux-ci demandèrent la clémence pour Charles II le Mauvais. Le roi de France se méfiait des Anglais, mais malgré tout Jean II le Bon accepta avec regret de traiter avec son gendre le roi de Navarre. Le traité qui fut signé à Valognes le 10 septembre 1355 confirmait le traité de Mantes. En outre, le roi de France rendait à Charles II de Navarre tous ses biens et privilèges. Par son changement d'attitude, le roi de Navarre anéantissait les projets qu'Édouard III d'Angleterre avait échafaudés pour l'avenir.
► 1355 octobre Reprise de la guerre. Le Prince Noir, fils d'Édouard III d'Angleterre, lance l'offensive dans le Languedoc.
► 1355 - 2 décembre Les États généraux accordent une subvention excep-tionnelle.
► 1355 - 28 décembre Les États généraux votent la Grande Ordonnance limitant les pouvoirs royaux.
► 1356 - 10 janvier : L'empereur Charles IV du Saint-Empire promulgue la Bulle d'or, qui fixe les conditions d'élection à la tête du Saint-Empire : Trois électeurs ecclésiastiques (les archevêques de Mayence, Trèves et Cologne), et quatre électeurs laïques (le roi de Bohême, le comte palatin du Rhin, le duc de Saxe et le margrave de Brandebourg) réunis à Francfort choisissent le souverain, couronné à Aix-la-Chapelle. La désignation du souverain échappe à la papauté, mais son pouvoir est réduit à néant.
Les grandes principautés peuvent préserver l'indépendance totale qu'elles ont acquise et les Électeurs prennent soin de choisir des candidats sans prestige et sans autorité. Cette politique entraîne le recul du germanisme vers l'Est et compromet la cohésion allemande. Charles IV du Saint-Empire, Charles IV de Luxembourg (14 mai 1316 - 29 novembre 1378) est roi des Romains (1346-1378), empereur du Saint-Empire (1355-1378), roi de Bohème (1346-1378), comte de Luxembourg (1346-1353) et margrave de Brandebourg (1373-1378). Fils de Jean de Luxembourg, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire et d'Élisabeth Premyslovna, héritière par son père Venceslas II de la couronne de Bohème.
Il reçoit le titre de Margrave de Moravie dès 1333 et, en 1346, il accède au trône de Bohème. Il est élu en 1355 empereur du Saint-Empire. La Bulle d'or, parfois appelée Bulle d'Or de Metz, était la charte de constitution du Saint Empire Romain Germanique, promulguée par l'empereur Charles IV le 10 janvier 1356. Elle donne sa forme constitutionnelle à l'Empire et attribue le choix du roi aux princes-électeurs. Les Princes-Électeurs - ou Électeurs - étaient les sept princes allemands qui élisaient l'empereur romain germanique, dont le statut fut défini par la Bulle d'Or de 1356. Il fallait la majorité des voix pour être élu Empereur. Les Électeurs disposaient de privilèges très étendus dont la souveraineté territoriale ("Landeshoheit") qui les rendaient quasi indépendants de l'Empereur.
► 1356 - 5 avril Jean II le Bon fait emprisonner Charles le Mauvais à Rouen. Charles le Mauvais, roi de Navarre et gendre du roi de France, complote avec le roi d'Angleterre et tente de dresser le Dauphin contre son père, Jean II le Bon. Excédé, le roi vient lui-même à Rouen où il fait enfermer son gendre.
► 1356 - 19 septembre : bataille de Poitiers : Édouard de Woodstock dit le Prince Noir, défait les Français à Poitiers et capture le roi Jean II le Bon ainsi que de nombreux chevaliers. Bataille de Poitiers en 1356 (livrée à Maupertuis), dans laquelle les Français furent battus par les Anglais et le roi Jean fait prisonnier et emmené à Londres. Le dauphin Charles (futur Charles V), régent pendant la captivité de son père, réunit à deux reprises (1358-1357) les États généraux pour leur demander de nouveaux subsides destinés à entretenir une armée pour défendre le territoire pendant la captivité du roi.
Les États, dirigés par Robert Le Coq, évêque de Laon et Étienne Marcel, prévôt des marchands, firent preuve d'une vive hostilité envers la couronne: ils accordèrent néanmoins les subsides demandés; mais à la condition qu'une commission de trente-six membres, nommée dans leur rein, aurait le contrôle de leur emploi. Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris et homme politique français né vers 1315, mort à Paris en 1358, Étienne Marcel joua un rôle considérable aux États généraux de 1355 et 1357.
Devant l'opposition du dauphin (futur Charles V) il organisa le 22 février 1358 la première journée révolutionnaire parisienne. Avec ses partisans, il envahit le palais et obligea le dauphin à renouveler l'ordonnance de 1357 qui prévoyait le contrôle des subsides par les États généraux, un conseil adjoint au dauphin. Devenu maître de Paris, il s'efforça de gagner la province à sa cause, mais le dauphin ayant pu s'enfuir bloqua Paris. Étienne Marcel se compromis par son alliance avec Charles II le Mauvais; alors qu'il essayait de faire entrer ce dernier dans Paris au milieu de la nuit, il fut surpris par l'échevin Jean Maillard, partisan du dauphin, qui l'éxecuta.
► 1356 Régence du futur Charles V.
► 1357 - 3 mars Grande Ordonnance sur la réforme du royaume. Les États généraux contraignent le dauphin Charles, futur Charles V le Sage, à promulguer la Grande Ordonnance qui vise à établir une sorte de monarchie constitutionnelle sur le modèle de la Grande Charte anglaise.
► 1357 - 23 mars Trêve de Bordeaux entre la France et l'Angleterre. Après la bataille de Poitiers où il a été fait prisonnier le 17 septembre 1356, Jean II le Bon signe une trêve de deux ans avec le Prince Noir. Il est envoyé en Angleterre où il demeurera en captivité pendant trois ans.
► 1357 - 9 novembre Évasion de Charles le Mauvais.
► 1357 apparition du linceul de Turin à Lirey. Le Suaire de Turin est un drap en lin ancien qui montre l'image d'un homme qui présente, semble-t-il, les traces de tortures physiques correspondant à une crucifixion. Il est conservé dans la chapelle royale de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, Italie. Les partisans de l'authenticité pensent que c'est le linceul, qui a recouvert Jésus de Nazareth quand il fut mis au tombeau : son image fut, d'une certaine manière, imprimée en négatif sur les fibres, à un moment qui correspondrait, peu ou prou, l'époque de la proclamation de la résurrection de Jésus.
Pour les sceptiques, le suaire est un faux : ou une contrefaçon médiévale ou l'oeuvre réaliste d'un artiste, à des fins de dévotions. Le Saint-Suaire désigne, dans le langage courant, un linge qui a recouvert le visage du Christ, ou bien le linceul qui a servi à envelopper son corps après la mort, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs, avant de le déposer au tombeau selon le Nouveau Testament. Très tôt, des linges assimilés à cet événement sont devenus l'objet d'un culte. Dans l'Histoire, l'Église n'a pas toujours reconnu l'authenticité de ces reliques, cela fut fonction des époques et des personnalités concernées. Depuis une vingtaine d'années, le linceul de Turin a fait l'objet de nouvelles études scientifiques.
► 1358 janvier Signature du traité de Londres entre Jean II et Édouard III d'Angleterre. Premier traité de Londres (janvier 1358), ce premier traité de Londres fut signé en janvier 1358, par Édouard III d'Angleterre et Jean II de France. Ce traité concernait la libération du roi de France. Édouard III obtient : Les anciennes possessions d'Aquitaine des Plantagenêts : La Guyenne (qui a été confisquée par Philippe VI en début de conflit), la Saintonge, la Poitou, le Limousin, le Quercy, le Périgord, le Rouergue et la Bigorre; Une rançon de 4 millions d'écus; Il ne renonce pas à la couronne de France.
► 1358 - 22 février Étienne Marcel soulève Paris avec l'aide de Charles le Mauvais. Étienne Marcel à la tête d'insurgés parisiens force les portes du Louvre et assassine devant le Dauphin, futur Charles V, le maréchal de Champagne et le maréchal de Normandie qui sont les conseillers du roi. A la tête d'un mouvement insurrectionnel, le chef de la municipalité de Paris, Etienne Marcel pénètre dans l'hôtel du dauphin.
Il fait assassiner sous ses yeux les maréchaux de Champagne et de Normandie. En l'absence du roi Jean II, prisonnier des anglais depuis septembre 1356, le dauphin, futur Charles V, se soumet aux exigences d'Etienne Marcel. Il accepte de renouveler l'ordonnance de réforme de mars 1357 associant les bourgeois à la gestion du royaume et prend le titre de régent dans l'attente de la libération de son père.
► 1358 Tentative de coup d'État d'Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris. Prévôt, au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, le prévôt est un agent d'administration domaniale. Il existe également des prévôts dans l'administration sous l'Ancien Régime, comme le prévôt de Paris (mort en 1789), le prévôt des maréchaux de France, le prévôt général et les prévôts royaux. Prévôt.
Officier du roi ou du seigneur chargé à partir du XIe siècle de rendre la justice et d'administrer les domaines. A Paris, le prévôt des marchands est le chef de la municipalité. Il gère l'arrivée des marchandises par voie d'eau, juge les officiers de la ville, exerce la justice entre les marchands et les commis, répartit la capitation, administre les dépenses relatives aux édifices, etc. Après la révolte d'Étienne Marcel, le roi limite les pouvoirs du prévôt dans la capitale.
► 1358 - 14 mars Le dauphin Charles devient régent.
► 1358 mars Le dauphin, régent quitte Paris pour Compiègne.
► 1358 - 21 mai Grande jacquerie contre les seigneurs. Des paysans du Beauvaisis (nord du Bassin parisien) se révoltent contre les taxations royales et seigneuriales (il faut alors payer la rançon du roi Jean le Bon, prisonnier des Anglais). Ils se regroupent en bande, pillent et incendient les châteaux, tuent les nobles. La révolte s'étend, menée par Etienne Marcel, le prévôt des marchands de Paris. Mais le roi de Navarre, Charles le Mauvais, écrasera les "Jacques" à Mello le 10 juin. Le mot "jacquerie" vient de "Jacques" le surnom des paysans, des vilains.
► 1358 - 28 mai Début du mouvement de la Jacquerie. Cette révolte des paysans de Picardie, d'Ile-de-France et de Champagne commence ce jour par une rixe entre paysans armés et les habitants de Saint-Leu-d'Esserent. L'émeute des Jacques, paysans riches qui soutiennent le roi de France, prisonnier en Angleterre, qui ont coupé l'approvisionnement de Paris où Étienne Marcel se dresse contre le Dauphin, futur Charles V, sera violemment écrasée par Charles de Navarre, le 10 juin suivant à Mello. La Jacquerie, éclata le mouvement populaire appelé la Jacquerie, du nom de Jacques sous lequel on désignait par dérision les paysans.
Ceux-ci, exaspérés par les longues misères résultant de l'invasion de la France par les bandes anglaises, se soulevèrent contre l'autorité royale et contre leurs seigneurs, dont ils pillèrent et brûlèrent les châteaux. Cette révolte fut durement réprimée et échoua misérablement. Pendant ce temps, le pays était dévasté par les Grandes Compagnies, bandes formées, pour la plus grande partie, des mercenaires étrangers qui avaient fait partie de l'armée du roi Jean, défaite à Poitiers, et avaient été licenciés sur place, et probablement sans solde.
Gens de sac et de corde, ils ne vivaient que de pillage dans les pays qu'ils parcouraient en tous sens jusqu'à ce qu'ils n'en pussent plus rien tirer. Les méfaits de ces bandes, en révélant le danger qu'il y avait à faire défendre le territoire national par des mercenaires étrangers dont on ne pouvait plus ensuite se débarrasser, furent sans doute une des raisons pour lesquelles les États généraux de 1357 votèrent la création d'une armée permanente de 30 000 hommes. Cette année 1358 fut encore marquée par une insurrection des habitants de Paris contre le dauphin Charles, qui faisait percevoir des impôts sans l'autorisation des États généraux.
► 1358 - 10 juin Écrasement de la révolte paysanne par Charles le Mauvais et Étienne Marcel. Charles le Mauvais écrase les jacques. Charles le Mauvais qu'Étienne Marcel a fait sortir de prison, achève de tailler en pièce, à Meaux, les jacques qu'entraîne un certain Guillaume Carle et qui se sont révoltés en Picardie, en Champagne et en Beauvaisis, depuis le 28 mai, contre les nobles et les propriétaires.
► 1358 - 31 juillet Étienne Marcel est exécuté par les partisans du dauphin (futur Charles V). Troublés que le prévôt des marchands de leur ville, capitale du royaume de France, puisse espérer le secours des armées de l'Angleterre et de la Navarre, et inquiets qu'il nomme capitaine de la ville, Charles le Mauvais qui prétend au trône de France avec le soutien des Anglais, les Parisiens, en ce 31 juillet 1358, exécutent Étienne Marcel et ses partisans.
► 1358 - 2 août Le dauphin (futur Charles V) regagne Paris.
► 1359 - 24 mars Jean II signe le second traité de Londres. Deuxième traité de Londres (l'endenture mars 1359), Ce second traité de Londres appelé également l'Endenture fut signé par Édouard III d'Angleterre et Jean II de France le 24 mars 1359. En France, le pouvoir de la noblesse est discréditée par les défaites militaires. Les Jacqueries sont exploitées par des opportunistes qui font sombrer le pays dans la guerre civile.
Etienne Marcel le prévôt des marchands de Paris et chef du tiers état tente de prendre le pouvoir à la faveur des états généraux. Charles le Mauvais tente de profiter de la situation pour revendiquer la couronne alors que ses parents y avaient renoncé. Profitant des troubles, Édouard III d'Angleterre impose un second traité encore plus contraignant. Par ce traité Jean II le Bon accordait au roi d'Angleterre les anciennes possessions d'Aquitaine des Plantagenêts: La Guyenne (qui a été confisquée par Philippe VI en début de conflit), la Saintonge, le Poitou, le Limousin, le Quercy, le Périgord, les comtés de Gaure et de Bigorre, l'Angoumois, l'Agenais, Calais, le Ponthieu et la Gascogne.
Il accordait également toutes les terres qui ont un jour appartenu à l'Angleterre : le Maine, la Touraine, l'Anjou et la Normandie. Le roi d'Angleterre reçoit l'hommage du duc de Bretagne. Ce qui permet de régler la guerre de succession de Bretagne en faveur de Jean de Montfort allié des Anglais. De plus il accordait la suprématie du duché de Bretagne au souverain anglais. Il s'agissait d'un véritable dépeçage du royaume de France. Quelles furent les menaces utilisées par le roi d'Angleterre, quelles furent les serments faits par Édouard III d'Angleterre, quelle rouerie, quelle perfidie le souverain anglais a t-il employé pour amener Jean II le Bon à céder autant de terres françaises au souverain anglais.
Le montant exhorbitant de la rançon pour la libération de Jean II le Bon (4 millions d'écus) devait être versé aux Anglais avant le 24 juin 1360. Cela représente plus de la moitié du territoire et plusieurs années de recettes fiscales. Accepter ces conditions discréditerait définitivement les Valois et risqueraient de faire ressombrer le Royaume dans la guerre civile offrant à Édouard III d'Angleterre la couronne sur un plateau. Lorsque ce second traité de Londres se trouva entre les mains des conseillers royaux, d'une seule voix ceux-ci refusèrent ce traité déshonorant, humiliant et dangereux pour le royaume de France.
► 1359 - 8 juin Bertrand du Guesclin prend Melun à Charles le Mauvais. Bertrand du Guesclin, né en 1320 à la Motte-Broons près de Dinan, mort en juillet 1380 devant Châteauneuf-de-Randon, est un connétable de France. il gagne le respect de la noblesse à la pointe de son épée. Engagé dans l'armée française à l'âge vingt ans et ne la quittera plus par la suite, il conduira de nombreuses attaques contre les Anglais dans les forêts bretonnes entre 1342 et 1360, à la tête d'une bande de partisans. Il participera à la défense de Rennes, assiégé par le duc de Lancaster, en 1356, avant d'être nommé lieutenant l'année suivante.
Il rendra part alors à plusieurs batailles contre les Anglais et les Navarrais, jusqu'en 1364. Victorieux à Cocherel, il sera nommé capitaine général des pays situés entre la Seine et la Loire, puis partira pour l'Espagne à la tête d'une armée de mercenaires. Il détrônera le roi de Castille Pierre le Cruel pour le remplacer par son demi-frère, Henri de Trastamare, allié des Français. Cette campagne durera cinq ans.
Promu connétable de France en 1370, Du Guesclin entreprendra la conquête du Périgord, du Poitou, de l'Angoumois, d'Aunis, et de la Normandie. Il luttera contre les Grandes Compagnies (pilleurs) qui sévissaient en Auvergne, à partir de 1379. Du Guesclin décédera pendant le siège de Châteauneuf-de Randon et aura droit à quatre sépultures : une à la basilique Saint-Denis, près du roi de France, une au Puy, une à Clermont-Ferrand et la dernière à Dinan, la seule demeurée inviolée. Le cénotaphe où repose son coeur, se trouve à l'église Saint-Sauveur de Dinan.
► 1359 - 25 juin Rejet du traité de Londres par le régent et les États Généraux.
47 - De 1360 (Traité de Brétigny) à 1420
► 1360 - 1er mai Ouverture des négociations du traité de Brétigny. Les négociations commencent. L'Angleterre envisage de libérer le roi Jean II le Bon moyennant une rançon de 3 millions d'écus et des avantages en droit sur la Guyenne, le Ponthieu, Calais et Guines. Jean le Bon, le traité signé, rentrera en France, laissant en otage son fils le duc d'Anjou (futur Louis Ier de Naples). Mais, parce que ce dernier s'évade, par respect pour sa parole donnée, le roi revient à Londres.
Louis Ier de Naples, Louis Ier, comte, puis duc d'Anjou, roi titulaire de Naples, (né à Vincennes le 23 juillet 1339 - mort au château de Biseglia, près de Bari, Italie, le 20 septembre 1384) est le deuxième fils de Jean le Bon et de Bonne de Luxembourg. Il est fait comte de Poitiers en 1350, comte d'Anjou et du Maine en 1356 ainsi que lieutenant du royaume la même année et enfin duc d'Anjou en 1360. Il est empereur titulaire de Constantinople (1383-1384), roi titulaire de Naples (1382-1384), duc d'Anjou, comte de Provence et de Forcalquier (1381-1384) et roi titulaire de Jérusalem.
► 1360 - 8 mai Traité de Brétigny. Édouard III d'Angleterre renonce au trône de France en échange de l'Aquitaine. l'Angleterre rendait la liberté au roi Jean II moyennant une rançon de trois millions d'écus d'or; et la France renonçait à tous droits sur la Guyenne, le Ponthieu et les villes de Guînes et de Calais. Jean le Bon rentra en France, laissant son second fils, le duc d'Anjou (Louis Ier de Naples), en otage à Calais, jusqu'au paiement de la rançon, mais le jeune prince s'étant évadé, le roi vint reprendre à Londres sa captivité, par respect dit-il de sa parole, et surtout, disait-on, parce que la captivité lui était douce.
Le traité de Brétigny est signé le 8 mai 1360, à Brétigny, (un village près de Chartres), entre Édouard III d'Angleterre et Jean II le Bon, à la fin d'une chevauchée, interrompue après un terrible orage de grêle. Il ne fut pas durable, mais permis une trève de neuf ans pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453), dont il marque la fin de la première phase. Le traité met un terme aux quatre années de captivité à Londres de Jean II le Bon, prisonnier à la bataille de Poitiers le 19 septembre 1356, libéré contre une rançon de 3 000 000 de livres.
Des otages sont livrés pour garantir le paiement, dont le plus important est sans doute son ambassadeur et conseiller : Bonabes IV, sire de Rougé et de Derval. Durant cette captivité le Dauphin, futur Charles V avait du faire face à une révolte d'Étienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, et à une jacquerie paysanne qui avaient affaibli le pouvoir de négociation français. L'Anglais obtient la Guyenne et la Gascogne en toute souveraineté ainsi que Calais, le Ponthieu et le comté de Guines. Il obtient également le Poitou - dont l'un des fils de Jean II, Jean, est pourtant comte -, le Périgord, le Limousin, l'Angoumois et la Saintonge.
Enfin, il devient souverain de toutes les terres du comte d'Armagnac (Jean Ier d'Armagnac) en recevant l'Agenais, le Quercy, le Rouergue, la Bigorre et le comté de Gaure. Les années suivantes, l'armée française commandée par Bertrand Du Guesclin, bat le roi de Navarre Charles le Mauvais et ses alliés anglais à Cocherel le 16 mai 1364, mais sera vaincu à la bataille d'Auray et fait prisonnier.
Traité de Brétigny. Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans. L'Angleterre envisage de libérer le roi Jean II le Bon moyennant une rançon de 3 millions d'écus et des avantages en droit sur la Guyenne, le Ponthieu, Calais et Guines. Jean le Bon, le traité de Brétigny signé (3 mai 1360), rentre en France, laissant en otage son fils le duc d'Anjou (Louis Ier de Naples). Mais, parce que ce dernier s'évade, par respect pour sa parole donnée, le roi revient à Londres.
► 1360 - 24 octobre Paix de Calais, ratification du traité de Brétigny. Édouard III d'Angleterre a déjà compris qu'il lui sera impossible de monter sur le trône de France. Le traité de Brétigny signé le 9 mai précédent était le premier signe de cette acceptation. En ce jour, il a renoncé à sa prétention à la couronne de France et libéré, en contrepartie d'une rançon de trois millions d'écus, le roi Jean II le Bon, prisonnier à Londres. En échange, la France reconnaît sa suzeraineté sur la Guyenne, la Gascogne, la Saintonge, l'angoumois, le Périgord, le Rouergue, l'agennais, le Poitou, le Limousin, le Ponthieu et Calais.
► 1360 - 8 juillet Jean II rentre en France.
► 1360 - 5 décembre Ordonnance de Compiègne instaurant l'impôt et le franc. C'est la guerre qui a convaincu les Français de se résigner à l'impôt. En 1356, le roi Jean le Bon est battu et fait, prisonnier par les Anglo-Gascons à Poitiers. Après quatre années noires, la paix est conclue et le roi libéré, mais il faut payer sa rançon, ou du moins, la première échéance, même si elle est un peu réduite. En conséquence, l'ordonnance de Compiègne, du 5 décembre 1360, met en place un système fiscal qui repose sur l'impôt indirect.
Franc, la première monnaie ainsi désignée est le franc à cheval, frappée en 1360. Le franc à cheval est le premier franc français, monnaie d'or à 24 carats pesant 3,88 grammes, émise pour financer la rançon du roi Jean II le Bon (1350-1364), prisonnier des Anglais. Crée le 5 décembre 1360, et mis en circulation en février 1361 jusqu'en 1364. Le nom "franc" signifiant "libre". Le franc fut émis à la valeur d'une livre tournois, et le mot franc devint vite synonyme de livre.
► 1360 Retour de captivité du roi Jean II.
► 1361 - 21 novembre Philippe Ier de Bourgogne meurt de la peste à Rouvres sans postérité.
► 1361 Jean le Bon fonda la deuxième maison de Bourgogne, en donnant cette province en apanage à son quatrième fils, Philippe II de Bourgogne (dit Philippe le Hardi), qui avait bravement combattu à ses côtés à Poitiers. Cette maison, qui devait s'éteindre en 1477, fut successivement représentée, après Philippe le Hardi, par Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. La première maison de Bourgogne était issue de Robert le Pieux.
Philippe II de Bourgogne, Philippe de France, duc de Bourgogne sous le nom de Philippe II, dit le Hardi, né à Pontoise le 17 janvier 1342, est le quatrième fils du roi de France Jean le Bon et de Bonne de Luxembourg. Il gagne son surnom au côté de son père à la bataille de Poitiers en 1356. Il reçoit le duché de Bourgogne en 1363. Il épouse en 1369 Marguerite de Flandre, veuve de Philippe de Rouvre, et se trouve ainsi à la tête des deux principautés quand meurt en 1384 le comte de Flandre Louis II de Male.
Le duché de Bourgogne prend forme en 888 lorsque que Richard le Justicier se voit autorisé par le roi Eudes de réunir les comtés d'Autun, de Sens, d'Auxerre et de Troyes. Il prend alors le titre de marquis (marchio) puis celui de duc (dux). En 1361 le duc Philippe de Rouvre meurt sans héritier, le roi de France Jean II le Bon récupère le duché et l'octroie à son fils Philippe le Hardi. Les descendants de ce dernier s'attachent à en faire une grande principauté, tendant à l'indépendance.
Conquêtes et alliances matrimoniales mettent les ducs de Bourgogne à la tête de vastes et riches domaines en Flandre et aux Pays-Bas, faisant d'eux de redoutables compétiteurs des rois de France au moment ou ceux-ci affrontent l'ennemi anglais. Philippe le Bon se fait reconnaître indépendant par le roi français Charles VII avec le traité d'Arras en 1435. En 1471, Charles le Téméraire proclame l'indépendance, cependant il ne tarde pas à mourir et le roi Louis XI s'empare alors du duché de Bourgogne. Charles Quint, héritier des ducs de Bourgogne n'aura de cesse de faire reconnaître ses droits au duché de Bourgogne auprès de son adversaire François Ier, sans aucun succès.
► 1362 Édouard III d'Angleterre donne à son fils, le Prince Noir, le duché d'Aquitaine, avec Bordeaux pour capitale.
► 1362 - 6 avril Défaite de Jean II le Bon à Brignais. La bataille de Brignais oppose les Grandes compagnies et l'armée royale française commandée par Jean de Melun, comte de Tancarville. Le 6 avril 1362, les Grandes compagnies bénéficiant de l'effet de surprise, taillèrent en pièce l'armée royale. Plusieurs barons trouvèrent la mort, parmi lesquels Jacques de Bourbon, comte de La Marche, connétable de France et Louis Ier d'Albon, comte de Forez.
En outre, beaucoup de seigneurs furent capturés. Cette défaite fut provoquée par le manque de discipline des chevaliers, qui progressaient sans la protection indispensable des éclaireurs et des flanqueurs (éclaireurs disposés sur les flancs d'une armée) et ne disposaient pas de piétaille (infanterie). Brignais est une commune française, située dans le département du Rhône et la région Rhône-Alpes.
► 1362 Édouard III d'Angleterre permet que l'on plaide en anglais devant le parlement anglais. / Statute of Pleading qui encourage l'anglais est rédigé en français.
► 1363 - 27 juin Jean II nomme son fils Philippe le Hardi gouverneur de Bourgogne.
► 1363 - 6 septembre Jean II donne le duché de Bourgogne en apanage à son fils Philippe le Hardi.
► 1363 à 1431 - naissance et mort de Christine de Pisan. Femme de lettres italienne, elle est une des rares figures féminines de la littérature française du Moyen Âge. Elle est aussi la première femme à avoir fait de son goût pour les lettres un métier, considérée d'ailleurs de ce fait avec sévérité par les critiques du XIXe siècle. Grâce à ses propres oeuvres, riche en confidences autobiographiques, son existence passablement mouvementée et son parcours littéraire sont relativement bien connus.
► 1363 Session du Parlement anglais s'ouvre par un discours en anglais.
► 1364 - 2 janvier Jean II retourne en Angleterre se constituer prisonnier à la place de son fils qui s'est échappé.
► 1364 - 7 avril Bertrand du Guesclin prend Mantes.
► 1364 - 8 avril Mort de Jean le Bon à Londres, en captivité. On ne sait de quoi, à cinquante-cinq ans, meurt le roi à nouveau prisonnier. Par respect pour sa parole donnée, il est revenu se constituer prisonnier après l'évasion de son fils, le duc d'Anjou (Louis Ier de Naples). A Londres, on le dit mort d'apoplexie mais, parce qu'on le sait mauvais joueur, on est prêt à croire qu'il aurait pris un mauvais coup au cours d'une partie d'échecs.
Il avait épousé Bonne de Luxembourg, dont il eut Charles V qui lui succéda, et Philippe le Hardi qu'il fit duc de Bourgogne. - Avènement de Charles V (né en 1337) surnommé le Sage, tant à cause de son savoir que de la prudence avec laquelle il gouverna. Le règne s'ouvrait dans de mauvaises conditions. Charles V sut s'entourer d'hommes de valeur et arriva à surmonter toutes les difficultés résultant des règnes précédents. Il eut surtout à lutter contre Charles le Mauvais, roi de Navarre, Pierre le Cruel, roi de Castille, les Grandes Compagnies et les Anglais. Son meilleur général fut le Breton Du Guesclin. Il laissa la France relativement prospère.
► 1364 Premiers établissements français à la Côte d'Afrique (les Dieppois en Guinée et au Sénégal).
► 1364 - 16 mai Victoire de Bertrand du Guesclin en Normandie à la bataille de Cocherel. Charles le Mauvais s'est rebellé en raison de la succession de Bourgogne à laquelle il prétend. Les troupes du captal de Buch qu'il envoie sont taillées en pièces par un chevalier “d'une laideur à faire peur aux dames” aussi fort qu'illettré, Bertrand du Guesclin. Victoire de Du Guesclin, sur Jean de Grailly, Captal de Buch, qui commandait les troupes de Charles le Mauvais.
Captal de Buch, Jean III de Grailly, dit le Captal de Buch, mort à Paris en 1377, est l'un des principaux capitaines de la guerre de Cent Ans. À l'instar de ses ancêtres, il épouse avec ardeur la querelle anglaise contre la maison de France. La bataille de Cocherel a lieu le 16 mai 1364 entre Charles V de France dont l'armée est commandée par Bertrand du Guesclin et Charles II de Navarre dont les troupes sont sous les ordres du captal de Buch (Jean de Grailly) ainsi que des archers anglais sous Blancbourg et Joüel et des routiers tels que Arnaud-Amanieu d'Albret.
► 1364 CHARLES V le Sage (1364-1380)
► 1364 Charles V le Sage. Lorsque Jean le Bon est fait prisonnier par les Anglais de 1356 à 1360, c'est son fils Charles futur Charles V qui assure la régence. Il devra faire face à une situation très dégradée. C'est la plus grave crise qu'ait connu la monarchie française. Les états généraux tentent d'imposer au régent une réforme profonde du système de gouvernement avec un contrôle de leur part, c'est la grande ordonnance de 1357. Accèder à leurs demandes reviendrait à instaurer une monarchie parlementaire.
Les campagnes se révoltent (jacqueries). Le roi de Navarre, Charles le Mauvais qui était prisonnier pour avoir semé des troubles, s'est évadé et traite avec Édouard III d'Angleterre pour se partager la France. Des bandes à la solde de Charles le Mauvais ravagent le royaume, et de conivence avec Étienne Marcel (prévôt des marchands de Paris) ils organisent des manifestations. Étienne Marcel est tué par le peuple de Paris accusé de vouloir livrer Paris à l'Anglais.
Charles V parvient à surmonter toutes ces difficultés. Le 8 avril 1364 Charles V devient roi de France. Charles V confie le commandement de ses armées au chevalier Bertrand du Guesclin. Il doit tout d'abord faire face à la révolte de Charles le Mauvais qu'il bat à Cocherel en 1364. Ensuite il doit résoudre le problème des grandes compagnies, ces bandes de soldats ou de mercenaires qui pillent les campagnes. En Espagne un conflit nait entre Pierre le Cruel (il à déjà fait assassiner un de ses frères) roi de Castille et son autre frère Henri de Trastamar qui est réfugié en France, pour le trône de Castille.
C'est l'occasion pour du Guesclin de regrouper ces compagnies et de les envoyer se battre en Castille afin de placer Henri de Trastamar sur le trône. Pierre le cruel s'alliera au Prince Noir (fils du roi Édouard III d'Angleterre) gouverneur de Guyenne. Du Guesclin est battu à Najera le 3 avril 1367 mais dégouté du comportement de Pierre le Cruel, le Prince Noir l'abandonne. Cette fois Du Guesclin sera vainqueur à Montiel le 14 mars 1369, Pierre le Cruel meurt le 23 mars de la même année.
Charles V et Du Guesclin se consacrent ensuite à reconquérir les territoires aux mains des Anglais, non pas par de grandes batailles mais par la technique du harcèlement, une guerre d'usure. Elle sera payante, le Rouergue, le Quercy et le Périgord sont récupérés en 1369, puis ce sont le Limousin et le Poitou en 1372 l'Aunis et la Saintonge en 1373. En 1375 les Anglais ne possèdent plus en France que la Guyenne et Calais. Du Guesclin qui avait été fait Conètable de France en 1370 meurt le 13 juillet 1380 au siège de Châteauneuf de Randon.
Le roi le fait inhumer à Saint Denis et il l'y rejoint deux mois après, le 16 septembre 1380. Tout en déployant une activité militaire, Charles V a redressé le royaume, il a renforcé l'autorité royale et rétablit la monnaie. Dépourvu de tout fanatisme religieux il a protégé les Juifs et s'est efforcé de freiner l'activité religieuse dans le Languedoc. Ce fut un roi lettré aimant à s'entourer d'hommes savants et un roi batisseur, il crée une nouvelle enceinte de Paris, modifie la forteresse du Louvre, fait construire la Bastide Saint Antoine dite Bastille, fait construire le donjon de Vincennes et le fortifie.
► 1364 - 19 mai Sacre de Charles V à Reims.
► 1364 - 2 juin Lettres de patentes constituant le duché de Bourgogne en apanage pour Philippe le Hardi. Lettres patentes. Actes royaux, scellés du sceau de la monarchie, dans lesquels le souverain s'adresse en législateur aux diverses cours de justice du royaume.
► 1364 - 29 septembre Bataille d'Auray (épisode de la guerre de Bretagne ou des Deux Jeanne), dans laquelle Jean de Montfort battit son rival Charles de Blois qui y fut tué, et fit prisonnier Du Guesclin qui d'ailleurs racheta peu après sa liberté. Depuis la mort de Jean II le Bon, la guerre de Succession de Bretagne oppose l'épouse de Charles de Blois, Jeanne de Penthièvre, nièce du défunt, à celui qui fut son demi-frère, Jean de Montfort. Le roi de France, Charles V, soutient les prétentions de la première, le roi d'Angleterre celles du second.
En ce jour, les armées anglaises et bretonnes sont commandées par Olivier de Clisson. Les armées des Français (et des Bretons) sont commandées par Charles de Blois. Auprès de lui, Bertrand du Guesclin. Au cours de la bataille, si Olivier de Clisson a un oeil crevé, Charles de Blois est tué, et Bertrand du Guesclin, se battant encore avec une épée brisée, est fait prisonnier par un conseiller du Prince Noir, qui lui lance : “Vous serez plus heureux une autre fois, messire Bertrand”. Ce sont 40 000 florins d'or que du Guesclin fixe pour sa rançon.
Si les Anglais alliés aux Bretons l'emportent et imposent que Jean de Montfort devienne duc de Bretagne sous le nom de Jean IV de Bretagne, le roi de France obtient qu'à ce titre il lui rende hommage. Charles de Blois, aussi appelé Charles Ier de Bretagne, est né en 1319 à Blois. Il a été canonisé comme Charles de Blois (bienheureux). Il est Baron de Mayenne, Comte de Penthièvre, Seigneur de Guise, et duc de Bretagne. La bataille d'Auray (29 septembre 1364) est la dernière bataille de la guerre de Succession de Bretagne. Elle joue un rôle dans la guerre de Cent Ans.
► 1364 Giovanni de Dondi (1318-1389) vient d'achever l'astrarium, une horloge astronomique, après seize années de labeur. L'ensemble de son travail est relaté dans deux traités l'Opus Planetarium et le Tractatus Astrarium. Ces traités sont si précis qu'ils ont même permis la reproduction de l'horloge. C'est le début de l'horlogerie de précision.
► 1364 Messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut. Probablement à l'occasion du sacre de Charles V, Guillaume de Machaut compose la Messe de Notre-Dame. Cette oeuvre est la première messe polyphonique à être composée par un seul homme. Elle représente l'apogée de l'Ars Nova dont Machaut fut le principal représentant.
► 1365 mars Traité d'Avignon : Après sa défaite à la bataille de Cocherel, Charles le Mauvais signe le traité d'Avignon où il abandonne ses possessions de Basse-Seine en Normandie contre la ville de Montpellier. La trêve d'Avignon est une interruption des combats de la guerre de Cent Ans, signée par les plénipotentiaires navarrais et français tous réunis à Avignon sur la demande du pape Urbain VI qui présidait les négociations. Cette trêve ordonnait que les armes soient déposés le 6 mars 1365.
► 1365 - 12 avril Traité de Guérande: Après la victoire d'Auray en septembre 1364 où Charles de Blois a été tué et Bertrand du Guesclin fait prisonnier, Jean de Monfort se fait reconnaître le titre de duc de Bretagne par Charles V le Sage, roi de France. Cette décision met fin à ce que l'on a appelé la guerre des Jeanne, Jeanne de Penthièvre, nièce de Jean III de Bretagne et Jeanne de Flandre. La Bretagne était attribuée à la maison de Montfort qui se reconnaissait vassale du roi de France et la maison de Blois (soutenue dans cette guerre par la France) recevait le comté de Penthièvre et la vicomté de Limoges.
Le premier traité de Guérande est signé en 1365. Il met fin à la première guerre de Succession de Bretagne qui opposait Jeanne de Penthièvre, nièce du dernier duc Jean III de Bretagne, soutenue par son époux Charles de Blois, à Jean de Montfort, demi-frère du précédent. Après sa mort, son fils Jean IV de Bretagne reprend sa revendication et finit par triompher à la bataille d'Auray. Le traité établit Jean IV de Bretagne comme héritier légitime. Il ne repousse pas totalement les prétentions des Penthièvre, puisqu'il établit ainsi la loi successorale en Bretagne : le duché se transmettra de mâle en mâle dans la famille des Montfort ; si l'héritage tombe en quenouille, il passera aux mâles de la famille de Penthièvre.
► 1365 Traité de Saint-Denis, qui mit fin à la guerre entre la France et la Navarre. Charles le Mauvais renonçait à ses prétentions au trône de France et abandonnait le duché de Normandie; il recevait par contre la seigneurie de Montpellier.
► 1366 à 1369 - Les Grandes Compagnies infestaient la France de leurs déprédations. Pour en débarrasser le pays, Charles V chargea Du Guesclin de les conduire en Espagne, au service d'Henri de Transtamare, révolté contre son frère, Pierre le Cruel, roi de Castille, qui avait fait étrangler leur mère. Du Guesclin pénétra avec ces bandes en Castille et fit couronner Henri de Transtamare à Burgos. Pierre le Cruel se réfugia à Bordeaux auprès du Prince Noir, avec l'appui duquel il ne tarda pas à recommencer la lutte.
Les grandes compagnies de mercenaires durant la guerre de Cent Ans, pendant les périodes de paix, se regroupaient en Grandes Compagnies ou routes - on parle aussi de routiers - et vivaient sur le pays environnant. Pierre le Cruel, Pierre Ier de Castille, (né le 30 août 1334 à Burgos mort le 23 mars 1369 à Montiel), seul fils légitime du roi Alphonse XI et de Marie de Portugal (fille du roi Alphonse IV de Portugal), connu comme Pierre le Cruel, fut roi de Castille et Leon (1350 – 1369). Henri de Trastamare (13 janvier 1334 Séville - 29 mai 1379 Santo Domingo de la Calzada), fut le fils bâtard d'Alphonse XI de Castille et Éléonore de Guzman, le demi-frère de Pierre Ier de Castille le cruel.
► 1366 janvier-mars Intervention française en Espagne.
► 1367 - 3 avril Bataille de Navarette. Du Guesclin, qui mène campagne pour le roi Charles V, tente de renverser depuis le début de 1366 Pierre le Cruel, roi de Castille, pour imposer sur le trône de Castille Henri de Trastamare. En ce jour, il est battu à Najera par les alliés de Pierre le Cruel : le Prince Noir et Chandos. Ces derniers le monnaient contre une rançon.
► 1367 - 16 octobre Le pape Urbain V quitte Avignon pour s'installer à Rome.
► 1368 - 3 septembre Naissance de Charles (futur Charles VI), fils de Charles V. Charles VI de France, dit Charles le Bien Aimé, puis Charles le Fol, (né à Paris, le 3 décembre 1368 - mort à Paris, le 21 octobre 1422) fut roi de France de 1380 à 1422. Il est le fils de Charles V et Jeanne de Bourbon.
► 1368 à 1644 - La dynastie mongole Yuan est renversée en Chine et est remplacée par la dynastie chinoise Ming (1368-1644). La dynastie Ming, 1368-1644, fut une lignée d'empereurs de Chine. Au milieu du XIVe siècle, après plus d'un siècle de domination mongole sous les Yuan, la population chinoise rejeta le "règne des étrangers". Ce mouvement, qui pris la forme d'une suite de révoltes paysannes, repoussa la dynastie Yuan dans les steppes mongoles et établit la dynastie Ming en 1368.
La dynastie Ming s'ouvrit sur une renaissance culturelle : les arts, particulièrement l'industrie de la porcelaine, se développèrent comme jamais auparavant. Hongwu, de son nom personnel Zhu Yuanzhang, fut l'empereur fondateur de la dynastie Ming. Il régna en Chine de 1368 à 1398. Paysan dans la province de l'Anhui, il dut se faire moine pour échapper à la famine qui résulta de l'incapacité à régner de la dynastie tombante des Yuan. Puis, à Gwongjau, il rejoint la secte du lotus blanc qui fomenta des troubles contre la dynastie régnante. Il en vint à combattre les Mongols de l'empereur Shundi.
C'était un excellent général et, scrupuleux, il interdit à ses hommes tout pillage, ce qui lui valut le soutien des populations qu'il conquit. Il eut également la sagesse d'éclipser la plupart des autres chefs rebelles. Puis, quand il arriva à Khanbalik (Pékin) avec ses troupes, les Mongols avaient déjà fui. L'année 1368 marqua la fin de la dynastie Yuan en Chine. Il se proclama empereur la même année. Il installa sa capitale à Nanjing et s'y fit bâtir un palais et commença même à y faire construire son grandiose mausolée.
C'était un homme particulièrement méfiant, et il était convaincu qu'un complot mettant en scène des fonctionnaires et des eunuques le menaçait. Ainsi, il en fit condamner nombre d'entre eux pour écrits subversifs. Il prit tout le pouvoir dans ses mains, l'autocratie montait. Il reboisa les endroits qui se déboisaient pour ainsi éviter les glissements de terrains. Il recommença à faire irriguer les terrains agraires. Le but était de renouveler et de faire prospérer une économie ruinée par les Mongols. Finalement, l'économie en revint à prospérer. Il mourut à Nanjing à 70 ans.
► 1368 Charles V reprend l'avantage sur les Anglais avec l'aide de Du Guesclin et des nombreuses régions du Sud-Ouest soulevées contre le Prince noir (1368-1380).
► 1368 Le roi Charles V installe sa librairie au Louvre, elle compte 900 manuscrits (début de la Bibliothèque nationale de France). Charles est un patron des arts, et il reconstruit le Louvre en 1367 et y fonde la première Bibliothèque royale de France qui deviendra quelques siècles plus tard la Bibliothèque nationale. Charles V fit aménager dans la Tour de la Fauconnerie des pièces où il transféra une partie de ses livres (à l'époque de 965 livres), il confia cette bibliothèque à Gilles de Malet (1368).
La légende veut que Charles V les ait tous lus, ce qui ne serait pas étonnant, son surnom de Sage incluant sa grande culture et ses connaissances variées, un fait exceptionnel pour son époque. La Bibliothèque nationale de France tire son origine de la bibliothèque du roi, constituée au Louvre par Charles V au XIVe siècle. Le premier libraire du roi s'appelait Gilles Mallet. Toutefois, c'est seulement à partir de Charles VIII (fin du XVe siècle) que la bibliothèque du roi connaît une certaine continuité, sans dispersion des collections.
► 1369 - 15 janvier Victoire française à Montalzat contre Édouard III d'Angleterre.
► 1369 - 19 juin Bataille de Montiel, gagnée sur les Anglais et les partisans de Pierre par Du Guesclin. Pierre le Cruel est tué peu après dans une rixe par son frère, Henri de Transtamare, qui prend la couronne de Castille.
► 1369 à 1380 - Sur les plaintes des seigneurs gascons, causées par les exactions du Prince Noir, Charles V cita ce dernier à comparaître devant la Cour de Paris, mais il se déroba, et Du Guesclin reprit les armes contre lui, secondé par Olivier de Clisson et par Boucicaut. Dans cette guerre, sur les instructions de Du Guesclin, les chefs français évitèrent les grandes rencontres, s'attachant surtout à réduire les Anglais en détail. Cette tactique réussit pleinement; les Anglais furent peu à peu chassés des territoires qu'ils occupaient.
A la mort de Charles V, ils ne tenaient plus que les places de Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux et Bayonne. Olivier V de Clisson est né le 23 avril 1336 au château de Clisson. Son existence fut jalonnée de multiples retournements. Il fit preuve d'une exceptionnelle valeur militaire, mais sa position de grand féodal qui le plongea au coeur des antagonismes de la guerre de Cent ans en fait un personnage-clé de l'Histoire de France. Boucicaut, Jean II Le Meingre, surnommé Boucicaut deuxième du nom, (né en 1364, Tours - mort en Angleterre, dans le Yorkshire, le 21 juin 1421), maréchal de France.
► 1369 - 30 novembre Charles V confisque l'Aquitaine aux Anglais.
► 1369 - décembre Convocation des États Généraux pour la levée de nou-veaux impôts.
► 1369 Philippe le Hardi, frère du roi, devient duc de Bourgogne.
► 1370 - 11 août Charles V prend Limoges.
► 1370 - 19 septembre : Sac de Limoges par le Prince Noir qui reprend la ville : massacre de la garnison "française".
► 1370 - 27 septembre retour du pape Urbain V en Avignon. Urbain V, Guillaume de Grimoard (1310-1370) devint pape sous le nom de Urbain V. La papauté à Avignon, les papes d'Avignon sont tous français selon le territoire actuel. En réalité, ce sont des papes de langues d'oc dont la région d'origine dépendait, soit directement du roi de France, soit du roi d'Angleterre (pour ses terres relevant du roi de France), soit du comté de Provence (qui relevait du saint Empire romain germanique.
Ce sont Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V et Grégoire XI. Urbain V prendra la décision de retourner à Rome mais la situation chaotique qu'il y trouve l'empêche de s'y maintenir. Il doit retourner en France pour arbitrer un conflit entre les Français et les Anglais et, de fait, il se réinstalle en Avignon. Il meurt très peu de temps après. Son successeur Grégoire XI décide à son tour de rentrer à Rome, ce qui met fin à la première période de la papauté d'Avignon.
► 1370 - 2 octobre Du Guesclin devient connétable. Connétable (du latin comes stabuli, le comte de l'étable, comprendre comte chargé des écuries et donc, à l'origine, de la cavalerie de guerre) était une haute dignité de nombreux royaumes médiévaux. Selon les pays son rôle était généralement de commander l'armée et de régler les problèmes entre chevaliers ou nobles, via un tribunal spécial, comme la court of Chivalry anglaise ou la juridiction du point d'honneur française.
Parfois, il avait aussi un pouvoir de police. Le connétable était secondé par un ou plusieurs maréchaux. Connétable. Tirant son nom de son origine de "comte de l'étable", le connétable a, au Moyen Âge, la charge de l'écurie et de l'organisation des voyages du roi. Au XIVe siècle, sa fonction évolue vers le commandement de l'armée en temps de guerre et le conseil militaire du roi en temps de paix. Du Guesclin, Clisson, Bourbon… font partie des grands connétables de France. Supprimée en 1627, la charge de connétable est rétablie par Napoléon Ier en 1804 pour son frère Louis.
► 1370 - 4 décembre Victoire de du Guesclin à Pontvallin sur les Anglais.
► 1370 Jean Froissart écrit 'Chroniques'. Ce célèbre chroniqueur, auquel on doit le plus de renseignements sur la guerre de Cent ans et dont les écrits ont beaucoup contribué à nous faire connaître le Moyen Âge, vécut sous ce règne (1325-1400). Jean Froissart (vers 1337, Valenciennes - après 1404) est l'un plus importants des chroniqueurs de la France médiévale. Pendant des siècles, les chroniques de Froissart ont été reconnues comme l'expression majeure de la renaissance chevaleresque dans l'Angleterre et de la France du 14e siècle. Il s'agit également d'une des sources les plus importantes sur la première moitié de la guerre de Cent Ans.
► 1370 Traduction en français pour Charles V du corpus d'Aristote par Nicolas Oresme (1370-1374). Un corpus est un ensemble de documents, artistiques ou non (textes, images, vidéos, etc.), regroupés dans une optique précise. On peut utiliser des corpus dans plusieurs domaines : études littéraires, linguistiques, scientifiques, etc.
► 1370 Nicolas Oresme: Traduction de 'l'Éthique à Nicomaque' et de la 'Politique' d'Aristote : enrichissement de la langue avec lexique mais aussi et surtout grande réflexion sur la langue française dans texte joint : 'Excusacion et commendacion de ceste oeuvre' : dans ce texte Oresme est le premier à avoir une vue à long terme sur les progrès de la langue française, conscient de ses défauts, il est convaincu que le travail des traducteurs la rendra plus précise (perfectibilité du français); il s'inspire de Cicéron face au grec. Il développe également le thème de la translatio studii, le savoir est passé de la Grèce à Rome, il doit passer de Rome à Paris. Il remet totalement en question la situation du latin.
► 1370 vers - Enrichissement du français (nombreuses traductions, aux importantes conséquences sur la langue française, sous Philippe le Bel et particulièrement Charles V, ce dernier étant le premier à vouloir réaliser une bibliothèque d'État).
► 1371 mars Traité de Vernon entre Charles V et Charles le Mauvais, roi de Navarre. Le traité de Vernon fut signé le 29 mars 1371 par Charles V de France et Charles II de Navarre. Ce traité consistait à confirmer celui de Pampelune (3 mars 1365). Toutefois grâce à ce traité Charles II le Mauvais prêta pour la première fois hommage à son beau-frère le roi de France pour ses possessions normandes. De plus Charles II de Navarre bénéficiait de la pleine possession de la baronnie de Montpellier mais toutefois le roi de France conservait un droit de souveraineté sur cette possession du roi de Navarre.
► 1371 septembre Le duc de Bretagne, Jean IV de Bretagne, s'allie au roi d'Angleterre.
► 1372 - 23 juin Les Castillans (Castille) détruisent la flotte anglaise au large de La Rochelle.
► 1372 - 13 août Du Guesclin prend Poitiers.
► 1372 - 23 août Du Guesclin prend La Rochelle.
► 1373 - 21 mars Victoire de Du Guesclin à Chizé. Chizé est une commune française, située dans le département des Deux-Sèvres et la région Poitou-Charentes.
► 1373 - 25 juillet Débarquement anglais à Calais.
► 1374 mort du poète italien Pétrarque à Arquà en Toscagne, un jour avant son 70ème anniversaire.
► 1375 - 1er juillet Trêves de Bruges entre la France et l'Angleterre. La trêve de Bruges fut signée le 27 juin 1376. Le roi Charles V de France gardait tous les territoires conquis lors de ses diverses opérations militaires. Le duché de Bretagne fut rendu à la France, hormis Brest, Auray et Berval qui demeuraient les possessions de Jean IV de Bretagne.
► 1376 Mort d'Édouard de Woodstock, prince de Galles, dit le Prince Noir, (Woodstock, 1330 - Westminster, 1376).
► 1377 - 17 janvier Grégoire XI réinstalle la papauté à Rome. Grégoire XI, Pierre-Roger de Beaufort (château de Maumont, diocèse de Limoges, France (1329 ou 1331 - Rome, 27 mars 1378) fut le 201ème pape du 30 décembre 1370 à sa mort sous le nom de Grégoire XI.
► 1377 - 21 juin Mort d'Édouard III d'Angleterre son petit-fils Richard II lui succède. Richard II d'Angleterre, né le 6 janvier 1367 à Bordeaux et mort le 17 février (?) 1400), est roi d'Angleterre de 1377 à sa mort. Il succède à Édouard III, son grand-père. Richard naît à Bordeaux, où ses parents, Édouard le Prince Noir et Jeanne de Kent, résident en tant que prince et princesse d'Aquitaine. Il devient l'héritier du trône d'Angleterre à la mort du Prince Noir en 1376 et roi le 22 juin 1377 à l'âge de dix ans lorsque son grand-père Édouard III d'Angleterre meurt.
► 1377 juin Reprise des hostilités avec l'Angleterre.
► 1377 à 1446 - naissance et mort de Brunelleschi. Sculpteur et architecte italien. Brunelleschi puise sa vigueur créatrice aux sources antiques pour rationaliser l'espace de la cité moderne et invente la perspective, opposant ainsi au gothique tardif un nouveau système de représentation du monde. Tenu pour un novateur par ses propres contemporains, Brunelleschi laisse une oeuvre architecturale - réalisée pour l'essentiel à Florence, pendant la première moitié du Quattrocento, puis complétée par des élèves comme Michelozzo et Alberti - qui fait de lui un brillant initiateur de la Renaissance.
► 1378 - 8 avril Urbain VI est élu pape. Urbain VI, premier pape italien, élu à Rome, depuis le retour du Saint-Siège dans cette ville le 17 janvier 1377. Né Bartolemeo Prignano, à Naples en 1318, élu pape au printemps 1378, il se rendra tellement odieux auprès des cardinaux français que ceux-ci, six mois plus tard, éliront un pape "avignonais", Clément VII. Ce sera le début du Grand Schisme d'Occident, qui verra deux (et même parfois trois) papes sur le trône de Saint-Pierre. Urbain VI mourra, à Rome en 1389.
► 1378 - 25 avril Capture de Charles le Mauvais par Charles V.
► 1378 - 20 septembre L'élection de Clément VII à la papauté marque le début du Grand Schisme. Grand Schisme (1378-1418), deux papes règnent, un à Rome et un autre en Avignon (jusqu'en 1415). Début du pontificat d'Urbain VI (jusqu'en 1389). Début du pontificat de l'antipape Clément VII (jusqu'en 1394). L'événement fondateur de la crise papale d'alors fut l'accession au titre de pape d'Urbain VI (1378–1389), successeur à Rome de Grégoire XI (qui avait résidé un temps en Avignon). Urbain VI serait devenu fou en prenant sa charge, c'est pourquoi le royaume de Naples déclara que Clément VII (1378–1394) serait le nouveau pape et régnerait en Avignon.
Lors du concile de Pise (1409), on déclara qu'Alexandre V (1409–1410) était lui aussi pape. C'est le concile de Constance (1414), présidé par Jean Allarmet de Brogny qui résolu ce problème d'Église tricéphale. En effet, Jean XXIII fut déposé et Grégoire XII fut poussé à abdiquer. Cependant, Benoît XIII était exilé à Peniscola, au Royaume d'Aragon, qui était le dernier État à le reconnaître. Ne voulant pas abdiquer, dépourvu de presque tout appui, il continuait à se déclarer pape. Il mourut seul (1423) mais avec la certitude d'être toujours le seul pape légitime.
Trois de ses quatre derniers cardinaux élirent tout de même, à Peniscola, l'antipape Clément VIII, qui finit par renoncer, quand le roi d'Aragon lui-même se rallia à Martin V. Martin V, élu le 11 novembre 1417 par ce conclave composé de cardinaux et de représentants de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la France et de l'Italie, prit la suite et s'installa à Rome en 1418, mettant ainsi un terme au Schisme. Martin V avait eu la bonne idée d'annoncer au préalable qu'il ne remettrait pas en cause les nominations de cardinaux effectuées par les deux autres papes, ce qui facilita probablement le consensus à son sujet.
La papauté d'Avignon en compétition avec celle de Rome, la deuxième période de la papauté d'Avignon débute quand les cardinaux, en conflit avec Urbain VI, qu'ils venaient d'élire à Rome après la mort de Grégoire XI, se révoltent contre lui, se réunissent à Fondi, le déposent, et élisent à la place le cardinal français Robert de Genève qui prend le nom de Clément VII. Soutenu par de nombreux États, dont la France, c'est naturellement à Avignon qu'il se réinstalle avec sa cour, tandis qu'Urbain VI et la sienne restent à Rome (les détails de cette période sont donnés à l'article Grand Schisme d'Occident).
À Clément VII succédera à Avignon l'Aragonais Benoît XIII : tous deux sont aujourd'hui considérés comme antipapes par l'Église catholique. Le concile de Pise échoue en 1409 à résoudre le schisme. Il élit un troisième pape (dit pape de Pise bien qu'il ne réside pas à Pise), en la personne d'Alexandre V, très vite remplacé par Jean XXIII. Cependant, le pape de Pise reçoit de nombreux soutiens d'États jusqu'ici fidèles à l'un ou l'autre pape. Le pape Benoît XIII d'Avignon perd ainsi le soutien français et doit s'exiler en Aragon, dernier pays à le soutenir. Il y restera jusqu'à sa mort, aura même des successeurs qui sombreront peu à peu dans l'oubli, mais le départ de Benoît XIII marque la fin définitive de la papauté d'Avignon.
► 1378 - 18 décembre Charles V confisque la Bretagne à Jean IV allié aux Anglais. Jean IV de Bretagne, né en 1339, mort le 9 novembre 1399 à Nantes, duc de Bretagne de 1364 à 1399, fils de Jean de Montfort et de Jeanne de Flandre. Son père mourut en pleine lutte contre Charles de Blois pour la succession de Bretagne et alors qu'il n'avait que six ans. Ce fut sa mère qui poursuivit la guerre, remportant des succès. Il commença à prendre parts aux opérations militaires en 1357. En 1364, il assiégeait Auray quand il apprit que Charles de Blois se préparait à l'attaquer.
Aidé par des renforts envoyés par le Prince Noir, il écrasa Charles de Blois à Auray. Il négocia avec Jeanne de Penthièvre, la veuve de Charles de Blois, le traité de Guérande en 1365, qui le reconnaissait comme duc de Bretagne. Allié à l'Angleterre (il avait épousé une soeur puis une belle-fille du Prince Noir), il se vit attaqué par Charles V qui lui confisqua le duché en 1378. Appuyé sur le nationalisme breton et sur la volonté d'indépendance des barons, Jean IV réagit fortement. Réconcilié avec Charles VI, il gouverne en paix son duché mais doit faire face à la rébellion d'Olivier de Clisson. Il parvient à racheter aux Anglais la place de Brest en 1397.
► 1378 Le 'Songe du Verger' texte anonyme. Le règne de Charles V le Sage est marqué par les progrès du pouvoir royal. Ce roi lettré, qui passait des heures dans sa "librairie" du Louvre, a puisé dans Aristote, qu'il fit traduire, quelques principes de gouvernement exposés en partie dans le 'Songe du verger' : le roi n'est pas seulement l'oint du Seigneur, mais il est encore le gardien de la "République", dont les actes, guidés par la raison, doivent se conformer à certaines règles.
► 1379 - 3 août Jean IV de Bretagne et Richard II d'Angleterre débarquent en France.
► 1380 - 1er mars Le duc de Bretagne s'allie au roi d'Angleterre.
► 1380 - 13 juillet Mort de du Guesclin devant la forteresse de Châteauneuf-Randon tenue par les Anglais et dont il faisait le siège. Charles V voulut qu'il fût inhumé auprès des rois de France, dans l'abbaye de Saint-Denis.
► 1380 - 19 juillet Débarquement anglais à Calais.
► 1380 - 16 septembre Mort de Charles V - Charles le Sage a quarante-quatre ans. Souvent on l'a appelé Charles le Maladif. Une maladie singulière lui a fait perdre ses cheveux et ses ongles. Au moment de mourir, après avoir aboli un impôt qui pesait sur son peuple, il se fait apporter la couronne royale. C'est à elle qu'il s'adresse : “Ah ! précieuse couronne, à cette heure si impuissante et si humble, précieuse par le mystère de justice renfermé en toi, mais vile à cause du fardeau du travail, des angoisses, des tourments, des périls de conscience que tu donnes à ceux qui te portent, s'ils pouvaient le savoir d'avance, ils te laisseraient plutôt tomber en boue que de te placer sur leur tête”.
Le règne de Charles V doit être regardé comme un des meilleurs que la France ai connus. II vit la réalisation de réformes heureuses el de grands progrès. Citons : l'agrandissement et la consolidation du domaine royal; la restauration des finances (vide à l'avènement, le Trésor contenait plusieurs millions à la mort de Charles V); l'économie instaurée dans les services publics, notamment dans la perception des impôts ; la substitution dans le Parlement des légistes aux barons ; la création, sous le nom de Librairie royale, de la Bibliothèque Nationale, dont le premier siège fut dans la Tour du Louvre (commencée avec 20 volumes, elle en contenait 900 quand mourut le roi)
L'établissement du Palais de justice (dans l'ancien château de Saint Louis) ; la fondation de la Bastille (qui ne fut du reste achevée que plus tard), etc. De plus, Charles V fixa à 13 ans révolus la majorité des rois de France. Charles V avait épousé Jeanne de Bourbon, dont il eut Charles VI (né en 1368) qui lui succéda. A la mort de Charles V son fils (né en 1368 de Jeanne de Bourbon) lui succède sous le nom de Charles VI, mais il est mineur et ne gouverne d'abord que sous la tutelle de ses oncles, les ducs d'Anjou, de Bourgogne et de Berry, qui mettent au pillage le trésor royal, lentement constitué par Charles V, et mécontentent la population par leur attitude hautaine et arrogante.
► 1380 CHARLES VI le Fou (1380-1422)
► 1380 Charles VI le fou. Lorsque Charles V meurt, Charles VI n'a que 12 ans. Il est placé sous l'autorité d'un conseil de régence. Il est constitué de ses oncles, les ducs d'Anjou (Louis Ier de Naples, Louis II d'Anjou), de Bourgogne (Philippe le Hardi) et de Berry (Jean Ier de Berry) ainsi que le duc de Bourbon (Louis II de Bourbon) son oncle maternel qui se disputent l'autorité. Sa minorité est marquée par des troubles sociaux les Maillotins à Paris, de la Harelle à Rouen, des Tuchins en Auvergne et par l'insurrection des villes de Flandre ce qui oblige l'armée à intervenir et qui réveille la lutte avec l'Angleterre.
A sa majorité Charles VI renvoie ses oncles et rappelle les anciens conseillers de son père "les marmousets" par dérision et en 1389 Charles VI le bien aimé (appellation d'alors) fait entrer dans Paris Isabeau de Bavière qu'il avait épousée en 1385. Il gouverne avec sagesse conclut des accords avec Gaston Phébus comte de Foix, et Jean duc de Bretagne. Il entreprend des discussions avec Richard II d'Angleterre mais cette négociation échoue à Amiens en 1392. C'est au cours d'une opération contre l'Anglais que les troubles mentaux de Charles VI apparaissent. Il aura des crises plus ou moins espacées d'abattement et de démence.
Encouragés par la folie du roi, les oncles reviennent et se disputent à nouveau le pouvoir. Le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi meurt, son fils Jean Sans Peur prend sa succession. On s'aperçoit vite que Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, mène une politique d'intérêt personnel alors que Louis Ier d'Orléans menait une politique Française. En 1407 Jean Sans Peur fait assassiner le duc d'Orléans (Louis Ier d'Orléans). Soutenu par l'université et la puissante corporation des bouchers, les Bourguignons massacrent les partisans du duc d'Orléans à Paris. Les Bourguignons gouvernent la France.
Pour mettre fin à la guerre avec l'Angleterre on conclut un contrat de mariage entre la fille de Charles VI, Isabelle, et Richard II d'Angleterre, une trêve de 28 ans est signée. Mais voici que des troubles surviennent en Angleterre et Richard II est détrôné par Henri de Lancastre qui règne sous le nom de Henri IV (1399). Il meurt en 1413 son fils hérite du trône. Il règne sous le nom de Henri V et revendique à son tour le trône de France. La guerre reprend. Bernard VII duc d'Armagnac dont la fille a épousé le fils du duc d'Orléans (1410) s'arme.
En 1413 en réaction aux exactions causées par les Cabochiens, qu'on appelait aussi les écorcheurs et dont le Chef Simon Caboche règne en dictateur à Paris, une révolte des parisiens las des violences font appel aux Armagnac. Bernard VII parvient à chasser les Bourguignons de Paris et est fait connétable (chef des armées royales et régent de fait) par la Reine Isabeau de Bavière en 1415. Les armées anglaises débarquent en Normandie avec pour mission de prendre Harfleur qui servira de tête de pont pour les prochaines incursions. L'objectif atteint elles sont sur le point de repartir.
Mais il avait été décidé du coté Français d'attaquer, mais que le roi ne devait pas être présent, bien que lucide, souvenir cuisant de Jean le Bon mais de ce fait il n'y avait personne dont la stature était suffisante pour commander. Un noble ne reçoit d'ordres que du roi. Lorsque les Français attaquent (25 octobre 1415) dans la plaine d'Azincourt, il a plu pendant plusieurs jours, dans la boue les chevaux glissent les cavaliers doivent mettre pied à terre, les flancs sont mal disposés, c'est un massacre. 1500 Anglais et 5000 Français ont péri. Toute la fine fleur de l'aristocratie française est décimée. C'est toute l'administration civile et militaire qui vient de disparaître.
De plus Bernard VII qui a un comportement odieux et tyrannique, est détesté par le peuple de Paris. Abandonné par la Reine il est massacré ainsi que plusieurs milliers de ses partisans par les Parisiens (1418). A nouveau ce sont les Bourguignons qui reviennent au pouvoir, qui concluent une alliance avec l'Angleterre (1419) et avec la complicité de la reine Isabeau de Bavière concluent le traité de Troyes (1420) qui fait du roi d'Angleterre l'héritier du trône de France au détriment du fils de Charles VI.
Les Armagnacs deviennent alors le parti de la France. Une entrevue entre le Jean Sans Peur et le dauphin (Charles VII de France) est organisée le 10 septembre 1419 sur la pont de l'Yonne à Montereau mais le duc y est assassiné par un Armagnac Tanneguy Duchatel qui voulait venger l'Assassinat du duc d'Orléans (1407). En 1422, la même année Henri V roi d'Angleterre qui a 34 ans et le roi Charles VI, délaissé par tous meurent. Le successeur de Henri V, son fils Henri VI d'Angleterre, n'a qu'un an, c'est le duc de Bedford (Jean de Lancastre) qui devient son tuteur. Charles VII qui s'était réfugié à Bourges lorsque les Bourguignons occupèrent Paris (1418) déshérité par sa mère en 1420 n'est pas vraiment le roi de France.
► 1380 Le palais du roi. Charles VI possède plusieurs palais, transformés par son père, dans Paris. La capitale compte également des demeures princières très luxueuses. Chartes VI délaisse le palais royal. Le palais royal au coeur de l'île de la Cité symbolise le pouvoir. Les événements importants y sont marqués par des réceptions officielles. L'administration royale et le Parlement y siègent, mais Charles VI préfère vivre dans trois autres résidences plus vastes, aménagées de manière somptueuse par son père. Vincennes en chantier. Le château de Vincennes, à une demi-journée de cheval de Paris, fut construit par Philippe VI, Jean le Bon puis Charles V.
C'est une véritable petite ville, protégée par une enceinte rectangulaire et des fossés en eau. Les appartements royaux sont dans le donjon. Poursuivant L'oeuvre de son père, Charles VI achève la réalisation d'une sainte-chapelle comme celle du palais de la Cité. Ses murs sont percés de fenêtres élancées, ornées de dentelles de pierre. Ces longs travaux ne seront pas terminés sous son règne. L'hôtel Saint-Pol a la préférence du roi. De joyeuses fêtes y sont organisées. Ce palais est situé sur la rive nord de la Seine, près de la Bastille. Il est composé de plusieurs bâtiments reliés par des galeries couvertes.
Le roi, la reine et leurs enfants y ont chacun un hôtel indépendant. Les jardins sont célèbres dans toute l'Europe. Ils abritent une ménagerie et ses lions ravissent les visiteurs. Le Louvre se transforme. Le palais du Louvre situé à l'ouest, sur la rive nord de la Seine, fut construit par Philippe Auguste à l'extérieur des murs de la ville. La nouvelle enceinte de Charles V inclut le château qui perd tout intérêt défensif. Le roi décide alors de le transformer en palais.
En cette fin du XIVe siècle, ses façades sont percées de nombreuses fenêtres, les toits hérissés de hautes cheminées. La Cour aime à se promener dans le jardin du roi, composé de parterres de fleurs, de petits pavillons de treillages et d'un verger. Les demeures princières. Les grands princes, qui doivent rester proches du roi, occupent ou se font construire à Paris une résidence digne de leur rang. Le duc de Berry possède l'hôtel de Nesle sur la rive gauche. Celui des ducs de Bourgogne et l'hôtel de Bohême occupé par Louis Ier d'Orléans sont sur la rive droite, non loin du Louvre. Ces palais, presque aussi luxueux que celui du souverain, accueillent de véritables Cours.
► 1380 16 septembre Le duc d'Anjou, Louis Ier de Naples (frère de Charles V) assure la régence. Louis Ier de Naples, comte, puis duc d'Anjou, roi titulaire de Naples, (né à Vincennes le 23 juillet 1339 - mort au château de Biseglia, près de Bari, Italie, le 20 septembre 1384) est le deuxième fils de Jean le Bon et de Bonne de Luxembourg. Il est fait comte de Poitiers en 1350, comte d'Anjou et du Maine en 1356 ainsi que lieutenant du royaume la même année et enfin duc d'Anjou en 1360. Il est empereur titulaire de Constantinople (1383-1384), roi titulaire de Naples (1360-1384), duc d'Anjou, comte de Provence et de Forcalquier (1381-1384) et roi titulaire de Jérusalem.
► 1380 - 30 novembre Charles VI est sacré à Reims. Le roi n'a pas douze ans encore en ce jour où il est sacré à Reims. L'ordonnance qu'a signée son père en 1374 établissant la majorité du roi à quatorze ans ne saurait lui être appliquée. Les quatre oncles du roi assurent le conseil de régence. Parce qu'ils viennent d'apprendre que la suppression des fouages, décidée par feu le roi Charles V le Sage, est maintenue, les habitants de Reims saluent le sacre par les cris de : “Vive le roi de France ! Montjoie Saint Denis !”
► 1380 Le roi d'Angleterre ne conserve que Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux et Bayonne.
► 1381 - 4 avril Second traité de Guérande rétablissant Jean IV de Bretagne. Le duc de Bretagne, Jean IV de Bretagne renonce à son alliance anglaise, sollicite et obtient le pardon du roi de France moyennant un nouvel hommage et la promesse de verser une indemnité de guerre de 200 000 livres. Il doit encore accepter le principe d'une amnistie générale, renvoyer chez eux les capitaines et ses conseillers anglais, récupérer les places fortes tenues par des mains étrangères, y compris Brest.
Un article secret, absent du texte officiel, dispense le duc de Bretagne de participer en personne à la lutte contre ses anciens alliés. Dépitées, les troupes britanniques évacuent le duché, sauf Brest. Une brouille s'installe entre Bretagne et Angleterre, qui confisque le comté de Richemont. Le second traité de Guérande est signé le 4 août 1381. Le duc Jean IV de Bretagne recouvre ses biens, contre l'hommage prêté au roi de France, le versement d'une indemnité et le renvoi des conseillers anglais.
► 1381 - 1er septembre Émeutes de Béziers. Bien que le roi Charles VI le Fou ait atteint sa majorité, ses oncles les ducs d'Anjou (Louis II d'Anjou), de Bourgogne (Philippe le Hardi) et de Bourbon (Louis II de Bourbon) continuent d'assumer la régence. Ce qui leur permet de vider les caisses royales. Ils ont créé de nouvelles taxes, dont les fouages. Cet impôt provoque des troubles et des émeutes dans tout le royaume. Les bourgeois de Béziers se révoltent eux aussi. Ils sont réprimés par les "tuchins" (autrement dit par les “tue-chiens” !), qui pillent, violent et volent.
En dépit de cette répression, l'agitation gagne dans tout le Languedoc. La révolte des Tuchins ou tuchinat est une révolte languedocienne survenue entre 1381 et 1384 contre les prélévements fiscaux et la présence des mercenaires. C'est aussi une organisation de défense active contre les garnisons anglo-gascones. Elle est menées par de bandes armées composées de paysans et d'artisans et soutenues par certains grands seigneurs et l'élite urbaine de la province. Elle toucha aussi l'Auvergne entre 1384 et 1389.
► 1382 Les régents font annoncer qu'ils rétablissent des taxes qui avaient été abolies par le feu roi. A cette nouvelle, le peuple de Paris se révolte, massacre un collecteur d'impôts et s'empare des armes qui étaient tenues en réserve à l'Hôtel de Ville, notamment de maillets de plomb fabriqués autrefois pour être distribués en cas de besoin aux défenseurs des remparts : de là le surnom de Maillotins donné à ces insurgés qui, maîtres de la ville, y font régner la terreur et y commettent toute sorte d'excès.
En même temps, des troubles analogues éclatent dans plusieurs villes, telles que Reims, Sens, Compiègne, Amiens et Rouen, et jusque dans le Languedoc, où les révoltés prennent le nom de Tuchins. Pendant ces troubles, les Flamands se sont, de leur côté, soulevés contre leur comte, et se sont donné pour chef Philippe van Artevelde (fils de Jacques van Artevelde que les Français ont combattu sous le règne de Philippe VI). Le comte de Flandre étant le beau-père du duc de Bourgogne (l'un des régents de France), celui-ci pousse Charles VI à prendre les armes en sa faveur.
La chevalerie française obéit d'autant plus volontiers en cette circonstance à Charles VI, que le mouvement qui se produit dans les Flandres est en réalité une révolte des artisans et des bourgeois contre les seigneurs. Les Français sont commandés par un ancien compagnon d'armes de Du Guesclin, le connétable Olivier de Clisson. La rencontre a lieu le 17 novembre 1382 à Roosebecke; les Flamands y sont complètement battus par les Français et leur chef Artevelde y est tué.
A la suite de cette victoire, Charles VI entre à Gand et y fait décapiter plusieurs bourgeois regardés comme les chefs du mouvement. Après quoi il rentre à Paris pour réduire la révolte des Maillotins. Révolte des maillotins. Insurrection de Parisiens en mars 1382. Ayant pillé l'Arsenal où ils s'arment de maillets de plomb – d'où leur nom –, ils sèment la terreur en tuant de nombreux percepteurs. Leur révolte a en effet pour origine l'annonce de la collecte d'une taxe indirecte sur les comestibles, en dépit de promesses contraires. La révolte n'est écrasée qu'en novembre 1382, par les troupes royales de retour de guerre.
► 1382 - 27 novembre : Charles VI remporte la bataille de Roosebeke sur les Flamands, à l'issue d'une véritable expédition militaire menée à la suite de la révolte des tisserands de Gand, menée par Philippe van Artevelde, qui sera pendu sans procès au lendemain de la victoire. La bataille de Roosebecke se déroula près du village de Roosebecke, actuellement Westrozebeke en Flandre-Occidentale, le 27 novembre 1382. Les chefs furent d'une part Philippe van Artevelde pour les Flamands, d'autre part Charles VI de France conduisant l'armée française commandée par Olivier IV de Clisson.
Philippe van Artevelde né en 1340, fut tué à la bataille de Roosebecke le 27 novembre 1382. Fils de Jacob Van Artevelde. Lors de la bataille qui l'opposa à Louis Ier de Flandre, comte de Flandre, Philippe van Artevelde capitaine des Gantois fut victorieux. Mais il subit une cuisante défaite à la bataille de Roosebecke le 27 novembre 1382. Charles VI de France écrasa l'armée flamande commandée par Philippe van Artevelde à Roosebecke. Au cours de cette bataille, Philippe van Artevelde mourut par étouffement au milieu de ses soldats aissaillis par les troupes françaises.
► 1382 mort de Nicolas d'Oresme.
► 1383 - 29 février Exécution du dernier prévôt des marchands. En janvier, le roi Charles VI le Fol a mis fin à la prévôté des marchands de Paris, il a supprimé les maîtrises des métiers et interdit les assemblées. Pour signifier sa volonté, il fait exécuter le dernier des prévôts des marchands, des Marès.
► 1383 mars Débarquement des Anglais à Calais qui occupent la Flandre.
► 1384 - 14 septembre Trêve entre la France et l'Angleterre.
► 1384 La Flandre devient bourguignonne. Le dernier comte de Flandre trouve la mort. Son gendre, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne obtient le territoire flamand. C'est ainsi que naissent les Pays-Bas bourguignons. Par la suite, Philippe le Bon annexera au territoire le comté de Namur, le duché de Brabant-Limbourg, les comtés de Hainaut, Zellande, Hollande et Frise. Il y ajoutera encore le duché de Luxembourg et la principauté de Liège.
Bourguignons, lors de la guerre de Cent Ans, les Bourguignons sont un des partis, qui s'oppose aux Armagnacs dans la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. L'histoire du parti des Bourguignons s'inscrit dans celle de la guerre de Cent Ans. En 1361 le duc Philippe de Rouvre meurt sans héritier, le roi de France Jean II le Bon récupère le duché et l'octroie en apanage à son fils Philippe le Hardi en 1363. Celui-ci et ses descendants s'attachent à en faire une grande principauté, tendant à l'indépendance.
Les Armagnacs furent au XVe siècle l'un des deux partis qui s'opposèrent dans une guerre civile en France. Leurs adversaires étaient les Bourguignons. À l'origine le conflit oppposait le duc de Bourgogne, Jean sans Peur à Louis Ier d'Orléans. Suite à la folie de Charles VI, la France est gouvernée par un conseil de régence présidé par la reine Isabeau depuis 1393. La reine est piètre politique, et le membre le plus influent du conseil est le duc de Bourgogne (Philippe le Hardi) qui est l'oncle du roi.
► 1385 - 17 juillet Charles VI épouse Isabeau de Bavière, qui est restée célèbre par les scandales de sa vie privée et publique. Dans le but d'obtenir de l'aide de certains États du Saint-Empire romain germanique contre l'Angleterre, Charles VI le Fol épouse Isabeau de Bavière, fille du duc Étienne II de Bavière-Ingolstadt. Isabeau de Bavière, Élisabeth avant son mariage (1371-29 août 1435) est la fille d'Étienne II, duc de Bavière-Ingolstadt et de Thadée Visconti. Elle se marie le 17 juillet 1385, à Amiens, avec Charles VI de France (dit le Bien-Aimé) et devient reine de France.
► 1385 à 1433 - naissance et mort de Alain Chartier, écrivain et diplomate français du Moyen Âge, étudia à l'université de Paris, fut secrétaire de Charles VI et de Charles VII, et exerça comme ambassadeur en Allemagne, à Venise et en Écosse. L'oeuvre de ce grand poète de la fin du Moyen Âge reste injustement négligée: il a pourtant laissé une marque profonde et subtile dans la littérature française. Clément Marot dit de ses vers qu'ils étaient un honneur pour toute la Normandie et sa province natale. Le grand humaniste Étienne Pasquier (1529-1615) prolongea cet éloge, nommant Chartier le "grand poète de son temps".
► 1386 à 1466 - naissance et mort de Donatello. Sculpteur italien. Il est né à Florence en 1386. Il commença à pratiquer la sculpture à l'âge de 20 ans et travailla dans le magasin de Lorenzo Ghiberti. Plus tard dans sa vie il étudia les ruines romaines et devint un humaniste. Il eut également un atelier à Florence où il créa plusieurs de ses chefs d'oeuvre. Parmi ceux-ci ont peu citer son: 'Saint Pierre', 'Saint Georges et le dragon', 'Saint Jean l'Évangéliste', 'Saint Antoine' et une statue équestre appelée 'Gattamelata'.
Beaucoup de ses sculptures annonçaient la Renaissance. Son 'David' fut la première statue nue de la Renaissance, et sa 'Gattamelata', a été considérée comme une des meilleures sculptures la mieux proportionnées. Il a employé un réalisme puissant qui donna à ses statues un regard distinct. Donatello a eu un immense impact sur l'art et les artistes de la Renaissance. Il caractérisa chacune de ses figures. Il fit également la première sculpture en bronze. Il créa les premières statues libres de la Renaissance, indépendantes de l'architecture ou de la décoration.
Un de ses premiers ouvrages pour la cathédrale de Florence fut son 'Saint Michel'. A cette occasion il défini un type de statuaire monumental dont les concepts sont demeurés incontesté jusqu'au début du XXème siècle. Les cinq statues des prophètes faits entre 1418 et 1435 ont fixé ces concepts définitivement. Dès le début, Donatello était sensible à la physionomie et il eu le talent d'exprimer des émotions dans ses oeuvres notamment avec le plissement des fronts, les regards fixes. Il fut un des artistes les plus admirés et les plus respectés de son temps.
Le sens tactile de la profondeur et de la récession était un des dispositifs constants de l'art de Donatello. Le meilleur éclairage à cet égard est son 'Pazzi Madonna' considéré comme un de ses premiers travaux, précédant son 'Saint Georges'. Dans son oeuvre postérieure connu sous le nom de Madone des nuages, Donatello a recourt, comme dans son 'saint Georges', à des effets plus imagés. Il est souvent associé à l'épanouissement de Florence.
Mais sa renommée se fait dans toute l'Italie. Il réussit à présenter une grande diversité dans son oeuvre, dans un domaine plutôt restreint - la sculpture - et cela en fait un créateur incomparable à d'autres artistes de son époque. Il travaille la sculpture sous plusieurs aspects comme la statue, le relief, tabernacle, statue équestre. Il exploite plusieurs matériaux comme le marbre, le bronze, le stuc, la terre cuite et le bois.
► 1387 Gaston Phébus écrit 'Livre de Chasse'. Gaston Phébus, Gaston III de Foix-Béarn, comte de Foix, vicomte de Béarn, né le 30 avril 1331 à Orthez et mort en 1391 est un écrivain et un seigneur féodal du Midi de la France. Il est le fils de Gaston II de Foix-Béarn, comte de Foix-Béarn et d'Aliénor de Comminges.
► 1387 Le père de la poésie anglaise, Geoffrey Chaucer, écrit ses 'Contes de Cantorbéry'. Geoffrey Chaucer (Londres vers 1343 - 1400) fut un auteur, philosophe, diplomate et poète anglais, mieux connu comme l'auteur des "Canterbury tales" (Contes de Cantorbéry). Il est parfois considéré comme le premier auteur à démontrer la légitimité artistique de la langue anglaise.
► 1388 - 3 novembre Charles VI, décidé à gouverner seul, renvoie ses oncles dont l'action a été si funeste, et rappelle les anciens conseillers de son père, gens de petite noblesse, et même de mince origine (et que pour cette raison on appela les Marmousets), mais sages et prévoyants. L'administration prudente et économe des Marmousets ramène quelque prospérité dans le pays. Les marmousets furent entre autres : Jean de Montagu, Olivier IV de Clisson, Bureau de la Rivière, Jean Le Mercier.
Ils n'étaient pas issus du peuple, il n'étaient pas des princes, ni des fonctionnaires, ils étaient tout simplement très proches du roi Charles VI de France. C'est grâce à cette position qu'ils ont pu accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Ces hommes étaient dotés d'une autre qualité, la solidarité entre eux. Choisis par Charles VI en 1388, ils firent le serment de rester unis et amis, solidaires l'un envers l'autre.
► 1388 - 18 août Trêve de Leulinghem entre la France et l'Angleterre.
► 1389 Louis Ier d'Orléans, duc d'Orléans, frère de Charles VI, épouse Valentine Visconti, qui reçoit en dot des droits sur le Milanais (cause des futures guerres d'Italie). Louis Ier d'Orléans (1372 - Orléans, 1407) fut duc d'Orléans. Fils du roi de France Charles V, et frère de Charles VI, il était le chef de la faction des Armagnacs et fut assassiné sur l'instigation du chef des Bourguignons, Jean sans Peur.
Il épouse en 1389 Valentine Visconti (1368 † 1408), fille de Jean-Galéas Ier Visconti, seigneur de Milan, et d'Isabelle de France. C'est ce mariage qui seront à l'origine des prétentions des rois Louis XII et François Ier sur le duché de Milan. Duc d'Orléans, le titre de duc d'Orléans est un titre de noblesse présent dans la famille royale française depuis 1344. Il était traditionnellement réservé au deuxième fils du roi. C'est donc un apanage de la couronne.
► 1389 Les Turcs ottomans battent les croisés et les Serbes à la bataille de Kosovo Polje le 28 juin et annexent la Serbie. Le prince de Serbie Lazare est tué. Le Serbe Miloc Kobilovic poignarde le sultan Murat Ier. Le grand vizir ottoman écrase les Bulgares à Nicopolis. Les Ottomans occupent en Europe la Macédoine, la Thrace orientale et la Bulgarie.
La bataille de Kosovo Polje eut lieu le 28 juin 1389 au Kosovo sur le "champ des Merles" entre l'empire Ottoman et les Serbes. Cette bataille est particulièrement chère au coeur de la plupart des serbes, qui aiment à se rappeler cette date particulière, qui marqua la fin de leur indépendance, pour près de cinq siècles et leur passage sous la domination ottomane.
► 1389 Pierre d'Ailly devient chancelier de l'Université de Paris. Pierre d'Ailly, né en 1351 et mort en 1420, est un prélat français fort influent de son temps et un auteur universitaire prolixe. Né à Compiègne en 1351 dans une famille bourgeoise aisée (son père était un boucher prospère), Pierre d'Ailly étudie à Paris au Collège de Navarre à partir de 1364 et devient maître en théologie en 1381, puis recteur du collège en 1384. Il devient aumônier du roi Charles VI en 1389 et, la même année, il est nommé chancelier de l'université de Paris. Il est alors le maître de Jean Gerson qui sera son disciple préféré et deviendra son ami et successeur en tant que chancelier de l'université.
► 1390 à 1441 - naissance et mort de Jan van Eyck. Déjà considéré en son temps comme le plus grands des peintres, Jan van Eyck est resté le plus célèbre des primitifs flamands. Depuis le XVIe siècle, la tradition lui attribue l'invention de la peinture à l'huile. Même si cette technique existait bien avant lui, il est certainement celui qui a le plus contribué à son amélioration et son expansion (l'utilisation de l'huile de térébenthine, c'est lui).
Obsédé par le réalisme et guidé par un perfectionnisme ambitieux, il est devenu inégalable dans le rendu des surfaces, matières, textures (brocards, fourrures, velours, pierres précieuses, métaux, armures, marbres, verre, chair...) et de tous leurs effets de lumière, reflets et transparences. Le même souci d'exactitude se retrouve dans ses portraits, dont il peint chaque détail avec acuité. Il ne nous est parvenu que 9 tableaux signés et datés par Van Eyck et une dizaine dont l'attribution est à peu près certaine. Sa devise était 'Als ich kan' (Comme je peux).
► 1392 Attentat à Paris de Pierre de Craon contre Olivier de Clisson, qui est laissé pour mort, mais réchappe de ses blessures. Cette tentative de meurtre a eu lieu à l'instigation du duc de Bretagne, Jean IV de Bretagne, ennemi mortel du connétable. Charles VI exige la remise du meurtrier qui s'est réfugié à la cour du duc, et que celui-ci refuse de livrer. Le roi de France, pour venger son fidèle lieutenant auquel il doit la victoire de Roosebecke (1382) ainsi que le rétablissement du prestige royal et qui est du reste un personnage considérable, prépare une expédition contre le duc, et entre en campagne.
Le 5 août, comme l'armée, au sortir de la forêt du Mans, débouchait en plaine par une chaleur torride, Charles VI, déjà troublé par l'apparition soudaine d'un individu qui, sous bois, lui avait crié d'arrêter parce qu'il était trahi, devient subitement fou en entendant le bruit d'armes qu'un soldat laissait par négligence s'entrechoquer. Il se jette l'épée haute sur son entourage, tue quatre hommes de son escorte et n'est maîtrisé qu'à grand-peine. Ses oncles reprennent le pouvoir concurremment avec son frère Louis Ier d'Orléans.
Sa folie cependant n'est pas absolue, et on le voit pendant trente-cinq ans que dure encore son règne, s'occuper fréquemment des affaires de l'État. Pierre de Craon, ce digne chambellan, est encore connu par l'assassinat d'Olivier de Clisson, qu'il fit attaquer la nuit, à Paris, au sortir de l'hôtel Saint-Pol, par plusieurs hommes armés. Olivier de Clisson, laissé pour mort, guérit de ses blessures.
Ce fut en se dirigeant vers l'Anjou pour tirer vengeance de ce crime que le roi Charles VI fut atteint de cette démence fatale qui livra la France aux fureurs rivales de ses parents et aux dévastations des étrangers. Condamné par le parlement, enfermé dans la tour du Louvre, Pierre de Craon, dont les biens devaient être confisqués, obtint du roi des lettres d'abolition pour son double crime. Le parlement, indigné, refusa l'entérinement des lettres de grâce et confirma son premier arrêt par un autre plus sévère, mais qui ne fut pas plus exécuté que le premier.
► 1392 - 5 août, le roi Charles VI de France est victime, dans la forêt du Mans, de la première crise de la folie qui va marquer tout le reste de son règne. Après avoir tué quatre hommes et tenté de tuer son frère Louis Ier d'Orléans, il s'enfuit. Ses suivants mettront une heure à le retrouver et à le maîtriser. C'est le début d'une alternance entre crises de folie et périodes de lucidité qui va durer trente ans et avoir des conséquences terribles pour le royaume de France. Ses retours intermittents à la raison empêchent l'établissement d'une régence solide.
► 1393 - 28 janvier Son frère Louis Ier d'Orléans devient régent avec les ducs de Berry (Jean Ier de Berry) et de Bourgogne (Philippe le Hardi). Jean Ier de Berry, Jean de France, né le 30 novembre 1340 à Vincennes, mort en 1416 à Paris, est un prince français de la branche Valois de la dynastie capétienne, Duc de Berry de 1360 à sa mort.
► 1393 Début de la rivalité entre le régent Orléans et le duc de Bourgogne.
► 1394 - 17 septembre Ordonnance sur l'expulsion des Juifs. Par ordre du roi, Charles VI le Fol, tous les Juifs de France perdent l'autorisation de résider dans le royaume.
► 1395 à 1455 - naissance et mort de Fra Angelico (Guido di Piero). Peintre italien. Considéré dès son vivant comme l'un des peintres les plus importants de la première moitié du Quattrocento, Fra Angelico a, pendant des siècles, fasciné les mémoires pour ce trait supplémentaire, mais essentiel, d'avoir été "saint homme", prêtre et frère dominicain. De cette mémoire, une mythologie est née, faisant du peintre ce personnage "angélique" qui n'aurait, dit-on, jamais pris ses pinceaux avant d'avoir fait une prière...
L'histoire de l'art cherchant, quant à elle, l'apport spécifique de l'artiste - ou, au contraire, ses résistances - aux grands bouleversements stylistiques de la Renaissance. Mais l'art de Fra Angelico exige une approche médiane, ou plutôt dialectique. Dépositaire d'un immense savoir - théologique, exégétique, liturgique -, l'artiste aura dû forger une poétique singulière qui utilisait, voire détournait les formes "humanistes" aux fins d'une pensée ancrée dans le Moyen Âge. Et une telle poétique démontre toute sa génialité dans le jeu qu'elle instaure, souvent paradoxal, d'une intense matérialité colorée aux effets toujours "anagogiques": signe d'une peinture constamment en quête de son au-delà.
► 1396 Naissance de Philippe le Bon, futur duc de Bourgogne. Philippe le Bon, Philippe III de Bourgogne, dit Philippe le Bon, né en 1396, mort en 1467, était un prince français de la deuxième branche bourguignonne de la dynastie capétienne. Il fut duc de Bourgogne de 1419 à 1467. Il était le fils unique de Jean sans Peur. Son fils Charles le Téméraire lui succéda.
► 1396 Jean sans Peur, fils du duc de Bourgogne, conduit une expédition de chevaliers français à la défense de la Hongrie contre les Turcs; il est battu à Nicopolis par le sultan Bayezid Ier. Jean sans Peur, Jean Ier de Bourgogne, dit Jean sans Peur, duc de Bourgogne est né le 28 mai 1371 à Dijon. Il est le fils aîné de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et de Marguerite III de Flandre. Il est d'abord comte de Nevers en 1384, comté qu'il abandonne en 1404 à son frère Philippe.
La Bataille de Nicopolis eut lieu le 25 septembre 1396 sur la rive droite (sud) du Danube (aujourd'hui Nikopol en Bulgarie). Le Sultan ottoman Bayezid Ier ("Bajazet" en français, fils de Mourad Ier) et le Prince Stefan Lazarevic de Serbie défirent une croisade d'ampleur sans précédent menée par Sigismond de Luxembourg, Roi de Hongrie-Croatie. C'est la cavalerie serbe de Stefan Lazarevic, vassal et beau-frère du Sultan qui, en attaquant l'armée hongroise sur son flanc droit, assura la défaite de la coalition chrétienne.
Bayezid conquiert ensuite la Thessalie sur ce qui reste de Byzance. Cependant l'irruption en Europe de Tamerlan, qui écrase Bayezid à la Bataille d'Angora en 1402, retarde la chute des Balkans aux mains des Ottomans. Bayezid Ier est né à Edirne en 1360. Désigné par testament, il succéda à son père Murad Ier en 1389. À peine eut-il pris le pouvoir qu'il fit étrangler son frère aîné Yakub Çelebi. Son caractère emporté, et la rapidité de ses décisions lui valurent son surnom de "Foudroyant". Il est fait prisonnier en 1402 par Tamerlan et est mort en captivité.
► 1396 Trêve anglo-française signée pour 28 ans (1396-1415)
► 1396 Jean Gerson devient chancelier de l'Université de Paris. Jean Gerson (1363-1429) : Né à Gerson, de son vrai nom Jean Charlier. Élève de Pierre d'Ailly au collège de Navarre, docteur en 1392, chancelier de l'Université en remplacement de D'Ailly. Doyen de Notre-Dame de Bruges de 1397 à 1401, il est en contact avec les Frères de la Vie Commune et lit les 'Noces Spirituelles' de Ruysbroeck, mais il les trouve trop proches des Beghards.
Il tenta de participer aux solutions diplomatiques du grand Schisme, puis prôna énergiquement les réformes : il écrit le 'De Auferibilitate papae ab ecclesia' pour défendre le concile de Pise, puis assiste au concile de Constance et y compose en 1417 son 'De Potestate ecclesia'. Menacé par Jean sans Peur, il s'exile pendant deux ans dans le Tyrol et en Autriche, puis rentre à Paris en 1419 avant de se retirer chez les Célestins à Lyon. Il y mourra. Nicolas de Clémanges est un de ses plus célèbres élèves.
► 1397 à 1475 - naissance et mort de Paolo Uccello, est un peintre, mosaïste et marqueteur italien, qui travailla notamment à la basilique Saint-Marc de Venise. On lui doit deux "Saint Georges et le dragon".
► 1398 - 17 décembre Victoire de Tamerlan en Inde. Le conquérant tuco-moghol Tamerlan, vainc les troupes du sultanat et parachève sa conquête avec la destruction de Delhi. La ville est pillée et les habitants massacrés par les armées de Tamerlan. Il abandonne ensuite la région à la famine et reprend la route pour d'autres conquêtes. Le sultanat de Delhi se reformera pour encore 150 ans. Tamerlan, parent éloigné de Gengis Khan, se considéra comme son fils spirituel. Son prénom, Timur, signifie "fer" en turco-mongol et se rapproche de celui de Gengis Khan, Temüdjin.
On l'appelle aussi Amir Timur (Émir de fer). Né près de Samarcande en Ouzbékistan en 1336 et devenu émir de Transoxiane, il se révéla un redoutable chef de guerre, bâtissant un immense empire reposant sur la force et la terreur. Il se montra cependant aussi protecteur des arts et des lettres qui firent la grandeur de sa capitale, Samarcande. Apres la mort de Tamerlan en 1405 son empire, gouverné par ses descendants (les Timourides), fut grignoté par les puissances voisines jusqu'à l'assaut final des Ouzbeks de la dynastie des Chaybanides.
► 1399 Henri IV d'Angleterre: premier roi de langue maternelle anglaise.
► 1400 Enguerrand de Monstrelet, 'Chroniques' (1400-1444). Enguerrand de Monstrelet, chroniqueur né sans doute à Montrelet (Somme) vers 1390, mort vers le 15 juillet 1453. il a écrit en français, pour continuer Froissart, une Chronique qui s'étend de 1400 à 1444 en deux livres.
► 1400 à 1456 - naissance et mort de Jacques Coeur. Jacques Coeur, l'argentier du roi. Homme d'affaires audacieux, Jacques Coeur devint en quelques années un personnage puissant et incontournable du royaume de France. Anobli par Charles VII, il est chargé de combler les moindres exigences du roi et de la cour, une fonction domestique qui va lui permettre de s'enrichir.
Jacques Coeur est l'ami des rois, des papes et des princes. Grand Argentier du roi Charles VII, c'est avec l'argent prêté au roi qu'il permet au "Petit Roi de Bourges de bouter les Anglais hors de France". Il fut un homme d'affaires remarquable. Sa vie dans les honneurs et sa fin tragique font de cette existence un véritable roman. Argentier, surintendant ou ministre des Finances.
► 1401 à 1428 - naissance et mort de Masaccio (Tommaso di Ser Giovanni) eut une influence déterminante sur les artistes de la Renaissance, dont on peut considérer qu'il est l'un des premiers avec Brunelleschi et Donatello. Masaccio se rend à Florence, où, en 1422, il s'inscrit à la corporation des médecins et des pharmaciens. Il entre dans le cercle de Masolino da Panicale et des peintres florentins. On ne sait exactement si Masolino (bien plus âgé que lui) fut son maître, ou si la position de Masaccio était plus indépendante.
Masaccio est en fait le continuateur de Giotto par la force de ses sentiments, le calme de sa composition, la mise en valeur des volumes. Léonard de Vinci, dans son Traité de la peinture, a défini, avec justesse, la nouveauté de Masaccio: "Après Giotto, l'art retomba en décadence pendant plus d'un siècle, parce que les peintres commencèrent à imiter les oeuvres de Giotto. Puis vint le Florentin Tommaso (Masaccio); il prouva, par la perfection de ses oeuvres picturales, que tous ceux qui ne prennent pas comme modèle la nature, cette éducatrice de tous les maîtres, s'efforcent vainement de faire de l'art."
► 1401 Jean Gerson écrit 'Sermons' (1401-1413)
► 1402 - 20 juillet : Tamerlan (Timour lenk) défait les Turcs Ottomans à Ankara et s'empare du sultan Bayezid Ier. Les Ottomans perdent des émirats turcs d'Anatolie. Brousse est occupée et pillée. Smyrne, ville chrétienne, est prise et détruite par Tamerlan. A Sivas, Tamerlan fait enterrer vivant 4000 guerriers arméniens et fait écraser sous les sabots de ses chevaux tous les enfants de la cité. Tamerlan, parent éloigné de Gengis Khan, se considéra comme son fils spirituel. Il se révéla un redoutable chef de guerre, bâtissant un immense empire reposant sur la force et la terreur. Il se montra cependant aussi protecteur des arts et des lettres qui firent la grandeur de sa capitale, Samarkand. Brousse, ville de Turquie, appelée Bursa en turc.
► 1402 Querelle du 'Roman de la Rose'. La seconde partie a provoqué des polémiques sur la vision de la femme par Jean de Meung, en particulier la réponse de Christine de Pisan sur ses positions conduisant à une des premières querelles féministes. Elle a été impliqué dans la première querelle littéraire française que certains considèrent comme un manifeste, sous une forme primitive, du mouvement féministe. En effet 'Epistre au Dieu d'Amours' 1399 et son 'Dit de la Rose' 1402, critique de la seconde partie du Roman de la rose écrite par Jean de Meun, provoquèrent des remous considérables dans l'intelligentsia de l'époque.
► 1403 Naissance de Charles (futur Charles VII), cinquième fils de Charles VI et Isabeau de Bavière. Charles VII de France, dit Charles le Victorieux ou encore Charles le Bien Servi (né à Paris le 22 février 1403 - Mehun-sur-Yèvre, 22 juillet 1461). Roi de France de 1422 à 1461. Il mit fin en 1453 à la guerre de Cent Ans sur une victoire française. Son nom reste principalement attaché à l'épopée de Jeanne d'Arc, qui lui permit de renverser une situation compromise et d'être sacré à Reims (17 juillet 1429).
► 1403 26 avril 1403 Ordonnance concernant la régence. Une ordonnance est créée qui institue la régence et le gouvernement pendant “les absences” du roi Charles VI le Fol, faible mot pour parler des crises de démence du souverain.
► 1404 janvier Reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre.
► 1404 - 26 avril Mort de Philippe le Hardi, son fils Jean sans Peur devient duc de Bourgogne.
► 1404 à 1472 - naissance et mort de Léon Battista Alberti. Humaniste et architecte florentin. L'architecte est mêlé à l'édification d'un monument en 1454; c'est après cette date qu'il laisse dans l'histoire de l'architecture une marque profonde qui lui vaut sa réputation universelle, concevant plusieurs édifices qui vont ouvrir des voies radicalement nouvelles à cet art. Mais de l'âge de vingt ans à l'âge de cinquante ans (et au-delà), les résultats prodigieux qu'il réussit à atteindre en particulier comme écrivain, en latin et en italien, comme philosophe ou comme ingénieur - et que ce livre se fixe aussi comme objectif d'illustrer - ne peuvent que surprendre et fasciner.
Sa devise était d'ailleurs Quid tum et son symbole un oeil ailé, signes de cette volonté d'aller toujours de l'avant, de ne jamais répéter ce que les autres ont fait ou de ne jamais se répéter lui-même. Son jeune contemporain Landino parlera plus tard de lui comme d'un caméléon, qui s'adapte sans cesse à de nouveaux domaines au point que son esprit polymorphe est impossible à classer. Ce qui fait de lui, sans conteste, le génie le plus universel du XVe siècle.
►1404 Christine de Pisan écrit 'Livre des fais de Charles V’
► 1405 juin Débarquement anglais dans le Cotentin. Le Cotentin est un pays de la Normandie autrefois appelé Pagus Constantiensis (pays de Coutances).
► 1405 Début des voyages de l'amiral chinois eunuque Zheng He vers l'Indonésie, l'Inde, l'Arabie et la côte Est de l'Afrique (jusqu'en 1433). Il mène sept expéditions qui conduisent à l'hégémonie navale de la Chine sur les mers de la Sonde et sur l'océan indien (1405-1424) : Champa, Cambodge, Siam, Malacca, Java, Sumatra, Ceylan, Bengale et Inde méridionale. Les escadres chinoises sont présentes à Ormuz, à Aden et à Djedda. A deux reprises, la flotte touche la côte orientale de l'Afrique. Zheng He était un eunuque chinois et un explorateur maritime célèbre. Zheng He, surnomé "l'Eunuque aux trois joyaux", né en 1371 et mort en 1433, était un eunuque chinois et un explorateur maritime célèbre.
► 1406 Début de la construction de la Cité interdite à Pékin. La Cité Interdite est le Palais impérial de Pékin dont la construction fut ordonnée par Yongle, troisième empereur Ming. Ce palais, d'une envergure inégalée, fait partie des palais les plus anciens et les mieux conservés. Le nom "cité interdite" vient du fait que son accès était interdit au "peuple" à l'époque des grands empereurs chinois. Comme résidence de ces grands empereurs, elle est devenue symbole d'interdit. Son nom complet est "cité interdite pourpre", en référence à l'étoile "sacrée", l'étoile polaire, de couleur pourpre pour les Chinois.
► 1407 La mésintelligence règne entre les régents du royaume au nombre desquels se place la reine Isabeau de Bavière: elle est particulièrement vive entre le duc d'Orléans (Louis Ier d'Orléans), et le duc de Bourgogne (Jean sans Peur), qui, pour se débarrasser de son rival, le fait assassiner à Paris dans un guet-apens.
► 1407 - 23 novembre : L'assassinat à Paris de Louis Ier d'Orléans, frère cadet du roi Charles VI le Fou, par les hommes de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, déguisés en une bande de malfrats masqués et dirigés par Raoul d'Octonville. Le Duc de Bourgogne avait pour dessein d'unir l'Artois et la Flandre à son duché. Mais son cousin, Louis Ier d'Orléans, fils du roi de France Charles VI, s'opposait à son projet.
Cet assassinat entraîne la guerre civile en France entre Armagnacs et Bourguignons. Jean sans Peur quitte Paris après avoir fait assassiner Louis Ier d'Orléans. C'est alors que Louis Ier d'Orléans sort de l'hôtel Barbette, où réside sa belle-soeur la reine Isabeau de Bavière, à laquelle il vient de rendre visite, qu'il est poignardé par des sbires de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. La haine que celui-ci porte à Louis dure depuis des années. Trois jours plus tôt, le duc de Bourgogne avait feint de se réconcilier avec son cousin…
► 1407 à 1435 - guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. - Charles d'Orléans, fils de Louis Ier d'Orléans qui vient d'être assassiné, épouse la fille du comte d'Armagnac (Bonne d'Armagnac, fille du comte Bernard VII d'Armagnac) et rallie autour de lui tous les partisans de sa maison, auxquels on donne le nom d'Armagnacs; il entre en lutte armée avec les partisans du duc de Bourgogne, appelés les Bourguignons. Cette querelle, qui partage la France en deux camps, dégénère en une véritable guerre civile; les deux factions rivalisent d'atrocités.
Les Bourguignons dominent d'abord dans Paris, où ils s'appuient sur la corporation des bouchers dirigés par Caboche et Capeluche, et surnommés les Cabochiens. Ceux-ci poussent les excès si loin que la population appelle les Armagnacs à son secours (1413), et l'on voit les fureurs des Armagnacs succéder à celles des Bourguignons. La lutte continue entre ces irréconciliables adversaires. Le parti Armagnac s'aliène les sympathies du peuple en sollicitant le concours des Anglais.
En 1414, Charles VI marche contre le duc de Bourgogne qu'il va assiéger à Arras. C'est au cours de ce siège qu'il est fait pour la première fois usage des arquebuses que l'on appelait alors les canons à mains. Cette expédition n'a pas de suites: Charles VI accorde la paix au duc. Les Armagnacs furent au XVe siècle l'un des deux partis qui s'opposèrent dans une guerre civile en France. Leurs adversaires étaient les Bourguignons. À l'origine le conflit oppposait le duc de Bourgogne, Jean sans Peur à Louis Ier d'Orléans.
Suite à l'assassinat de ce dernier en 1407, ses partisans se rallièrent à Bernard VII d'Armagnac, comte d'Armagnac, beau-père de son successeur Charles d'Orléans. Les Bourguignons sont les habitants de la Bourgogne. En 1411 un conflit ouvert éclate entre les Armagnacs, partisan de Louis Ier d'Orléans puis de Bernard VII d'Armagnac, comte d'Armagnac et les Bourguignons partisans de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Les Armagnac sont proches du pouvoir royal, notamment du Dauphin, tandis que les Bourguignons s'allient aux Anglais en France.
La guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons est un conflit qui ravagea la France, déjà en lutte avec l'Angleterre pendant la guerre de Cent Ans. Le conflit trouve ses racines sous le règne de Charles VI. Pendant la minorité de ce dernier, son oncle Philippe le Hardi fut régent. Puis lorsque la folie de Charles VI se révela, les princes de Bourgogne et d'Orléans se partagèrent le pouvoir, tandis que Jean Ier de Berry servait de médiateur. En 1407, craignant de se voir écarter du pouvoir, le duc de Bourgogne fait éliminer son concurrent, déclenchant la guerre civile.
Le 19 septembre 1419, l'assassinat de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, sur le pont de Montereau-Fault-Yonne empêche tout apaisement. Charles d'Orléans (24 novembre 1394, Paris- 5 janvier 1465, à Amboise), duc d'Orléans est surtout connu par son oeuvre poétique réalisée lors de sa longue captivité anglaise. Son enfance est marquée par le conflit qui oppose son père à Jean sans Peur, duc de Bourgogne, conflit qui est à l'origine de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Son père est tué sur l'ordre du duc de Bourgogne le 23 novembre 1407. En sa qualité d'aîné, il recueille la plus grande part de l'héritage dont le duché d'Orléans, les comtés de Valois et de Blois, et les seigneuries de Coucy et de Chauny.
► 1409 - 9 mars Paix de Chartres. Jean sans Peur a le pardon du roi. Paix de Chartres signée le 9 mars 1409 comportait 21 articles rédigés par Jean de Montaigu. Dans ces articles on peut y lire entre autres : l'aveu de Jean sans Peur, duc de Bourgogne concernant le meurtre de Louis Ier d'Orléans "Par sa volonté et par ses ordres, pour le bien du royaume". des excuses aux enfants du duc d'Orléans.
Il fut prévu une cérémonie en la cathédrale de Chartres le 9 mars 1409. Cette cérémonie de réconciliation fut une véritable crève-coeur pour Charles d'Orléans (1394-1465) et son frère Philippe d'Orléans (1396-1420), comte de Vertus. En effet, en larmes ils accordèrent leur pardon à Jean sans Peur l'assassin de leur père. Puis, ils prêtèrent le serment sur les Évangiles de respecter cette paix qui venait d'être signée.
► 1409 - 26 juin Concile de Pise élit un nouveau pape Alexandre V, mais Grégoire XII et Benoît XIII refusent d'abdiquer. Alexandre V (antipape) (né en 1340 et mort le 3 mai 1410) a été élu pape à Pise sous le nom d'Alexandre V durant le Grand Schisme d'Occident. Comme tous les papes d'Avignon et les papes de Pise de cette époque, il est aujourd'hui considéré par l'Église catholique romaine comme un antipape. Grégoire XII, né à Venise en 1325, pape de 1406 à 1415. Benoît XIII (antipape) Pedro de Luna (1329 - 1423), originaire d'Aragon, devient pape sous le nom de Benoît XIII.
Le concile de Pise a été convoqué en 1409 pour tenter de régler le sérieux problème du Grand Schisme d'Occident. Depuis 1378, deux papes rivaux se trouvent à la tête de la Chrétienté. Celui de Rome a l'appui de l'Italie du nord, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Pologne et de la Hongrie. Derrière son adversaire, installé à Avignon, se rangent la France, la Castille, l'Aragon, le Portugal, le royaume de Sicile, la Savoie et le royaume de Chypre. En 1394, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et véritable maître de la France (Charles VI est devenu fou), demande à l'Université de Paris de le conseiller sur les moyens de mettre fin au schisme.
Celle-ci présente trois solutions: la voie de compromis (laisser aux pontifes le soin de mettre fin eux-mêmes au schisme), la voie de cession (il faut les obliger à abdiquer simultanément puis en faire élire un autre), et la réunion d'un concile qui tenterait de régler lui-même le problème. Philippe le Hardi a pris d'abord parti pour la voie de cession. En 1398, lors d'un concile tenu à Paris, les évêques français décident de retirer au pape d'Avignon les fonds venant des bénéfices et des revenus ecclésiastiques dans le but de l'obliger à se démettre.
Seule l'autorité spirituelle lui est reconnue. C'est ce que l'on appela la soustraction d'obédience. Appauvri, assiégé dans sa ville d'Avignon, le pape Benoît XIII tient cependant bon. En 1403, il parvient à se réfugier en Provence où l'accueille Louis II d'Anjou, hostile à la soustraction d'obédience. Devant l'échec de cette politique, le Conseil du roi de France la lui restitue en 1403. À mesure que les années passent, on s'aperçoit que seule la tenue d'un concile, troisième solution envisagée par l'Université de Paris, peut mettre fin au schisme. Réunis à Livourne en juin 1408, 8 cardinaux romains et 5 avignonnais décident d'en convoquer un à Pise pour mars 1409.
Le concile de Pise réunit 24 cardinaux (14 romains et 10 avignonnais), 300 hauts prélats et des ambassadeurs venus de toutes les parties de la Chrétienté. À cette époque, Benoît XIII est toujours pape d'Avignon; Grégoire XII est pape de Rome depuis 1406. Les deux pontifes ne s'entendent que sur une seule chose: le concile de Pise est illégal. Les pères conciliaires se réunissent de mars à août. Ils décrètent des mesures radicales. Ils accusent les deux papes d'hérésie et de sorcellerie et les assignent à comparaître.
Ceux-ci, abandonnés par la majorité de leurs cardinaux et réfugiés, l'un en Aragon et l'autre dans la région de Naples, refusent de se rendre à Pise sous la contrainte. Le concile décide donc de les déposer et, réuni en conclave, élit pape l'archevêque de Milan, le Grec Petros Filargis, qui prend le nom d'Alexandre V. Le concile de Pise n'a réussi qu'à envenimer la situation puisqu'il y a maintenant trois papes au lieu de deux sur le trône de St Pierre. Benoît XIII, pape d'Avignon, a derrière lui l'Espagne, le Portugal, la France et l'Écosse. Grégoire XII, pape de Rome, garde pour lui le sud de l'Italie et une partie de l'Allemagne. Tout le reste de la Chrétienté se range derrière le pape de Pise, Alexandre V. Il faudra attendre le concile de Constance, réuni à partir de 1414 pour que se règle le problème du Grand Schisme.
► 1410 15 avril Pacte de Gien contre Jean sans Peur. Jean Sans Peur (Jean de Bourgogne) fait assassiner le frère de Charles VI, Louis Ier d'Orléans. Son fils Charles d'Orléans lui succède et c'est le début d'une guerre civile qui oppose Orléans et Bourgogne. Le 28 novembre 1408 les partisans de Jean l'accueillent à Paris où il établit sa propre régence.
Pour la légitimer, il n'hésite pas à se "réconcilier" avec Charles d'Orléans le 9 mars 1409. Cette trêve sera de courte durée car le pacte de Gien (15 avril 1410) "unira" contre Jean sans Peur, tous les princes : le duc de Bourbon (oncle du roi par sa mère), le duc d'Orléans et son frère (petits-fils de Jean le Bon), les comtes d'Alençon et de Clermont (parents plus éloignés), le duc de Bretagne et Bernard d'Armagnac.
Comme ce dernier prend la tête de la coalition, on appellera cela le parti des Armagnacs. Le roi est totalement impuissant. Il remaniera son conseil et on profitera de ses brefs instants de lucidité pour le faire signer tel ou tel acte. Il sait que ses moments de clairvoyance sont chronométrés et s'en remet totalement à ses conseillers.
► 1410 - 23 mai Élection de Jean XXIII par le concile de Pise. Jean XXIII (antipape) Baldassarre Cossa (Procida, province de Naples, v. 1360–Florence, 27 décembre 1419), élu pape par le concile de Pise en 1410 sous le nom de Jean XXIII, déposé par le concile de Constance en 1415, reconnu comme antipape par l'Église catholique romaine.
► 1410 Début du travail sur les 'Très Riches Heures du duc de Berry' par les frères Limbourg, illustrateurs flamands (fin en 1416). Ce document constitue l'une des plus beaux exemples de l'art du manuscrit et de l'enluminure au Moyen Âge et une source importante pour les médiévistes.
► 1410 écriture d''Imago mundi', de Pierre d'Ailly, ouvrage qui le fait apparaître comme un précurseur de Copernic. 'L'Imago mundi' est un ouvrage de cosmographie rédigé par Pierre d'Ailly, théologien français. C'est une représentation typique pour le Moyen Âge en forme de TO. Il faut ajouter que ces cartes on TO sont largement influencées par les pensées religieuses, et c'est par ce fait que dans ces cartes il n'existe souvent pas de distinction entre le monde réel et spirituel. Car ladite distinction était brouillée par l'influence religieuse, importante à l'époque.
► 1411 - 23 octobre Jean sans Peur revient à Paris.
► 1412 - 6 janvier Naissance de Jeanne d'Arc à Domrémy. Domrémy, ville de Lorraine, dans le département des Vosges, près de Neufchâteau, à une cinquantaine de kilomètres de Nancy.
► 1412 - 8 mai Traité d'alliance entre les Armagnacs et Henri IV d'Angleterre. les Armagnacs signent une alliance avec l'Angleterre qui n'en demandait pas temps. Ils font ainsi entrer le loup dans la bergerie et la guerre anglo-française se superpose à la guerre civile. Le 10 août, c'est la chevauchée du duc de Clarence qui part de la Normandie et qui se termine à Bordeaux.
► 1412 - 22 août Traité d'Auxerre. La "Paix d'Auxerre" entre les princes. Le conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons est un de ceux qui ont le plus touché l'Auxerrois à la fin du Moyen Âge. En mai 1412, Charles VI de France, passe à Auxerre à la tête d'un long convoi de munitions, des chariots transportant des bombardes et autres instruments de tir, pour se rendre au siège de Bourges, ville tenue par les Armagnacs.
La situation militaire en France est périlleuse, tant pour le parti du roi que pour le parti du duc de Berry, Jean Ier de Berry. Les troupes royales, qui assiègent la capitale du Berry, sont victimes de la dysenterie et d'une véritable épidémie de peste, qui fait des ravages considérables dans le royaume de 1411 à 1413. Les assiégés, quant à eux, essaient de ne pas mourir de faim dans une ville exsangue mutilée par les machines de guerre royales.
Un élément de poids intervient le 8 mai 1412 ; les ducs Jean Ier de Berry et Charles d'Orléans signent avec Henri IV de Lancastre, roi d'Angleterre, le traité d'Eltham. Ce pacte de guerre prévoit qu'en échange de l'aide militaire britannique accordée aux Armagnacs contre le parti de Bourgogne, un duché d'Aquitaine sera reconstitué sous souveraineté anglaise.
► 1413 20 mars Mort du roi Henri IV d'Angleterre, Henri V qui lui succède revendique le trône de France. Henri V (9 août ou 16 septembre 1387 - 31 août 1422), roi d'Angleterre, fils du roi Henri IV et de Marie de Bohun, est né à Monmouth au Pays de Galles.
► 1413 - 27 avril Début des émeutes contre les Armagnacs à Paris.
► 1413 - 28 avril Révolte des cabochiens. Pendant 1 mois, les "cabochiens" (du nom du meneur Simon Caboche), bouchers ou écorcheurs, remplissent Paris de leurs violences. Le royaume de France est alors divisé entre les factions du duc de Bourgogne, les "Bourguignons" et celles du duc d'Orléans, les "Armagnacs". Le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, impose un temps sa domination sur Paris, soulève le peuple et réussit à faire passer une réforme administrative appelé "ordonnance des cabochiens".
Mais les Armagnacs reprendront vite le dessus. La révolte des Cabochiens est un épisode de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Au printemps 1413, Jean sans Peur, duc de Bourgogne parvient à soulever le peuple de Paris et à imposer une réforme appelé ordonnance des cabochiens. Mais après quelques mois les Parisiens aspirent à un retour à l'ordre et les Armagnacs reprennent l'ascendant. Simon Caboche ou Simonet Caboche, de son véritable nom Simon le Coutelier, est le chef populaire de la révolte des Cabochiens, une insurrection parisienne favorable au duc de Bourgogne Jean sans Peur au début du XVe siècle.
► 1413 - 28 juillet Paix de Pontoise entre les Armagnacs et les Bourguignons. La paix de Pontoise fut conclue entre le 28 juillet 1413 et le 8 août 1413. En août 1413, Jean Ier de Berry et son neveu Jean sans Peur, duc de Bourgogne entrent dans Pontoise. Cette paix ne peut en aucun cas être signée sans l'accord de Paris, en effet la capitale retient prisonniers le roi Charles VI de France, son épouse Isabeau de Bavière et son fils le dauphin de France Louis de Guyenne otages des Cabochiens.
Ceux-ci après délibération dans chaque quartier de la capitale accepteront la paix proposée par Charles VI, à l'exception du quartier des Halles où l'on trouve une forte concentration de Cabochiens et l'Hôtel d'Artois (résidence des ducs de Bourgogne à Paris). Cette paix permettra la libération de Louis de Bavière (futur Louis VII de Bavière-Ingolstadt) et d'Édouard III de Bar détenus au Louvre.
► 1413 - 28 août : Les Armagnacs chassent le duc de Bourgogne de Paris et gouvernent par la terreur contre les cabochiens. Les ordonnances cabochiennes sont abrogées.
► 1414 - 23 mai : Henri V d'Angleterre conclut une alliance offensive et défensive avec Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
► 1414 - 1er novembre Concile de Constance pour mettre fin au Grand Schisme d'Occident. En cette période de Grand Schisme de l'église d'occident s'ouvre la concile de Constance, qui s'achèvera quatre ans plus tard après avoir mis fin à la crise. L'église tente d'adopter des réformes pour museler les hérésies et affirmer la supériorité du concile sur le pape. Trois papes sont déposés avant que l'élection de Martin V ne réunifie le clergé.
Le concile de Constance est, pour l'Église catholique romaine, le XVIe concile oecuménique, convoqué par l'empereur Sigismond Ier et l'antipape Jean XXIII. Présidé par Jean Allarmet de Brogny, il mit fin au Grand Schisme d'Occident. Le concile de Constance (1414-1418) est, pour l'Église catholique romaine, le XVIe concile oecuménique, convoqué par l'empereur Sigismond Ier et l'antipape Jean XXIII. Présidé par le cardinal Jean Allarmet de Brogny, il mit fin au Grand Schisme d'Occident. À la suite du concile de Pise de 1408, l'Église catholique se retrouvait avec trois papes à sa tête : Alexandre V, Benoît XIII et Grégoire XII.
Dans la confusion générale, l'Empereur choisit de se substituer au Sacré Collège défaillant, comme certains canonistes lui en conféraient le droit. Jean XXIII, successeur d'Alexandre V, lui en fournit l'occasion : il fut vaincu par le roi de Naples, Ladislas Ier, partisan de Grégoire XII, et dut se réfugier à la cour impériale. Sigismond accepta à condition qu'un concile fût tenu dans une ville d'Empire. Il put donc annoncer que le 1er novembre 1414, le concile se réunirait à Constance. Sigismond s'assura ensuite du succès du futur concile.
Devant la résistance de Jean XXIII et de ses partisans italiens, il modifia le mode de scrutin. Le vote par nation remplaça le vote par tête, ne laissant à l'Italie qu'une seule voix. Comprenant son échec, Jean XXIII s'enfuit le 20 mars 1415. Les Pères conciliaires adoptèrent le 6 avril le décret Haec sancta, affirmant la supériorité du concile sur le pape. Jean XXIII et Grégoire XII s'inclinèrent et se démirent. Sigismond fit avancer ses troupes en Espagne et au Portugal, écrasant les partisans de Benoît XIII.
Avant de procéder à une nouvelle élection, les Pères conciliaires s'assurèrent de leur indépendance en votant le 30 octobre 1417 le décret Frequens. Celui-ci disposait que le concile se réunirait de nouveau en 1423, puis en 1430, puis tous les dix ans à compter de cette date. Dès lors, le concile n'était plus soumis au bon vouloir du pape. ceci fait, le concile élu le 11 novembre, jour de la saint Martin, le Romain Oddone Colonna, qui prit le nom de Martin V. Celui-ci, rejetant les appels de la France à gagner Avignon, et ceux de l'Empereur à choisir une ville d'Empire, choisit de partir pour Rome, où il entra le 16 mai 1418. Le concile prit alors fin.
► 1415 - 23 février Paix d'Arras entre les Armagnac et les Bourguignons. La paix d'Arras est signée entre les envoyés de Jean sans Peur, duc de Bourgogne et Louis de Guyenne représentant son père Charles VI de France qui de nouveau, avait sombré dans un crise de démence. C'est une trêve dans la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. Concernant l'unité du royaume et la paix, les pensées de Louis de Guyenne allaient dans le même sens que celles de son père.
Le 4 septembre 1414, il signe la paix et fait prêter serment aux prélats, aux grands seigneurs de l'armée royale de respecter cette paix. Le port de la croix de Saint-André et la bande blanche portées respectivement par les Bourguignons et les Armagnacs fut interdit. Sur l'ordre de Louis de Guyenne les mots Bourguignons et Armagnacs furent bannis du royaume, il était formellement interdit de les prononcer.
► 1415 - 4 juillet le pape Grégoire XII abdique.
► 1415 - 13 août Henri V débarque en Normandie.
► 1415 - 21 août Les Portugais prennent Ceuta. Le roi du Portugal Jean Ier s'empare de la ville de Ceuta, sur la côte méditerranéenne du Maroc. Cette conquête marque le début de l'expansion outre-mer des Européens. Cette politique d'expansion stimulera les explorations maritimes pour s'enrichir, mais aussi, pour s'attaquer aux "infidèles" musulmans.
Ceuta sera annexée par les Espagnoles en 1580. Ceuta (Sebta) est une ville autonome espagnole enclavée sur la côte nord-est du Rif oriental Marocain. Elle est l'une des deux enclaves de ce pays en Afrique du Nord avec Melilla, sur la Méditerranée. Avec Tanger et Tetouan, elle est la porte d'entrée du Nord-ouest-Afrique vers l'Europe.
► 1415 - 22 septembre Henri V prend Harfleur.
► 1415 Les Anglais ont cherché à profiter du désordre où se trouve la France pour débarquer des troupes à l'embouchure de la Seine. Un grand nombre d'Armagnacs et de Bourguignons font trêve à leur querelle pour marcher ensemble contre eux sous le commandement du connétable d'Albret; le duc de Bourgogne ne se joint pas à eux. Les Français livrent bataille aux Anglais à Azincourt où la chevalerie française subit un désastre sans précédent.
► 1415 - 25 octobre : L'armée française composée de 50 000 hommes est écrasée par les troupes de 15 000 hommes d'Henri V d'Angleterre à la bataille d'Azincourt. Les pertes s'élèvent à près de 10 000 hommes contre 1 600 du côté anglais, montrant la supériorité de la stratégie anglaise basée sur l'utilisation des archers contre la lourde cavalerie des chevaliers français. À la suite de la bataille, Charles d'Orléans échappe à l'égorgement, contrairement à ses compagnons d'armes, et devient prisonnier du roi d'Angleterre - il le restera 25 ans - et commence son oeuvre poétique.
Jean II Boucicaut, maréchal de France, est également fait prisonnier. La bataille d'Azincourt se déroule le 25 octobre 1415 pendant la guerre de Cent Ans. Elle oppose les troupes françaises (entre 25 000 et 45 000 hommes) au contingent anglais fort d'approximativement 10 000 hommes (entre 6 000 et 15 000, selon les sources). Cette bataille est une défaite importante pour le camp français ; la cavalerie lourde, rendue moins efficace par un terrain boueux et les retranchements anglais, est transpercée par les archers en majorité gallois, équipés de grands arcs (long bows) à très longue portée.
Cette bataille, où la chevalerie française est mise en déroute par des soldats anglais inférieurs en nombre, sera souvent considérée comme la fin de l'ère de la chevalerie et le début de la suprématie des armes à distance sur la mêlée, suprématie qui ne fera que se renforcer par la suite grâce à l'invention des armes à feu. Elle sera, en réaction, une cause majeure de l'épopée de Jeanne d'Arc, puis de l'investissement dans l'artillerie qui deviendra une spécialité française.
► 1415 Début de la captivité de Charles d'Orléans. Charles d'Orléans fait partie de l'armée française poursuivant Henri V retraitant dans le nord de la France. À la débacle d'Azincourt, le 25 octobre 1415, Charles d'Orléans est fait prisonnier et emmené en Angleterre. Sa libération est conditionnée au paiement d'une rançon. Il restera 25 ans en Angleterre. Il est surtout connu par son oeuvre poétique réalisée lors de sa longue captivité anglaise.
► 1415 à 1492: naissance et mort de Piero della Francesca, ce peintre et mathématicien du début de la Renaissance italienne. Moins d'une trentaine d'oeuvres nous est parvenue, à des degrés divers de conservation mais qui suffit pourtant à témoigner de ses apports: introduction d'une lumière neuve, éclat des couleurs, maîtrise parfaite des perspectives. Ce qu'on peut voir aussi dans ses tableaux, c'est que Piero della Francesca, qui peignait pour l'esprit autant que pour l'oeil, avait tout de l'humaniste progressiste: simple, sincère, intelligent, érudit, ouvert.
► 1417 - 1er août Henri V débarque à Trouville.
► 1417 - 4 septembre Henri V s'empare de Caen.
► 1417 - 11 novembre L'élection au concile de Constance du pape Martin V marque la fin du Schisme. Martin V, Oddone Colonna (Genazzano, 1368–Rome, 1431), 204ème pape (1417-1431) sous le nom de Martin V. Il fut élu pape lors du concile de Constance le 11 novembre 1417 et prit le nom de Martin V en hommage à Martin de Tours, dont la fête était célébrée le jour de son élection. Consacré le 21 novembre par le président du Concile, Jean Allarmet de Brogny, il mit fin au grand schisme d'Occident. Il concentra tous les pouvoirs et réunit le concile de Pavie-Sienne en 1423, puis celui de Bâle en 1431.
► 1418 - 28 mai Les Parisiens ouvrent les portes de la capitale aux Bourguignons.
► 1418 - 29 mai Le dauphin, Charles VII, quitte Paris.
► 1418 Henri V d'Angleterre profite de sa victoire pour continuer la conquête de la Normandie; Caen et Rouen se défendent héroïquement. Jean sans Peur exploite cet événement en soulevant le peuple de Paris contre les Armagnacs dont le chef, Jean d'Armagnac, vient d'être fait connétable. Les Bourguignons entrent dans la ville avec l'aide des Cabochiens, se saisissent de tous les Armagnacs qu'ils peuvent trouver et les massacrent. Le dauphin Charles VII (fils aîné de Charles VI et d'Isabeau de Bavière) n'échappe à la mort que grâce au dévouement de Tanneguy Duchâtel, prévôt des marchands, qui l'emporte couvert d'un manteau et réussit à le faire sortir de Paris.
Le dauphin prend le titre de régent et transfère à Poitiers le siège du gouvernement et ce qui, du Parlement et de l'Université, s'attache à sa fortune. Henri V d'Angleterre (9 août 1387, Monmouth, Pays de Galles – 31 août 1422), duc de Cornouailles et de Lancastre, fut roi d'Angleterre de 1413 à 1422. Vainqueur de la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415, il parvint à se faire reconnaître comme héritier du trône de France au traité de Troyes (1420), mais mourut prématurément avant son beau-père Charles VI de France, sans avoir pu ceindre une seconde couronne.
► 1418 - 12 juin Massacre des Armagnacs à Paris.
► 1418 - 29 mai : Prise de Paris par Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Dans la nuit du 28 au 29 mai, un certain Perrinet Le Clair, fils d'un marchand de fer, ouvre à Jean de Villiers de L'Isle-Adam, capitaine bourguignon, la porte Saint-Germain-des-Prés.
► 1418 Le 12 juin, les bouchers forcent les portes des prisons et égorgent tous les Armagnacs détenus, dont Bernard VII d'Armagnac. Bernard VII d'Armagnac, né vers 1360 à Paris, mort le 12 juin 1418, fut comte de Charolais (1384-1391), puis comte d'Armagnac, de Fézensac, de Rodez (1391-1418), comte de Pardiac (1402-1418) et connétable de France. Il était le fils de Jean II, comte d'Armagnac, de Fézensac, de Rodez et de Charolais, et de Jeanne de Périgord.
► 1418 - 29 juin : Les Anglais entament le siège de Rouen qui s'achèvera le 19 janvier 1419. Le siège de Rouen en 1418-1419 par les Anglais a lieu durant la guerre de Cent Ans. Au moment du siège de Rouen (juillet 1418-janvier 1419), la ville compte environ 70 000 habitants, ce qui en fait une des plus grandes villes de France. La prise de cette ville est cruciale pour s'emparer du duché de Normandie, point d'orgue de la guerre de Cent Ans.
► 1418 - 26 décembre Le dauphin devient régent. Le dauphin, de sa propre autorité, prend le titre de régent du royaume. Il institue par lettres patentes le parlement à Poitiers.
► 1418 Régence du futur Charles VII.
► 1418 Le prince portugais Henri le Navigateur, fils cadet du roi Jean de Portugal, lance les premiers voyages d'exploration portugais. Il décide de découvrir et d'évangéliser les populations noires du Sahara. Installé à Sagres, il engage plusieurs navigateurs chargés d'explorer le littoral occidental de l'Afrique.
La noblesse s'oppose à cette politique, qui est soutenue par la bourgeoisie. Henri le Navigateur, Infante Dom Henrique (4 mars 1394 - 13 novembre 1460) fut un prince du Portugal, souvent regardé comme le personnage le plus important du début de l'expansion coloniale européenne, et le troisième fils de Jean Ier de Portugal, le fondateur de la dynastie d'Aviz. Sa mère est Philippa de Lancastre, la fille de Jean de Gand.
► 1419 - 19 janvier La capitulation de Rouen marque la fin de la conquête de la Normandie par Henri V.
► 1419 - 13 juillet Paix de Pouilly-le-Fort entre Jean sans Peur et le dauphin, Charles VII de France.
► 1419 Les amis du dauphin, feignant de désirer une réconciliation avec le duc de Bourgogne Jean sans Peur, attirent ce dernier à Montereau, où il est assassiné par Tanneguy Duchâtel.
► 1419 - 10 septembre Assassinat de Jean sans Peur au pont de Montereau, son fils Philippe le Bon lui succède. Face à face sur le pont de Montereau, le dauphin Charles (futur Charles VII) qui a seize ans, et Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Cette rencontre, qui doit permettre une réconciliation entre Bourguignons et Armagnacs, se tend lorsque le Dauphin accuse le duc de ne pas tenir ses engagements et de se rapprocher des Anglais.
Offensé, le duc porte la main à son épée. Des chevaliers ne doivent en aucun cas faire un tel geste devant le roi de France ou devant son fils, qui le représente. Robert de Loire lance au duc : “Mettez-vous la main à votre épée en la présence de monseigneur le Dauphin ?”. A cause de cette offense, Tanneguy du Chastel frappe le duc d'un coup de hache. Les chevaliers qui entourent le Dauphin l'achèvent. Ce meurtre rejette la Bourgogne dans le camp anglais.
► 1419 - 2 décembre Alliance entre Philippe le Bon, duc de Bourgogne et Henri V d'Angleterre.
► 1419 Georges Chastellain écrit 'Chroniques' (1419-1475). Georges Chastellain, après d'excellentes études à l'université de Louvain vers 1430, il devint historiographe officiel de Philippe le Bon dont il fut écuyer puis membre du conseil privé. Il servira ensuite Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon. Il résida souvent à Valenciennes où il mourut et donna son nom à une rue de la ville. il servit pendant dix ans (1435-1446) à la cour de France.
Considéré comme étant le plus grand des chroniqueurs bourguignons, Michelet le qualifia de "grand et éloquent historien". Il établira des chroniques qui couvrent la période 1420 - 1474 : Chroniques des choses de ce temps, qui s'ouvrent sur l'assassinat de Jean sans Peur, père de Philippe le Bon, à Montereau. Il est également l'auteur de 'Récollection des merveilles advenues en nostre temps' (vers 1462). Georges Chastellain a laissé de nombreuses oeuvres poétiques (l'Outré d'amour) avec des ballades, des complaintes, des panégyriques, un mémoire justificatif adressé au roi Charles VII et des épitaphes.
► 1420 - 21 mai Traité de Troyes, négocié par Isabeau de Bavière et Philippe le Bon, duc de Bourgogne (fils de Jean sans Peur) avec les Anglais, et qu'on fait signer à Charles VI malgré sa débilité mentale. Par ce traité, le dauphin est déshérité au profit de Henri V d'Angleterre qui est déclaré régent, et héritier de la couronne de France. Henri se marie avec Catherine de Valois, fille de Charles VI. Henri V fait son entrée à Paris et se fait remettre le Louvre, la Bastille, Vincennes, Sens, Montereau et Melun, que ses troupes occupent.
Le dauphin Charles se voit renié et déshérité par Charles VI le Fol qui ne s'oppose pas à ce traité “honteux” par lequel il donne sa fille Catherine en mariage à Henri V d'Angleterre dont il fait le régent et l'héritier du royaume de France. Le dauphin Charles ne deviendra Charles VII que grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. Le traité de Troyes est le traité marquant la suprématie anglaise au cours de la Guerre de Cent Ans. Il a été signé le 21 mai 1420 dans la cathédrale de Troyes et prévoit que Charles VI de France après sa mort serait succédé par Henry VI.
Dans ce traité, Philippe le Bon, Charles VI et Henri V d'Angleterre forment une alliance contre le dauphin Charles VII. La légitimité du dauphin est mise en doute, le soi-disant dauphin, en remettant en question son droit à la couronne. Ils poussent Charles VI et Isabeau de Bavière à renier et déshériter leur propre fils. Ils conviennent par ailleurs qu'Henri V épousera Catherine, la fille de Charles VI de Valois et d'Isabeau de Bavière. Il sera à ce titre le seul héritier de la couronne. Le 1er décembre 1420, Henri V fait une entrée triomphale à Paris en compagnie du roi Charles VI et de Philippe le Bon.
L'Université et les États généraux de langue d'oïl lui apportent leur soutien en enregistrant le traité de Troyes. Les juristes casseront le traité de Troyes en disant que la Couronne de France n'appartenant pas au roi de France celui-ci ne peut donc en disposer. C'est un argument similaire qui est à l'origine de la Guerre de Cent Ans. Deux ans après la signature du traité, Henri puis Charles VI meurent. Le fils d'Henri, âgé de dix mois, est proclamé roi des deux royaumes, dont Paris, sous le nom d'Henri VI. Le duc de Bedford assure la régence en France et met le siège devant Orléans, la dernière ville au nord de la Loire, qui reste fidèle à Charles VII.
► 1420 - 1er décembre Entrée triomphale de Henri V, Philippe le Bon et Charles VI à Paris.
► 1420 - 12 décembre : Réunis à Paris par Henri V d'Angleterre et Charles VI de France, les États généraux approuvent la paix avec l'Angleterre et accordent la couronne au roi d'Angleterre à égalité avec le roi de France.
48 - De 1420 (La France est "anglaise") à 1498 (Louis XII)
► 1420 En ce début du XVe siècle l'État français n'est plus. La France est "anglaise". Depuis le traité de Troyes (21 mai 1420) qui a suivi le désastre d'Azincourt où la chevalerie française s'est enlisée dans la boue "jusque au gros des jambes", et littéralement étouffée elle-même sous le poids de ses armures. Une hécatombe dans les rangs de la noblesse du royaume qui "fut là tuée et découpée têtes et visages". Selon les clauses du traité "honteux", Charles VI renie et déshérite son fils le dauphin Charles et reconnaît le roi d'Angleterre Henri V comme héritier du royaume de France.
A la mort de ce dernier (1422), son fils Henri VI lui succède. C'est un bébé de six mois. Aussi son oncle le duc de Bedford exerce-t-il en son nom la régence en France. Quelle France ? En fait il en existe trois. La France "anglaise" : elle comprend la Normandie, la Guyenne et une partie des régions situées au nord de la Loire. La France du "royaume de Bourges" : en gros la moitié méridionale du pays dans laquelle s'est réfugié le dauphin Charles avec des partisans fidèles, qui l'ont reconnu roi après le décès de son père. Enfin la France de "l'État bourguignon" : donné en apanage au duc de Bourgogne, ce vaste territoire s'est agrandi de l'Artois, la Flandre, le Brabant et les Pays-Bas.
De Philippe III le Hardi à Jean sans Peur et au dernier duc Philippe le Bon, tous ont contribué à consolider leur puissance en faisant de leur apanage un véritable État indépendant. Restée à l'écart des opérations militaires, la France bourguignonne est la plus riche et, malgré les malheurs des temps, la cour des ducs brille par son faste et sa magnificence. Qui gouverne la France ? Le régent anglais le duc de Bedford ? Le petit roi de Bourges ? Le duc de Bourgogne Philippe le Bon ? Cette situation politique extrêmement confuse ajoute encore à l'état pitoyable de la France.
Mais les difficultés ne datent pas d'hier. Elles sont le résultat de plusieurs facteurs conjugués : la crise dynastique, les ravages des épidémies et de la guerre, le marasme économique qui en est la conséquence. Depuis Hugues Capet, la belle continuité monarchique a été brisée. Quand le dernier roi capétien meurt sans laisser d'héritier mâle, les évêques et les barons du royaume sont alors contraints d'élire un neveu du souverain, Philippe VI de Valois. Avec lui naissait une nouvelle dynastie. Mais ce changement ne fait pas l'adhésion de tous.
En France, il sert de prétexte aux prétendants évincés pour se rebeller, pour former des partis hostiles, pour faire de leurs apanages des états dans l'État, bafouant ainsi l'autorité royale. En Angleterre, le roi qui se considère également comme un prétendant possible au trône, entre en conflit avec le nouveau roi de France. C'est le début de la guerre de Cent Ans (1337-1453) ou plus exactement de cent ans d'hostilités entre les deux royaumes. Cette longue période de conflits intermittents (en moyenne une année de guerre sur cinq), coupée de trêves et de négociations est cependant désastreuse pour le pays.
Bien que n'affectant que quelques cantons successivement, la guerre est profonde et destructrice. Les campagnes sont dévastées, soit par le pillage des troupes anglaises qui vivent dans le pays, soit par les destructions tactiques des Français qui visent à priver l'ennemi de ravitaillement. De plus la guerre a changé dans ses techniques et dans la mentalité des guerriers. Les armes à poudre sont de plus en plus employées, et l'artillerie seconde les toujours redoutables archers et les nouveaux arbalétriers. Pour s'en protéger, les chevaliers endossent une armure complète, exagérément lourde (de 20 à 60 kg) qui les entrave et rend le combat à cheval quasiment impraticable. La chevalerie anglaise s'adapte mieux.
Elle a introduit la lutte au sol avec des armes courtes, des poignards qui se glissent facilement dans les jointures des armures. A l'inverse des chevaliers français qui dédaignent leur aide, les Anglais s'entourent d'archers montés, donc très mobiles. Tactique qui va leur apporter une supériorité décisive et tous les succès militaires. Nouveaux moyens, nouvel esprit. Les guerriers sont désormais des spécialistes qui traitent la guerre en hommes de métier et non plus comme une joute réglée par un code de courtoisie et des gestes "chevaleresques". Rares sont les batailles rangées où deux blocs s'affrontent toutes lances dehors.
La guerre est faite d'embuscades, d'escarmouches, de chevauchées rapides. La ruse et la surprise priment. L'ennemi est harcelé par des petites bandes bien armées et d'une grande mobilité. Ce sont exclusivement des entrepreneurs de combats. Le roi traite avec ses mercenaires, aventuriers de toutes origines (Allemands, Bretons, Comtois, Basques, Espagnols etc.). Moyennant une rémunération substantielle, ces capitaines, issus pour la plupart de la noblesse, mettent à la disposition du roi leurs "compagnies ou routes", d'où leur nom de "routiers". Le groupe d'une quinzaine ou trentaine d'hommes au plus est fortement solidaire sous l'autorité du chef.
Mais quand viennent les trêves les compagnies se dissolvent. Dès lors les hommes astreints au chômage pillent, attaquent les caravanes, exigent tribut aux villes en échange de leur "protection". Mais ceux que les citadins et les villageois appellent les "écorcheurs" ou "retordeurs" grossiront bientôt les rangs des compagnons de Jeanne d'Arc. Jamais terminée malgré des trêves, la guerre est coûteuse, dévoreuse de monnaie, ruineuse pour le trésor royal. Où trouver de nouvelles ressources pour la financer ? Le temps féodal n'est plus où l'on pouvait lever une armée sans la payer, où nobles vassaux et simples soldats devaient aide au souverain.
Les soldats comme les routiers ont désormais une solde. La gabelle (taxe sur le sel), la taille (impôt sur chaque feu c'est à dire sur chaque famille paysanne) ne suffisent plus. Des levées "extraordinaires", les maltôtes, constituent des ponctions supplémentaires dans l'épargne privée des bourgeois ou dans celle des paysans. Le coût insupportable de la guerre frappe également la noblesse qui doit réunir l'argent de rançons énormes pour délivrer un seigneur prisonnier. Elle n'en a souvent plus les moyens et le combattant captif peut rester des années aux mains de l'ennemi. Par dizaines des lignages se sont ainsi éteints.
Par domaines entiers les terres ont été laissées à un abandon forcé. Poussés par la guerre, les paysans se sont enfuis à l'abri des murailles des cités. Car à moins d'une ruse ou d'une trahison, la ville fortifiée demeure imprenable. Le siège, interminable pour les deux parties, est souvent abandonné. Mais les terres environnantes gardent longtemps les empreintes des exactions ennemies. Après le passage des hommes en armes, la campagne ressemble à un désert. Les bâtiments de ferme sont brûlés, les récoltes saccagées, les outils volés, les vignes, fours et moulins anéantis pour longtemps. Pour les paysans c'est le début de l'exode.
En quête de sécurité ou de conditions de vie moins misérables, ils abandonnent derrière eux la terre laissée en friche, qui retourne vite à la forêt, au taillis ou en "épines". Pour les contemporains de Charles VII le bon temps était l'époque où tous avaient toujours de quoi manger. Ce temps est révolu. Mais l'occupant anglais et la guerre n'en sont pas les seuls responsables. Après un formidable essor, la France comme toute l'Europe subit une crise massive. Recul des espaces cultivés, mais aussi stagnation des rendements, pas d'amélioration dans l'outillage, régression de la production vivrière.
Avant les méfaits de la guerre, c'était déjà le déclin des campagnes et leur dépeuplement : la courbe démographique a chuté. Les intempéries répétées et les famines qui s'ensuivent en sont les causes premières. Durant des décennies la hantise de la faim va obséder le paysan comme l'homme de la ville. Cependant le fléau majeur reste la Peste noire. Apparue au milieu du XIVe siècle, se prolongeant par poussées intermittentes au XVe siècle, la peste a traversé la France du sud au nord. Souffrant d'une sous-alimentation chronique, la population résiste mal aux chocs de l'épidémie.
Selon les régions, le quart, le tiers, la moitié, parfois 80% de la population disparaît. De 1330 à 1450, le pays passe de 20 millions à 10 millions d'habitants ! Le mal a gagné partout en dépit des cordons sanitaires aux portes des villes, des feux d'herbes aromatiques dites “désinfectantes de l'air”, des pénitences collectives, des processions de flagellants, du massacre des Juifs rendus responsables de la calamité ou des recherches nombreuses de la Faculté de médecine. La mort qui fauche pareillement chevaliers ou vilains, pauvres ou riches, faibles ou forts, hante toute la population.
La religion constitue un recours et devient plus individuelle. On appelle au repentir. Des prêcheurs haranguent les foules des villes. Pour leur édification on multiplie la représentation des Passions, des Mystères à grand renfort de machineries et de figurants. L'image de la mort est partout, dans les livres d'Heures ou ornant tombeaux et sépultures de macabres squelettes rongés par les vers. On se prépare à la mort en pratiquant une religion plus profonde, moins tournée vers la contemplation de Dieu que fondée sur l'idée du péché et de la crainte de l'Enfer. Aux malheurs des temps s'ajoute l'effondrement économique. L'économie d'échanges n'est plus regroupée autour de l'axe routier Flandre-Italie.
Traversant les pays français, cet axe avait fait leur étonnante prospérité aux siècles précédents. Jadis carrefour commercial, la France se situe maintenant un peu à l'écart, dans une Europe qui a créé de nouveaux foyers économiques et des itinéraires marchands par mer, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie ou en Espagne. Bruges, Gand, Anvers, Gènes, Barcelone, Londres ont remplacé les foires grouillantes de marchandises de la Champagne et de la Brie. La pénurie du numéraire, les désordres monétaires, l'abaissement très net du pouvoir d'achat du haut clergé comme des seigneurs ruraux, expliquent la paralysie de l'activité commerciale autant que les déplacements des grands circuits marchands.
Comme celle des campagnes, l'activité urbaine a beaucoup décliné. Ruines, maisons branlantes, quartiers désertés attestent de l'appauvrissement général. Comme en milieu rural, le nombre des habitants a parfois diminué de moitié (de 40 000 à 20 000 à Toulouse). Les associations de métiers se durcissent et se sclérosent. Comparé à son confrère italien, le marchand des cités provinciales paraît singulièrement retardataire. Il vend un peu de tout (produits de première nécessité) sans pouvoir se spécialiser. En temps de disette, il est essentiellement pourvoyeur de grain. Symptôme des temps difficiles, la grande industrie drapière elle-même entre en décadence.
Arras résiste cependant grâce à la fabrication nouvelle de la tapisserie de haute lisse, très à la mode dans les demeures nobles. Car le marasme n'est pas absolument général. En dépit du commun fléchissement de la fortune, quelques hommes s'enrichissent. Des entrepreneurs de guerre placent leurs immenses profits dans des seigneuries foncières. Des familiers du prince ou du souverain, directement branchés sur la fiscalité, font de prodigieuses ascensions. Tel Jacques Coeur, fils d'un pelletier de Bourges devenant l'homme le plus riche du royaume, maître des monnaies, grand argentier de Charles VII et anobli par lui.
Construit en moins de dix ans, son hôtel particulier à Bourges a coûté la somme folle pour l'époque de 100 000 écus d'or. Quelques îlots exceptionnels de prospérité subsistent donc dans un pays politiquement cloisonné. Ainsi par exemple les capitales politiques comme Bourges mais aussi Paris ou Dijon. Les villes où résident les cours royales ou princières sont devenues des places de commerce ou d'argent.
Là converge tout l'or des impôts. Levées sous prétexte de guerre, des sommes fabuleuses sont dépensées dans le luxe et les fêtes par les princes. La cour de Bourgogne est la plus brillante. Son palais de Dijon et ses châteaux de campagne regorgent d'objets et d'oeuvres d'art commandés aux Pays-Bas ou en Italie. On fait appel aux meilleurs compositeurs pour élaborer un nouveau style musical ; on charge les plus habiles artistes d'éclairer de vitraux les chapelles privées. Les tournois sont des spectacles réglés comme des ballets dont les livrets sont tirés des romans courtois. Les tombeaux des ducs de Bourgogne, avec à leurs pieds un cortège sculpté des princes du sang et des grands vassaux, ont vite fait école hors du duché.
Moins fastueuse à Bourges, la cour de Charles VII va néanmoins retrouver tout son éclat à Paris, après qu'une petite paysanne entre en scène, triomphe de l'Anglais et permet le sacre du roi à Reims, le 17 juillet 1429. La France a à nouveau un vrai souverain, oint du Seigneur. En le sortant de son “exil”, Jeanne d'Arc semble avoir insufflé au roi l'énergie de se battre, et redonné aux Français la force de relever la tête. Ceux qui vivaient encore dans les territoires occupés ont compris que les Anglais “ne recherchaient qu'à les accabler et à les faire périr sous le poids des misères”.
Le sursaut est général, enflammé par le revirement de la fortune des armes. Les soulèvements se multiplient, villes et places fortes tombent successivement aux mains des Français. Sagement conseillé, totalement transformé par ses succès, Charles VII se réconcilie avec le duc de Bourgogne qui reconnaît enfin sa légitimité. Grâce à la réorganisation complète de l'armée et son institution en corps permanent, l'Ile-de-France est reconquise. Paris est libéré, puis en quelques années toute la Normandie et la Guyenne. La France en a fini avec la présence anglaise et la guerre de Cent Ans.
Dès lors elle peut reprendre haleine, se reconstruire. C'est ce à quoi toute la nation s'emploie durant les vingt dernières années du règne de Charles VII. Le roi est le principal acteur de cette rénovation. Secondé par des conseillers énergiques, nobles et bourgeois, il restaure l'autorité royale en mettant fin aux intrigues de cour et aux derniers États princiers. Mais ce triomphe de la royauté ne peut être durable que par l'union de toutes les régions au domaine de la couronne.
Par confiscations, par la diplomatie, la rigueur ou par héritage, le domaine finira par s'élargir au-delà des limites du royaume. Bien administrer ce vaste territoire exige des réformes. Les "gens du roi" (agents de justice, sergents d'arme et de police, auxiliaires de tous rangs, clercs et laïcs) ont considérablement gonflé l'appareil administratif. C'est une lourde machine mais capable de fonctionner par elle-même, de gouverner efficacement avec son Parlement, sa Chancellerie, sa Chambre des comptes. Voulue par le souverain, la puissance publique se met en place de façon progressive mais profonde.
L'ordre est rétabli dans la justice. Nomination des magistrats, exercice de leurs fonctions, règles de procédures sont fixées. La rédaction du droit coutumier, jusqu'alors oral, est inaugurée. En province, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Perpignan sont également dotés d'un Parlement. Des assemblées d'état répartissent les taxes. A force d'être sans cesse renouvelés pour l'effort de guerre, les impôts "extraordinaires" sont devenus réguliers. Sans violence, presque subrepticement, une transformation essentielle s'est produite dans la fiscalité : la monarchie a instauré un système d'imposition permanent qui remplit régulièrement les caisses de l'État.
Pour faciliter la perception des impôts, on crée un corps de fonctionnaires spécialisés : généraux des finances et receveurs. Priorité est donnée aux campagnes. Toutes initiatives individuelles pour repeupler et remettre en culture les terres sont fortement encouragées. Des ordonnances royales favorisent la renaissance de l'activité économique : exemption d'impôt pour les paysans revenus cultiver les terrains en friches. Le roi offre également des primes à tous ceux qui débarrasseraient les campagnes et les abords des villes des hordes de loups, qui menacent jusqu'aux portes de Paris.
Dans les champs, dans les vignes, dans les bois on travaille avec une ardeur redoublée. Les progrès de l'agriculture commencent à porter leurs fruits. Des villages nouveaux surgissent. Les cités relèvent leurs ruines. On constate une sensible reprise industrielle. Les fabrications se raniment, des industries nouvelles se développent. Jean Gobelin pratique à Paris la teinture de tapisseries auxquelles il a légué son nom. L'imprimerie est introduite à Lyon et dans la capitale. Les gisements de plomb argentifère sont relancés.
Le système monétaire est enfin assaini. Mais sans “le support de la conscience nationale”, la reconstruction de la France serait fragile. L'unité de la langue devient un élément de l'unité française. De la Bretagne aux pays occitans, le français est langue officielle. Il se substitue partout au latin dans les actes de Chancellerie et tous les actes publics dans les parlements régionaux. Un véritable élan créateur prend son départ vers 1440. Né du gothique, l'art flamboyant transfigure le décor architectural.
En même temps est née la grande peinture. Aux enluminures des livres, les amateurs préfèrent maintenant le tableau peint sur panneaux de bois. Il connaît son épanouissement dans l'oeuvre de Jean Fouquet, peintre du roi et de quelques grands personnages du royaume tel le Chancelier de France Guillaume Jouvenel des Ursins. Revenus à la cour à Paris avec Charles VII, les artistes, peintres, sculpteurs et maîtres verriers contribuent également à une vraie renaissance artistique.
La capitale s'embellit de nombreux hôtels particuliers en pierre, de fontaines richement décorées. Les églises sont parées d'une exubérante floraison sculpturale de feuillages et d'arabesques qui expriment l'opulence et la joie de vivre retrouvées. Paris qui a survécu au désastre de la guerre de Cent Ans est plus que jamais au XVe siècle et bien au-delà, "le foyer où s'élabore les modes, où s'inventent les rites sociaux, où se définit le style de vie, où se forme le goût de tous ceux qui en Europe prétendent vivre noblement".
► 1420 Robert Campin peint 'La Madone à l'écran d'osier'. Robert Campin (vers 1378-1445), peintre, dit le "Maître de Flémalle" Issu d'une famille de Valenciennes, il fait une partie de son apprentissage à Dijon. Sa première apparition en tant que peintre se situe à Tournai où plusieurs acquisitions immobilières sont à son nom, ce qui dénote une certaine réussite matérielle. Entre 1418 et 1432, il devient chef d'atelier à Tournai et a comme élève Rogier van der Weyden. Il y rencontre probablement Jan van Eyck durant ses visites dans cette ville. Il va par la suite s'engager intellectuellement du côté des Français contre les pro-Bourguignons, ce qui lui occasionne plusieurs condamnations en justice.
► 1420 Robert Campin peint 'Nativité’
► 1420 à 1481 - naissance et mort de Jean Fouquet. Peintre et enlumineur, portraitiste réputé, Jean Fouquet est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands créateurs de son temps. Au confluent des influences flamandes et toscanes qui dominent la peinture européenne de l'époque, son art renouvela profondément la peinture française du XVe siècle.
► 1420 vers - renaissance italienne. Mouvement humaniste, qui rejetant les valeurs médiévales tend à renouer avec la tradition gréco-romaine. Un des aspects essentiel de la Renaissance en tant que période est le renouvellement des thèmes et de l'esthétique en Europe. Régulier et Séculier sont des termes qui fréquemment dans la rhétorique religieuse sont opposés ; leur emploi est associé à la cosmologie percue par les sacerdotes. Séculier : qui vit dans le siècle. Désigne le pouvoir temporel, la justice de l'État, par opposition à spirituel.
Par extension : laïc, non soumis à l'autorité et/ou l'influence religieuse. Clergé séculier: clergé non régulier; le clergé séculier regroupe donc les prêtres en paroisse, les diacres, les évêques, les cardinaux, etc. Régulier : soumis à une règle de vie, telle que celle des moines. Clergé régulier, obéissant à la règle d'un ordre monastique; Renaissance artistique, la Renaissance, Rinascimento en Italien, est une période de renouveau littéraire, artistique, et scientifique, qui se produisit en Europe par la diffusion de connaissances nouvelles parmi un milieu lettré. Un des aspects essentiels de la Renaissance en tant que période est le renouvellement des thèmes et de l'art en Europe après le Moyen Âge.
Donner des bornes chronologiques précises pour ce mouvement artistique est difficile. Il est couramment admis que la Renaissance artistique commence en Italie au XVe siècle puis se diffuse dans le reste du continent, à des rythmes et des degrés différents selon la géographie. Elle se prolonge au XVIe siècle et atteint alors dans de nombreux pays son apogée. La Renaissance ne constitue pas un retour en arrière : les techniques nouvelles, le nouveau contexte politique, social et scientifique permettent aux artistes d'innover. Pour la première fois, l'art pénètre dans la sphère du privé : les oeuvres ne sont plus seulement commandées par le pouvoir religieux ou séculier, mais entre dans les maisons bourgeoises.
► 1420 Sciences en Europe durant la Renaissance, la Renaissance en Europe (qui commença en Italie), fut une période qui se termina par une véritable révolution scientifique. Des théories tout à fait nouvelles sont apparues, remettant en cause la façon dont l'homme voyait le monde et sa place dans ce dernier. En fait, ce que l'on appelle couramment la Renaissance commença beaucoup plus tôt en Italie et à Avignon, que dans le reste de l'Europe (ce mot commença seulement à se répandre), et surtout en France, qui resta longtemps affectée par les soubresauts de la guerre de Cent Ans.
- Dès le XIVe siècle (Trecento), on vit des foyers de Renaissance apparaître à Venise, Sienne, Florence, Rome et encore davantage au XVe siècle (Bruges et les cités flamandes, Rhénanie, Alsace, Bourgogne, Portugal, Castille, Bourges, etc.). Les raisons de cette Renaissance sont multiples, comme :
- la redécouverte dès le XIIe siècle des textes anciens (Aristote) conservés et enrichis par les Arabes,
- l'invention du papier (importé de Chine), l'invention de l'imprimerie (1453) (également importée et améliorée par Gutenberg) qui permit de diffuser en plus grand nombre des livres (les copies sur manuscrit prenaient du temps) et surtout de publier des livres en langues vernaculaires à la place du latin, donc de propager la culture,
- les progrès en géographie et en cartographie (Pierre d'Ailly et l'Imago mundi de 1410, cartes de Fra Mauro en 1457),
- les progrès techniques autour de la navigation (caravelle) et du positionnement (boussole, sextant, etc.),
- l'expansion de l'exploration maritime autour du continent africain (Portugais), puis vers le nouveau monde,
- la naissance du protestantisme et de l'hermétisme qui força l'Église catholique romaine à se remettre en cause, amorçant ce qui sera une séparation de la science et de la religion.
Copernic vécut pendant la Renaissance, mais les possibilités de diffusion de l'information n'étaient pas encore telles que ses idées, pas toujours si mal acceptées au départ, pussent être diffusées largement. On ne peut pas parler de révolution copernicienne au sens propre pour la Renaissance (elle fut un peu postérieure). Toutefois, il y eut bien un changement radical de vision du monde, qui portait davantage sur la prise de conscience par le plus grand nombre de la rotondité de la Terre (on le savait depuis le XIIe siècle au moins dans les milieux cultivés), dès l'instant que les navigateurs eurent traversé l'Atlantique.
En particulier, les voyages de Christophe Colomb eurent un retentissement considérable. Les progrès scientifiques et techniques de la Renaissance, ainsi que le renouveau dans les autres domaines (art) furent l'une des causes de l'extraordinaire période d'explorations par les navigateurs européens, d'abord portugais, et italiens, puis espagnols et français, qualifiée de grandes découvertes, qui permit à l'Europe de s'assurer la suprématie mondiale.
► 1421 Le dauphin Charles VII n'a pas cessé de guerroyer contre les Anglais. Sept mille Écossais sont venus se mettre à sa solde, mais en général le sort des armes ne lui est pas favorable.
► 1421 - 3 janvier Le dauphin Charles VII est banni du royaume.
► 1421 - 22 mars Victoire du dauphin Charles VII et des Écossais sur les Anglais à Baugé. Bataille de Baugé, le 21 mars 1421, la bataille de Baugé voit la défaite de l'armée anglaise du duc de Clarence (environ 3000 hommes) face à l'armée franco-écossaise de Motier de la Fayette et du comte écossais John Stuart de Buchan. Cette bataille est la première défaite anglaise en bataille rangée depuis 1415.
► 1422 - 2 juin Mariage du Dauphin Charles VII avec Marie d'Anjou. Marie d'Anjou (1404-1463). Fille de Louis II d'Anjou, duc d'Anjou et roi titulaire de Naples, et de Yolande d'Aragon, Marie est née le 14 octobre 1404 à Angers. Elévée auprès de son futur époux, ils furent mariés en avril 1422 à Bourges. Elle est couronnée reine de France en 1422 avec son époux, Charles VII de France - fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière.
► 1422 - 31 août Mort de Henri V, son fils Henri VI d'Angleterre (10 mois) lui succède. Henri VI d'Angleterre (6 décembre 1421 - 27 mai 1471), roi d'Angleterre, était le seul enfant du roi Henri V d'Angleterre. Sa mère était Catherine de Valois. Henri fut déposé le 4 mars 1461, par Édouard IV. Restauré sur le trône le 30 octobre 1470, il fut à nouveau déposé le 11 avril 1471. Il fut mis à mort, en secret, à la Tour de Londres.
► 1422 - 21 octobre Mort de Charles VI et de Henri V d'Angleterre; On ne sait quelle affection emporte le roi, qui meurt à cinquante-quatre ans. Alors qu'il a perdu la raison des années plus tôt, le roi est lucide au moment de mourir. Peu avant de rendre l'âme, il dit à sa fille Marguerite : “Ma fille, je te donne… Mais j'oublie que le roi de France ne possède plus rien !… Il ne peut plus donner que sa bénédiction”. A l'annonce de la mort du roi, Jean-Juvénal des Ursins rapporte : “Les François-Anglois commencèrent à crier : vive le roi Henri de France et d'Angleterre, et criaient Noël comme si Dieu fut descendu du ciel”.
En dépit de leur joie, c'est Charles VII, surnommé quelques années plus tard “le Victorieux”, qui lui succède. Henri VI, qu'Henri V a eu de la fille de Charles VI, âgé seulement de dix mois, est proclamé à Paris roi de France et d'Angleterre, tandis que le dauphin Charles se proclame roi de France à Mehun-sur-Yèvre (en Berry), sous le nom de Charles VII. La règne de Charles VI a été désastreux pour la France.
Pendant que le pays était livré aux horreurs de la guerre civile, ceux qui prétendaient le gouverner au nom du roi fou l'exploitaient indignement, et finalement en vendaient aux Anglais la plus grande partie. La reine Isabeau, qui a marqué ce long règne de ses débauches et de ses exactions, survit à son complice Henri V d'Angleterre jusqu'en 1435. Charles VI passa presque toutes les années de sa folie dans une sorte d'internement, livré aux soins d'une compagne, Odette de Champdivers, qui inventa pour le distraire, dit-on, les cartes à jouer. Lors de la mort de Charles VI, les Armagnacs et les Bourguignons étaient encore en guerre : les premiers représentaient le parti du dauphin, les Bourguignons étaient inféodés aux Anglais.
► 1422 Avènement de Charles VII (né en 1403). - A ce moment, il ne possède que la Touraine, l'Orléanais, le Berry, l'Auvergne et le Dauphiné: il a fixé sa capitale à Bourges, aussi les Anglais l'appellent-ils par dérision le roi de Bourges. Tout le reste du royaume, tel qu'il était à l'avènement de Charles VI, est entre les mains des Anglais qui, tout au moins, en occupent les points les plus importants, et gouverné par leur duc de Bedford; celui-ci, allié avec le duc de Bourgogne, continue la conquête de la France. Charles VII est entouré de capitaines braves et dévoués, tels que La Hire, Xaintrailles, le connétable de Richemond, mais il manque de ressources pour soutenir efficacement la lutte. D'ailleurs, bien qu'il ait donné à l'occasion des preuves de bravoure, il est indolent et prodigue et sacrifie tout au plaisir.
► 1422 CHARLES VII (1422-1461)
► 1422 Charles VII le Victorieux. Lorsque Charles VI meurt abandonné de tous, Charles VII, qui avait fui les Bourguignons et sa mère (Isabeau de Bavière), s'était réfugié à Bourges en 1418 déshérité par sa mère en 1420 il n'est pas vraiment le roi de France. La reconquête du royaume est sa tâche primordiale, mais les premières années sont difficiles, l'armée royale est battue à Cravant en 1423 puis à Verneuil-sur-Avre en 1424 par les Anglo-Bourguignons qui font le siège d'Orléans en 1428. Progressivement un élan de résistance nationale s'incarne dans la personne de Jeanne d'Arc à partir de 1429.
Les états du Languedoc votent des subsides pour le roi de Bourges, Charles VII peut ainsi lever une armée, tous les états du midi repondent à son appel. Les occupants commencent à avoir des problèmes des troubles éclatent un peu partout. Dans certaines régions de France les occupants avaient été accueillis favorablement, Flandres, Normandie, Paris, parce qu'ils promettaient l'ordre et la prospérité mais ils n'apportèrent que la guerre et la famine. Les Anglais réagissent avec vigueur mais les effectifs manquent. Lorsque les Anglais commandés par le duc de Bedford (Jean de Lancastre) font le siège d'Orléans, le Dauphin se sent perdu.
C'est à ce moment qu'il reçoit la visite de Jeanne d'Arc une petite paysanne de Donrémy à qui dieu avait donné la mission de faire couronner le roi à Reims et de bouter l'Anglais hors de France. Le roi lui confie une petite armée commandée par Dunois pour porter main forte aux assiégés d'Orléans. Lorsqu'elle se présente sous les murs d'Orléans, les Anglais sont déconcertés et les assiègés réconfortés. Le 8 mai 1429 les Anglais lèvent le siège. Elle accomplit la première partie de sa mission divine le 17 juillet 1429 le roi est sacré à Reims.
Toute la France apprend alors qu'elle a un roi guidé par la pucelle. La foi de Jeanne se communique dans toute la France. La contre offensive est pour les Anglais et les Bourguignons de la faire passer pour une sorcière, surtout auprès du clergé du nord favorable aux occupants. Jeanne échoue dans la libération de Paris, car les Parisiens lui sont hostiles. Un coup de main des Bourguignons leur permet de capturer Jeanne qui est aussitôt remise aux Anglais qui font une grande opération "médiatique" de son procès la faisant condamner par des juges français et brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431.
Jeanne avait réveillé contre l'occupant anglais la conscience nationale, son martyre allait faciliter la réconcilliation des Français. Le roi bénéficie alors d'hommes de guerre valeureux comme Lahire, Xaintrailles ou le connètable Richemond. Mais la France comme l'Angleterre et la Bourgogne est exangue. L'initiative vient du duc de Bourgogne qui propose une trève, les Anglais refusent mais Charles VII accepte. C'est la paix d'Arras en 1435. Des concessions importantes sont faites aux Bourguignons mais elles brisent l'alliance des Bourguignons avec l'Angleterre ce qui permet au roi de reprendre Paris et d'y faire son entrée en 1437.
En 1438 le roi publie la pragmatique sanction de Bourges dans laquelle le clergé français est placé sous la coupe du roi et non du pape. Il peut notamment, intervenir dans les élections des prélats. L'année suivante le clergé français accepte ce texte, il a choisi son maître. En 1440 a la suite d'une réforme de l'armée, une révolte seigneuriale visant à renverser le roi et placer sur le trône le dauphin, futur Louis XI, éclate. Elle sera appelée Praguerie. Le meneur est cousu dans un sac et jeté à l'eau, le dauphin est exilé dans le Dauphiné.
En 1444 les Anglais acceptent une trêve de 5 ans que Charles VII utilise à réorganiser l'armée, créant des compagnies d'ordonnances et d'archers, ainsi que les finances, la taille est devenue depuis 1439 un impôt permanent. La reprise de la guerre en 1449 marque la fin de la reconquête du sol national. La Victoire de Formigny en 1450 ramène la Normandie dans le giron français puis la victoire de Castillon-la-Bataille la Guyenne et Bordeau en 1453. La guerre de 100 ans se termine les Anglais ne possèdent plus en France que Calais. Charles VII introduisit dans les moeurs de la royauté française un nouveau personnage celui de la favorite officielle du roi en la personne de Agnès Sorel. Elle lui donna 4 filles que le roi reconnut. Elle mourut en 1450 et fut rapidement remplacée par sa cousine Antoinette de Maignelais.
► 1422 - 30 octobre Le dauphin se proclame roi à Bourges.
► 1422 Le duc de Bedford (Jean de Lancastre) gouverne au Nord de la Loire au nom de Henri VI d'Angleterre. Jean de Lancastre, duc de Bedford (1389-Rouen 1435), parent des souverains anglais, il fut régent du royaume de France à partir de 1422. Troisième fils d'Henri IV et de Marie de Bohun. Il est le frère d'Henri V et l'oncle d'Henri VI. En 1423 Jean duc de Bedford épouse Anne de Bourgogne (?-3 novembre 1432) fille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne et de Marguerite de Bavière-Hainaut. En 1433 il épouse Jacquette de Saint-Pol (1416?-1472). Il fut duc de Bedford, comte de Richemont, connétable d'Angleterre, et se fit nommer duc d'Anjou et comte du Maine.
► 1423 à 1429 - Au cours de la lutte contre les Anglais, les Français et les Écossais, qui combattent avec eux, sont battus dans toutes les rencontres: à Cravan (1423), à Verneuil (1424), à Rouvray (1429) où ils ont la satisfaction platonique de détruire un convoi de harengs destiné au ravitaillement des Anglais, ce qui a fait donner à cette affaire le nom de Journée des Harengs.
Aussi les Anglais ont-ils pu descendre jusqu'à Orléans, qu'ils assiègent et autour de laquelle ils ont élevé des bastilles. Une bastille (de l'ancien provençal bastida, qui a donné aussi "bastide") est un ouvrage de fortification, bâti pour défendre une place. Il revêt souvent la forme d'un château fort à l'entrée d'une ville. Par extension, le terme peut désigner une ville neuve fortifiée, dans le Midi de la France.
► 1423 - 3 juillet Naissance de Louis (futur Louis XI) à Bourges. Louis XI de France, né le 3 juillet 1423 à Bourges, mort le 3 août 1483 au Château de Plessis-lez-Tours (commune de La Riche, Indre-et-Loire), fut roi de France de 1461 à 1483, sixième roi de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne.
► 1423 - 30 juillet Victoire des Bourguignons et des Anglais sur Charles VII à Cravan.
► 1423 Le Français est encore utilisé dans institutions officielles en Angleterre.
► 1424 - 17 août Défaite des Français et des Écossais à Verneuil contre les Anglais. La situation de Charles VII est presque désespérée. Les Anglais, auxquels Isabeau de Bavière, mère du Dauphin, a donné le royaume de France lors du traité de Troyes, sont à Paris. En ce 17 août, ce sont des troupes disparates qui au nom du Dauphin font face à celles du duc de Bedford : auprès des bandes d'Étienne de Vignolles, qu'on appelle La Hire, du comte d'Aumale, il y a là des Lombards, des Piémontais et qui plus est quelques Écossais, des Anglais même et des Normands. A peine la bataille s'engage-t-elle que les Lombards et les Piémontais se débandent. Les flèches des archers anglais pleuvent. Les Écossais sont massacrés. Aumale est tué. En quelques heures, l'armée du roi de France n'est plus rien.
► 1425 - 13 mai Jeanne d'Arc est conduite devant Robert de Baudricourt, gouverneur de Vancouleurs qui la renvoie. Robert de Baudricourt, Seigneur du lieu, de Blaise, Buxy et Sorcy. Capitaine de Vaucouleurs depuis 1415, châtellenie du duché de Bar, dont relevait le village de Domrémy. Conseiller et chambellan de René d'Anjou. Mort entre février et août 1454.
► 1425 - 7 octobre Traité de Saumur. Quoiqu'il ne soit encore que le Dauphin et que son royaume soit dérisoirement appelé le royaume de Bourges, Charles VII, dit bientôt “le Victorieux” reçoit l'hommage du duc de Bretagne Jean V de Bretagne.
► 1426 à 1516 - naissance et mort de Giovanni Bellini, peintre italien de la Renaissance, considéré comme le précurseur de l'école vénitienne (Titien, Tintoret, Tiepolo, Veronèse, etc.). Bellini marque la rupture définitive avec le style gothique, par son attachement à la rigueur géométrique, et par ses oeuvres qui effacent la différence entre monde sacré et profane.
► 1427 Masaccio peint 'Adam et Eve chassés du paradis'.
► 1428 - 12 octobre Début du siège d'Orléans par les Anglais.
► 1428 Sièges du Mont-Saint-Michel et d'Orléans par les Anglais.
► 1429 - 12 février : À la bataille de Rouvray, dite "journée des Harengs", de nombreux défenseurs de la ville d'Orléans meurent dans une expédition pour s'emparer d'un convoi de ravitaillement - des harengs - destinés aux Anglais. Orléans cesse de recevoir des secours.
► 1429 - 13 février Après avoir convaincu Robert de Baudricourt, Jeanne d'Arc part à la rencontre du Roi.
► 1429 à 1431 - Mission et actes de Jeanne d'Arc. - Jeanne d'Arc, fille de pauvres gens de Domrémy (village de Lorraine), est née en 1412. Vers l'âge de treize ans, elle a commencé à avoir des visions au cours desquelles, dit-elle, l'archange saint Michel et des saintes lui sont apparues, et lui ont ordonné de délivrer la France des Anglais. Elle se défend pendant cinq ans, que durent ces manifestations de l'au-delà, d'accepter cette mission pour laquelle elle ne se voit pas faite.
Cependant, dans sa province reculée, les gens souffrent cruellement de l'état de guerre permanent ; le bruit des défaites des compagnons du roi de France est parvenu jusqu'à eux ; ils n'ignorent pas qu'Orléans qui est le dernier rempart de la monarchie est dans une position précaire. Ces dernières nouvelles emportent le consentement de Jeanne. Elle va raconter ses visions au capitaine du pays pour le roi, le sire de Baudricourt, et le somme de la faire conduire auprès de Charles VII ; Baudricourt commence par la rebuter, et enfin ébranlé par la conviction de la jeune "pastoure", il consent à son départ, lui facilite l'achat d'un cheval et de vêtements masculins, lui donne une épée et une escorte de six hommes d'armes.
Après un voyage de vingt jours, Jeanne arrive à Chinon où se tient la Cour. Charles VII ne la laisse que trois jours plus tard pénétrer auprès de lui, encore s'est-il mêlé à la foule des courtisans pour voir si elle le reconnaîtra, mais elle va à lui sans hésitation. Le roi des cieux, lui dit-elle, vous mande par moi, gentil dauphin, que vous serez sacré et couronné à Reims. Après divers incidents, le roi, gagné lui aussi, ainsi que son entourage, par l'assurance de celle qui se dit envoyée de Dieu, consent à lui confier quelques troupes avec lesquelles elle part pour faire lever le siège d'Orléans.
Jeanne d'Arc réussit à pénétrer le 20 avril dans Orléans où les assiégés, confiants dans sa mission et subjugués par son ascendant, se rangent sous ses ordres : en quelques jours, elle rétablit la discipline, réorganise la défense et dirige de sa personne plusieurs coups de main hors des murs, au cours desquels différentes bastilles sont enlevées aux Anglais. Le 7 mai, malgré l'avis des capitaines, elle ordonne une grande sortie qui donne lieu à un violent combat où elle est blessée, mais les Français, après avoir été sur le point de lâcher pied, sur ses exhortations reprennent vigoureusement l'offensive et remportent la victoire.
Le lendemain, les Anglais épouvantés lèvent le siège. C'est cet événement que la ville d'Orléans en particulier, et la France en général, commémorent par de grandes fêtes le 8 mai. Les Français, électrisés par ce succès magnifique, suivent dès lors aveuglément Jeanne d'Arc. Sous ses ordres, ils pourchassent les Anglais en retraite, leur reprennent Jargeau, Beaugency et Meung. Enfin, le 18 juin, elle remporte à Patay une nouvelle grande victoire qui lui ouvre la route de Reims ; Troyes et Châlons lui font leur soumission. Le gouverneur bourguignon de Reims est contraint par l'enthousiasme populaire d'ouvrir les portes de la ville à Jeanne et à Charles VII.
Le 17 juillet, en présence de Jeanne d'Arc, des capitaines et de l'armée, a lieu dans la cathédrale le sacre solennel de Charles VII par l'archevêque Regnault de Chartres, que le retour des Français a remis en possession de son siège. Jeanne est décidée à poursuivre sans autre répit les Anglais, mais les chefs de l'armée, jaloux sans doute de l'ascendant qu'elle pourrait prendre sur le roi, ne la secondent que mollement. Cependant elle vient attaquer Paris (fin août 1429), et bien qu'elle manque des moyens nécessaires pour une aussi grosse entreprise, elle tente de forcer l'entrée de la ville par la porte Saint-Honoré. La ville est sur le point d'être prise, lorsque Jeanne est blessée : ses troupes l'entraînent en arrière, et les Anglais restent maîtres de la place.
Jeanne continue de tenir la campagne, mais le mauvais vouloir des chefs des troupes paralyse ses efforts et elle ne remporte plus que des succès sans conséquence. En 1430, le duc de Bourgogne étant venu mettre le siège devant Compiègne, qui tenait pour le roi de France, les habitants demandent le secours de Jeanne ; tout ce que l'héroïne peut obtenir de Charles VII est un renfort de 70 hommes, avec lequel elle essaye de bousculer dans une sortie les assiégeants (24 mai). La sortie est malheureuse; d'ailleurs les Français n'étaient pas en force ; en rentrant en désordre et précipitamment dans la ville, ils abandonnent Jeanne qui vient d'être blessée, et tombe aux mains des Bourguignons, dont le chef, Jean de Luxembourg, la vend aux Anglais (novembre 1430).
Conduite à Rouen où elle est emprisonnée, Jeanne expie par toute sorte de mauvais traitements ses victoires sur les Anglais : ceux-ci l'accusent de sorcellerie pour se débarrasser plus facilement d'elle en se réservant les apparences du bon droit. Un tribunal est formé soi-disant pour la juger, mais qui a en réalité pour mission de la condamner. En effet, après diverses péripéties où se révélèrent manifestement la duplicité et la rancune des Anglais, Jeanne est condamnée à être brûlée vive et subit héroïquement le dernier supplice le 30 mai 1431. L'histoire a gardé le nom, à jamais souillé, du personnage qui, pour complaire aux Anglais, dirigea ce procès inique de manière à le faire aboutir à la condamnation de Jeanne d'Arc: c'était Cauchon, évêque de Beauvais.
► 1429 - 23 février Jeanne d'Arc est à Chinon. Chinon est une commune française, située dans le département d'Indre-et-Loire et la région Centre.
► 1429 - 6 mars Rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII à Chinon. Cette jeune paysanne lorraine convaincue de sa mission, bouter les Anglais hors de France et conduire jusqu'au trône celui qui n'est encore que le “roi de Bourges” – rencontre enfin celui qu'elle appelle son “Gentil Dauphin”, qu'elle reconnaît bien qu'il se soit mêlé aux personnages de sa cour. Elle le convainc de sa légitimité et obtient de lui les moyens militaires qu'elle demande.
► 1429 - 29 avril L'armée de Jeanne d'Arc arrive devant Orléans.
► 1429 - 8 mai Jeanne d'Arc délivre Orléans. Le 28 avril, Jeanne d'Arc a quitté Blois avec une armée. Le lendemain, elle est à Orléans. Elle reprend aussitôt deux bastides. En ce 8 mai, les Anglais défaits lèvent le siège.
► 1429 - 12 juin Victoire de Jeanne d'Arc à Jargeau. Jargeau est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre. Elle est située sur la rive gauche de la Loire, en face de la commune de Saint-Denis de l'Hôtel et à une vingtaine de kilomètres en amont d'Orléans.
► 1429 - 15 juin Prise de Meung par Jeanne d'Arc. Meung-sur-Loire est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre.
► 1429 - 17 juin Prise de Beaugency par Jeanne d'Arc. Beaugency est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre.
► 1429 - 18 juin Jeanne d'Arc emporte la victoire à Patay. Patay est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre.
► 1429 - 10 juillet Prise de Troyes.
► 1429 - 16 juillet Charles VII entre à Reims.
► 1429 - 17 juillet Sacre de Charles VII à Reims. Sous l'influence de Jeanne d'Arc, Charles VII se fait sacrer à Reims et commence la reconquête de son royaume. C'est en hâte que, la veille, on a décoré la cathédrale pour le sacre du roi qui, avec sa petite troupe, a traversé des terres peu sûres occupées encore par la soldatesque anglaise et bourguignonne.
En présence de Jeanne d'Arc qui l'a convaincu de venir à Reims malgré les avis contraires de certains de ses conseillers, le roi est enfin, à vingt-six ans, définitivement légitimé par ce sacre. Lors de l'un de ses interrogatoires, en mars 1431, on demande à Jeanne : “Pourquoi votre étendard fut-il porté en l'église de Reims, au sacre, plutôt que ceux des autres capitaines ?” “Il avait été à la peine, c'était bien raison qu'il fut à l'honneur”.
► 1429 - 8 septembre Jeanne d'Arc blessée échoue devant Paris.
► 1430 - 16 mai Début du siège de Compiègne par les Bourguignons.
► 1430 - 22 mai Jeanne d'Arc entre dans Compiègne.
► 1430 - 23 mai Jeanne d'Arc est capturée par les Bourguignons devant Compiègne. Jeanne d'Arc entre dans la ville à l'aube. Le soir, au cours d'une sortie, elle est faite prisonnière. Elle est vendue aux Anglais par un Bourguignon du nom de Jean de Luxembourg pour la somme de 10 000 livres tournoi.
► 1430 - 21 novembre Jeanne d'Arc est livrée aux Anglais.
► 1430 à 1479 - naissance et mort de Antonello de Messine, est sans doute un des plus méconnus du grand public : moins de cinquante oeuvres dispersées de Dresde à New York, Paris ou Venise. Incomparable portraitiste, il introduit la lumière du Nord dans les perspectives apprises de Piero della Francesca. Et marie le tracé gothique à la sensualité de Giovanni Bellini: mais on ne se trompe jamais sur sa manière. Il peint des personnages inquiétants, et un Christ au tombeau soutenu par les anges qui paraît presque adolescent. Ses Vierges sont parmi les plus belles de l'iconographie chrétienne, son saint Sébastien presque païen dans un savant décor de songe.
► 1431 - 3 janvier Henri VI d'Angleterre charge Pierre Cauchon, évêque de Beauvais du procès de Jeanne d'Arc. Pierre Cauchon est né vers 1371 à Reims ou dans les environs. Il est l'un des membres actifs du parti réformiste, gallican et bourguignon. En 1420, sur la recommandation de Henri V, duc de Bourgogne, il devient évêque de Beauvais et à ce titre est le principal animateur du procès de Jeanne d'Arc puisque cette dernière a été prise dans son diocèse, à Compiègne. Après sa mort, il est nommé, en 1431, évêque de Lisieux. Il meurt à Rouen en 1442.
► 1431 - 9 janvier Début du procès de Jeanne d'Arc.
► 1431 - 13 février des délégués de l'université de Paris arrive pour le procès de Jeanne d'Arc.
► 1431 - 13 mai Jeanne d'Arc est reconnue coupable et condamnée à abjurer.
► 1431 - 14 mai L'université de Paris apporte sa caution au procès de Jeanne d'Arc.
► 1431 - 24 mai Jeanne d'Arc abjure et évite la condamnation à mort.
► 1431 - 29 mai Jeanne d'Arc est déclarée relapse et condamnée à mort. Relaps est le terme sous lequel l'autorité religieuse désigne un adepte retombé dans ce qu'elle considère comme une hérésie après qu'il y avait solennellement renoncé. Jacques de Molay, dernier Grand-Maître de l'Ordre du Temple fut exécuté comme relaps après être revenu sur les aveux qu'il avait consentis sous la torture. Et Jeanne d'Arc fut exécutée comme relaps pour avoir malgré sa promesse porté des vêtements d'homme, bien que ses vêtements féminins lui avaient été retirés. D'une façon générale, tout suspect de l'inquisition (nouveau converti, marranes) était d'abord soupçonné d'être un relap
► 1431 - 30 mai Exécution de Jeanne d'Arc place du vieux marché à Rouen. Elle a dix-neuf ans. Sur la place du marché où elle est conduite pour être brûlée, un panneau rappelle que Jeanne est, selon le tribunal qui vient de la juger pour la seconde fois, “menteresse, pernicieuse, abuseresse du peuple, devineresse, superstitieuse, blasphématrice de Dieu, présomptueuse, mal créante de la foi de Jésus-Christ, venteresse, idolâtre… hérétique”. Alors que les flammes commencent à s'élever autour d'elle, Jeanne crie : “De l'eau ! Jésus !” Ses cendres seront jetées dans la Seine.
► 1431 à 1435 - Charles VII n'avait tenté que peu d'efforts pour sauver celle à qui il devait d'avoir pu recouvrer une grande partie de son royaume. Cependant, la mort de l'héroïne provoqua une réaction favorable dans les esprits. Le roi se mit sérieusement au travail; tandis que ses capitaines continuaient à batailler contre les Anglais et les Bourguignons, il réorganisait le pays et entamait des négociations avec le duc de Bourgogne en vue d'une réconciliation avec celui-ci.
► 1431 - 13 décembre Trêve entre Charles VII et Philippe le Bon, duc de Bourgogne.
► 1431 - 16 décembre Henri VI d'Angleterre est sacré roi de France à Paris. Pour légitimer ses droits à la couronne de France, Henri VI d'Angleterre se fait couronner roi à Paris. Mais Charles VII, parce qu'il avait été sacré à Reims le 17 juillet précédent, est seul reconnu pour roi légitime.
► 1431 à 1506 - naissance et mort de Andrea Mantegna. Dès sa première oeuvre, Mantegna est considéré comme le peintre le plus doué de sa génération en Italie du Nord, ce qui lui vaut la commande d'un retable pour l'Église Saint Zénon à Vérone. La Crucifixion du Louvre constitue la pièce centrale de la prédelle de ce retable, ramené par Napoléon Bonaparte et partiellement restitué depuis.
Plusieurs innovations caractérisent ce retable, dont le thème principal est une Vierge à l'enfant entourée de saints (sainte conversation): la pièce centrale est unifiée alors qu'auparavant on avait plutôt à faire à des polyptyques. Mantegna utilise des éléments d'architecture tant à l'extérieur (dans l'encadrement) qu'à l'intérieur de la toile (loggia dont la profondeur est créée par des pilastres. Il fait également apparaître un élément décoratif dont il est le premier à faire usage: la guirlande avec fruits.
► 1431 Fondation de l'ordre de la Toison d'or. L'Ordre de la Toison d'or est un ordre de chevalerie autrefois prestigieux fondé à Bruges par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à l'occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal. Philippe le Bon portant le collier de l'Ordre de la Toison d'or. Cet ordre était destiné à rapprocher la noblesse bourguignonne de Philippe le Bon, ainsi que lui permettre d'honorer ses proches. Le premier chevalier fut Guillaume de Vienne. À la mort de Philippe le Bon en 1467, son fils Charles le Téméraire devint grand-maître de l'ordre, puis à la mort de ce dernier en 1477, son gendre Maximilien Ier du Saint-Empire qui avait épousé Marie de Bourgogne.
En effet, l'ordre ne se transmettait que par les hommes, ou, à défaut d'héritier mâle, à l'époux de l'héritière jusqu'à majorité du fils de celle-ci. Ainsi l'ordre arriva t il à Charles Quint qui en fit l'ordre le plus important de la monarchie habsbourgeoise. À l'abdication de l'empereur, la Toison passa à la branche espagnole jusqu'à la Guerre de Succession d'Espagne. Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV, et nouveau roi d'Espagne continua à conférer l'ordre, mais la branche des Habsbourgs d'Autriche décida de reprendre l'ordre à son compte. Le droit international n'ayant jamais tranché la question il existe depuis lors deux Ordre de la Toison d'or, l'ordre autrichien et l'ordre espagnol (seul reconnu par la République Française).
► 1431 à 1463 - naissance et mort de poète François de Montcorbier, dit François Villon. Poète français. Né en 1431 ou 1432, orphelin de père, il est confié à maître Guillaume de Villon, chanoine et chapelain de Saint-Benoît-le-Bétourné, qui l'envoie faire des études à la faculté des arts. Mais, après avoir obtenu une maîtrise, il néglige l'étude pour aller courir l'aventure. À partir de cette époque, sa vie a pour toile de fond le lendemain de la guerre de Cent Ans et son cortège de brutalités, de famines et d'épidémies. Accusé du meurtre du prêtre Philippe Sermoise, son rival en amour, il est obligé de fuir Paris.
Mais il obtient des lettres de rémission en janvier 1456. Peu après, il participe à un vol au collège de Navarre. De 1456 à 1461, il poursuit ses pérégrinations dans la vallée de la Loire, est emprisonné durant l'été 1461, mais libéré quelques mois plus tard à l'occasion d'une visite de Louis XI dans cette ville. De retour à Paris, il écrit le 'Testament' mais est encore arrêté en 1462. Il est alors torturé et condamné à la potence, mais le jugement sera cassé en appel en janvier 1463. La peine est commuée en dix ans de bannissement de Paris. On perd sa trace après ce dernier épisode.
► 1431 L'humaniste Lorenzo Valla publie 'De voluptate' et prend position dans une série d'écrits contre le pouvoir temporel du pape. Lorenzo Valla, dit aussi Laurentius della Vale (Rome, 1407–1457), humaniste, philosophe et polémiste italien. Valla enseigna à Pavie, Naples et Rome. Dans ses premiers travaux, il se présenta comme un porte-parole ardent d'un nouvel humanisme devant réformer la langue et l'éducation. Il rechercha des textes oubliés de l'Antiquité classique, pensant que l'esprit gréco-romain qui avait été perdu au Moyen Âge devait être rétabli.
Connaissant aussi bien le grec que le latin, il fut choisi par le pape Nicolas V pour traduire 'Hérodote et Thucydide' en latin. Par sa focalisation sur des disciplines humanistes, c'est-à-dire la poésie, la rhétorique, l'éthique, l'histoire et la politique, il accorda une dignité spéciale à la vie et à la conduite de l'homme. Dans un travail exemplaire, Valla démontra que le long texte nommé 'Donation de Constantin' n'était qu'une contrefaçon grossière puisque le texte latin avait été écrit très vraisemblablement en 754, soit quatre siècles après la mort de Constantin Ier en 315. À 26 ans, il écrivit 'De Voluptate', un dialogue en trois livres qui analyse le plaisir et opte pour une condamnation humaniste de la scolastique et de l'ascétisme monastique.
Agressif dans sa tonalité, cet ouvrage a été reçu avec hostilité. Dans 'l'Arbitrio de libero' il démontra que le conflit entre la prescience divine (la grâce) et la volonté du libre arbitre ne pourront jamais être résolus. Mais ce sont les six livres des 'Latinae de linguae Elegantiae' (1444) qui constituent son oeuvre maitresse. Il y présente une défense philologique brillante du latin classique dans laquelle il met en contraste l'élégance des travaux de la Rome antique (particulièrement ceux de Cicéron, Sénèque et Quintilien) avec la maladresse du latin d'Église médiéval. Ce travail eut une énorme influence et a connu 60 (ré)éditions dès avant 1537. Les recherches de Valla sur les erreurs textuelles dans la Vulgate ont conduit des érudits, Érasme entre autres, à étudier les Évangiles dans le texte grec originel.
► 1431 mort de Christine de Pisan.
► 1432 - 5 mars Ralliement du duc de Bretagne (Jean V de Bretagne), à Charles VII. Jean V de Bretagne, né le 24 décembre 1389, mort le 29 août 1442 à Nantes, au manoir de la Touche, duc de Bretagne de 1399 à 1442, fils de Jean IV, duc de Bretagne, et de sa troisième épouse Jeanne de Navarre.
► 1432 Jan van Eyck peint 'L'agneau mystique’
► 1433 Jan van Eyck peint 'La Vierge au chancelier Rolin’
► 1433 mort d'Alain Chartier.
► 1434 Premières expéditions portugaises vers l'Afrique. Le navigateur portugais Gil Eanes passe le cap Bojador au Maroc, limite sud du monde connu alors. Une tradition y voyait la limite symbolique et infranchissable entre Création et Chaos. Quinze expéditions envoyées par Henri le Navigateur ont échouées à le doubler depuis 1424. Eanes avance de cinquante lieux et trouve des traces d'hommes et de chameaux. Gil Eanes ou Gil Eannes était un navigateur et explorateur portugais du XVe siècle. Eanes était au service du prince portugais Henri le Navigateur. Il réalisa un nombre inconnu de voyages le long de la côte africaine.
Lors d'une expédition en 1433, il atteint les îles Canaries. Il fut le premier européen à parvenir jusqu'au cap Bojador (aujourd'hui cap Boujdour, au Sahara occidental), en 1434. La découverte d'une possible route maritime au-delà du cap Bojador marqua le début des explorations portugaises de l'Afrique. Avant cette expédition, il existait une légende sur une mer des Ténèbres s'étendant après le cap Bojador, qui jusque là était le point le plus méridional de l'Afrique, connu des Européens. Gil Eanes réalisa un autre trajet, avec Alfonso Goncalves Baldaya, en 1435. Ils naviguèrent à environ 200 kilomètres au sud du cap Bojador, le long des côtes africaines.
Cap Bojador, appelé aujourd'hui cap Boujdour, ce cap est situé au Sahara Occidental. Longtemps considéré comme la limite méridionale du monde, une légende disait qu'une mer des Ténèbres s'étendait après le cap Bojador, il était le point le plus méridional de l'Afrique, connu des Européens. Réputé infranchissable, il a été passé en 1434 par le navigateur portugais Gil Eanes, ouvrant la voie aux explorations portugaises de l'Afrique. Sous l'impulsion d'Henri le Navigateur en effet, les Portugais cherchaient une voie maritimes pour l'accès aux Indes. La progression vers le Sud, initiée entre autre par le passage de ce Cap, eut pour achèvement le voyage de Vasco de Gama aux Indes en 1497
► 1434 Jan van Eyck peint 'L'Annonciation’
► 1435 - 21 septembre Traité d'Arras entre Charles VII et Philippe le Bon. Charles VII de France, et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, signent la paix. Charles cède les comtés de Mâcon et d'Auxerre, la châtellenie de Bar-sur-Seine et les villes de la Somme au duc, qu'il dispense de tout hommage qu'un vassal doit à son suzerain pour toute la durée de sa vie.
Au prix de concessions territoriales importantes, Charles VII réussit à détacher le duc de Bourgogne de ses alliés les Anglais, il abandonnait à Philippe le Bon les comtés de Mâcon et d'Auxerre, ainsi que quelques villes de la Somme: Abbeville, Amiens, Corbie, Péronne et Saint-Quentin que, d'ailleurs, il se réservait la faculté de racheter; mais ce sacrifice mettait fin à la lutte entre Armagnacs et Bourguignons. Traité d'Arras (1435). Par le traité d'Arras signé le 21 septembre 1435 le roi Charles VII cède les villes de la Somme, le comté de Mâcon et le comté d'Auxerre et à Philippe le Bon. Les villes de la Somme seront rachetés par Louis XI à Philippe le Bon.
► 1435 Fra Angelico peint 'L'annonciation’
► 1435 à 1494 - naissance et mort de Hans Memling. Peintre allemand, puis flamand. Considéré comme un grand maître dans sa ville d'accueil, Memling n'entre jamais dans la guilde, préférant rester indépendant. Il peint aussi bien pour une clientèle bourgeoise et relativement cultivée (sensible à la mode italienne) que pour la cour ducale. Son oeuvre est importante. On dénombre 30 portraits, 20 retables, 15 Vierges, 20 autres oeuvres sur divers sujets.
► 1435 à 1505 - naissance et mort de Jean Molinet. Chroniqueur et poète français. Son oeuvre poétique est très diverse. Outre les poèmes ampoulés dits de circonstance, il écrit des poésies religieuses, oeuvres peu originales, mais comportant des interprétations symboliques inattendues. D'autre part, il s'amuse à composer des parodies de textes sacrés, de prières liturgiques ou de sermons. Enfin, il écrit des poésies familières, genre auquel appartient Nymphes des bois.
Si par sa mentalité, Jean Molinet n'appartient pas à la Renaissance naissante, mais encore au Moyen Âge, il s'intéresse au mouvement artistique de son temps. Il est l'ami de peintres et c'est un fin mélomane. Il connaît tous les termes techniques musicaux et fait souvent l'éloge de cet art : "Car la musique est la ressource des cieulx, la voix des angeles, la joye de paradis, l'esperit de l'aer, l'organe de l'église, le chant des oyselets, la recreation de tous coeurs tristes et desolés, la persecution et enchassement des diables..."
► 1435 Olivier de La Marche écrit 'Mémoires' (1435-1488). Olivier de la Marche, le premier en date des poètes franc-comtois, né en 1426, au bailliage de Saint-Laurent, mourut en 1502. Il était connu surtout comme chroniqueur. Plus vrai que Froissard, au dire des auteurs du temps, il n'en avait cependant ni la légèreté ni le brillant.
► 1435 Début du Quattrocento. Le Quattrocento, contraction de mille quattrocento en Italien, correspond au XVe siècle italien ; s'y déroule le mouvement appelé Première Renaissance. Au Quattrocento, un profond changement s'opère en Italie. Une nouvelle ère fleurit, une ère qui rompt avec le Moyen Âge qualifié généralement d'ère de l'ignorance, c'est le début de la Renaissance.
► 1435 Van der Weyden peint 'Descente de croix'. Rogier Van der Weyden (Tournai, v. 1400 - Bruxelles, 1464) (en français Rogier de la Pasture) est un peintre belge. Apprenti de Jan Van Eyck, ses premières oeuvres reflètent l'influence de son maître, puis il s'en affranchit en introduisant un réalisme dans l'expression de ses personnages, êtres de chair et de sang. A côté des oeuvres à caractères religieux, il a réalisé de magnifiques portraits comme par exemple le portrait d'une jeune femme vers 1432.
► 1436 Prise de Paris par le Connétable de Richemont. Paris était toujours occupé par les Anglais. Les notables se concertèrent pour mettre fin à la domination étrangère. Dans ce but, à l'instigation de l'un d'eux, Michel Laillier, ils ouvrirent clandestinement les portes au connétable de Richemond qui reprit promptement possession de la ville. La garnison anglaise se retira dans la Bastille, d'où il lui fut permis plus tard de sortir sans dommage pour quitter la capitale. Connétable de Richemont : Arthur III de Bretagne (1393-1458), duc de Bretagne de septembre 1457 à décembre 1458, également connu sous le nom de connétable de Richemont.
Il fut également duc de Touraine, comte de Richemond, de Dreux, d'Étampes, de Montfort et d'Ivry et baron de Parthenay. Second fils du duc Jean IV et de Jeanne de Navarre, il succèda à son frère Jean V de Bretagne. Il combat les Anglais avec son frère dès son plus jeune âge. Blessé et fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 1415, il reste cinq ans prisonnier en Angleterre. Il épouse en 1423, Marguerite de Bourgogne, fille de Jean sans Peur. Le 7 mars 1425, il fut nommé connétable de France par Charles VII.
Ayant à ses côtés Jeanne d'Arc et Dunois, il commande l'armée française en 1429 et bat les Anglais à Beaugency et à Patay. De 1429 à 1457, il chasse les Anglais de Normandie et d'une partie de la Guyenne. C'est lui qui rétablit la discipline dans l'armée et crée les Compagnies d'Ordonnance (aujourd'hui gendarmes). Il devient Duc de Bretagne à la mort de son frère, mais ne règne qu'un an de 1457 à 1458. Il meurt à Nantes, sans postérité, le 24 décembre 1458.
► 1436 - 13 avril Libération de Paris du joug anglais. Ce sont les troupes du connétable de Richemont qui entrent dans Paris. Les Anglais n'abandonnent la ville que deux jours plus tard. Ce n'est que le 12 novembre 1437 que le roi lui-même pourra enfin faire une entrée solennelle dans sa capitale.
► 1436 - 24 juin Mariage du dauphin Louis (futur Louis XI) avec Marguerite d'Écosse. Marguerite d'Écosse (1424-1445), fille du roi Jacques Ier d'Écosse et de Joan Beaufort; mariée en 1436 avec le dauphin Louis, futur Louis XI; sans postérité connue.
► 1437 - 12 novembre Charles VII entre à Paris.
► 1437 Charles d'Orléans écrit 'La departie d'Amour’
► 1438 Une violente épidémie de peste désole Paris et une partie de la France.
► 1438 - 7 juillet Sanction de Bourges de Charles VII affranchissant l'église de la tutelle du pape. Le concile de Bourges édicte la Pragmatique Sanction qui règle les rapports du clergé de France avec le Saint-Siège et établit l'Église gallicane. La Pragmatique Sanction de Bourges est une ordonnance qui fut promulguée le 7 juillet 1438, par le roi de France Charles VII, avec l'accord du clergé réuni en assemblée à Bourges. Le roi s'affirme comme le gardien des droits de l'Église de France. Pragmatique sanction. Il s'agit d'un édit promulgué par un souverain pour régler définitivement une question importante.
Ainsi, l'empereur d'Allemagne Charles VI du Saint-Empire règle sa succession en 1713 par une pragmatique sanction qui décide de la transmission de la couronne à l'héritier direct, quel que soit son sexe. Sa fille Marie-Thérèse Ière d'Autriche pourra ainsi lui succéder. Le gallicanisme est une doctrine religieuse et politique qui sous-tendait l'organisation d'une Église catholique de France largement autonome du pape. Le gallicanisme affirme la spécificité française, et rejette une trop grande intervention du Pape dans les affaires françaises. Il reconnaissait au Pape une primauté d'honneur et de juridiction, mais contestait sa toute-puissance, au bénéfice des conciles généraux dans l'Église et des souverains dans leurs États.
En pratique cela se traduisit surtout par une mainmise étroite du souverain français (roi ou empereur) sur les nominations et les décisions des évêques. Bien que respectueuse de la papauté, cette doctrine posait néanmoins certaines limites à sa puissance ; elle enseignait en particulier que le pouvoir des évêques réunis en concile était plus grand que celui du pape. Au XVe siècle la France fit une première tentative de gallicanisme. En 1438, le roi Charles VII par la Pragmatique Sanction de Bourges, limite les prérogatives papales et affime la supériorité des décisions des conciles de Bâle et de Constance sur celles du pape.
► 1439 mai Le dauphin, Louis XI, est nommé gouverneur général du Languedoc.
► 1439 Il s'était formé un peu partout des bandes de malfaiteurs, hommes de guerre renvoyés sans solde, mercenaires étrangers sans emploi, gens sans aveu de toute sorte qui, sous le nom d'Écorcheurs, ravageaient la France. Charles VII convoqua en 1439 les États généraux à Orléans et obtint d'eux, sous le nom de taille permanente, les fonds nécessaires pour la création de troupes permanentes qui devaient rétablir partout l'ordre et la sécurité. La création de cette force royale inquiéta les seigneurs, qui y virent (non sans raison) un instrument à l'aide duquel la monarchie pourrait les dépouiller de leurs privilèges féodaux ; ils se révoltèrent contre le roi : ce mouvement fut appelé la Praguerie parce qu'il coïncidait avec une manifestation analogue qui avait lieu en Bohême ; Charles VII en vint à bout facilement.
Charles VII conclut une trêve avec l'Angleterre et en profita pour persuader les Écorcheurs d'aller se battre pour le compte d'autres princes en Lorraine et en Suisse : il en enrôla cependant un certain nombre des plus braves dans ses troupes de récente création. La taille, c'est une imposition sur les personnes ou sur les biens, longtemps perçue par les seigneurs sur leurs serfs et censitaires, mais levée aussi parfois par eux pour le compte du roi : c'est jusqu'en 1695 le seul impôt direct. Noblesse et clergé sont exemptés de la taille. La taille personnelle est assise sur les facultés des taillables, qu'apprécient les collecteurs.
La taille réelle porte sur les biens, par exemple sur la terre roturière, même si elle appartient à des privilégiés. La taille royale, établie en 1439 pour pourvoir aux besoins de l'armée permanente, ne pèse que sur les roturiers. Le roi fixe chaque année en son conseil le brevet de la taille, c'est-à-dire le montant global, réparti ensuite entre les généralités. Puis elle est répartie entre les élections par la commission de la taille, enfin entre les paroisses où la cote est faite par les asséeurs dans le rôle de taille. Les asséeurs sont des habitants élus dans le cadre de chaque paroisse pour établir, sous leur propre responsabilité, les rôles de la taille, qui est ensuite levée par les collecteurs.
Par l'édit de mars 1600, les deux fonctions sont confondues. Pour éviter les inégalités et les abus de la taille personnelle, on s'efforce au XVIIIe siècle de mettre en place une taxation des revenus d'après un tarif fixé préalablement : c'est la taille tarifée. Taille. Impôt de l'Ancien Régime. La taille seigneuriale comme son nom l'indique est payée au seigneur par tous les sujets roturiers de son domaine, en particulier les serfs, en échange de la protection et de la sécurité assurées. La taille royale se substitue au XVe siècle à la taille seigneuriale. Le montant de cet impôt indirect, fixé par le Conseil du roi est réparti entre les diverses communautés, qui la prélèvent sur les roturiers. L'Ancien Régime désigne la période qui va du Moyen Âge à la Révolution française (XVIe - XVIIIe siècle).
► 1439 - 2 novembre Réunion des État Généraux à Orléans.
► 1439 novembre Ordonnance sur l'armée et la taille désormais monopole royal.
► 1439 Suppression des armées féodales, les troupes relèvent désormais du roi.
► 1440 invention de la presse à imprimer à caractères mobiles par Gutenberg. Gutenberg, Johannes Gensfleisch, imprimeur allemand plus connu sous le surnom de Gutenberg, vraisemblablement né à Mayence vers 1400, mort le 3 février 1468 dans sa ville natale, après un séjour de 1439 à 1444 à Strasbourg. Novateur dans l'usage des caractères mobiles, il est reconnu comme le premier imprimeur à avoir utilisé les caractères métalliques amovibles.
► 1440 février Révolte du dauphin et d'une partie de la noblesse contre Charles VII. Praguerie de la noblesse contre la suppression des armées seigneuriales. La Praguerie (1440) fut une révolte menée par les grands vassaux de France contre les réformes militaires du roi Charles VII. Le dauphin, futur Louis XI, fit partie des révoltés. La fronde fut nommée "praguerie" en allusion à la révolte des Hussites à Prague, au début du XVe siècle.
►1440 - 27 octobre Exécution du maréchal de France Gilles de Rais. L'homme qui est aujourd'hui pendu et brûlé à Nantes a été le fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. C'est pour apostasie, hérésie, crime contre nature qu'il fut condamné ; en fait son procès semble avoir été aussi politique que l'avait été celui de Jeanne d'Arc. (La légende a fait de cet homme une sorte de Barbe-Bleue qui aurait torturé, violé et égorgé des enfants.)
Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, Baron de Rais, appelé Gilles de Rais (ou Gilles de Retz), surnommé Barbe-bleue (1404 - 26 octobre 1440), maréchal de France, exécuté pour meutres et sorcellerie. Il est apparenté à la famille de Montmorency. Il est seigneur de Rais, d'Ingrandes et de Champtocé. Crime d'apostasie, on nomme ainsi le fait d'abjurer sa croyance et d'abandonner sa vie chrétienne.
► 1441 - 19 septembre Charles VII reprend Pontoise.
► 1441 - Début de la traite des Noirs au Portugal. Deux cent quarante esclaves sont vendus à Lagos. Pendant la seconde moitié du siècle, le Portugal aurait importé 140 000 esclaves Noirs. Traite des Noirs, pour reprendre les termes exacts de la définition du Dictionnaire de l'Académie française, la traite des noirs est "le commerce d'esclaves noirs". L'historien Olivier Pétré-Grenouilleau, dans son livre 'Les Traites négrières'. Essai d'histoire globale, estime à environ 42 millions le nombre d'esclaves qui furent déportés lors des trois grandes traites qu'il propose:
- la traite orientale, faite par les musulmans: 17 millions de personnes.
- la traite intra-africaine, faite par les royaumes Africains : 14 millions de personnes.
- la traite atlantique, faite par les Européens et les Américains : 11 millions de personnes.
La motivation en aurait été avant tout économique, les esclaves servant principalement de main-d'oeuvre à bas coût. Le racisme a aussi servi à justifier la mise en esclavage. La traite atlantique, la plus connue et la plus intense, est celle qui a été pratiquée par les Européens (Anglais, Français, Hollandais, Portugais, etc.) et ensuite par les Américains. Cette traite est la plus connue car la plus récente et la mieux documentée. La traite atlantique commença en 1441, lorsque des Portugais ramènent dans leur pays les premiers esclaves noirs.
En 1452, Le Pape Nicolas V autorisa le roi Alphonse V du Portugal à conquérir des terres africaines et à réduire des noirs en servitude perpétuelle, en les expropriant. Malgré les interdictions de l'esclavage par les papes Pie II dès 1462, Paul III en 1537, Pie V en 1568, Urbain VIII en 1639 et Benoît XIV en 1741, elle connut un important développement, notamment après la controverse de Valladolid, qui interdisait l'esclavage des Indiens. Les Indiens, qui servaient jusqu'alors de main d'oeuvre coloniale, avaient été décimés par les abus des européens, les conditions de travail et de vie, et n'étaient plus assez nombreux pour satisfaire le besoin européen en main d'oeuvre.
Traite des Noirs. L'ère des grandes découvertes est aussi celle du grand esclavage. Ces nouveaux territoires conquis doivent être peuplés de travailleurs capables de mettre en valeur leurs richesses. Ainsi la chrétienté organise, à partir du début du XVIe siècle, la traite des Noirs. Il est stipulé en 1517 que chaque colon espagnol d'Haïti a le droit d'importer d'Afrique une douzaine d'esclaves. Les Anglais, cent ans plus tard, peuplent leurs colonies américaines et antillaises à grand renfort de bateaux chargés d'Africains, véritables "marchandises" que l'on peut vendre, acheter, céder, voire tuer.
Vers 1790, l'ensemble de la traite des Noirs représente annuellement le transfert de 70 000 esclaves vers les diverses colonies européennes outre-atlantique. Il faudra attendre la déclaration des droits de l'homme pour que les premières voix abolitionnistes parviennent à se faire entendre. La traite orientale a concerné un territoire qui déborde de l'aire arabe ; les négriers n'étaient ni exclusivement musulmans, ni arabes : Persans, Berbères, Indiens, Chinois et Noirs ont participé à ces entreprises, à des degrés plus ou moins grands. D'un point de vue centré sur l'Occident, le sujet s'assimile à la traite orientale.
Celle-ci a suivi deux types d'itinéraires au Moyen Âge : les routes terrestres à travers les déserts du Maghreb et du Machrek d'une part (itinéraire transsaharien) ; les routes maritimes à l'est de l'Afrique (Mer Rouge et Océan Indien) d'autre part (itinéraire oriental). Elle n'a pas eu les mêmes destinations que la traite transatlantique : elle a alimenté en esclaves noirs le monde musulman qui, à son apogée, s'étend sur trois continents, de l'océan Atlantique (Maroc, Espagne) à l'Inde et l'est de la Chine. Elle a été plus étalée dans le temps : elle commence dès le Moyen Âge et s'arrête au début du XXe siècle : le dernier marché aux esclaves est fermé au Maroc en 1920 ; environ 1/3 des Éthiopiens étaient des esclaves en 1923.
La traite intra-africaine, la traite africaine aurait touché, tout comme la traite orientale, les femmes principalement. Certains hommes noirs importants les auraient achetées pour en faire leur femme et avoir des enfants avec elles. Selon Olivier Pétré-Grenouilleau, principal tenant de cette thèse en France, cette traite aurait fait environ 14 millions de victimes. La traite transatlantique, le Commerce triangulaire est l'une des formes de la traite des noirs. La traite consistait à transporter des marchandises d'un point à un autre. Cela s'appliquait tout aussi bien au blé, au vin, qu'aux esclaves noirs qui n'étaient que des "outils vivants". - Le Commerce triangulaire était une forme de traite, liée à l'exploitation du sol américain par les pays européens.
Des navires partaient d'Europe avec divers articles de pacotille destinés au troc. Ils se rendaient dans les comptoirs côtiers d'Afrique où ils échangeaient leur marchandise contre des captifs. Les négriers transportaient ceux-ci dans les colonies d'Amérique pour qu'ils travaillent comme esclaves à l'exploitation des ressources du continent. Les négriers retournaient ensuite en Europe avec à bord les produits de cette exploitation. - Les estimations relatives au nombre de noirs déportés sur le sol américain sont assez variables et pas toujours objectives. Elles se situent entre 6 et 50 millions de personnes entre la fin du XVe et le milieu du XIXe siècle.
► 1441 mort de Jan van Eyck.
► 1444 - 28 mai Traité de Tours instaurant une trêve de deux ans entre la France et l'Angleterre. La trêve de Tours fut conclue au château de Montils-les-Tours entre les Anglais conduit par William de la Pole, comte de Suffolk. la France quant à elle était représentée par Jean de Dunois, comte de Longueville et Louis II de Bourbon, ceux-ci conduisaient la délégation française. Jean Dunois, comte de Longueville et Louis II de Bourbon représentant Charles VII de France à ses négociations acceptèrent de remettre aux Anglais la Guyenne, le Quercy, les villes de Calais et de Guînes sous une seule condition Henri IV d'Angleterre était tenu de se reconnaître vassal du souverain français pour ses possessions détenues en France.
Les conditions anglaises étaient les suivantes : l'abandon par la France de la Guyenne et de la Normandie et la jouissance de la souveraineté anglaise sur ces deux possessions. Ne pouvant parvenir à un accord, ils décidèrent de conclure une trêve et d'unir Henri VI d'Angleterre à Marguerite d'Anjou. Les divers arrangements concernant ce mariage conclus, l'acte connu sous le nom de traité de Tours fut signé par les deux partis le 28 mai 1444. A vrai dire, il ne s'agissait que d'une trêve commençant le 1er juin 1444 et se terminant le 1er avril 1446. Cette trêve comportait une clause où il était mentionné que Charles d'Anjou recouvrait les places du Maine détenues par les Anglais.
► 1444 Konrad Witz peint 'La pêche miraculeuse'. Konrad Witz, peintre allemand. Il arriva en 1431 à Bâle, où il réalisa le Polyptyque du Miroir du salut. Appelé à Genève par l'évêque F. de Mies, il y exécuta en 1444 le Retable de Saint Pierre pour la cathédrale du même nom. De cette oeuvre on conserve quatre panneaux dont la fameuse "Pêche miraculeuse", premier paysage réaliste de la peinture de chevalet européenne.
Witz, auquel on attribue avec certitude une vingtaine de tableaux et qui semble avoir connu la peinture flamande, rompt avec les conceptions médiévales; l'usage de la lumière, la plasticité des figures et des innovations dans la manière de traiter l'espace annoncent les préoccupations de la Renaissance.
► 1445 Création par des Compagnies d'ordonnance (15 de 600 hommes à cheval) qui furent le noyau de la cavalerie française. Le Connétable Arthur de Richemont réorganise l'armée française en créant les Compagnies de l'Ordonnance, payées à l'année (alors que l'état des finances anglaises rend pénible le paiement de la solde aux Anglais, encourageant la tendance à se servir sur le pays occupé). Les frères Bureau ont mis en état le parc de canons et le génois Louis Giribaut invente un chariot pour les couleuvrines ; c'est la première artillerie de campagne.
► 1445 Ordonnance de Louppy-le-Châtel sur la permanence d'une armée de métier.
►1445 à 1510 - naissance et mort de Sandro Botticelli. Peintre de la renaissance italienne, peintre fort apprécié par le milieu officiel, on lui confie notamment la représentation, vers 1476-1477, de Côme et se famille en Rois Mages à Santa Maria Novella. On considérera toutefois comme infiniment plus révélatrice la position qu'il occupait dans le milieu florentin à la suite de tableaux allégoriques qui lui furent commandés pour la décoration des villa médicéennes : 'le Printemps' (1478 environ) et la 'Naissance de Vénus'. Il lui manquait la consécration des peintures murales. En 1481, il est appelé avec d'autres peintres florentins par Sixte IV pour exécuter une fresque d'essai dans la chapelle Sixtine à Rome.
Sa part fut importante avec les scènes de la vie du Christ et de la vie de Moïse. De retour en Toscane, il participe à la décoration de la villa de Laurent de Médicis. Il reçoit ensuite la commande d'un grand nombre de tableaux religieux comme 'l'Annonciation'. Il réalise ensuite les illustrations de la 'Divine Comédie' de Dante. Ses dernières années sont plus difficiles, les commandes se raréfient, son style a passé de mode. De plus, au début du XVIe siècle arrivent à Florence les trois génies de ce siècle: Leonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Botticelli s'isole de plus en plus en refusant tout ce qui lui était apparu comme un progrès dans l'art: la mythologie classique renaissante et la perspective. Ses dernières oeuvres sont peintes volontairement de manière classique, sans respect des proportions. Le 17 mai 1510, il est enseveli à Ognisanti.
► 1447 janvier Le dauphin, futur Louis XI, est envoyé en exil dans le Dauphiné pour avoir comploté contre son père. Il était frustré de n'avoir retiré que le Dauphiné de la Praguerie. En 1446, il fut accusé d'avoir assassiné le favori du roi, Pierre de Brézé. Il fut chassé de la Cour et se réfugia dans son gouvernement.
► 1447 Début du pontificat de Nicolas V (fin en 1455). Nicolas V, né Tommaso Parentucelli à Sarzana vers 1398, pape du 8 mars 1447 à 1455. Il mit fin au schisme de l'antipape Félix V et il fonda la Bibliothèque vaticane. Nicolas V met en place à Rome de nouveaux équilibres politiques et internationaux. Reconnu comme seul souverain pontife (1449), il stabilise ses rapports avec Naples, et garde une position de neutralité en Italie, jusqu'à la paix de Lodi (1454).
Il remet sur pied une armée efficace et augmente les rentrées fiscales. Il accorde aux dirigeants municipaux un certain nombre de privilèges tout en gardant fermement le contrôle de la commune. La bulle papale de Nicolas V commanda aux puissances européennes de combattre, déposséder, exproprier et soumettre les peuples d'afrique noire, par tous les moyens possibles, au nom de l'église et de la supériorité blanche sur les sarrasins.
► 1448 Création de l'infanterie régulière française dont les premières unités sont les francs-archers. Perfectionnement et extension de l'artillerie, sous la direction des frères Bureau. Les bombardes du temps de Crécy font place à de véritables canons. Jean Bureau, seigneur de Montglat (ou Montglas), Grand-Maître de l'Artillerie du Roi Charles VII qui, en utilisant massivement l'artillerie pour la première fois en Occident, a remporté la victoire contre les Anglais à la bataille de Castillon, mettant ainsi un terme à la guerre de Cent Ans.
Gaspard Bureau, seigneur de Villemomble. En 1444, il succéda à Pierre Bessonneau comme maître d'artillerie du roi. Illustre grand capitaine de Charles VII, il développa avec son frère Jean Bureau l'artillerie de campagne qui permit de prendre un avantage décisif sur les anglais et de mettre fin a la guerre de Cent Ans.
► 1448 Réorganisation des finances sous la direction de Jacques Coeur, qui mit sa grande fortune personnelle à la disposition du roi pour lui permettre de réaliser ses projets.
► 1449 - 24 mars Les Anglais s'emparent de Fougères. Fougères est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.
► 1449 juillet Début de la reconquête de la Normandie.
► 1449 - 29 octobre Prise de Rouen par les troupes anglaises.
► 1449 à 1450 - Charles VII put reprendre sur une grande échelle la lutte contre les Anglais qui possédaient toujours la Normandie et la Guyenne. La Normandie leur fut d'abord reprise. Rouen ouvrit ses portes et les Anglais furent chassés peu à peu de la province; ayant tenté de débarquer une armée à Cherbourg pour s'opposer aux progrès de Charles VII, ils subirent à Formigny une défaite qui débarrassa d'eux définitivement la Normandie (1450). Le roi d'Angleterre ne conservait dans cette région que les îles dites anglo-normandes qui depuis lors sont restées anglaises.
► 1449 - 10 novembre Charles VII reprend Rouen.
► 1450 - 11 février Décès d'Agnès Sorel, favorite du roi. Agnès Sorel est née au début du XVe siècle, fort probablement dans les années 1420. Sa jeunesse et sa beauté vont très rapidement la faire remarquer par le roi de France, Charles VII, le petit roi de Bourges, ce dauphin sans beauté, sans grande intelligence et sans fortune, fils d'un roi fou et d'Isabeau de Bavière, considérée par nombre de ses contemporains comme une ogresse. Elle a le statut de favorite officielle, ce qui est une nouveauté : les rois de France avaient jusque là des maîtresses mais elles devaient rester dans l'ombre.
Charles VII a d'ailleurs eu d'autres maîtresses, mais elles n'ont pas eu l'importance d'Agnès Sorel. Le dauphin, futur Louis XI, ne supporte pas la relation d'Agnès avec son père le roi Charles VII. Il estime que sa mère est bafouée et a de plus en plus de mal à l'accepter. Un jour il laisse éclater sa rancoeur et poursuit, l'épée à la main, l'infortunée Agnès dans les pièces de la maison royale. Pour lui échapper, elle se réfugie dans le lit du roi. Charles VII, courroucé par tant d'impertinence, chasse son fils de la Cour et l'envoie gouverner le Dauphiné.
► 1450 - 15 avril Victoire de Charles VII à Formigny contre les Anglais. L'arrivée du duc de Bretagne et du connétable de Richemont ont sauvé Charles VII lors de cette bataille décisive qui lui permet d'occuper toute la basse Seine. La bataille de Formigny est une bataille de la guerre de Cent Ans qui s'est déroulée le 15 avril 1450 à Formigny en Normandie entre les Anglais et les Français.
► 1450 - 24 juin Charles VII reprend Caen.
► 1450 - 12 août Charles VII reprend Cherbourg.
► 1450 Fin de la reconquête de la Normandie.
► 1450 Construction de Machu Picchu (Pérou): la citadelle inca. Le Machu Picchu est une ancienne cité inca perchée sur les hauteurs de la Cordillère des Andes. On pense aujourd'hui que la ville a été construite sous le règne de l'empereur Pachacuti qui débuta en 1440.
La ville a été habitée jusqu'à l'invasion espagnole en 1532. D'après les recherches archéologiques effectuées sur le site, le Machu Picchu n'était pas une ville traditionnelle, mais plutôt une forteresse utilisée comme palais secondaire par l'empereur et sa cour. On estime que le lieu ne comptait pas plus de 750 personnes à la fois.
► 1451 - 9 mars Mariage du dauphin (futur Louis XI) avec Charlotte de Savoie contre la volonté de Charles VII. Charlotte de Savoie (1440-1483), fille de Louis Ier, duc de Savoie et prince de Piémont et d'Anne de Chypre-Lusignan, elle épouse le dauphin Louis de France, futur Louis XI, le 14 novembre 1451, qui malgré ses vertus la négligea. Elle lui donne cinq enfants dont le futur Charles VIII, et les princesses Anne de France - future Anne de Beaujeu et régente du royaume - et Jeanne de France - future épouse de Louis XII.
► 1451 - 23 juin Capitulation de Bordeaux devant les armées de Charles VII.
► 1451 - Fin de la reconquête de la Guyenne.
► 1451 - 31 juillet Arrestation de Jacques Coeur accusé de conspiration et malversation. Jacques Coeur étant très jalousé pour sa grande fortune, ses ennemis et ses envieux parvinrent à le perdre. Après la mort d'Agnès Sorel qui le protégeait, Charles oublia ses services et l'abandonna à l'avidité des courtisans, qui se partagèrent ses dépouilles. Accusé de crimes imaginaires, lavé d'une accusation d'empoisonnement, il est arrêté pour malversation en 1451, condamné à la prison, et ses biens sont confisqués ; un arrêt lui épargne la peine de mort, pour services rendus.
► 1451 à 1506 - naissance et mort de Christophe Colomb. Explorateur italien. Né à Gênes. Marin très tôt. Fait partie en 1476 d'un convoi en partance pour Lisbonne et l'Angleterre. Le convoi es attaqué par des français. Colomb se réfugie à Lagos puis retrouve son frère, un cartographe, à Lisbonne (Portugal) où vit une grande colonie de génois. Il épouse en 1479 la fille d'un des premiers colonisateurs de Madeire, Filipa Perestrelo e Moniz, qui lui donnera un fils et mourra peu de temps après. Colomb se perfectionne à la science de la navigation.
Voyage en Afrique et peut-être en Islande. À partir de 1484, environ, il devient possédé par l'idée que l'on peut éviter le long et couteux voyage vers les Indes par l'Afrique, en coupant par l'Atlantique. Était-ce possible?. À vrai dire, il n'est pas le premier à penser une telle chose. Les savants de l'époque concevaient en effet comme possible un tel voyage, grâce aux écrits de Ptolémée qui donne même un chiffre pour cette distance: 16.090 km. En fait, la distance est largement sous-estimée mais personne ne le savait à l'époque. Colomb se persuade en lisant différents auteurs que la distance donnée par Ptolémée est surestimée et qu'elle se réduit à 2414 km.
La lecture de Marco Polo, notamment, lui donne l'espoir d'atteindre les riches territoires du Cipangu (Japon). Un comité d'experts de Jean II du Portugal rejette son projet. Furieux, Colomb décide de le présenter à des chefs d'états désireux de rivaliser avec le Portugal. En 1486, il est finalement reçu par Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Un comité d'experts se réunit et rend un verdict négatif en 1490. En 1491, le comité est prêt d'accepter, mais les exigences démesurées de Colomb (titre de noblesse, amiral de l'océan, gouverneur et vice-roi de toutes les terres à découvrir) font échouer à nouveau le projet.
C'est finalement le conseiller du roi Ferdinand qui convaint la Reine que la somme à investir est dérisoire comparée aux possibles retombées. Colomb part donc avec trois navires et 90 membres d'équipage de Palos le 3 août 1492. Arrêt aux Canaris et après une période de tension toujours de plus en plus vive entre Colomb et ses marins, le 10 Octobre, les premiers signes indirectes de terre se montrent. Le 12, la terre est en vue. C'est une île, Guanahami (San Salvador). Les "indiens", puisque Colomb n'hésite pas à les appeler ainsi dans ses descriptions, lui assurent qu'il faut aller plus à l'ouest pour trouver de l'or.
Le 28 octobre, il est à Cuba. Colomb est persuadé d'avoir atteint le continent asiatique et de connaître sa position exacte sur le continent. La flotille se dirige alors vers l'est le long de la côte cubaine. Le capitaine de la Pinta déserte à la poursuite de l'or vers l'ouest. À Hispaniola, une grande île à l'est de Cuba, il trouve enfin de l'or en quantité. La santa-Maria s'échoue et devient inutilisable. Colomb laisse 39 hommes dans un fort et rentre au plus vite vers l'Espagne. Sur le chemin du retour, il croise la Pinta. À peine arrivé, Colomb pense déjà à un second voyage encore plus ambitieux.
Il repart de Cadiz en septembre 1493 avec une flotte de 17 navires et 1500 hommes avec l'idée de fonder une colonie. Il retrouve le fort détruit par les indiens et installe la colonie sur un autre emplacement appelé Isabela. Colomb repart avec trois caravelles vers l'ouest et explore la côte sud de Cuba. Son enthousiasme d'avoir trouvé l'Asie n'est pas diminué. Ce n'est qu'en 1498 qu'il assemble une flotte de 8 navires pour un troisième voyage. Le 31 juillet, il arrive avec trois navires (le reste des navires est détourné vers Hispaniola pour soulager la colonie où sévit une dure pénurie de produits de première nécéssité) à l'île de Trinidad, juste en face de la côte sud américaine.
Enfin, devant la masse d'eau fraîche se déversant dans la mer, il déduit que la côte à l'ouest ne peut être qu'un continent mais préfère revenir régler les affaires de plus en plus désorganisées de la colonie. Devant les plaintes et rumeurs contre Colomb, Ferdinand et Isabelle dépêche Bodadilla vers la nouvelle colonie. Celui-ci fait arrêter les frères Colomb et les renvoie en Espagne pour être jugés. En Espagne, les choses s'arrangent. Colomb peut repartir en 1502 mais il a été écarté des affaires de la nouvelle colonie. Colomb reprend donc son rôle d'explorateur.
Il arrive aux côtes du Honduras et descend vers le sud à la recherche d'un passage vers l'ouest. L'or abonde au Panama et provoque des incidents avec les indiens. Colomb apprend qu'il est en face d'un isthme qu'il prend pour l'isthme malaisien. Les quatre navires de Colomb sont un à un perdus. Colomb doit dépêcher quelques hommes sur un canot pour réclamer de l'aide à la colonie d'Hispaniola qui ne se presse pas pour venir en aide à son fondateur. Colomb revient piteusement en 1504 en Espagne. Aigri et frustré par tous les privilèges qu'il avait obtenu au départ et qui lui ont été un à un retirés, Colomb finit sa vie à Séville et mourut en 1506 à Valladolid, toujours persuadé d'avoir atteint les Indes, et certainement pas dans la pauvreté.
► 1452 à 1519 - naissance et mort de Léonard de Vinci (Leonardo da Vinci), peintre, sculpteur, architecte et homme de science italien (Vinci, 1452 - Amboise, 1519). Homme d'esprit universel, à la fois artiste, scientifique, inventeur et philosophe, Léonard incarna l'esprit universaliste de la Renaissance et demeure l'un des grands hommes de cette époque. Fils naturel d'un riche notaire florentin et d'une paysanne, élevé dans un village de Toscane qui porte désormais son nom, Léonard de Vinci s'est formé dans les ateliers de Verrocchio et d'Uccello avant d'intégrer la compagnie de Saint-Luc, la guilde des peintres.
On lui doit 'La Cène', 'La Joconde', 'La Vierge aux rochers', et la fresque de 'La bataille d'Anghiari' au Palazzo Vecchio. Selon lui, l'art est intimement lié aux sciences et techniques. A-t-il peint pour mener des réflexions de type mathématique ou a-t-il développé ses connaissances scientifiques en autodidacte pour apporter davantage de grandeur à son oeuvre ? Toujours est-il qu'il a montré des talents d'ingénieur militaire, d'urbaniste, de biologiste et de physicien, pressentant souvent les grandes découvertes des siècles suivants (concernant les lois du mouvement et de la gravité par exemple). En quête de mécènes et de commandes comme tous les artistes de la Renaissance, il a commencé "Maître des arts et ordonnateur des fêtes" de Ludovic Sforza à Milan, et a achevé sa vie auprès de François Ier. Sa dépouille repose dans la chapelle Saint Hubert d'Amboise.
► 1452 François Villon reçu maître ès arts à la Sorbonne.
► 1453 - 29 mai La peine de mort de Jacques Coeur est commué en bannissement. Charles VII est particulièrement ingrat à l'égard de ce conseiller que protège cependant sa maîtresse, Agnès Sorel. Il a pourtant restauré et administré sagement les finances du royaume. Il n'a pas hésité à contribuer par ses propres deniers au redressement de la monarchie et du pays. Le roi le sacrifie à ses ennemis. Le jugement le condamne à la confiscation de ses biens et à l'exil.
► 1453 - 29 mai En cette année se produit un événement capital dans l'histoire du monde. La prise de Constantinople par les Turcs (ottomans) précipite l'effondrement de l'empire d'Orient ou Bas-Empire ou empire Byzantin, et marque la fin du Moyen Âge et le commencement des temps modernes. L'Empire ottoman, l'un des nombreux États fondés par les Turcs, exista entre 1299 et 1922 (soit 623 ans). Fondé par une tribu turque oghouze en Anatolie occidentale, l'Empire ottoman s'étendait au faîte de sa puissance sur toute l'Anatolie, les Balkans, le pourtour de la Mer Noire, la Syrie, la Palestine, la Mésopotamie, la péninsule arabique et l'Afrique du Nord.
La chute de Constantinople a eu lieu le 29 mai 1453 et marqua la fin de l'empire byzantin, ainsi qu'une nouvelle ère d'expansion pour l'empire ottoman. Les historiens considèrent parfois que cette date marque aussi la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. La chute de Constantinople en 1453 est un moment clé de l'histoire. Cette date peut-être considérée logiquement comme marquant la fin du Moyen Âge. En effet, la disparition de l'empire byzantin marque le début d'une nouvelle ère. Malgré leur désintéressement complet pour l'état de Constantinople, sa chute provoque un grand vide en Occident.
L'empire byzantin avait depuis sa création été un rempart aux invasions arabes, protégeant ainsi la plus grande part de l'Europe chrétienne. Cet empire était continuellement en guerre et il est étonnant de se dire qu'il a résisté pendant plus de 1000 ans à l'assaut de 20 peuples et que sa capitale eut à subir le nombre incroyable de 30 sièges. Constantinople avait pendant des siècles été une des villes les plus riches et la plus populeuse au monde. L'empire byzantin avait perpétué l'héritage de l'empire romain qui, lui, croûlait sous l'assaut des barbares.
Cet héritage fut perpétué au travers des siècles et enrichi. Constantinople marqua l'histoire des peuples d'une manière indélébile. La capitale de cet empire était de plus située à un carrefour stratégique de première importance entre l'Orient et l'Occident, l'Asie et l'Europe. Toutes les principales routes de commerces y convergeaient. Mais l'empire fut ruiné par les croisades et par la prise de Constantinople par les Latins. Il fut ruiné inutilement car jamais les croisés ne purent s'installer durablement en Orient.
Bien sûr l'empire avait su se relever sous l'impulsion des Comnène et des Paléologue, mais l'Occident l'en empêcha et plus particulièrement Gênes et Venise qui, voulant s'attribuer les points stratégiques de l'Empire lui ravirent sa principale source de richesse, à l'image des génois de Galata qui, attirant les bateaux du monde entier, les avaient fait déserter le port constantinopolitain. De plus, les guerres entre les deux puissances maritimes ruina définitivement l'Empire. Les Turcs n'avaient fait que sa conquête territoriale, l'Occident l'avait ruiné au niveau commercial. Cependant la chute de Constantinople ouvre une ère nouvelle en Occident : tous les savants grecs après la chute du dernier état grec qu'était Trébizonde se réfugient en Italie où ils amènent le reste de leur bibliothèque et leur savoir. Ce mouvement conduit à la Renaissance.
► 1453 L'ÉPOQUE MODERNE ou RENAISSANCE.
► 1453 L'Époque moderne couvre la période historique allant de la fin du Moyen Âge à la Révolution française. Cette période couvre les XVIe siècle, XVIIe siècle et XVIIIe siècle. La Renaissance, terme qui désigne un courant artistique et idéologique qui a trait à la redécouverte du savoir antique, et les grandes découvertes marquent les débuts de l'époque moderne et post-moderne. Sur le plan religieux, la Réforme protestante et son pendant, la Contre-Réforme, marquent la fin de l'emprise sans limites de l'Église catholique romaine sur la vie spirituelle en Europe occidentale. À la fin des guerres de religion qui ensanglantent l'Europe, s'instaure l'Ancien Régime, marqué par l'"absolutisme" de sa monarchie.
Les XVIIe siècle et XVIIIe siècle sont également marqués par les guerres européennes puis par la rivalité franco-anglaise pour la domination du monde. Ainsi, le théâtre de la guerre se mondialise, tandis que s'affirme la domination européenne sur le reste du monde. Au XVIIIe siècle, caractérisé par les philosophes des "Lumières" et le "despotisme éclairé", la monarchie absolue a atteint ses limites. Elle s'effondre en France, avec la Révolution. La fin de l'époque moderne coïncide avec la fin de l'Ancien Régime et les débuts de la domination de l'empire colonial britannique. À l'échelle de la France, la date finale de l'époque moderne pose problème, selon qu'on y intègre les différents régimes issus de la Révolution et précédant le Premier Empire (Directoire, Consulat) ou non.
La Renaissance est une période de rénovation littéraire, artistique, et scientifique, qui se produisit en Europe par la diffusion de connaissances nouvelles parmi un milieu lettré. Ce mouvement eut comme origine la Renaissance italienne : une Pré-Renaissance se produisit dans plusieurs villes d'Italie dès le XIVe siècle (Trecento), se propagea au XVe siècle dans la plus grande partie de l'Italie, en Espagne, dans certaines régions d'Europe du Nord et d'Allemagne, sous la forme de ce que l'on appelle la première Renaissance (Quattrocento), puis gagna l'ensemble de l'Europe au XVIe siècle (Cinquecento). Dans le courant du XVe siècle et au XVIe siècle, ce mouvement permit à l'Europe de se lancer dans des expéditions maritimes d'envergure mondiale, connues sous le nom de grandes découvertes. La Renaissance s'accompagna aussi d'un ensemble de réformes religieuses.
► 1453 - 17 juillet Victoire de Charles VII à Castillon-la-Bataille contre l'Angleterre. Bataille de Castillon : l'armée française l'emporte sur les Anglais, et met fin à la Guerre de Cent Ans (1337 - 1453). La bataille de Castillon eu lieu le 17 juillet 1453 entre les armées de Henri VI d'Angleterre et Charles VII de France. C'est une victoire décisive pour les Français.
► 1453 19 octobre La capitulation de Bordeaux marque la fin de la guerre de Cent Ans et le retour de la Guyenne sous domination française.
► 1453 à 1461 - Les dernières années du règne virent s'accomplir encore d'autres réformes et créations utiles. Charles VIl crée le Parlement de Toulouse et celui de Grenoble et fait commencer la rédaction des diverses Coutumes qui régissaient la vie civile. On doit reprocher à ce souverain son ingratitude envers Jacques Coeur qui avait restauré et administré sagement les finances du royaume, et qui avait puissamment aidé de ses deniers au relèvement de la monarchie et du pays. Le grand argentier fut sacrifié à ses ennemis, ses biens furent confisqués et il alla mourir en exil.
La favorite de Charles VII, Agnès Sorel, dame de Beauté (nom d'une seigneurie qu'elle possédait) née en 1422 (morte en 1450) fut mêlée de très près aux affaires de la monarchie, mais elle eut sur l'esprit du roi et sur la marche des événements une heureuse influence. Au contraire, le dauphin Louis (plus tard Louis XI) fut pour Charles VII son père un ennemi infatigable. Né en 1423 (fils de Marie d'Anjou), il s'était dès 1440 joint à la Praguerie. En 1455, il fomenta une nouvelle révolte contre Charles VII: celui-ci châtia rudement les révoltés et le dauphin dut chercher un refuge auprès du duc de Bourgogne (1456). Ces derniers événements altérèrent la santé de Charles VII qui d'ailleurs vivait dans la crainte continuelle d'être empoisonné à l'instigation du dauphin ; il mourut en 1481.
Le règne de Charles VII a vu la France réduite à la dernière extrémité, puis sauvée par une intervention miraculeuse et finalement relevée de ses ruines. On peut reprocher à Charles VII son indolence, sa négligence de ses devoirs pendant ses premières années de règne ; mais on doit reconnaître que, par la suite, il fit preuve d'énergie et de grands talents d'administrateur. Malheureusement, l'ingratitude dont il fit preuve envers Jeanne d'Arc et Jacques Coeur a jeté une ombre défavorable sur sa mémoire. Les circonstances de son règne lui ont fait donner par les historiens les surnoms de l'Indolent, puis le Bien-Servi, puis le Victorieux.
► 1453 à 1516 - naissance et mort de Jérôme Bosch. Peintre flamand au génie singulier, célèbre pour son iconographie fantastique au sens narratif inépuisable, tantôt attribuée à une tradition populaire, tantôt à l'alchimie, mais jamais éloignée des préoccupations morales et religieuses.
► 1453 Début de l'Humanisme. L'humanisme est un mouvement européen et une philosophie qui met l'homme et les valeurs humaines au dessus de tout. Il englobe les XIVe, XVe et XVIe siècles. Il se caractérise par un retour aux textes antiques, et par la modification des modèles de vie, de l'écriture, et de la pensée. Mouvement intellectuel de la Renaissance, né en Italie au XIVème siècle, qui s'étendit progressivement en Europe et s'épanouissant au XVIème siècle.
Il est marqué par le retour aux textes antiques qui servirent de modèle de vie, d'écriture et de pensée. Pétrarque, Ficin, Pic de la Mirandole, Érasme en furent les principaux représentants. Le terme désigne donc un courant culturel, scientifique, philosophique et, par bien des aspects, politique qui propose un "modèle humain" défini comme synthèse des qualités intellectuelles, sociales, affectives, caractéristiques de la "nature humaine". L'humanisme est un courant de pensée idéaliste et optimiste qui place l'Homme au centre du monde, et honore les valeurs humaines.
► 1454 - 15 avril Ordonnance de Montil-les-Tours sur la rédaction des usages coutumiers. Promulguée par Charles VII, il avait obligé que l'on rédigeât les coutumes orales, qui tenaient lieu de droit ; ces rédactions se sont faites en langues vulgaires, que ce soient des langues d'oïl au nord, d'oc au sud. D'autres édits royaux préconisaient les langues vulgaires, sans rendre obligatoire le français.
► 1454 François Villon écrit 'Lais’
► 1455 - 31 mai : Début de la Guerre des Deux-Roses crise de succession en Angleterre (1455-1485). Richard d'York, devenu protecteur du royaume, s'oppose à Henry VI de Lancastre, roi légitime. La Guerre des Deux-Roses désigne une série de guerres civiles qui eurent lieu en Angleterre entre la maison royale de Lancastre et la maison royale d'York. La guerre prit fin en 1485, quand le dernier des rois Plantagenêt Richard III d'Angleterre mourut au champ d'honneur, et qu'Henri VII devint roi. La maison de Lancastre descendait de Jean de Gand, duc de Lancastre et fils du roi Édouard III d'Angleterre.
Celle de York descendait de Lionel d'Anvers, fils du même roi. L'emblème de la maison de Lancastre était la rose rouge, tandis que celui des York était la rose blanche, ce qui est à l'origine du nom donné a posteriori à ce conflit. Richard d'York, Richard Plantagenêt ou Richard d'York (21 septembre 1411 – 30 décembre 1460), comte de March, de Cambridge et d'Ulster, puis 3e duc d'York. Il était membre de la famille royale anglaise. Par la guerre des Deux-Roses, il disputa le trône d'Angleterre au roi Henri VI (de la maison de Lancastre), trône auquel sa propre maison (la maison d'York) accéda après sa mort, par l'entremise de ses fils Édouard IV d'Angleterre (1461 – 1483) et Richard III d'Angleterre (1483 – 1485), de son petit-fils Édouard V d'Angleterre (qui régna très brièvement en 1483), et de son arrière-petit-fils le roi Henri VIII d'Angleterre (1509 – 1547).
Richard III d'Angleterre (2 octobre 1452 - 22 août 1485), duc de Gloucester, fut le dernier des rois Plantagenêt d'Angleterre (1483-1485). Fils de Richard Plantagenêt, duc d'York et de Cécile Neville (1415-1495). C'est le plus jeune frère du roi Édouard IV. La mort soudaine de son frère donne à Richard l'occasion de s'emparer du trône après avoir évincé son neveu, le roi Édouard V, dont il est nommé tuteur. Le jeune Édouard et son frère Richard sont envoyés à la Tour de Londres. Personne ne les revoit après l'été 1483, et on suppose qu'ils y sont assassinés. C'est là le sujet d'une grande controverse. Il est perçu plus tard comme un monstre, un homme méchant, assassin de tous ceux qu'il voyait comme ses ennemis.
C'est en effet un homme ambitieux, mais probablement innocent de la plupart des crimes dont il est accusé. Une grande partie de cette réputation est due à la pièce de Shakespeare qui porte son nom. Henri VII d'Angleterre, Henri Tudor (28 janvier 1457 - 21 avril 1509), fut comte de Richmond (1456-1461), puis roi d'Angleterre à partir de 1485 sous le nom de Henri VII, premier souverain de la dynastie Tudor. La famille Tudor renvoie à la période de l'histoire anglaise située entre 1485 et 1603 pendant laquelle la dynastie régna sur le trone et qui marqua l'irruption de l'Angleterre comme une puissance européenne majeure. La dynastie Tudor ou la Maison Tudor voit son origine remontée au XIIIe siècle. Elle comprend une suite de cinq monarques d'origine galloise qui régna sur le royaume d'Angleterre et le Royaume d'Irlande de 1485 jusqu'à 1603.
Les trois principaux monarques les rois Henri VII d'Angleterre, Henri VIII d'Angleterre et la Reine Élisabeth Ière d'Angleterre jouèrent chacun une part fondamentale dans la mutation de l'Angleterre d'une arrière cour européenne toujours plongée dans le Moyen Âge en un puissant État de la Renaissance qui allait dominer la plus gande partie du monde connu. Elle acquit sa puissance lorsque Henri Tudor (1457-1509), ayant battu le roi Richard III à la bataille de Bosworth, devint Roi d'Angleterre prenant le nom d'Henri VII. Henri Tudor, par sa mère, une Plantagenêt, descendait du roi Édouard III d'Angleterre ; et en outre il se maria en 1486 avec la fille aînée du roi Édouard IV, Élisabeth Plantagenêt (1466-1503).
► 1455 François Villon écrit 'La Ballade des Pendus’
► 1455 mort de Fra Angelico.
► 1456 mort de Jacques Coeur.
► 1456 7 juillet Réhabilitation de Jeanne d'Arc.
► 1456 Charles VII envoie une armée contre son fils en Dauphiné.
► 1456 30 août Le Dauphin quitte le Dauphiné pour se réfugier en Franche-Comté, puis à Louvain, en territoire bourguignon. Il y fut bien reçu, et en octobre, Philippe le Bon lui rendit hommage.
► 1456 François Villon écrit 'Les Testaments’
► 1456 La Bible de Gutenberg, le premier livre à être imprimé mécanique-ment, est publié à Mayence. En 1456, Gutenberg termina l'impression, sur une presse de sa fabrication, d'une Bible en latin connue aujourd'hui sous le nom de Bible de Gutenberg. La mise en pages de cette Bible a la particularité de comporter quarante-deux lignes, d'où son autre nom Bible à quarante-deux lignes. Mayence, ville d'Allemagne, capitale, arrondissement et plus grande ville du Land de Rhénanie-Palatinat. Entourée de vignobles, elle est située sur la rive gauche du Rhin, en face de l'embouchure du Main.
► 1457 août Le Dauphiné est annexé au domaine royal.
► 1457 René d'Anjou écrit 'Livre du cuer d'Amour espris'. René d'Anjou, René Ier de Naples né en 1409, fut seigneur puis comte de Guise (1417-1425), duc de Bar (1430-1480) de fait dès 1420, duc consort de Lorraine (1431-1453) roi de Naples (1435-1442), duc d'Anjou (1434-1480), comte de Provence et de Forcalquier (1434-1480), et roi titulaire de Jérusalem (1435-1480) et d'Aragon (1466-1480). On parle encore de René d'Anjou, ou de René de Sicile. À Aix-en-Provence et à Angers, il entretint une cour littéraire et savante et ne dédaigna pas lui-même composer plusieurs ouvrages ('Traité de la forme et devis comme on fait les tournois', 1451-1452 ; 'le Livre du coeur d'amour épris', 1457).
► 1460 - 20 septembre Mort de Gilles Binchois. Le plus célèbre représentant de l'école franco-flamande, Gilles Binchois, laisse au monde une oeuvre profane et audacieuse. Influencé par l'Ars Nova mais aussi par la musique plus sobre de John Dunstable, le musicien belge vivant au service de Philippe le Bon à la cour de Bourgogne a composé de nombreuses chansons dont "Je ne vis oncques la pareille". Mais il a aussi laissé des oeuvres de musique sacrée.
Gilles Binchois, compositeur franco-flamand. Il est né à Mons (Belgique) vers 1400 et mort à Soignies le 20 septembre 1460. Bien qu'il ait été d'abord connu comme auteur de musique religieuse – tel son Te Deum, ouvrage polyphonique le plus ancien qui nous soit parvenu –, on le connaît surtout pour ses oeuvres profanes, chantant l'amour courtois. La cinquantaine de chansons connues – des rondeaux et quelques ballades –, souvent mélancoliques, se sont inspirées de poèmes d'auteurs plus ou moins célèbres, tels Alain Chartier ou Charles d'Orléans.
► 1461 Henri VI d'Angleterre est déposé par Édouard IV d'Angleterre. (Henri VI d'Angleterre sera restauré sur le trône le 30 octobre 1470, il est à nouveau déposé le 11 avril 1471). Début du premier règne de Édouard IV d'Angleterre, fils de Richard d'York (fin en 1470, puis 1471-1483). Édouard IV d'Angleterre (28 avril 1442 – 9 avril 1483), fut roi d'Angleterre de 1471 à 1483. Il était le fils aîné de Richard Plantagenêt, comte de Rutland, March, Ulster et Cambridge, duc d'York († 1460) et de Cécile Neville († 1495).
► 1461 - 17 juillet Le Dauphin s'installe à Avesne pour se rapprocher du royaume de France.
► 1461 - 22 juillet Mort de Charles VII. A cinquante-huit ans, c'est d'inanition que meurt le roi. Il redoute depuis une semaine que son fils Louis XI l'empoisonne. “Par saint Jean, nous ne mangerons plus”. Épuisé, le roi demande aux religieux qui l'entourent “Quel jour est-il ? - Il est le jour de la glorieuse Madeleine. - Ah, je loue mon Dieu de ce qu'il lui plaît que le plus grand pécheur du monde meure le jour de la pécheresse !”. Louis XI devient roi de France.
► 1461 LOUIS XI l'Aragne (1461-1483)
► 1461 Louis XI. Impatient de règner il n'a cessé de comploter contre son père. Dés 1440 (il a 17 ans) il se joint à la praguerie. Son père lui pardonne et lui confit le gouvernement du Dauphiné. Louis XI réorganise remarquablement cette région mais il se lance dans une nouvelle révolte en 1455. A l'approche des armées du roi il se réfugie chez le duc de Bourgogne Philippe le Bon. Charles VII, son père, vécu dans la hantise d'être empoisonné par son fils. En 1461 il a 38 ans il succède enfin à son père. Il s'entoure de gens d'origine modeste. Il oppose à ces adversaires la diplomatie et la ruse plutôt que la force.
En 1465 se forme une coalition féodale dite "ligue du bien public", augmentation des impôts, rejet de la noblesse au profit des bourgeois, ce qui fait dire à Louis XI "si j'avais voulu augmenter leur pension et leur permettre de fouler leurs vassaux comme par le passé, ils n'auraient jamais penser au bien public". Cependant une armée de 60 000 hommes converge vers Paris. Une bataille indécise se déroule à Montlhéry le 16 juillet 1465. Les armées de la ligue campe sous les murs de Paris. Louis XI juge plus prudent de négocier le "traité de Conflans - l'Archevêque" 5 octobre 1465, dans lequel dit Commynes (auteur des mémoires sur Louis XI et Charles VIII); "Les princes butinèrent le monarque et le mirent au pillage.
Chacun emporta sa pièce". Louis XI entreprent aussitôt de récupérer ce qu'il avait du abandonner. En 1466 il reprend la Normandie que son frère (Charles de Berry) avait prise. Il doit combattre principalement la maison de Bourgogne d'abord, en la personne de Philippe le Bon, puis ensuite Charles le Téméraire qui le retient prisonnier lors des entretiens de Péronne en octobre 1468. Louis XI voulait récupérer les concessions faites précédemment. Il entreprit des discussions avec Charles le Téméraire tout en incitant les Liégeois à se révolter contre le duc.
Au cours de l'entrevue, Le Téméraire apprit l'origine des troubles, ne pouvant l'avouer, Louis XI fut dans l'obligation d'aider le Téméraire à réprimer la révolte alors que les Liègeois attendaient son aide. La mort du Téméraire au siège de Nancy en 1477 met fin à cette rivalité et à la maison de Bourgogne, dont la majeure partie fut annèxée à la France (traité d'Arras 1482). L'agrandissement du royaume fut complèté par l'héritage de l'Anjou, du Maine et de la Provence. Louis XI établit les premières postes, améliora les routes, se soucia du développement industriel et commercial. Il créa de nouveaux parlements pour améliorer la justice et oeuvra à l'unification du royaume.
► 1461 Avènement de Louis XI (né en 1423, fils de Charles VII et de Marie d'Anjou). - Il a épousé, étant encore dauphin, Marguerite d'Écosse (née en 1424). Il monte sur le trône dans des conditions de sécurité que n'ont pas connues beaucoup de ses prédécesseurs. La monarchie est affermie, la grande féodalité très ébranlée, les finances sont mieux réglées, une armée permanente permet au roi d'imposer ses décisions; enfin des institutions administratives et judiciaires assurent un certain ordre dans le pays. Mais Louis XI n'entend pas suivre toutes les voies ouvertes par Charles VII; à peine sacré à Reims, il entame avec le Saint-Siège des négociations en vue de l'abandon de la Pragmatique Sanction.
►1461 - 15 août Louis XI est sacré à Reims. Louis XI a déjà trente-huit ans lors de son sacre. Depuis l'avènement d'Hugues Capet, aucun roi de France n'est monté sur le trône aussi âgé. C'est le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui a dirigé et payé tous les frais de la cérémonie. Depuis 1457, le Dauphin qui est aujourd'hui sacré a été son protégé. Charles VII de France, en apprenant que le duc de Bourgogne protégeait son fils, auquel il était opposé, avait commenté : “Monseigneur de Bourgogne reçoit en sa maison un renard qui lui mangera ses poules”.
► 1461 - 31 août Entrée triomphale de Louis XI à Paris.
► 1461 - 2 octobre “Micquemacque” de Reims. Les impôts que sont les aides et les gabelles mécontentent le peuple de Reims, alors que Louis XI commence de régner depuis quelques mois. Si les révoltes qui éclatent alors ont le nom de “micquemacque”, c'est qu'en français on dénomme encore une rébellion par le mot “mutemacque”. Ce terme est un héritage du néerlandais, de l'expression “muyte maken” qui se traduit par “faire émeute”.
► 1461 Jean de Bueil écrit 'Le jouvencel'. Jean de Bueil, un ancien compagnon de Jeanne d'Arc, Jean de Bueil, reçoit la charge d'amiral de France. Cette charge était unique. Il s'agissait d'une dignité et non d'un grade dans la marine. Mais l'amiral possédait des pouvoirs étendus, tant sur la marine de guerre que sur le commerce maritime, de même que le droit de justice sur sa juridiction que constituait l'amirauté. Il a laissé un récit à clefs du siège d'Orléans – où cette ville est appelée Crathor – dans un ouvrage ayant pour titre : 'Le Jouvencel'.
► 1462 - 27 juin Naissance de Louis II d'Orléans (futur Louis XII) fils de Charles d'Orléans, le prince poête. Louis XII, né le 27 juin 1462 au château de Blois, mort le 1er janvier 1515 à Paris, surnommé le Père du peuple par les états généraux de 1506, fut roi de France, de 1498 à 1515.
► 1462 - 9 mai Traité de Bayonne entre Jean II d'Aragon et Louis XI qui récupère le Roussillon et la Cerdagne. La Cerdagne est un fossé d'effondrement situé dans l'est du massif des Pyrénées. D'une supérficie de 1 086,07 km² cette région naturelle est partagée par l'Espagne et par la France.
► 1462 Naissance d'Anne de Beaujeu, fille de Louis XI. Anne de Beaujeu, Anne de France dite Anne de Beaujeu (avril 1461 à Genappe - 14 novembre 1522 à Saint-Vincent-de-Salers, au château de Chanterelle) fut une princesse et régente. Fille aînée de Louis XI elle épouse à l'âge de 12 ans Pierre de Beaujeu, qui devient duc de Bourbon. Pendant la minorité de Charles VIII, son frère, elle exerce la régence de 1483 à 1491 avec son mari. Contrairement aux attentes des princes du royaume, elle maintient fermement contre les Orléanistes, l'autorité royale et l'unité française en mettant un terme à la Guerre folle en 1485 à Saint-Aubin-du-Cormier. Conséquence de la Guerre folle, elle marie son frère Charles VIII à Anne de Bretagne, ce qui lie le sort du duché au royaume français.
► 1463 5 janvier François Villon banni de Paris. D'abord condamné à mort, le poète François de Montcorbier, ou des Loges, connu sous le nom de son professeur Guillaume de Villon, est condamné au bannissement. A 44 ans, François Villon a déjà été gracié plusieurs fois par le roi Louis XI et Marie d'Orléans et notamment pour le meurtre du prêtre Philippe Sermoise. Dans l'attente de la sentence des jurés, François Villon écrit "La Ballade des pendus" où il donne voix aux condamnés qui vont mourir sur le gibet. Sa peine de mort sera transformée en exil forcé pendant 10 ans. François Villon disparaît sans laisser aucune trace.
► 1463 - 12 septembre Louis XI achète Abbeville, Amiens et Saint-Quentin à Philippe le Bon. Louis XI rachète cinq villes d'Artois. C'est à Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui a institué l'ordre de la Toison d'or, que Louis XI achète cinq villes d'Artois. Lorsque le roi de France entre dans Abbeville aux côtés du duc, les habitants déçus par la mise pauvre du souverain s'étonnent : “Est-ce là un roi de France, le plus grand roi du monde ! Ce semble mieux un valet qu'un chevalier. Tout ne vaut pas vingt francs, cheval et habillement de son corps”.
► 1464 Louis XI ne cache pas son intention de poursuivre la lutte contre les derniers représentants de la féodalité. - Formation de la Ligue du Bien public, entre les grands seigneurs féodaux (ducs de Bourgogne, de Nemours, de Bourbon, de Bretagne et comte d'Armagnac) contre Louis XI, qui les a tous mécontentés et surtout alarmés par quelques réformes précipitées, ainsi que par l'annonce de ses projets de leur abaissement. Bien que l'intérêt de ces princes soit entièrement opposé à celui de la population, ils n'hésitent pas à qualifier leur alliance Ligue du Bien public.
Ligue du Bien Public, révolte des princes contre la politique de Louis XI qui veut briser leur volonté d'indépendance, la Ligue du Bien Public est une révolte féodale contre l'autorité royale, obligeant le roi à s'engager à la tête d'une armée de fidèles pour ramener ses vassaux dans le droit chemin. Avec à leur tête Charles, comte de Charolais (futur Charles Le Téméraire) rendu furieux par la vente à Louis XI des villes de la Somme par son père Philippe le Bon, la haute noblesse rejette les décisions royales qui réduisent ses prérogatives.
► 1465 - 10 mars Publication du "manifeste du Bien public", base de la Ligue du Bien public, révolte nobiliaire contre le roi de France Louis XI. Les grands (Jean II de Bourbon, Charles de Berry, René d'Anjou, Jean II d'Alençon, François II de Bretagne, Albret, Jean V d'Armagnac), dirigés par Charles le Téméraire, comte de Charolais, et sous la direction nominale du frère du roi, Charles de Berry, souhaitent la mainmise sur les finances royales, sur la distribution des offices, sur l'armée, sur la personne royale (qu'on envisage de limoger) et sur son gouvernement. Début de la guerre de Louis XI contre la Ligue du Bien Public de Charles le Téméraire et Charles de Berry.
Guerre du Bien public. Insurrection féodale d'une coalition de seigneurs, menée par le frère du roi, Charles de Berry, qui tente de s'opposer en mars 1465 à la politique de renforcement du pouvoir royal entreprise par Louis XI. La victoire (indécise) de la ligue du Bien public, qui s'est alliée à Charles le Téméraire, à la bataille de Montlhéry (juillet 1465) contraint le roi à restituer les villes de la Somme à Charles le Téméraire, et la Normandie à son frère. Charles le Téméraire, Charles de Bourgogne, habituellement appelé Charles le Téméraire, est un prince français de la deuxième branche bourguignonne de la dynastie des Capétiens. Il est le troisième fils (les deux premiers sont morts en bas âge) de Philippe le Bon (1396-1467), duc de Bourgogne, et de sa troisième épouse l'infante Isabelle de Portugal (1397-*1471), elle-même Capétienne. Charles naît à Dijon en 1433. Il sera élevé aux Pays-Bas.
► 1465 - 17 juin Alliance de Louis XI avec les Liégeois.
► 1465 - 16 juillet Bataille de Montlhéry. La forteresse de Montlhéry, dont le donjon se dresse à 32 mètres de hauteur, est le théâtre d'une bataille qui oppose Louis XI à la coalition de la Ligue du bien public qui s'est alliée à Charles le Téméraire. La bataille est violente et l'issue en est indécise. Reste que, dans la panique, selon Philippe de Commynes “un seigneur du roi s'enfuit à Lusignan en Poitou et un seigneur de la Ligue jusqu'à Quesnoy-en-Hainaut”. L'un et l'autre de ces seigneurs se sont, dans leur fuite, simplement trompés de direction…
Louis XI se hâte de rentrer dans Paris et de le mettre en état de défense; pour s'assurer la bienveillance des bourgeois, il leur rend leurs privilèges et pendant ce temps, il noue des négociations avec les chefs de la ligue. Ces démarches réussissent à les désunir. Il fait alors avec eux les traités de Conflans et de Saint-Maur par lesquels la ligue est dissoute. Il cède la Normandie à son frère, Charles de Berry. Mais il est bien résolu à n'exécuter aucune des clauses qu'il vient de signer. Charles de Berry, Charles de France, 1446-1472, était le plus jeune frère du roi de France Louis XI, son aîné de 23 ans, contre lequel il ne cessa de comploter dès l'accession de celui-ci au trône de France le 22 juillet 1461.
► 1465 - 5 octobre Traités de Conflans et de Saint-Maur. Comme il s'est révolté contre son père, Louis XI voit se lever contre lui et le pouvoir ferme qu'il impose son frère Charles, duc de Berry, dit “Monsieur Charles” ou Charles de Berry. Les ducs de Bretagne et de Bourbon ainsi que Charles le Téméraire se sont alliés à lui. Leur coalition forme la ligue du Bien public. Après l'indécise bataille de Montlhéry, le roi est contraint de négocier. Par des paix séparées, il doit rendre des villes de la Somme au Téméraire, et donner la Normandie à son frère Charles (Charles de Berry), qui lui cède le Berry.
► 1465 - 29 octobre Traité de Saint-Maur. Charles le Téméraire récupère les villes vendues par son père.
► 1465 - 12 décembre Le frère du roi, Charles de Berry, reçoit le duché de Normandie en apanage.
► 1465 mort du poète Charles d'Orléans.
► 1466 Louis XI de France reprend la Normandie à son frère Charles de Berry, ce qui déclenche une nouvelle révolte féodale dirigée par Charles le Téméraire et François II de Bretagne. François II de Bretagne, né le 23 juin 1435 au château de Clisson et mort à Couëron le 9 septembre 1488, est le dernier duc de la Bretagne indépendante. Fils aîné de Richard d'Étampes, il est comte titulaire d'Étampes et vit à la cour de France lorsqu'il hérite du duché de Bretagne et des comtés de Richemont et de Vertus.
L'ordre de succession au trône de Bretagne ayant été modifié par le premier traité de Guérande en 1365, pour éviter toute contestation, voire une crise de succession, le duc François Ier lui fait épouser sa fille aînée Marguerite, héritière selon la tradition antérieure au traité de Guérande. Il accède au trône en 1458 après la mort de ses cousins François Ier et Pierre II et de son oncle Arthur III, le connétable de Richemont.
► 1466 à 1536 - naissance et mort de Desiderius Erasmus (Érasme). Humaniste hollandais d'expression latine. Son activité intellectuelle est intense. Il achève l'édition des Adages, "arsenal de Minerve", élargie de 4151 proverbes et sentences. Il traduit Plutarque, Platon, Pindare et s'initie à l'hébreu. En traversant les Alpes, il compose, "à cheval", 'l'Éloge de la folie' (1509), qu'il dédie à Thomas More. Ayant conçu de bonne heure une profonde répulsion à l'égard de la théologie scolastique, Érasme veut compléter humanisme et christianisme en conciliant les études religieuses et l'étude des lettres classiques.
Il approuve les premières prises de position luthériennes, mais il souhaite aussi sauvegarder l'unité du monde chrétien, et se prononce bientôt contre Luther en défendant, contre lui, le libre arbitre et la tolérance. Cette position de conciliateur lui vaut un rayonnement européen, mais aussi les attaques de tous les esprits partisans, réformés comme catholiques. Il quitte définitivement les Pays-Bas et s'installe à Bâle, où il publie en 1524 son 'Essai sur le libre arbitre', auquel Luther répond par le 'De servo arbitrio' ("Du serf arbitr"). L'humaniste réplique par 'l'Hyperaspistes' (1527). Correspondant avec toute l'Europe, il compose en 1534 un Traité sur la concorde de l'Église et assure le pape de son entier dévouement à la cause de l'unité de l'Église.
► 1467 - 15 juin Mort du duc de Bourgogne Philippe le Bon. Son fils Charles le Téméraire lui succède. Gand et Liège se révoltent contre lui et Louis XI leur donne clandestinement son appui. A l'intérieur, Louis XI déclare les offices inamovibles et organise militairement les corps de métiers de Paris. Cependant, les traités que Louis XI a signés ne s'exécutant pas, une deuxième ligue se forme contre lui, cette fois entre Charles le Téméraire, son beau-frère, Édouard IV d'Angleterre et le duc de Bretagne (François II de Bretagne). Louis XI fait tête d'abord contre ce dernier; il lui inflige une défaite et lui impose le traité d'Ancenis.
Puis il se retourne vers les deux autres, mais n'étant pas suffisamment fort pour les attaquer, il cherche à agir de ruse contre le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Charles le Téméraire, Charles de Valois-Bourgogne, dit Charles le Téméraire, vécut au XVe siècle. Il est (après Philippe II le Hardi, Jean sans Peur et Philippe III le Bon) le quatrième et dernier duc de Bourgogne de la branche des Capétiens-Valois. Ce surnom de Téméraire ne lui fut donné qu'à l'époque romantique. Ses contemporains le qualifièrent de Grand Lion, de Guerrier, de Travaillant, de Terrible ou encore de Hardi (Dijon 10 novembre 1433 – Nancy 5 janvier 1477). Charles le Téméraire était un prince français, descendant et héritier direct de 4ème génération du roi de France Jean II le Bon et du duché de Bourgogne.
Il est le père de la duchesse Marie de Bourgogne (1457-1482), qui, à la mort de son père en 1477, allie un état bourguignon en grand danger (d'être entièrement dépecé par Louis XI) à la maison des Habsbourg d'Autriche par son mariage avec le futur empereur germanique, Maximilien Ier du Saint Empire (1459-1519). François II de Bretagne, né en 1435 au château de Clisson et mort à Couëron en 1488, est le dernier duc de la Bretagne indépendante. Fils aîné de Richard d'Étampes, il est comte titulaire d'Étampes et vit à la cour de France lorsqu'il hérite du duché de Bretagne et des comtés de Richemont et de Vertu.
►1468 - 1er avril : Réunion des États généraux, à Tours, par Louis XI, qui obtient une condamnation de la Ligue du Bien public. Les États affirment l'inaliénabilité de la Normandie, qui appartient à la couronne. Ils agissent par loyalisme monarchique mais aussi par solidarité avec les contribuables, la création d'un apanage normand ayant signifié un manque à gagner pour le trésor. États généraux de 1468, réunion des états généraux du royaume de France, à Tours. Ils s'opposèrent à ce que la Normandie fut démembrée pour le frère du roi, et décidèrent que l'apanage des princes ne consisterait désormais qu'en un revenu fixe de rente.
► 1468 Louis XI fait déclarer par les États généraux réunis à Tours, la Normandie inaliénable, comme faisant partie du domaine de la couronne : elle ne pourra donc être attribuée à son frère ; après quoi il sollicite une entrevue avec Charles le Téméraire à Péronne, où devront être débattues et, promet-il sans doute, résolues les questions qui les divisent. Mais en même temps, afin de créer à Charles des embarras qui le rendront de composition plus facile, il pousse les Liégeois à une nouvelle révolte, cette fois contre leur évêque, parent de Charles, qu'ils chassent de son siège.
Charles apprend cette traîtrise et retient Louis prisonnier dans le château de Péronne. Louis XI, cependant, désarme son redoutable adversaire par sa soumission affectée, et consent à signer le traité qu'il lui impose. Aux termes de ce traité, dit de Péronne, le frère de Louis XI, Charles de Berry, (qui est l'allié du Téméraire et qui a été frustré de la Normandie) recevra les provinces de Champagne et de Brie (qui relient les possessions du duc de Bourgogne en Bourgogne et en Flandre) et Louis XI devra assister à la campagne contre les Liégeois.
A cette occasion, Louis XI détache du service du duc, Charles le Téméraire, par ses promesses et sa duplicité, le célèbre Philippe de Commines, qui après avoir été le meilleur conseiller de Charles le Téméraire sera l'ami, le confident et l'historiographe du roi de France. Après quoi, Louis XI part avec Charles contre les villes flamandes dont ses intrigues ont provoqué la révolte, et assiste au sac de Liège par les Bourguignons. Une fois rentré à Paris, Louis XI s'efforce de ne pas tenir les engagements qu'il vient de prendre; il commence par attribuer à son frère la Guyenne au lieu de la Champagne qui lui a été promise par traité, mais qui, à son gré, est trop voisine de Paris pour être possédée par un seigneur aussi turbulent et qui, d'ailleurs, reste l'allié du duc de Bourgogne.
Philippe de Commines (ou de Commynes ou "Philip de Comines") (1447-1511) est un homme politique, écrivain et historien francophone flamand. Il fut attaché à dix-sept ans au comte de Charolais, futur duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Il quitta ce seigneur en 1472 pour s'attacher à Louis XI, qui le combla de richesses et d'honneur. Il fut nommé sénéchal du Poitou. Louis XI en fit son confident et son ministre. Après la mort de Charles le Téméraire sur l'ordre du roi il prit possession de la Bourgogne et essaya de réunir la Flandre à la France.
► 1468 Louis XI fait enfermer dans une cage de fer son conseiller, le cardinal La Balue, qu'il accuse de l'avoir trahi. Cardinal Jean de La Balue, il gravit rapidement les degrés de la gloire: évêque d'Évreux et d'Angers avant d'être cardinal, aumônier du roi, intendant des finances, il devient Secrétaire d'État du roi Louis XI. Complotant contre celui-ci avec Charles
Le Téméraire, et reconnu coupable, il fut enfermé de 1469 à 1480 dans une cage de fer, au château d'Auzain près de Blois. Le Pape Sixte IV le fit libérer et le prit sous sa protection. Le Cardinal La Balue mourut en Italie près d'Ancôme en 1491. Cardinal, les cardinaux sont de hauts dignitaires de l'Église catholique chargés d'assister le pape. Ils forment le Collège des cardinaux.
► 1468 - 3 juillet Le mariage de Charles le Téméraire avec Marguerite d'York (1446-1503), soeur du roi Édouard IV d'Angleterre, marquant l'alliance anglo-bourguignone. Marguerite d'York ou Margaret Plantagenêt ou Marguerite de Bourgogne (3 mai 1446 - 23 novembre 1503), fille du 3e duc d'York Richard de Plantagenêt (Richard d'York) et de Cécile Neville. Elle était l'une des soeurs des rois Édouard IV d'Angleterre et Richard III d'Angleterre et la troisième épouse du puissant duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Elle est la duchesse la plus élégante, la plus riche et la plus puissante d'Europe du XVe siècle.
► 1468 - 10 septembre Traité d'Ancenis entre François II de Bretagne et Louis XI de France. Le duc de Bretagne s'engage à rompre ses alliances avec le duc de Bourgogne Charles et le roi d'Angleterre Édouard IV d'Angleterre, tandis que le roi de France promet une pension de 60 000 livres à son frère Charles de Berry ainsi que la concession d'un apanage restant à définir.
► 1468 - 9 octobre Début de l'entrevue de Péronne. C'est Louis XI lui-même qui a proposé à Charles le Téméraire qu'ils se rencontrent à Péronne. Il veut négocier seul à seul avec lui alors que, pour la deuxième fois, une coalition se dresse contre lui. Charles de Berry (son propre frère), le duc François II de Bretagne et Jean II d'Alençon sont les alliés du Téméraire. Contre toute attente, l'entrevue vire à l'humiliation pour le roi de France.
Charles le Téméraire, qui redoute la duplicité du roi.“Il n'est venu là que pour me trahir” –, ordonne que l'on ferme les portes de la ville, rompt les négociations, et fait le roi prisonnier. Les conseillers du duc de Bourgogne lui disent alors : “Profitez des circonstances pour tirer du roi ce qu'il vous plaira”. Jean II d'Alençon, Jean II de Valois, né à Argentan le 2 mars 1409, exécuté à Paris en 1476, duc d'Alençon, comte de Perche, fils de Jean Ier et de Marie de Bretagne.
► 1468 - 14 octobre Louis XI accepte les conditions de Charles le Téméraire qui le retient prisonnier à Péronne. Louis XI de France et Charles le Téméraire ont une entrevue et signent le traité de Péronne. Louis XI cherche à négocier avec Charles contre la Bretagne. Charles le Téméraire retient le roi de France et ne le libère qu'après qu'il ait donné la Champagne à son frère Charles de Berry et assisté à la répression de la révolte de Liège (30 octobre).
► 1469 à 1539 - naissance et mort de Nanak, instructeur spirituel indien, il fonde la religion sikhisme. Les Sikhs reconnaissent onze gurûs, dix ayant vécus en chair et en os, et le dernier incarnant l'âme des dix précédents et prenant la forme d'un livre saint, le Siri Gurû Granth Sahîb.
► 1469 - 26 avril Charles de Berry reçoit en apanage la Guyenne en remplacement de la Normandie.
► 1469 - 1er août Création de l'ordre de Saint-Michel par Louis XI. Les souve-rains s'en serviront pour récompenser les nobles. Il encadre la haute noblesse dans l'intérêt du pouvoir central. L'Ordre de Saint-Michel est un ordre de chevalerie, fondé à Amboise le 1er août 1469 par Louis XI. Il fut fondé en réplique à la fondation de l'ordre bourguignon de la Toison d'Or.
Le roi de France le dirigeait et les chevaliers, au nombre de trente-six, devaient lui prêter serment. Le siège était l'abbaye du Mont-Saint-Michel, transféré ensuite à la Sainte Chapelle de Vincennes, puis par Louis XIV aux Cordeliers de Paris. Ordre de Saint-Michel. Ordre militaire créé à Amboise le 1er août 1469 par le roi Louis XI. Sous Louis XIV, il s'élargit aux artistes et écrivains, à qui il conférait des lettres de noblesse. L'ordre disparaît en 1830.
► 1469 à 1527 - naissance et mort de Nicolas Machiavel. Homme politique et philosophe italien. Entré en 1498 au service de la République florentine, Nicolas Machiavel exerce la fonction de secrétaire de la Chancellerie des Dix. Ce poste le conduit à mener de nombreuses missions diplomatiques, missions dont la délicatesse est à la mesure des incessants renversements d'alliances. Il se rend ainsi en France, auprès du Saint-Siège, auprès de César Borgia, dont il mesure alors toute la fourberie.
Mais la république s'effondre bientôt, et le retour des Médicis au pouvoir sonne aussi le glas de sa carrière. Torturé, jeté en prison, il est contraint à l'exil. C'est alors qu'il écrit 'Le prince', dans l'espoir d'un retour en grâce dans sa ville natale, ce qui se produit effectivement. Contrairement aux idées reçues, Machiavel était loin d'être un cynique ayant rédigé un "manuel à l'usage des tyrans".
Son but est de dévoiler le pouvoir dans sa nudité, et de s'interroger, non pas sur ce qu'un État devrait être, sur des Idées à l'instar de Platon, mais sur ce qu'il est en vérité, ce qui constitue à l'époque une innovation. Brillant historien, diplomate de talent, républicain convaincu, quelle ironie d'entendre actuellement son nom comme synonyme d'un acte de manipulation perverse !
► 1470 - 30 juin Naissance de Charles (futur Charles VIII), fils de Louis XI et Charlotte de Savoie à Amboise. Charles VIII de France, né le 30 juin 1470 au château d'Amboise, de Louis XI et de Charlotte de Savoie, mort le 7 avril 1498 au même endroit, fut roi de France de 1483 à 1498, septième et dernier roi de la succession directe de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne.
► 1470 Formation d'une nouvelle ligue à l'instigation du nouveau duc de Guyenne, qui a encore pour alliés Charles le Téméraire et Édouard IV d'Angleterre. De même qu'il la déjà fait, Louis XI n'oppose d'abord à ses ennemis que des ruses dilatoires par lesquelles il espère les diviser.
► 1470 - 6 octobre Henri VI d'Angleterre récupère son trône avec l'appui de Louis XI.
► 1470 novembre Louis XI convoque à Tours, l'Assemblée des Notables, par laquelle il fait annuler le traité de Péronne. Se prévalant de cette décision (qui est beaucoup son ouvrage), il fait saisir les villes de la Somme: Saint-Quentin, Roye, Montdidier, Amiens, qu'il avait rachetées au duc de Bourgogne et que celui-ci lui avait reprises. L'Assemblée des notables est, en France, une assemblée consultée par le roi au sujet de questions concernant le royaume et dont les membres sont désignés par lui.
Elle a porté de nombreux noms et l'expression "notables" apparaît avec l'Assemblée réunie à Rouen en 1596. Elle diffère des États généraux par le mode de désignation des députés : les personnages éminents qui la composent, membres du clergé, de la noblesse, des corps de ville, voire délégués des cours souveraines, ne sont pas élus mais désignés par le roi. De plus, ils sont invités à émettre un avis et non à rédiger des doléances.
► 1470 Hugo van der Goes peint 'Le péché'. Hugo van der Goes est un peintre belge. Ce peintre influencé par Jan Van Eyck et Roger Van der Weyden, qui collaborera, à Bruges, à la décoration des fêtes en l'honneur des noces du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, exécutera pour Tommaso Portinari, représentant des Médicis dans la cité des Flandres, le grand triptyque Portinari. Atteint de maladie mentale, l'artiste se retirera comme frère convers dans un couvent près de Bruxelles en 1477. Il y peindra la 'Mort de la Vierge'.
► 1470 Installation des premières presses d'imprimerie à Paris.
► 1471 mars Édouard IV d'Angleterre reprend le trône à Henri VI avec l'appui de Charles le Téméraire. Restauré sur le trône en 1470, Henri VI fut à nouveau déposé le 11 avril 1471. Il fut mis à mort, en secret, à la Tour de Londres.
► 1471 à 1528 - naissance et mort de Albrecht Dürer. Peintre allemand, peintre Issu de la tradition du gothique flamboyant de l'Europe du Nord et influencé par les oeuvres italiennes de la Renaissance, Albrecht Dürer abordera de nombreux thèmes parmi lesquels la compositions religieuses, les allégories profanes, le paysage les animaux et les portraits. Dürer sera l'artiste allemand du passage entre la tradition plastique médiévale et l'art moderne.
► 1472 à 1475 - La trêve de Senlis n'empêche pas Louis XI de reprendre les villes de la Somme que Charles le Téméraire lui a récemment enlevées et de débarrasser peu à peu la région des forces bourguignonnes qui pouvaient s'y trouver encore, tandis que le duc de Lorraine bataille en Lorraine, en Allemagne, avec l'espoir d'arrondir et de souder les unes aux autres ses possessions dont il rêve de former un royaume. Sur la demande du duc, Édouard IV d'Angleterre lui amène des troupes en France, mais les finasseries de Louis XI, une fois de plus, font avorter le projet des deux alliés.
Charles, d'ailleurs, ne peut rejoindre Édouard IV dans les délais prévus pour le déclenchement de leur action commune ; Louis XI obtient d'Édouard la signature d'un traité de paix, à Pecquigny (1475). Lorsque le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, arrive enfin, il se trouve seul pour engager la lutte, et à son tour signe un traité avec Louis XI, ce qui d'ailleurs lui permettra de se retourner vers les Suisses et vers la Lorraine, qu'il cherche à asservir, et contre lesquels il fera deux expéditions malheureuses, dans la dernière desquelles il trouvera la mort (1477).
►1472 - 24 mai La mort de Charles de Berry, duc de Guyenne, marque le retour de la Guyenne au domaine royal.
► 1472 Mort du duc de Guyenne, Charles de Berry, frère de Louis XI. Cette mort survient trop opportunément pour qu'on ne soupçonne pas Louis XI d'en être l'instigateur: cela ne l'empêche pas de saisir la Guyenne. Charles le Téméraire, en proie à la fureur, accuse Louis XI d'empoisonnement, et jette des troupes contre les villes de Picardie que le roi vient de lui reprendre. Nesle et Roye sont saccagées; mais les Bourguignons échouent devant Beauvais, grâce surtout à l'héroïsme d'une jeune fille: Jeanne Lainé, dite Jeanne Hachette.
Pour se dédommager de cet échec, Charles le Téméraire ravage la Normandie, espérant que, par la possession de cette province, il pourra faire sa jonction avec le duc de Bretagne. Mais entre temps, Louis XI, tant par force que par ruse, a imposé à ce dernier une trêve; Charles réduit à ses propres moyens, se voit lui-même contraint d'en signer une, à Senlis. Jeanne Laisné, connue sous le nom de Jeanne Hachette, figure emblématique de la résistance française face à Charles le Téméraire.
En 1472, Charles le Téméraire envahit le nord du royaume de France, aidé par Jean II d'Alençon. Après avoir tout balayé sur son passage, il mit le siège devant Beauvais. Selon la tradition, Jeanne Laisné, une jeune habitante de la ville, saisit une hache pour repousser un Bourguignon qui sautait de son échelle d'assaut. Les défenseurs de la ville, galvanisés par son courage, repoussèrent alors le Téméraire, dont l'avance en France fut stoppée net.
► 1472 - 22 juillet Charles le Téméraire échoue devant Beauvais.
► 1472 - 31 octobre Signature du Concordat entre Louis IX et Sixte IV. En ce 31 octobre, Louis XI arrête par édit la formule qui signifie sa volonté : “Car tel est notre plaisir”. C'est à la même formule, à peine modifiée en “Car tel est notre bon plaisir”, qu'aura recours encore Louis XVI. Par ce concordat Sixte IV, voulant pacifier les dissensions qui subsistaient entre la cour de Rome et la France, à l'occasion de la pragmatique sanction, donna aux collateurs ordinaires six mois libres pour conferer les bénéfices; à savoir, Février, Avril, Juin, Août, Octobre et Décembre, au lieu de quatre mois libres, pendant lesquels ils n'étaient pas sujets aux graces expectatives; il se réserva néanmoins la faculté d'accorder six graces; il se réserva aussi jusqu'à un certain temps la disposition des bénéfices de France, possedés par les cardinaux et par leurs familiers; il fit aussi quelques réglements sur le jugement des causes et appellations, et ordonna que les taxes faites par Jean XXII pour les bénéfices seroient observées; mais ce concordat ne fut pas exécuté:
le procureur général de Saint-Romain s'y opposa comme étant contraire aux decrets des conciles de Constance et de Basle. Sixte IV, Francesco della Rovere, né le 21 juillet 1414 à Celle Ligure, près de Savone, mort le 12 août 1484 à Rome, couronné pape le 25 août 1471 sous le nom de Sixte IV. Ses contemporains baptisent son oeuvre restauratio Urbis : la restauration de la Ville. Il fait aménager la chapelle Sixtine. Il se montre également un mécène humaniste, en partie pour des fins politiques. Il reconstitue l'Académie romaine, embauche des chanteurs pour la chapelle pontificale, accroît les fonds de la Bibliothèque vaticane.
La chapelle Sixtine est l'une des salles des palais pontificaux du Vatican. À l'heure actuelle, elle fait partie des musées du Vatican. C'est dans la chapelle Sixtine que les cardinaux, réunis en conclave, élisent chaque nouveau pape. La chapelle doit son nom de "sixtine" au pape Sixte IV, qui la fit bâtir de 1477 à 1483. Elle est située à l'angle sud-ouest du palais et communique avec les chambres de Raphaël et ce qui est actuellement la collection d'art religieux moderne.
Son architecte est Giovanni de' Dolci. Elle comprend un souterrain, un entresol et la chapelle à proprement parler, bordée en hauteur d'un chemin de garde : la chapelle devait servir à un but religieux, mais aussi pouvoir assurer la défense du palais. Elle doit sa célébrité au fait que sa décoration a été réalisée par les plus grands artistes de la Renaissance : Michel-Ange, Le Pérugin, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Pinturicchio, notamment.
► 1473 - 30 septembre Rencontre à Trèves entre Frédéric III du Saint-Empire et Charles le Téméraire. Frédéric III du Saint-Empire, Frédéric de Habsbourg (né à Innsbruck en 1415, décédé à Linz en 1493). Roi des Romains (1440) puis empereur romain germanique sous le nom de Frédéric III de 1452 à 1493.
► 1473 à 1543 - naissance et mort de Nicolas Copernic. Astronome polonais. Nicolas Copernic doit être considéré comme l'un des plus grands génies de son époque. Il a conquis une gloire universelle grâce à sa théorie du mouvement de la Terre et des planètes. Dans son système héliocentrique (connu, depuis lors, sous le nom de système de Copernic), toutes les planètes tournent autour du Soleil, et la Terre n'est plus qu'une planète comme les autres, dont la rotation sur elle-même donne l'alternance du jour et de la nuit.
Malgré la grande simplicité de son système, Copernic ne réussit pas à faire admettre ses idées à ses contemporains. À côté de son intérêt astronomique, l'oeuvre de Copernic eut une portée philosophique immense. Elle marqua l'un des tournants essentiels de la pensée, ébranlant la vision médiévale du monde, qui plaçait l'homme au centre d'un univers fait pour lui. Cela explique les réactions violentes qu'elle souleva pendant plus de deux siècles.
► 1474 Incorporation du Roussillon au domaine royal. - Le roi d'Aragon, Jean II d'Aragon, avait engagé le Roussillon au roi de France pour 200 000 écus. Cette somme n'ayant pas été remboursée, Louis XI fit saisir Perpignan et occuper la province qui depuis lors est restée française. Jean II d'Aragon, né le 29 juin 1398 à Medina del Campo, mort le 19 janvier 1479 à Barcelone, fut roi de Navarre par mariage entre 1425 et 1441 puis par usurpation entre 1441 et 1479), et enfin roi d'Aragon, de Majorque, de Sardaigne et de Sicile (sous le nom de Jean Ier), comte de Barcelone, de Roussillon et de Cerdagne entre 1458 et 1479.
► 1474 L'imprimeur anglais William Caxton publie à Bruges le premier livre imprimé en anglais. William Caxton (v. 1422 dans le comté de Kent - v. 1491) imprimeur anglais. Après avoir séjourné quelque temps en Hollande, et y avoir fait le commerce avec succès, il y apprit l'art d'imprimer, et l'introduisit en Angleterre vers 1472; il publia en 1474 son premier livre, le 'Jeu d'échecs moralisé' (en anglais) ; il donna en 1481 le 'Miroir du Monde', avec gravures. Ses éditions sont fort recherchées des bibliophiles.
► 1475 à 1477 - Louis XI se donne tout entier à la lutte contre la féodalité. Prenant acte de l'hostilité que lui ont témoignée la plupart de ses grands chefs et des perfidies dont, il faut bien le dire, ils s'étaient rendus coupables envers lui, Louis XI fait agir contre eux, selon le cas, son Parlement ou ses troupes, et leur fait expier les actes qu'il leur reproche.
Ainsi périssent le duc d'Alençon (Jean II d'Alençon), et son fils le comte d'Armagnac (René d'Alençon), le comte de Saint-Pol (Louis de Luxembourg-Saint-Pol), le duc de Nemours (Jacques d'Armagnac-Nemours). Leurs domaines, confisqués, sont incorporés au domaine royal. La féodalité est ainsi décapitée, et l'unité territoriale de la France presque réalisée.
► 1475 juin Échec de Charles le Téméraire devant Cologne.
► 475 Alliance entre Frédéric III du Saint-Empire et Louis XI.
► 1475 juin Édouard IV d'Angleterre débarque à Calais.
► 1475 - 29 août Rencontre de Picquigny entre Louis XI et Édouard IV d'Angleterre. 1er document officiel mettant fin à la guerre de Cent ans. Le traité de Picquigny est signé à Picquigny (actuellement, département de la Somme) le 29 août 1475 entre Louis XI et Édouard IV. Il met définitivement fin à la Guerre de Cent Ans qui s'était "endormie" en 1453 après la Bataille de Castillon.
Édouard IV, contre une somme de 75 000 couronnes d'or et une pension annuelle de 50 000 couronnes d'or, retournait en Angleterre avec son armée et renonça à son alliance avec le duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Ce traité contenta les deux parties: Édouard IV d'Angleterre prétendit recevoir ainsi un tribut de la France, tandis que Louis XI de France affirmait fournir une pension à son sujet le roi d'Angleterre. Grâce aux talents de négociateurs de Louis XI, l'invasion anglaise se termine sans aucune victime et les deux armées festoient ensemble pendant toute une journée dans la campagne de Picquigny.
► 1475 - 13 septembre Trève de Soleuvre entre Charles le Téméraire et Louis XI.
► 1475 - 29 septembre Paix de Senlis entre Louis XI et François II de Bretagne.
► 1475 - 19 décembre Exécution du connétable de France, Louis de Luxembourg, pour trahison. Supplice du connétable de Saint-Pol. Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, fut connétable de France, sous le règne de Louis XI, dans un temps de troubles continuels. Général de Louis XI par sa place, il traitait par esprit d'intrigue avec tous les partis. Il voulait se rendre indépendant, et jouer un rôle principal au milieu des troubles. Il s'était emparé de Saint-Quentin au nom du roi, et le gardait pour lui-même.
Fier de la possession de cette importante place, qu'il promettait tour à tour de remettre au roi de France, au roi d'Angleterre, au duc de Bourgogne, il se faisait rechercher et redouter de tous ces princes. Louis XI, dans une entrevue avec le roi d'Angleterre, Édouard IV d'Angleterre, sur le mont de Picquigny, eut l'adresse de tirer de lui les instructions dont il avait besoin sur les projets et les démarches du connétable : celui-ci n'avait fait que les trahir tous deux. Édouard l'abandonna sans peine, et le duc de Bourgogne, instruit à son tour par les deux rois, des fourberies du connétable, le livra lui-même à Louis XI, qui lui fit trancher ce jour la tête à Paris, place de Grève.
► 1475 à 1564 - naissance et mort de Michel-Ange. Sculpteur, architecte, peintre et poète italien. Michelangelo Buonarotti, dit Michel-Ange, fut au même titre que Léonard de Vinci une légende de l'histoire de l'art, un génie de la Renaissance qui influença ses contemporains et de nombreux artistes bien après sa mort survenue en 1564 à l'âge canonique de 89 ans. Michel-Ange, qui fut également ingénieur militaire et poète, se révéla comme la véritable incarnation de la Renaissance et de l'humanisme qu'elle engendra.
Plus que tout autre grande figure de l'histoire de l'art, il s'affirma comme un artiste au talent colossal, incomparable comme sculpteur, extraordinaire dans la mise en scène, étonnant comme dessinateur et comme peintre. On considère aujourd'hui que Michel-Ange, qui était également un fin lettré, n'eut pour rival que Léonard de Vinci, qui produisit cependant peu d'oeuvres, pour lui contester sa place de plus grand génie de l'histoire de l'art. Plus encore que tout autre géant de la peinture, cet artiste, à la fois patriote, indépendant, orgueilleux, irascible, exigeant et inflexible, fut le premier depuis l'antiquité à glorifier l'homme avec une audace extraordinaire, bousculant ainsi de nombreux principes en matière de représentation picturale et marquant profondément son époque de son empreinte.
► 1475 Jean Fouquet peintre du roi, il illustrera les 'Grandes chroniques de France et les Antiquités judaïques'.
► 1476 - 2 mars : Bataille de Grandson, victoire des Suisses sur Charles le Téméraire. Bataille de Grandson, en 1475, les Suisses s'étaient emparés de la place de Grandson. Au matin du 2 mars, des éclaireurs suisses attaquent un camp avancé bourguignon déclenchant la bataille.
► 1476 - 22 juin Défaite de Charles le Téméraire contre les Suisses à Morat. La bataille de Morat est une victoire des Suisses, alliés de Louis XI de France, sur Charles le Téméraire, le 22 juin 1476. Bataille de Morat. Conflit opposant les Suisses et le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire.
Ce dernier, vaincu une première fois à Grandson, reconstitue son armée et marche sur Berne. Arrêté à Morat par une garnison petite mais tenace, il est définitivement vaincu à l'arrivée des renforts suisses. De cette défaite meurtrière et cuisante, Charles le Téméraire ne se remettra jamais. Il meurt quelques mois plus tard.
► 1477 - 5 janvier Mort de Charles le Téméraire devant Nancy. Le corps du duc de Bourgogne, nu, percé de deux coups de pique, défiguré par les loups, n'est retrouvé que trois jours après la bataille de Nancy, enfoui sous la neige.
► 1477 à 1482 - A la mort de Charles le Téméraire qui ne laisse qu'une fille, Marie de Bourgogne, Louis XI essaye de mettre la main sur les possessions du duc. Pour y parvenir, il affiche le projet de marier Marie, qui a vingt ans, avec le dauphin, son fils (futur Charles VIII), qui en a huit: d'ailleurs il fait envahir les États de Bourgogne par ses troupes, dont les exactions mécontentent les populations. Pour se débarrasser de ses prétentions, Marie donne sa main à l'archiduc Maximilien Ier du Saint-Empire.
Celui-ci prend les armes pour recouvrer l'héritage de sa femme. En 1479, il gagne sur les Français la bataille de Guinegatte; l'Artois se révolte contre Louis XI, mais ce mouvement est vite réprimé. Une révolte des Flamands arrive à point pour empêcher Maximilien de pousser les hostilités contre le roi de France ; l'archiduc est amené à signer le traité d'Arras (en 1482) qui donne à la France, l'Artois, les villes de la Somme et le duché de Bourgogne.
Les Pays-Bas restent à la maison d'Autriche et sont attribués au fils de Maximilien et de Marie (qui entre temps est morte prématurément) : Philippe le Beau (lequel sera le père de Charles Quint). Philippe Ier de Castille, le Beau (22 juillet 1478 à Bruges, Belgique - 25 septembre 1506), roi de Castille et de Leon, fils de l'empereur germanique Maximilien Ier du Saint-Empire, et époux de Jeanne la Folle, fille de Ferdinand et Isabelle, fut le fondateur de la dynastie Habsbourg en Espagne.
► 1477 - 18 août Les Pays-Bas sous les Habsbourg. Mariage de la fille de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne, avec le fils de Frédéric III du Saint-Empire, Maximilien Ier du Saint-Empire. Fille et héritière de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne épouse Maximilien de Habsbourg (futur Maximilien Ier du Saint-Empire), auquel reviendront les Pays-Bas et donc, les terres de la future Belgique. Plus tard, Charles Quint, leur petit-fils héritier, y ajoutera de nouveaux territoires, donnant naissance aux Dix-Sept Provinces unies des Pays-Bas.
Marie de Bourgogne, née à Bruxelles le 13 février 1457, décédée en Flandre en 1482, princesse de la branche bourguignonne de la dynastie capétienne fut duchesse de Bourgogne (1477-1482), comtesse de Bourgogne (1477-1482) (et autres titres). Maximilien Ier du Saint-Empire, Maximilien Ier de Habsbourg, (°22 mars 1459 à Wiener Neustadt, †12 janvier 1519 à Wels fut empereur romain germanique de 1508 à sa mort. Fils de l'empereur Frédéric III du Saint-Empire et d'Aliénor du Portugal, il épouse l'héritière de la Bourgogne, la duchesse Marie, seule enfant de Charles le Téméraire.
Par ce mariage Maximilien obtint les Pays-Bas bourguignons et la Franche-Comté, pendant que la France prit la Bourgogne. Les Dix-sept Provinces, elles désignent les territoires relevant aujourd'hui principalement de la Belgique, du Luxembourg, du Nord de la France et des Pays-Bas actuels, qui, du XIVe siècle au XVIe siècle appartenaient aux ducs de Bourgogne.
► 1477 à 1528 - naissance et mort de Giorgione, peintre italien. Giorgione est le nom familier de Giorgio Barbarelli da Castelfranco, un peintre vénitien. Il était l'une des figures les plus importantes de la haute Renaissance vénitienne. Giorgione est connu pour la qualité romantique de son travail, et pour le fait que très peu de peintures (autour de six) soient reconnues comme étant de sa main.
Il ne signait pas ses oeuvres. À sa mort soudaine de la peste, il a probablement laissé quelques travaux non finis, qui ont pu avoir été terminés par ses élèves Titien ou Sebastiano del Piombo. L'incertitude résultante de la difficulté à identifier ses oeuvres et de la signification de son art a fait de Giorgione la figure la plus mystérieuse dans la peinture occidentale.
► 1477 Dislocation des territoires de Charles le Téméraire, annexion de la Bourgogne.
► 1478 Ivan III de Russie réunit Novgorod à l'état moscovite. De nombreuses familles sont exilées. Ivan III confisque le patrimoine des boyards de Novgorod et leur concède le bénéfice de terres (pomestie) dans la région de Moscou en échange de leurs services militaires et de leur loyauté. Ivan III de Russie (22 janvier 1440-27 octobre 1505), grand prince de Vladimir et de Moscou de 1462 à 1505. Fils de Vassili II. Il épouse Zoé (Sophie Paléologue). Il est le père de Vassili III (1479-1533), André (1490-1533), Youri (1480-1533).
Son règne est important car il marque une étape cruciale de l'unification de l'État russe. C'est sur les marches de la cathédrale de l'Assomption que Ivan III déchira le traité qui soumettait Moscou au pouvoir Mongol et déclara ainsi l'indépendance de la Russie. Novgorod, est une cité du nord-ouest de la Russie, située sur le fleuve Volkhov, à six Kms du lac Ilmen.
► 1478 Sandro Botticelli peint 'le Printemps’
► 1478 - 26 avril La conjuration des Pazzi. Une échauffourée dans la cathé-drale de Florence, pendant la messe, se solde par la mort de Julien de Médicis. Les frères Médicis, Julien 25 ans et Laurent 29 ans, dirigent la République de Florence. La famille rivale des Pazzi, mécontente d'avoir été privée de certaines fonctions rémunératrices, organise la conspiration avec le soutien du pape Sixte IV. Laurent de Médicis qui en réchappe gagnera le soutien du peuple et fera pendre les conspirateurs aux fenêtres de son palais.
Laurent de Médicis dit aussi Laurent Le Magnifique, Lorenzo di Piero de' Medici fut un homme d'État italien et le dirigeant de facto de la république florentine durant la Renaissance italienne. Laurent le Magnifique, fut un grand mécène. Il accueillit par exemple Michel-Ange à ses débuts, fasciné par ses sculptures à l'antique. Il mourut en 1492, provoquant deux ans plus tard la chute (provisoire) de la famille Médicis. Sa mort marque également la fin des succès artistiques de Florence, période dite première Renaissance. Les Médicis (Medici en italien) est une puissante famille florentine de la Renaissance italienne entre les XVe siècle et XVIIIe siècle; leur pouvoir se consolide aux Quattrocento et Cinquecento.
Leur richesse, leur pouvoir et leur influence proviennent initialement du commerce et de la transformation de la laine et de leur action au sein de la guilde des lainiers Arte della Lana. D'abord banquiers, puis politiciens, membres du clergé et nobles, les Médicis ont atteint leur prééminence la plus grande comme figures de premier plan de Florence autant que d'Italie, et d'Europe. La famille donna 3 papes, un grand-duc à la Toscane, et 2 reines à la France. La famille de Médicis compta jusqu'à dix filiales bancaires: à Venise, Rome, Naples, Milan, Pise, Genève, Lyon, Avignon, Bruges et Londres. En 1378, Salvestro propose une réforme démocratique, attirant la sympathie du petit peuple pour sa famille. La branche aînée descend de Pierre Ier de Médicis et Laurent le Magnifique, son fils pour s'achever par l'assassinat d'Alexandre le Maure en 1537.
Le pouvoir passa alors à la branche cadette descendant de Laurent l'Ancien, alors représentée par Cosme Ier de Médicis qui accède au pouvoir en 1537. La ligne directe mâle de la descendance s'est éteinte en 1737. Dans les Arts, Les Médicis étaient une dynastie adepte du mécénat et du collectionnisme; la dernière des Médicis légua sa collection à la ville de Florence, sous la condition que les trésors restent dans la ville, ce qui la transforma en une gloire du Monde, regroupant plus de 50 musées. L'histoire de la Maison des Médicis a le mérite d'être riche et complexe mais le bilan que l'on dresse de la famille florentine doit être nuancé.
► 1479 - 7 août Défaite de Louis XI face à Frédéric III du Saint-Empire à Guinegatte. Maximilien Ier du Saint-Empire veut récupérer l'héritage de sa femme, Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, mort à Nancy le 5 janvier 1482. Les troupes du roi de France sont défaites. Ce que les armes ne lui permettent pas d'obtenir en ce jour, la rouerie du roi le lui accordera trois ans plus tard.
► 1480 - 10 juillet Mort de René d'Anjou. l'Anjou passe au domaine royal.
► 1480 La Provence échoit au futur Charles VIII (avec l'héritage italien, Naples notamment)
►1480 Domenico Ghirlandaio peint 'La dernière cène'. Domenico Ghirlandaio est un peintre italien, né à Florence (1449-1494), il entrera dans l'atelier du peintre Baldovinetti, plus tard avec l'aide de ses frères il formera son propre atelier repris par son frère David, à sa mort dans lequel Michel-Ange étudiera. Bien que très attaché aux exigences de son métier, il saura y ajouter une part de sensibilité qui rendra son art unique.
► 1481 Entre temps, Louis XI a hérité des possessions du duc d'Anjou, René, qui lui a volontairement légué l'Anjou, le Maine, la Provence. Louis XI règne maintenant sur un vaste royaume d'un seul tenant. La Lorraine ainsi que les droits sur le royaume de Naples restent à René II de Lorraine, petit-fils du duc d'Anjou. René II de Lorraine, né en 1451, fut duc de Lorraine et de Bar. Le fils de Ferry II de Vaudémont et de Yolande d'Anjou, la fille du roi René, devient duc de Lorraine en 1473.
► 1482 Le prédicateur Savonarole sème l'agitation dans Florence par une vive critique des moeurs de ses contemporains. Jérôme Savonarole, en italien Girolamo Savonarola, né à Ferrare, le 21 ou le 24 septembre 1452 et mort sur le bûcher à Florence, le 23 mai 1498, est un frère dominicain et prédicateur italien, qui dirige Florence de 1494 à 1498.
Également appelé Hieronymus Savonarola ou encore Girolamo Savonarole, il est connu pour ses réformes religieuses, ses prêches anti-Renaissance, son bûcher des vanités où disparurent de nombreuses oeuvres d'art. Il prêcha de façon véhémente contre la corruption morale du clergé, ce qui en fait un des précurseurs de la Réforme protestante, bien qu'il soit resté catholique romain toute sa vie ; les Florentins lui rendent un culte, à l'égal d'un saint.
► 1482 - 27 mars Mort de Marie de Bourgogne.
► 1482 - 23 décembre Traité d'Arras entre Frédéric III du Saint-Empire et Louis XI qui récupère la Picardie et la Bourgogne. Le roi de France et l'empereur d'Autriche signent le traité d'Arras. Il stipule que les duchés de Bourgogne et de Picardie reviennent à Louis XI et prévoit l'union du dauphin Charles VIII avec la fille de Maximilien Ier du Saint-Empire, Marguerite d'Autriche. Par cette union, l'Autriche apportera en dot la Franche-Comté et l'Artois.
Le traité d'Arras a été conclu le 23 décembre 1482 et concerne le partage de l'État bourguignon, à la mort de Marie de Bourgogne, entre Louis XI et Maximilien de Habsbourg (futur Maximilien Ier du Saint Empire). Le roi de France garde la Bourgogne et la Picardie, qu'il a fait occuper dès janvier 1477. Maximilien garde les Pays-Bas. La fille de Maximilien et de Marie de Bourgogne, Marguerite d'Autriche (1480-1530), est promise en mariage au futur Charles VIII. Le mariage ne sera pas célébré car Charles épousera Anne de Bretagne, et le traité de Senlis de 1493 rendra au Habsbourg l'Artois et la Franche-Comté.
► 1483 - 30 août Mort de Louis XI. Une hémorragie cérébrale emporte le roi, âgé de soixante ans, à Plessis-lez-Tours. La mort lui faisait depuis si longtemps peur qu'il avait interdit que le mot “mort” soit seulement prononcé et qu'il s'était entouré de reliques, espérant qu'elles seraient en mesure de repousser la fatale échéance. A son chapelain qui priait pour le salut de son âme comme pour son rétablissement, le roi ordonna : “N'en demandez pas tant. Vous troublez le saint.
Priez seulement pour la santé du corps”. Il voulut enfin qu'on lui annonça l'imminence de la mort par ces seuls mots : “Parlez peu”. - L'histoire a gardé le souvenir de ses fourberies et on peut dire aussi de ses crimes ; mais elle lui tient compte de son patriotisme inlassable. Si ce roi montra peu de scrupules dans la poursuite de ses desseins, peu d'honnêteté dans sa manière de gouverner, on doit reconnaître que tous ses actes eurent pour but la consolidation du pouvoir royal et l'extension du domaine de la couronne, c'est-à-dire la grandeur de la France.
Peu estimable comme homme, il n'en fut pas moins un grand roi par ses conceptions politiques et les conséquences de leur réalisation. Louis XI créa les parlements de Bordeaux et de Dijon. Il encouragea le commerce et facilita l'accès de la France aux négociants étrangers ; il améliora les routes, établit les premières postes (qui, à vrai dire, ne servirent d'abord qu'à la transmission de ses ordres) ; il favorisa l'établissement de l'imprimerie à Paris et grâce à lui se fondèrent, à Tours, les premières manufactures de soieries.
► 1483 CHARLES VIII l'Affable (1483-1498)
► 1483 Charles VIII. Lorsque Louis XI meurt en 1483, Charles VIII n'a que 13 ans, selon la volonté de Louis XI c'est Anne, sa soeur, agée de 23 ans mariée à Pierre de Beaujeu duc de Bourbon qui assurera la régence. Anne de Beaujeu (Anne de France) doit affronter une révolte du duc Louis II d'Orléans (futur Louis XII) allié aux barons bretons : "la guerre folle", la victoire des troupes royales conduites par Louis II de la Trémoille à Saint-Aubin-du-Cormier (au cours de la bataille, François II de Bretagne, partisan de l'indépendance, meurt) puis le traité du Verger en 1488 y mettent fin.
Louis II d'Orléans est emprisonné. Elle arrange le mariage de son frère avec Anne de Bretagne (fille de François II) celle-ci étant promise à Maximilien Ier du Saint-Empire, elle doit négocier. Maximilien était veuf de Marie de Bourgogne, il avait donc hérité d'une partie de la maison de Bourgogne, une alliance avec la Bretagne eut été dangereuse pour la France prise en tenaille. Le contrat de mariage prévoit que si l'union reste stérile, Anne devra épouser le prochain roi. Charles VIII met fin à la régence de sa soeur en 1491 il a 21 ans et, nourri de récits de chevalerie, il ne rêve que d'expéditions lointaines et de croisades contre les Turcs.
Il libère Louis II d'Orléans et lui accorde son pardon. Il voulu faire valoir ses droits, qui avaient été légués par la maison d'Anjou au roi de France, sur le royaume de Naples. Il entreprend une expédition qui le mène jusqu'à Naples sans grandes difficultés, Louis II d'Orléans (Louis XII) commande son armée et le chevalier Bayard est à son service. Rapidement, il se heurte à une ligue formée de Ferdinand d'Aragon, le pape Alexandre VI, Milan et Venise. Il doit abandonner ses conquêtes napolitaines et parvient difficilement à s'ouvrir la route du retour en France par la victoire de Fornoue en juillet 1495 où Bayard se distingue par sa bravoure.
Ce sera la fin de ses rêves italiens mais déjà, ils auront permis aux Français de découvrir les lumières d'Italie et d'accueillir les courants artistiques de la renaissance italienne. Charles VIII meurt peu après son retour en se heurtant la tête au linteau d'une porte basse du château d'Amboise en 1498, il n'a pas de descendant mâle, son fils Charles-Orland étant mort de la rougeole à 3 ans et les autres morts à la naissance. C'est son cousin Louis II d'Orléans qui prendra la succession et qui épousera Anne de Bretagne. Ce qui met fin à la branche des Capétiens Valois direct.
► 1483 Avènement de Charles VIII; âgé seulement de treize ans et d'ailleurs débile et maladif, il est trop jeune pour régner. Selon le voeu de Louis XI, la tutelle du jeune prince et la régence seront exercées par sa soeur aînée Anne, mariée au sire de Beaujeu. Cette princesse, douée d'une haute raison et de brillantes qualités, tout entière à ses devoirs, a laissé un grand renom dans l'Histoire. Cependant, les seigneurs que Louis XI avait tenus en respect, jugent le moment propice pour renverser l'oeuvre du feu roi, reconquérir leurs privilèges perdus et imposer l'un d'eux comme régent: une ère de troubles se prépare.
Anne de Beaujeu réunit les États généraux pour la première fois au grand complet (paysans compris). Elle fait régler la question de la régence, de manière que Louis II, duc d'Orléans (futur Louis XII), dont on doit redouter la frivolité, en soit exclu, et elle se fait attribuer, à défaut du titre, les pouvoirs de régente; enfin, elle obtient d'eux les subsides nécessaires pour faire face à l'orage qui menace.
► 1483 - 14 mai Sacre de Charles VIII.
► 1483 à 1520 - naissance et mort de Raphaël. Peintre et architecte italien. Formé par le Pérugin, Raffaello Sanzio - dit Raphaël - se fait connaître grâce à l'exécution de commandes de Jules II, et notamment grâce à la décoration des Chambres et de la galerie des Loges du Vatican. Ses compositions comme ses madones surprennent par leur équilibre et la pureté de leurs lignes. Citons à ce titre 'La belle jardinière' exposée au Louvre, ou encore la 'Madone à la chaise' de Florence. Architecte, il réalise les plans du palais Pandolfini ; dessinateur, il trace une histoire de Psyché et fournit les cartons pour les tapisseries des Actes des Apôtres.
Les oeuvres de Raphaël frappent les esprits de ses contemporains et ont largement influencé la production artistique occidentale des siècles suivants. La mesure et la grâce de ses tableaux - ce rapprochement qu'il effectue entre amour terrestre et amour céleste - ont ainsi été érigées en canons académiques dans la sphère artistique. Raphaël au nom d'ange, beau comme un ange, peint des anges, comme les célèbres anges rêveurs de "La Vierge Sixtine" (1512), abondamment reproduits. Il décore les chambres privées de Jules II au Vatican, devient son peintre officiel puis architecte en chef de la basilique Saint-Pierre.
► 1483 à 1546 - naissance et mort de Martin Luther. Théologien et réformateur allemand. Moine augustin (ordre mendiant) du couvent de Wittenberg en Saxe, Martin Luther fait l'expérience d'une libération intérieure vis à vis de ses angoisses de salut, à la lecture de Saint Paul et de Saint Augustin, et acquiert la conviction que seule la foi peut rendre l'homme juste et le sauver. "Jusqu'au jour où je compris enfin que la justice de Dieu, c'est celle par laquelle Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous justifie par la foi" (Préface de Luther). Cette prise de position publiquement affichée en 1517 lui vaut d'être excommunié en 1521 par le pape Léon X.
Ses idées se diffusent en Allemagne et seront encouragées par de nombreux princes : elles coïncident avec la prise de conscience de l'identité nationale. La protestation des princes en 1520 contre un compromis signé par Charles Quint vaudra à ce mouvement le nom de protestantisme. Le luthéranisme est la théologie fondée à partir des écrits et des pensées de Martin Luther. C'est ensuite devenu le regroupement des Églises protestantes luthériennes se rattachant à cette doctrine. C'est pourquoi, on parle de luthérien, d'Églises luthériennes ou de théologie luthérienne.
Il est à noter que la théologie de Luther est le bien commun de l'ensemble de la Réforme protestante. Il existe par ailleurs des courants théologiques se référant plus spécialement à lui, y compris dans les Églises réformées. Luthériens. Adeptes de la doctrine religieuse du réformateur Martin Luther (1483-1546). Les luthériens sont des protestants qui reconnaissent la Bible comme seul guide et autorité en matière de foi. Ils n'acceptent que le baptême et l'eucharistie comme sacrement et critiquent sévèrement le clergé et sa hiérarchie.
► 1484 - 15 janvier Ouverture des États Généraux à Tours (jusqu'au 14 mars). Anne de Beaujeu, régente du royaume, réunit les États généraux au grand complet, paysans compris. Elle fait débouter Louis II d'Orléans, de ses prétentions à la régence et obtient les subsides dont elle a besoin. Les états généraux de 1484 sont convoqués par la régente Anne de Beaujeu à Tours, afin de désigner qui doit occuper la régence après la mort de Louis XI (30 août 1483) et pendant la minorité de Charles VIII. Bien que le roi défunt l'ait désignée, elle et son mari Pierre de Beaujeu, le successeur de Charles VIII, Louis II d'Orléans, lui conteste ce titre. La convocation des États généraux est une première victoire pour le prince.
► 1484 à 1531 - naissance et mort de Huldrych Zwingli. Réformateur religieux suisse. Dès 1516, il se plonge dans le texte grec du Nouveau testament qu'Érasme vient de publier. Il y découvre que la bonne nouvelle est la miséricorde. Devenu curé de la collégiale de Zurich (1519), à la suite d'une recherche personnelle devient un Réformateur et expose sa pensée en soixante sept thèses, reconnaissant la Bible comme seul fondement de la loi et rejetant l'autorité de Rome dont il critique la corruption.
Sa réforme s'appuie sur une étude systématique de la Bible qu'il lit avec les méthodes humanistes. Il reconnaît en Luther un esprit voisin du sien tout en gardant son originalité. Les paroissiens et le conseil de Zurich prennent son parti et Zwingli entreprend la réforme de la ville (1522). Il se marie (1524) et abolit la messe (1525). Il développe ses positions sociales dans La justice divine et de la justice humaine.
► 1484 Sandro Botticelli peint 'La naissance de Venus’
► 1485 - 22 août : Le roi d'Angleterre, l'impopulaire Richard III d'Angleterre est tué à la bataille de Bosworth ; sa mort et la défaite de son camp met fin à la Guerre des Deux-Roses, et a pour conséquence l'avènement de Henri VII d'Angleterre, qui consacre la victoire des Tudor. (fin du règne en 1509).
► 1485 - 22 septembre Création du parlement de Rennes par François II de Bretagne. Informé du fonctionnement des structures administratives d'un grand état comme la France, il obtient finalement du Saint-Siège la création de l'Université de Nantes dans les années 1460, donnant ainsi à la Bretagne le moyen de former ses prélats, officiers, cadres et magistrats à la maison. Suite logique, il transforme en 1485 la "Cour de interlocutoires" et les sessions saisonnières de justice des États en un Parlement sédentarisé à Vannes. Cette cour de justice étant souveraine, aucun appel au Parlement de Paris ne sera plus possible.
► 1485 à 1488 - Le duc d'Orléans, futur Louis XII, s'associe avec le duc de Bretagne, François II, et quelques seigneurs mécontents, et prend les armes en 1485, puis en 1487 contre la régente, mais ces tentatives, quoique vivement poussées, n'ont aucun résultat. Anne de Beaujeu a confié le commandement de l'armée royale à Louis II de la Trémoille. Celui-ci conduit énergiquement la guerre. En 1488, il bat les alliés, et fait le duc d'Orléans prisonnier à Saint-Aubin-du-Cormier. Le duc de Bretagne, François II, est obligé de signer le traité de Sablé. On a appelé cette guerre la guerre folle, à cause de l'imprudence que montrèrent les seigneurs en s'attaquant au pouvoir royal déjà assez fort pour résister à toute révolte.
Guerre folle, c'est en 1485 que commence la Guerre folle qui oppose Louis II d'Orléans (futur Louis XII de France) et François II de Bretagne à la régente d'Anne de Beaujeu après la mort de Louis XI et en attendant la majorité de Charles VIII. Au départ simple révolte contre l'autorité royale, elle met fin à l'ébauche d'État indépendant en Bretagne. Les premiers sont battus à Saint-Aubin-du-Cormier le 28 juillet 1488, ce qui met fin à la guerre. Louis II d'Orléans est enfermé en forteresse puis gracié par Charles VIII à sa majorité, trois ans plus tard.
La Guerre folle oppose à la fin du Moyen Âge une coalition de princes apanagistes et féodaux à Anne de Beaujeu, régente après la mort de Louis XI et en attendant la majorité du jeune roi Charles VIII. Elle commence en 1485 et se termine en 1488. Du côté des princes, on trouve le cousin du roi Louis II d'Orléans – futur Louis XII de France -, le duc René II de Lorraine, François II de Bretagne, Alain d'Albret, Jean de Châlon, prince d'Orange, le comte Charles d'Angoulême.
Jean de Lescun, bâtard d'Armagnac, comte de Comminges et gouverneur de Guyenne, et Commines, soutiennent la révolte de leurs conseils. Enfin, cette révolte contre l'autorité royale est soutenue par les ennemis étrangers du roi de France, Angleterre, Espagne et Autriche, et elle est à l'origine de la fin de l'indépendance de la Bretagne. Louis II de la Trémoille, ou de La Trimouille, né à Bommiers le 29 septembre 1460, mort à Pavie en 1525, est un homme d'État et un chef de guerre français de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance, qui a servi les rois Charles VIII, Louis XII et François Ier.
► 1486 Invasion autrichienne stoppée en Picardie.
► 1487 février Soulèvement en Guyenne.
► 1488 - 28 juillet Défaite de François II de Bretagne et Louis II d'Orléans à Saint-Aubin-du-Cormier par l'armée royale. La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier a lieu le 28 juillet 1488 entre d'une part, les troupes du roi de France, et d'autre part, celles du duc de Bretagne François II de Bretagne et de ses alliés.
La défaite de ces derniers clôt la guerre folle, guerre féodale qui voit quelques princes français profiter d'une période de régence pour se révolter contre la puissance royale, défendue par la régente Anne de Beaujeu pour son frère mineur Charles VIII. Bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Épisode de la Guerre folle (révolte de nobles contre la régence d'Anne de France), où Louis II de Louis II de la Trémoille l'emporte sur François II de Bretagne et le duc d'Orléans (futur Louis XII).
► 1488 - 20 août Traité du verger ou de Sablé marquant la soumission de François II. Le Traité du Verger, le traité de Sablé dit "traité du Verger" est signé par Charles VIII de France, et François II de Bretagne le 19 août 1488. Il stipule que l'héritière du duché ne peut se marier sans l'accord du roi de France. Louis XI avait mené une politique visant à soumettre la noblesse agitée du royaume, dont le duc de Bretagne, et d'éviter un encerclement de la France par la réunion de la Bretagne à l'Ouest et des possessions bourguignonnes à l'Est.
À sa mort, c'est Anne de Beaujeu qui tient la régence. Les grands féodaux du royaume tentent de profiter de cette période de supposée faiblesse de la royauté pour récupérer ses prérogatives et déclenchent la guerre folle en 1485. En 1487, l'armée royale entame sa marche vers l'ouest, elle est accueillie favorablement à Châteaubriant, Vitré, Ancenis et Clisson, toutes villes acquises au parti français. Ploërmel, fidèle au duc est saccagée par la troupe qui compte jusqu'à 12 000 hommes. Nantes est assiégée, mais des Bretons de Cornouaille aidés de mercenaires étrangers, brisent l'encerclement ; Vannes est libérée en mars 1488.
La guerre se poursuit avec notamment la prise de Fougères par les troupes royales, jusqu'à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier près de Rennes, le 28 juillet, où 6 000 soldats du parti princier trouvent la mort, contre 1 500 morts pour leurs ennemis conduits par Louis II de la Trémoille. Louis II d'Orléans, futur Louis XII, qui avait pris parti pour les révoltés, est également fait prisonnier.
Le 19 août 1488, c'est la signature du traité du Verger, à Sablé-sur-Sarthe, non loin d'Angers. Le duc de Bretagne, François II doit l'hommage lige au roi de France et consent l'appel des cours de justice au Parlement de Paris. En outre, il ne peut marier sa fille sans l'accord de Charles VIII. Le 9 septembre, François II fait une chute de cheval mortelle. Sa fille, Anne lui succède. Elle décide d'épouser Maximilien Ier du Saint-Empire ; la cérémonie a lieu par procuration en décembre 1490 en violation du traité.
► 1488 - 9 septembre Mort de François II de Bretagne, sa fille, Anne de Bretagne, lui succède. Anne de Bretagne, née le 25 janvier 1477 (1476 ancien calendrier) à Nantes, morte le 9 janvier 1514 à Blois, est duchesse de Bretagne, de 1488 à 1514 et, par mariages successifs, archiduchesse d'Autriche et reine de Romains (1490-1491), reine de France (1491-1498) et reine de Sicile et de Jérusalem dans la foulée, puis de nouveau reine de France (1499-1514) et duchesse de Milan.
► 1488 à 1576 : naissance et mort de Le Titien. Peintre et graveur italien. Comme chez tous les grands maîtres italiens (Raphaël, Michel-Ange...), c'est le prénom du peintre qui a été retenu pour le dénommer et non son nom de famille. Le Titien est né à côté de Venise (sur la terre ferme et non dans la lagune), autour de 1488. Il est mort à environ 90 ans. Sa carrière est indissociable de la ville de Venise, alors à son apogée. Issu d'une famille de notables, il reçoit tout d'abord une formation chez un mosaïste. Il entre ensuite dans l'atelier des Bellini.
Le père, Jacopo, est un peintre et théoricien, qui a introduit à Venise la perspective découverte à Florence. L'atelier appartient à son fils aîné, Gentile, mais Titien s'inspire surtout du plus talentueux des trois fils, Giovanni, qui accorde, dans sa peinture, la primauté à la couleur. Enfin, le Titien reçoit une dernière influence, celle de Giorgione (mort en 1510), qui établit dans ses oeuvres une sorte de synthèse entre les clair-obscur de Vinci et la couleur de Bellini.
► 1489 Philippe de Commynes écrit 'Mémoires' (1489-1498)
► 1489 Impression des 'Testaments' du poète français François Villon, une des premières oeuvres imprimées en France.
► 1490 - 19 décembre Anne de Bretagne épouse Maximilien Ier du Saint Empire par procuration.
► 1490 Après la mort du duc de Bretagne, François II - Il ne laisse qu'une fille, Anne de Bretagne, qui est promise à Maximilien Ier du Saint Empire (veuf de Marie de Bourgogne). Mais celui-ci ne se presse pas de réaliser ce mariage. Charles VIII se rend en Bretagne, dont sa soeur a fait saisir entre temps les principales villes et se fait agréer pour époux par Anne, d'où résulte l'incorporation au royaume du duché de Bretagne.
► 1490 Geertgen Tot Sint Jans peint 'Saint Jean Baptiste dans le désert'. Geertgen Tot Sint, né à Leyde, dans ce nord des Pays-Bas qui devait plus tard devenir Hollande, Gérard de Saint-Jean (Geertgen tot Sint Jans) tire son nom de la confrérie de Saint-Jean, où il passa ses dernières années.
► 1490 - 28 décembre - Ordonnance de Moulins prescrit, article 101, que les dépositions des témoins soient faites 'en langage françois ou maternel': le choix linguistique est possible.
► 1491 - 20 mars Prise de Nantes par les troupes Royales.
► 1491 - 15 novembre Traité de Rennes, capitulation d'Anne de Bretagne à Rennes.
► 1491 - 6 décembre Mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne. Elle s'engage à se remarier avec son héritier s'il n'y a pas postérité. Anne est soucieuse de préserver l'indépendance de son duché. Elle a épousé par procuration Maximilien de Habsbourg (futur Maximilien Ier du Saint Empire) en 1490.
Mais ce mariage est intolérable à la couronne de France, qui oppose qu'avant de mourir François II de Bretagne a donné au roi de France un droit de regard sur le mariage de ses filles. Après le siège de Rennes par les troupes royales, Anne se résigne à épouser le roi de France Charles VIII. Par cette union, la Bretagne devient fief français, mais seulement en droit.
► 1492 à 1493 - Charles VIII se croyant appelé à une carrière militaire glorieuse projette de revendiquer les droits de la maison d'Anjou sur le royaume de Naples et, de là, de porter la guerre en Orient pour briser la puissance des Turcs et rétablir, à son profit, le trône de Jérusalem. Afin de se rendre les mains libres pour ces expéditions, il rétrocède, par le traité de Narbonne, le Roussillon à Ferdinand le Catholique (Ferdinand II d'Aragon) et, par le traité de Senlis (1493), la Franche-Comté et l'Artois à la maison d'Autriche.
Il convient de dire d'ailleurs que ces deux dernières provinces étaient réservées par le traité d'Arras, pour servir de dot à la fille de Maximilien (Marguerite), que Charles VIII devait épouser, et qui était élevée à la cour de France, mais qu'il renvoya pour se marier avec Anne de Bretagne. Ferdinand le Catholique, Ferdinand II d'Aragon, né le 10 mars 1452 (ou 10 mai ?) à Saragosse, mort le 23 juin 1516 à Madrigalejo, dit Ferdinand le Catholique, fut, par mariage, roi de Castille et Leon de 1474 à 1504 (sous le nom de Ferdinand V) puis, de son propre chef, roi d'Aragon, de Valence, de Majorque et de Sicile et comte de Barcelone de 1479 à 1516, comte de Roussillon et de Cerdagne de 1493 à 1516 et roi des Deux-Siciles en 1504.
Marguerite d'Autriche, archiduchesse d'Autriche, (née le 10 janvier 1480 à Bruxelles, morte le 1er décembre 1530 à Malines) était duchesse de Savoie et gouvernante des Pays-Bas. Elle était la seule fille de Marie de Bourgogne (1457-1482) et de l'empereur Maximilien Ier et la petite-fille du duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Marguerite fut fiancée en 1483 au dauphin, le futur roi Charles VIII de France, qui la renvoya en 1489, avant d'épouser deux ans plus tard la duchesse Anne de Bretagne.
► 1492 - 2 janvier Les Espagnols s'emparent de Grenade dernier bastion musulman en Espagne. L'Année cruciale est un terme employé de l'historiographie espagnole pour désigner le fameux an de grâce 1492. C'est l'année de la prise de Grenade en Andalousie. Cette année voit, en Espagne, la fin d'un processus de reconquête qui dura sept siècles, ce qui scelle son Moyen Âge. Ce même pays inaugure la même année la découverte d'un continent, sacrant la réunion de l'humanité au niveau mondial. 1492 projette donc le Royaume de Castille et ses alliés, "Les Espagnes", dans les temps modernes, à l'avant-scène européenne.
Pour affirmer son programme politique et démographique (Limpieza de sangre), la mainmise de l'Église catholique au travers de la mission de la Sainte Inquisition lui donne des pouvoirs obscurantistes, à la fois temporels et spirituels : les conséquences seront lourdes pour l'Espagne dans la compétition européenne du concert des nations; expulsion des Sépharades d'Espagne, certains vont contribuer à l'essor financier des Pays-Bas, alors sous domination espagnole, d'autres iront dans le Maghreb; expulsion des Morisques et des non convertis (conséquence ultérieure: 1502 ou 1525 selon leur localisation); autodafés des livres en arabe accumulés à Grenade, point focal de la Reconquista, par l'évêque nouvellement nommé : ce sont huit siècles de culture islamique qui partent en fumée, y compris des tomes retranscrits du grec ancien et provenant des textes des penseurs de l'Antiquité grecque. C'est aussi l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb au nom des rois chrétiens et du royaume d'Espagne, bien que à l'époque, il ne pensaient que seulement avoir découvert une nouvelle route vers les Indes.
► 1492 - 8 février Sacre d'Anne de Bretagne à Saint-Denis.
► 1492 - 31 mars : Décret d'Alhambra, portant l'expulsion des Juifs d'Espagne par les Rois Catholiques, Isabelle la Catholique et Ferdinand II d'Aragon, qui leur laissent jusqu'au 31 juillet pour se convertir au christianisme ou quitter le pays. 150 000 choisissent la conversion, 150 000 à 200 000 l'exil en Navarre, au Portugal, en Italie, en Afrique du Nord ou en Méditerranée orientale. Ce décret resta officiellement en vigueur jusqu'en 1967. Isabelle la Catholique, Isabelle Ière de Castille, dite Isabelle la Catholique, née le 22 avril 1451 à Madrigal de las Altas Torres, morte le 26 novembre 1504 à Medina del Campo, fut, de son propre chef, reine de Castille et Leon de 1474 à 1504 et, par mariage, reine d'Aragon, de Sicile et autres terres (1479-1504).
► 1492 mai Alliance de Charles VIII avec Ludovic Sforza, duc de Milan, contre le roi de Naples, Ferdinand le Catholique. Lodovico Sforza dit Ludovic le More (27. juillet, 1452 -27. mai, 1508), était un duc de Milan de la dynastie de Sforza de Milan, Italie. Il était le deuxième fils de François Ier Sforza et de Blanche-Marie Visconti, et était célèbre comme patron de Léonard de Vinci, Bramante et d'autres artistes.
► 1492 - 6 octobre Les Anglais assiègent Boulogne.
► 1492 11 octobre - Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Au bout de 65 jours de navigation, pendant lesquels il eut souvent à lutter contre les terreurs et l'insubordination de son équipage, il découvrit la terre, le 12 octobre 1492 : il croyait être parvenu aux extrémités orientales de l'Asie, ce qui fit donner à ces nouvelles contrées le nom d'Indes orientales. Il aborda d'abord dans une des Lucayes, qu'il appela San Salvador, découvrit ensuite Cuba et Haïti, à laquelle il donna le nom d'Hispaniola, et revint en Espagne en mars 1493.
Il fut nommé vice-roi des pays qu'il avait découverts. En septembre 1493, il entreprit un 2ème voyage, découvrit la plupart des Petites Antilles, soumit Haïti et y fonda la ville de Saint-Domingue (Haïti). Dans un 3ème voyage, exécuté en 1498, il découvrit le continent et parcourut la côte de l'Amérique méridionale depuis l'embouchure de l'Orénoque jusqu'à Caracas; enfin, dans une 4° et dernière expédition, en 1502, il poussa jusqu'au golfe de Darien (La Découverte de l'Amérique). Colomb eut plusieurs fois à réprimer des révoltes parmi ses compagnons; il eut aussi cruellement à souffrir de l'envie.
Accusé après son premier voyage par ceux qu'il avait châtiés, il les confondit aisément; mais pendant sa 3ème expédition, il devint la victime de la calomnie, fut dépouillé de son commandement, et remplacé par Bobadilla qui le renvoya en Espagne chargé de fers. Il obtint facilement sa liberté, mais il ne put recouvrer son crédit, et après son 4ème voyage, il se vit négligé par le roi Ferdinand. Il mourut en 1506, accablé d'infirmités et de chagrins.
► 1492 Arrivée de Christophe Colomb, parti de Palos le 3 août en compagnie des frères Martin et Vincent Pinzon à bord de la Pinta, de la Nina et de la Santa Maria. Le 12 octobre, ils atteignent l'île de Guanahani (Bahamas), baptisée San Salvador, puis les grandes Antilles, Cuba (28 octobre) et Haïti qu'ils appellent Juana et Espanola. A Haïti, ils laissent une garnison de 39 hommes au fort de Navidad construit le 25 décembre avec les débris de la Santa Maria échouée, avec pour mission de découvrir et d'entreposer l'or. Aux Bahamas, Colomb rencontre les Indiens Arawak.
Ils vivent dans des communautés villageoises et pratiquent la culture du maïs, de l'igname et du manioc. Ils savent filer et tisser mais ne connaissent pas le cheval et n'utilisent pas d'animaux pour le labour. Ils ignorent l'acier, mais portent de petits bijoux en or aux oreilles. Il les appelle les Indiens, car il voulait aller en Inde. Dès qu'il arrive, il envoie une lettre à son roi, disant "les gens d'ici sont bons à aller dans les mines ou pour aller couper du bois, ils ne demandent rien en échange, et ne mangent pas beaucoup."
► 1492 Les Grandes Découvertes. L'Espagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas et l'Angleterre forment des puissances économiques, maritimes et militaires qui recouvrent le globe. Colomb découvre l'Amérique en 1492. Le commerce maritime se déploie, les échanges entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique se multiplient. Dès les années 1500, les Européens partent à la conquête du monde à la recherche de nouvelles voies maritimes (Colomb, Vespucci, Magellan).
► 1492 Renaissance et Réforme (1492-1688). L'Europe décolle. Les historiens clôturent le Moyen Âge en 1453, avec la prise de Constantinople par les Turcs qui met fin au dernier vestige de l'empire romain, ou en 1492, avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. À ces dates-là, du Japon à l'Angleterre, tous les vieux pays sont à peu près au même niveau de développement économique. Par leur taille, les États chrétiens font piètre figure en regard des empires musulmans : l'empire ottoman, l'empire perse et le sultanat de Delhi.
Qui plus est, leur unité fondée sur la référence au catholicisme est brisée par la Réforme protestante. Mais l'Europe est saisie d'une telle effervescence intellectuelle, artistique et scientifique que très vite elle se distingue du reste du monde. Cette effervescence s'accompagne d'un retour aux modèles de l'Antiquité gréco-latine. C'est l'humanisme. L'époque a été pour cela qualifiée de Renaissance. Le terme, sous sa forme italienne Rinascita, est pour la première fois employé par le peintre Giorgio Vasari vers 1550 pour qualifier un mouvement littéraire et artistique.
Il est repris au XIXe siècle par l'historien suisse Jacob Burckhardt dans le titre d'un ouvrage : Civilisation de la Renaissance pour qualifier cette fois une époque historique, les XVe et XVIe siècles (mais des historiens contemporains considèrent cette définition très restrictive, estimant que depuis l'époque de Charlemagne jusqu'au siècle des Lumières, l'Europe est allée de "renaissance" en "renaissance"). L'Europe consolide son avance avec la colonisation de l'Amérique. C'est l'aboutissement d'un gigantesque effort de recherche et le début d'une prodigieuse aventure.
► 1492 La Renaissance. Aux XVe et XVIe, un puissant élan intellectuel s'étend à toute l'Europe. Des savants remettent en question les idées et les croyances traditionnelles (Copernic, Galilée, Léonard de Vinci, Érasme, etc). Gutenberg met au point l'imprimerie (1450). La Renaissance qui débute en Italie s'étend en Europe, ce renouveau artistique coïncide avec une reprise économique. La Renaissance est la période de l'Histoire qui commence, d'un point de vue académique français, après la fin du Moyen Âge, en 1492 et se termine à la mort de Charles Quint en 1558.
Le terme a été inventé en 1860 par l'historien de l'art suisse Jacob Burckhardt (1818-1897) dans son livre 'Civilisation de la Renaissance en Italie'. Durant la Renaissance, on s'intéressa de nouveau à l'Antiquité grecque et romaine, ce qui accompagna le mouvement intellectuel de l'humanisme ; ce mouvement eut comme source l'Italie, en particulier dans la région de Toscane sous le règne des Médicis.
Le terme de renaissance peut désigner d'autres périodes de l'Histoire que la période ci-dessus : la renaissance carolingienne (les lettrés de cette époque parlaient de renovatio), la renaissance du XIIe siècle (appelée "romane" au XIXe siècle)... On remarquera aussi que la renaissance qui a eu lieu en France au XVIe siècle a débuté plus tard que dans d'autres régions d'Europe : l'Italie (Quattrocento), les Flandres (primitifs flamands,...), la Bourgogne, le nord de la France et l'Angleterre (polyphonies...) ont connu des mouvements de renouveau antérieurs à la France.
►1492 Henri VII d'Angleterre a préparé une guerre contre la France; pour l'éviter, Charles VIII renouvelle à Étaples le traité par lequel Louis XI payait un tribut aux Anglais.
► 1492 - 3 novembre Traité d'Étaples, les Anglais lèvent le siège contre 745 000 écus. Charles VIII et Henri VII d'Angleterre signent un traité par lequel les Anglais acceptent de se retirer de France en échange de la somme de 745 000 écus d'or. Le traité d'Étaples est signé le 3 novembre 1492 entre le royaume de France et celui d'Angleterre. Philippe de Crèvecoeur d'Esquerdes l'a négocié du côté français. Le traité met fin à l'attaque anglaise du nord de la France (siège de Boulogne), lancée en représailles au soutien du roi de France au prétendant Perkin Warbeck. Le roi de France expulse Warbeck et paie une indemnité de 159 000 £. Le traité est ratifié en décembre.
► 1493 - 19 janvier Traité de Barcelone, Charles VIII restitue le Roussillon et la Cerdagne à l'Aragon. Charles VIII et le roi d'Espagne (Ferdinand le Catholique) signent ce traité par lequel le roi de France rend à l'Aragon le Roussillon et la Cerdagne. Traité de Barcelone (1493), par le traité de Barcelone du 19 janvier 1493, Charles VIII, arrière petit-fils de Yolande d'Anjou, abandonne à Ferdinand d'Aragon le Roussillon et la Cerdagne afin d'avoir sa pleine liberté pour concrétiser ses prétentions, qu'il tenait de la maison d'Anjou, sur le royaume de Naples, sur Chypre et sur Jérusalem.
► 1493 - 23 mai Traité de Senlis avec Maximilien Ier du Saint Empire qui récupère sa fille et sa dot. Ce traité est conclu entre Charles VIII, Maximilien Ier du Saint-Empire et Philippe le Beau. Charles VIII rend à Maximilien le Charolais l'Artois et la Franche-Comté, ces deux dernières provinces ayant été cédées à Louis XI par le traité d'Arras. En outre, ces deux mêmes provinces ont tenu lieu de dot pour Marguerite d'Autriche, qui a été fiancée à Charles VIII et élevée à la cour de France, mais que le roi s'est refusé à épouser…
La couronne de France n'en continuera pas moins à être suzeraine de l'Artois. Le traité de Senlis a été conclu le 23 mai 1493. Il a pour but de répartir l'héritage des anciens États bourguignons entre le royaume de France et la famille des Habsbourg, apparentée à la descendance des ducs Valois de Bourgogne par le mariage de Maximilien Ier du Saint-Empire avec Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire. Ce traité permet à Maximilien de récupérer la dot de sa fille Marguerite d'Autriche, (ex-fiancée de Charles VIII), c'est-à-dire l'Artois et le comté de Bourgogne (Franche-Comté) et rentrer en possession du Charolais et de Noyon.
► 1493 Alde Manuce fonde son imprimerie à Venise. Alde Manuce est, avec Johann Gutenberg et William Caxton, l'un des trois seuls imprimeurs-éditeurs du XVe siècle à avoir acquis une notoriété mondiale. Autant les deux derniers évoquent la première génération de l'imprimerie et la révolution, à la fois technique et culturelle, qu'elle imposa à l'Occident, autant Alde Manuce a, de tous temps, été synonyme de la Renaissance, de l'humanisme en expansion, de l'universalisme, bref de la glorieuse Venise, capitale européenne de la liberté de pensée au tournant du XVe siècle.
► 1493 à 1541 - naissance et mort de Paracelse. Alchimiste et médecin suisse. Il joue un rôle considérable dans l'histoire de la médecine, de la philosophie, des religions, entre le Moyen Âge et l'époque moderne. Il incarne les contradictions, les invraisemblances, les intuitions géniales de la Renaissance. S'il ouvre des voies nouvelles à la science, il est également alchimiste et théologien. Penseur qui réfléchit sur son art, il est, selon les mots de Giordano Bruno, "le premier qui ait de nouveau considéré la médecine comme une philosophie".
Considérée généralement comme synthèse médicale, l'oeuvre paracelsienne mérite tout autant d'être tenue pour une synthèse philosophique. Pourquoi les théories de Paracelse s'imposent-elles, malgré la personnalité de l'homme? Les historiens en débattent encore, mais l'avènement de la distillation semble avoir contribué au changement. La technique s'est imposée à la fin du Moyen Âge dans la communauté des chimistes, et de nombreux produits naturels ont été testés. À partir des substances naturelles comestibles, tels le fenouil, la noix de muscade et les clous de girofle, les chimistes obtiennent toujours trois types de produits : un fluide volatil, ou "esprit" ; une substance huileuse et un résidu solide.
Sur cette base, les chimistes proposent trois nouveaux éléments pour remplacer ceux d'Aristote : le mercure (c'est-à-dire l'essence des fluides vaporeux, et non pas l'élément chimique qui porte aujourd'hui ce nom), qui donne l'arôme à l'aliment ; le soufre (l'essence des substances huileuses, sans relation non plus avec l'élément chimique), qui véhicule l'humidité et le goût sucré ; le sel (l'essence des solides, différente du sel de table), qui détermine le goût et la consistance, et qui lie les deux autres éléments, normalement antagonistes. Les médecins se convainquent alors que la digestion n'est pas une cuisson, comme ils l'avaient soutenu précédemment, mais une fermentation.
► 1494 Institutions des foires de Lyon et de Nantes.
► 1494 - 25 janvier Suite à la mort de Ferdinand Ier d'Aragon, Charles VIII se proclame roi de Naples. Ferdinand Ier d'Aragon, né en 1423, mort en 1494, roi de Sicile péninsulaire (roi de Naples) (1458-1494), fils illégitime d'Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile, et de Giraldona Carlino.
► 1494 Charles VIII prend le titre de roi de Naples, premèreère guerre d'Italie (1494-1497). Les guerres d'Italie sont une suite de conflits menés par les souverains français en Italie au cours du XVIe siècle pour faire valoir leurs droits héréditaires sur le royaume de Naples, puis sur le duché de Milan. Le royaume de Naples, jusqu'en 1442, est aux mains des Anjou. À cette date, l'Aragon en prend le contrôle.
La famille d'Anjou essaye alors sans relâche d'en reprendre possession. Son dernier représentant, René d'Anjou meurt en 1481 : ses droits sur le royaume de Naples passent alors à la France, sur le trône de laquelle règne, dès 1483, Charles VIII. En 1486, certains barons du royaume de Naples, restés fidèles aux Anjou, se révoltent. Vaincus ils se réfugient en France. Les monarques français vont alors essayer de faire valoir leurs droits pendant près de 60 ans.
► 1494 à 1495 - Malgré des débuts brillants, l'expédition de Charles VIII échoue. Plusieurs princes italiens l'avaient encouragé à l'entreprendre, espérant chacun profiter de ses succès. II entra en triomphateur à Rome (31 décembre 1494), puis à Naples (22 février 1495). Mais sa rapide fortune qui avait d'abord ébloui ses nouveaux amis, ne tarde pas à les inquiéter. Ils redoutent de s'être donné un maître, là où ils ne cherchaient qu'un appui ou un instrument les uns contre les autres.
A peine est-il entré à Naples qu'une ligue se forme derrière lui entre le pape Alexandre VI, l'empereur d'Autriche (Maximilien Ier du Saint-Empire), la République de Venise, Ferdinand le Catholique (roi d'Espagne) et Ludovic le More (Sforza, qui entre temps a vu son ambition se réaliser en devenant duc de Milan). A cette nouvelle, Charles VIII reprend le chemin de la France avec l'armée très peu nombreuse qu'il a amenée. Les confédérés au nombre de 40 000 essaient de lui barrer le passage. Mais le 8 juillet, bien que n'ayant que 9 000 hommes (car il a laissé une partie de son monde à Naples), Charles écrase à Fornoue les Vénitiens et les Milanais, dans une grande bataille où se montrent tout particulièrement le courage et la fougue des Français que les Italiens reconnaissent en lui donnant le nom de furia francese.
Au cours de cette campagne, d'ailleurs, s'est imposée la supériorité de l'artillerie française. Après sa victoire de Fornoue, qu'il ne sut pas exploiter, Charles VIII rentre en France. Quant aux troupes laissées à la garde du royaume de Naples, elles eurent à se défendre contre les anciens maîtres du pays: après quelques succès dont le plus connu est celui de Seminara, en 1503, elles durent capituler à Atella et obtinrent leur retour en France.
► 1494 - 7 juin : L'Espagne et le Portugal signent, contraint par le pape Alexandre VI, le traité de Tordesillas, par lequel, ces deux puissances s'entendent sur le partage des territoires du Nouveau Monde. La ligne de 1493 est repoussée à 370 lieux plus à l'ouest. Tout ce qui serait découvert à l'ouest de la longitude 50° appartiendrait à l'Espagne, et tout ce qui serait à l'est (Afrique comprise) appartiendrait au Portugal. En fait la papauté avait attribué non pas des zones de colonisation, mais des zones d'évangélisation, distinction subtile qui ne résista pas aux appétits de ces deux puissances européennes.
Le traité de Tordesillas, signé à Tordesillas (Valladolid) en Castille le 7 juin 1494, établit le partage du Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal. Ce traité établi un partage entre les seuls deux États signataires avec pour ligne de partage un méridien nord-sud localisé à 370 lieues (1770 km) à l'ouest des îles du Cap-Vert – méridien qui se situerait aujourd'hui à 46° 37' ouest. Ce traîté fut ratifié par l'Espagne le 2 juillet et par le Portugal le 5 septembre de la même année.
► 1494 - 12 septembre naissance de François d'Angoulême (futur François Ier), fils de Charles d'Orléans. François Ier de France, appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne. Il est né le 12 septembre 1494 à Cognac (Charente). Il est le fils de Charles d'Angoulême (1459 - 1er janvier 1496) et de Louise de Savoie (11 septembre 1476 - 22 septembre 1531).
► 1494 - 31 décembre Charles VIII entre dans Rome. C'est par la Porte du peuple que Charles VIII entre dans Rome. Il est acclamé tout au long du parcours qui le mène au palais San Marco. Selon les témoins entourant Louis II d'Orléans (Louis XII), qui accompagne le roi, celui-ci “entra dans Rome plus triomphalement et mieux accompagné que ne fit aucun prince qui soit en la mémoire de ceux qui sont vivants”. Sur les étendards du roi, les mots “Voluntas dei. Missus a Deo” : “Volonté de Dieu. Envoyé de Dieu”. Le pape Alexandre Borgia se terre dans son palais…
► 1494 à 1553 - naissance et mort de François Rabelais. Écrivain français. Né d'un père avocat à Chinon, François Rabelais étudie le latin, le grec, et correspond avec le célèbre humaniste Guillaume Budé. Il a d'abord été moine et traducteur avant d'exercer les fonctions de médecin puis d'écrivain. Homme de la Renaissance, il a allié, sa vie durant, foi en Dieu, discours anticléricaux, pensée humaniste et sens de la farce. Ses deux principaux héros littéraires, des géants, père et fils, sont issus de la littérature du Moyen Âge.
Dans ses deux oeuvres majeures, 'Gargantua' et 'Pantagruel', il fait preuve d'un style hors du commun, d'une richesse de vocabulaire exceptionnelle et associe des opinions "éclairées" sur l'éducation, l'extension des savoirs ou la guerre, à une technique littéraire où le récit historique se mêle aux inventions fantastiques. Virtuose du langage et grand créateur de mots, polémiste, savant, précurseur dans de nombreux domaines, François Rabelais réalise la synthèse entre la tradition comique carnavalesque du Moyen Âge et les nouveaux savoirs de la Renaissance.
Sa vie et son oeuvre polymorphe, qui donne à rire et à penser, qui échappe à tout classement, sont le triomphe de la liberté d'esprit. "Polémiste, encyclopédiste, savant, grand voyageur épris de tolérance, moraliste sans morale, éducateur, ivrogne, humaniste camouflant son humanisme sous des torrents d'obscénités, romancier se servant du réalisme au seul bénéfice de l'imagination, linguiste maître du langage et créateur de mots, Rabelais est un précurseur dans tous les domaines et la plus comique de nos énigmes". Jean d'Ormesson.
► 1494 Le goût de l'innovation de Léonard de Vinci n'est pas toujours récompensé. De 1494 à 1498, De Vinci peint 'La Cène', une fresque située sur le mur du fond du réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces (Italie). L'oeuvre, considérée comme le premier travail de la Haute Renaissance, s'écaille malheureusement très rapidement. De Vinci a en effet utilisé un enduit expérimental qui résistera mal à l'atmosphère humide des lieux.
► 1495 à 1498 - Charles VIII emploie ces deux années, d'une part à réorganiser le Parlement (fixation du Grand Conseil) et à poursuivre quelques réformes intéressantes; d'autre part, à préparer une nouvelle expédition contre l'Italie.
► 1495 - 22 février Charles VIII entre dans Naples. C'est vêtu en empereur romain que Charles VIII fait une entrée solennelle dans la ville. Les troupes de celui qui, roi de France, monte sur le trône du royaume de Naples commencent de piller la ville.
► 1495 - 1er mars Création de la ligue de Venise contre Charles VIII.
► 1495 - 20 mai Charles VIII repart pour la France.
► 1495 - 6 juillet : bataille de Fornoue, victoire de la France sur la Sainte Ligue. Dans une "furieuse" charge, 9 000 royaux enfoncent 30 000 adversaires et laissent des milliers de morts. Charles doit néanmoins rapatrier ses troupes et rentre en France à l'automne. Naples est reprise par l'armée de Gonzalve de Cordoue (1496). Bataille de Fornoue, lors de la première guerre d'Italie, Charles VIII a réussi à s'emparer du royaume de Naples sans rencontrer beaucoup de résistance.
Cependant l'hostilité grandissante face à l'occupation et surtout la formation de la ligue de Venise contre les Français, l'obligent à écourter son séjour à Naples et à faire retraite vers la France afin de ne pas se retrouver pris au piège. Ses ennemis lui bloquent le passage à Fornoue l'obligeant à livrer bataille. Bataille de Fornoue. Charles VIII est contraint de battre en retraite et d'abandonner Naples. Le 6 juillet 1495, il se retrouve à Fornoue face aux troupes coalisées de la Sainte Ligue (Venise, Milan, Maximilien Ier du Saint-Empire, Ferdinand d'Aragon et le pape) qui tentent de l'empêcher de rentrer en France. S'engage alors une bataille acharnée, dont la "furie française" (furia francese) sort vainqueur.
► 1495 - 15 octobre Retour de Charles VIII en France.
► 1495 Albrecht Dürer peint 'L'étang dans la forêt’
► 1495 Construction du château d'Amboise. Le château d'Amboise surplom-be la Loire à Amboise dans le département de l'Indre-et-Loire. Charles VIII, né à Amboise, y fit les premières constructions marquantes. Louis XII y fait construire une seconde aile, perpendiculaire à l'aile Charles VIII, dans un style renaissance. François Ier y passa son enfance et y réaménagea l'aile Louis XII. Il invita Léonard de Vinci à séjourner à Amboise dans le Clos Lucé, situé près du château. Un souterrain, permettant la communication entre les deux sites, fut percé.
Le grand peintre mourut en 1519 à Amboise et fut inhumé secondairement dans la chapelle Saint-Hubert. Le château fut le théâtre de la conjuration d'Amboise en 1560, prélude aux guerres de religion. À partir d'Henri III, les séjours royaux se firent plus rares. Une grande partie du château fut démolie lors du premier Empire. Louis-Philippe Ier hérita du château par sa mère. Il dégagea les anciens remparts en faisant détruire les maisons attenantes et redécora l'aile Louis XII.
► 1496 - 17 décembre Les Espagnols attaquent Naples.
► 1496 à 1544 - naissance et mort de Clément Marot. Écrivain français. En plus d'être un grand poète, Clément Marot a beaucoup oeuvré pour faire connaître les poètes qu'il aimait. C'est à lui que nous devons en grande partie de pouvoir lire les poèmes de François Villon, dont il a réalisé une adaptation en 1533.
Peut-être, ayant eu lui aussi à subir des démêlés avec la justice, se sentait-il une fraternité particulière avec l'auteur de la Ballade des pendus. Emprisonné pour ne pas avoir respecté le jeûne prescrit par l'Église durant le Carême, accusé plus tard d'avoir participé à l'évasion d'un prisonnier, inquiété pour l'insouciance de sa façon de vivre, il ne se reconnaissait qu'un seul maître: l'Amour.
► 1497 - 15 février Naples capitule.
► 1497 - 25 février Capitulation de Tarente, perte du royaume de Naples. Charles VIII part de Lyon le 27 juillet 1494 et entre à Rome le 31 décembre. Ferdinand d'Aragon, roi de Naples, est mort le 25 janvier 1494, laissant le trône vacant. Charles VIII entre à Naples le 22 février 1495. Une ligue anti-française est formée par Venise, Milan, l'Aragon et la Castille. Charles VIII écrase les coalisés à Fornoue le 5 juillet et rentre en France en Décembre.
Après sa défaite à Tarente et la capitulation de Gaète en 1497, le royaume de Naples est définitivement perdu. Tarente est une ville et un port du sud de l'Italie, c'est le chef-lieu de la province de Tarente dans la région des Pouilles construite sur le golfe de Tarente. Charles VIII va intervenir en Italie à partir de mai 1492. Il s'allie avec Ludovic le More, duc de Milan, contre le roi de Naples.
► 1497 à 1543 - naissance et mort de Hans Holbein. Peintre et graveur allemand. L'artiste peignit les portraits des plus grands dignitaires de la cour du roi d'Angleterre et retourna à Bâle en 1528. Hans Holbein y resta trois ans et repartit pour Londres. Là, sa renommée s'établit rapidement à travers les merveilleux portraits qu'il réalisa. Thomas Cromwell, le joaillier du roi, le présenta croit-on à Henri VIII d'Angleterre. En 1536, il devint peintre du souverain et son portraitiste préféré. Cet artiste dont l'influence fut considérable sur ses suivants se signala en introduisant le réalisme dans les portraits, en n'idéalisant pas ses modèles mais en présentant sous leur véritable jour.
► 1498 - 7 avril Charles VIII meurt à Amboise, des suites d'un accident (il s'était frappé le front en passant sous une porte trop basse). Charles VIII ne laisse pas d'enfants. Son règne a appauvri le Trésor, mais a imposé à l'étranger le respect du nom français, et mieux, a vu s'affirmer l'existence d'une nationalité française. Louis II d'Orléans lui succède.
► 1498 Louis II d'Orléans, petit-neveu de Charles V, petit-fils du duc d'Orléans (Louis Ier d'Orléans assassiné par Jean sans Peur en 1407), fils de Charles d'Orléans et de Marie de Clèves, né en 1462, succède à Charles VIII sous le nom de Louis XII. C'est lui qui avait été fait prisonnier à Saint-Aubin-du-Cormier. Il avait épousé la fille de Louis XI, Jeanne de France, mais pour conserver la Bretagne, il répudia cette princesse, pour épouser en 1499 la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne, née en 1477.
Il avait combattu glorieusement en Italie pendant l'expédition de Charles VIII. Il avait lui-même des droits sur le royaume de Naples en tant que successeur de ce dernier, et sur le Milanais comme héritier de son aïeule Valentine Visconti. Valentine Visconti, née en 1361, morte avant 1393, fille de Barnabé Ier Visconti, seigneur de Milan, et de Béatrice della Scalla. Elle est membre de la famille Visconti. Elle épouse en 1378 Pierre II de Lusignan (1354 † 1382), roi de Chypre mais n'eut pas d'enfants. Veuve, elle se remarie après 1383 avec Galéas, comte de Virtu. Elle meurt avant 1393
49 - De 1498 (Les Valois) à 1547 (10e guerre d'Italie)
► 1498 LES VALOIS - ORLÉANS.
► 1498 Le rameau d'Orléans : Louis Ier, duc d'Orléans et comte de Valois, fils du roi Charles V ; Charles d'Orléans ; Louis XII le Père du Peuple, duc d'Orléans et comte de Valois sous le nom de Louis II, puis roi de France (1498-1515)
► 1498 LOUIS XII le Père du peuple (1498-1515)
► 1498 Louis XII. Charles VIII meurt sans descendance mâle son cousin Louis II d'Orléans est appelé à règner sous le nom de Louis XII. Il est le petit fils de Louis Ier d'Orléans frère de Charles VI et le fils du poète Charles d'Orléans et de Marie de Clèves. Son premier acte est de faire annuler son mariage avec Jeanne de France (fille de Louis XI) qui lui avait été imposée par Louis XI (il avait 14 ans et Jeanne 12) et d'épouser Anne de Bretagne, (1499) veuve de Charles VIII qui à l'époque n'a que 23 ans, (elle avait épousé Charles VIII à 16 ans) afin que la Bretagne entre dans le royaume. Il avait conduit l'armée de Charles VIII en Italie et le retour n'avait pas été triomphal. Il ajoute la revendication du Milanais, il est le petit fils de Valentine Visconti.
En 1499 il engage une campagne militaire en Italie qui lui assure le contrôle du Milanais en 1500 puis du royaume de Naples en 1501 mais, trahi par son allié Ferdinand d'Aragon, il en est chassé en 1504. C'est dans ces aventures qu'a eu lieu le fameux exploit du chevalier Bayard qui réussit seul à contenir 200 ennemis sur le pont de Garigliano (1503). Louis XII ne peut rétablir la situation malgré la victoire de Ravenne en 1512 et les campagnes qu'il mène de 1509 à 1513. Devant ces guerres le pape Jules II crée la sainte ligue contre la France qui regroupe l'Espagne, l'Angleterre et la Suisse.
Les Anglais débarquent dans le nord de la France et l'armée française est battue à Guinegatte en 1513 au cours de laquelle Bayard est fait prisonnier ayant refusé de fuir avec le reste de l'armée (il sera libéré sans rançon peu après ayant refusé d'entrer au service de Henri VIII d'Angleterre) et les Suisses conquièrent la Bourgogne. En 1514 Anne de Bretagne meurt et Louis XII rétablit la paix avec l'Angleterre et épouse Marie d'Angleterre soeur du roi Henri VIII d'Angleterre.
Mais il mourra après quelques mois de ce nouveau mariage sans descendant mâle c'est son cousin François d'Angoulême qui prendra sa succession sous le nom de François Ier. Louis XII est considéré comme "père de son peuple". Les guerres d'Italie ont détourné les ardeurs des chevaliers et le royaume de France a connu la paix. Il s'est occupé du bon fonctionnement des administrations, par l'organisation du grand conseil (1498), meilleure gestion des impôts.
► 1498 - 27 Mai Sacre de Louis XII à Reims. Fils du poète Charles d'Orléans et de Marie de Clèves, Louis II d'Orléans a trente-six ans, lorsqu'il entre dans la basilique. Il succède à Charles VIII dont il est le cousin au cinquième degré sous le nom de Louis XII.
►1498 - 17 décembre Annulation du mariage de Louis XII et de Jeanne de France.
►1498 Vasco de Gama arrive aux Indes par le sud de l'Afrique. Vasco de Gama (v. 1469, Sines, Portugal - 24 décembre 1524, Cochin, Inde) navigateur portugais, premier européen à arriver en Inde en contournant le Cap de Bonne Espérance. Lorsque Vasco de Gama s'embarque en 1497 à la tête de quatre navires, cela fait environ un siècle que les Portugais, à la suite des expéditions lancées par le prince Henri le Navigateur, explorent méthodiquement les côtes africaines. En particulier, Bartolomeu Dias a doublé en 1488 le Cap de Bonne Espérance, et l'étape suivante consiste à rallier l'Inde et ses richesses.
Au passage, on espère trouver le mythique royaume du prêtre Jean, et conclure avec lui une alliance contre les ottomans, mais cet espoir sera déçu. En revanche, Vasco de Gama arrivera en Inde, à Calicut, après environ un an de navigation. Sur le plan commercial cette expédition sera toutefois un échec : les marchands arabes sont implantés depuis longtemps dans la région, et font ce qu'il faut pour évincer des concurrents potentiels. En 1502, le nouvel "amiral des Indes" reprend la mer, avec une flotte conséquente (une vingtaine de navires de guerre). Cette expédition marque les débuts de l'empire colonial portugais, et rapportera à la couronne un butin conséquent ainsi que des privilèges commerciaux importants....
Couvert d'honneurs, Vasco de Gama va pourtant être laissé dans une semi-retraite pendant 20 ans, avant d'être nommé vice-roi des Indes en 1524. Il meurt cependant peu de temps après y être arrivé. Ses restes seront ramenés au Portugal en 1538. Bartolomeu Dias est un explorateur portugais, né vers 1450 en Algarve, mort en 1500 au large du Cap de Bonne Espérance. Il fut chargé par le roi Jean II de Portugal de poursuivre les explorations de Diogo Cao le long de l'Afrique, ce qui le conduisit à être le premier occidental à doubler le Cap de Bonne Espérance. Il accompagna Vasco de Gama lors de son voyage en Inde en 1497, et périt lors d'une expédition dirigée par Pedro Alvares Cabral, en 1500.
Royaume du prêtre Jean, au Moyen Âge, des rumeurs venues d'Arménie et de Venise faisaient état d'un mystérieux royaume chrétien, celui du Prêtre Jean, que l'on ne savait situer, en Afrique ou en Inde, tant les données géopolitiques étaient confuses. La perspective d'une terre chrétienne au-delà des terres musulmanes est pour les occidentaux, une possibilité de prendre les infidèles en tenaille. L'existence du royaume va alors servir de prétexte aux européens pour avancer vers la destination mystérieuse que sont les Indes, persuadés d'y trouver un soutien chrétien. Les Portugais ne cesseront plus d'essayer de découvrir l'accès au royaume du Prêtre Jean.
►1498 Albrecht Dürer peint 'Autoportrait au paysage’
►1498 Sébastien Brant écrit 'La Nef des fous'. Sébastien Brant (Strasbourg, 1458 - idem, 1521) est un poète satirique et humaniste strasbourgeois, auteur notamment de La Nef des fous (Das Narrenschiff), illustrée par Albrecht Dürer et qui fut, avant les Souffrances du jeune Werther de Goethe, l'ouvrage populaire le plus souvent imprimé. Il crée un nouveau genre littéraire, celui de la Narrenliteratur, le genre bouffon, en publiant son oeuvre majeure, La Nef des fous, critique de la faiblesse et de la folie de ses contemporains. Son succès est immédiat, au point qu'il est alors traduit en plusieurs langues (traduit en latin en 1496 par Badius Ascensius, et mis en rimes françaises par Pierre Rivière, 1497), dont une version française éditée entre 1497 et 1499.
►1499 deuxième guerre d'Italie (1499-1500), invasion du Milanais.
►1499 Installation à Paris du lyonnais Josse Bade, imprimeur et humaniste. Josse Bade, imprimeur et humaniste flamand (Asch, 1462 – Paris, 1535). Il fut en France le premier dont les éditions valaient autant par l'exécution typographique que par la correction du texte et les commentaires savants. Après avoir étudié en Italie, il professa le grec et le latin à Lyon où il travaille comme correcteur et conseiller littéraire chez l'imprimeur Trechsel dont il épouse la belle-fille. Jean Petit, qui apprécie la qualité des travaux de Bade, l'emploie et finit par installer pour lui une imprimerie à laquelle il confie les travaux dont il souhaite soigner tout spécialement la correction.
Dès 1500, Josse Bade se met à imprimer pour son compte et fait paraître près de 400 volumes (Érasme, Budé, Ange Politien), des classiques grecs et latins qu'il a lui-même annotés, ainsi que quelques ouvrages originaux (notamment le 'Navis stultarum', 'La Nef des fous'). Pendant ses trente-deux ans de carrière, Bade édita et commenta personnellement environ 110 textes.
►1499 - 8 janvier Mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII. Le roi, après l'annulation de son mariage avec Jeanne, fille bossue de Louis XI, épouse Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII, dont il a toujours été amoureux. En dépit de ce mariage, le duché reste indépendant.
►1499 - 9 février Alliance entre Louis XII et Venise.
►1499 Pietro de Crescenzi écrit 'Jardin médiéval'. Pietro de Crescenzi, agro-nome né à Bologne en 1230, mort en 1310. Il fut podesta de sa ville natale, puis banni; après trente ans de voyage, il rentra à Bologne où il fut élu sénateur. Il a publié un ouvrage capital sur l'agronomie, qui eut au Moyen âge et jusqu'au XVIIe siècle une grande réputation.
►1499 octobre La conquête du Milanais, dirigée pour le compte de Louis XII par Trivulce, avec le concours de troupes vénitiennes et suisses, s'effectue en vingt jours. Théodor Trivulce était le neveu du Maréchal Jean-Jacques de Trivulce, issu d'une noble famille milanaise. Il prit part à la guerre d'Italie sous le Roi Louis XII.
►1500 La population milanaise, durement opprimée par Trivulce, se révolte et il faut au condottiere de Louis XII une nouvelle campagne pour reconquérir le pays. Le duc Ludovic le More, duc de Milan, qui a profité du soulèvement populaire pour reprendre son trône, est abandonné par ses mercenaires suisses; livré au général français Louis II de la Trémoille, il est envoyé prisonnier en France et enfermé au château de Loches (où il mourra après dix ans de captivité).
Les Génois se placent volontairement sous la domination de Louis XII. Condottière, nés en Italie au Moyen Âge, les condottières, sont des chefs d'armées de mercenaires. Soldats réguliers démobilisés ou nobles en mal de gloire, ils mettent leur art de la guerre au services d'États. Rémunérés le plus souvent en espèces sonnantes et trébuchantes, ils ne rechignent pas à accepter des terres et titres en échange de leurs services.
►1500 troisième guerre d'Italie (1500-1504) contre l'Espagne dans le royaume de Naples.
►1500 - 9 mars : Départ de l'escadre de Pedro Alvares Cabral du port de Lisbonne, à destination du Brésil. Il passe aux Canaries, puis aux îles du Cap-Vert.
►1500 à 1590 - Écoles Rajpoutes du Rajasthan et du haut Pendjab: Art précieux de la miniature en Inde. Les Rajputs ou Rajpoutes - fils de prince, de râja, prince et putra, fils - forment la majorité des habitants du Rajasthan, autrefois le Râjputâna, et une partie de celle du Goujerat. Le Pendjab désigne des subdivisions de l'Inde et du Pakistan.
►1500 - 22 avril : Pedro Alvares Cabral, amiral portugais, profitant des alizés, débarque sur le site de Porto Seguro (au sud de l'actuelle Salvador de Bahia), prend possession du territoire au nom du Portugal et le baptise Terra da Vera Cruz (Terre de la Vraie croix). Il s'y établira en 1503. Parce que la végétation offrait quelques variétés de brésil, arbre connu aux Indes orientales pour la production de teinture rouge, on surnomme l'île de Santa Cruz "terre du brésil".
►1500 - 14 mai : Pedro Alvares Cabral prend officiellement possession du Brésil au nom du roi du Portugal.
►1500 à 1590 - Apogée de l'art du Bénin: Ivoire et bronze: L'art dogon. Ancienne tradition du bronze remontant au XIVe siècle avec le royaume d'Ifé situé dans l'actuel Nigeria. Cet Art royal nous a laissé de véritables oeuvres d'art. Perpétuant la civilisation d'Ifé, le royaume du Bénin, même s'il ne domina jamais un vaste territoire atteignit l'apogée de sa gloire en 1500.
L'art du Bénin connut son expression la plus élevée dans les sculptures en bronze, dont beaucoup étaient fondues selon la technique de la cire perdue, parmi lesquelles se distinguent les plateaux à bordure ajourée et les têtes massives. Ils gardèrent leurs croyances ancestrales où tous les êtres et les choses étaient dotées d'un esprit. Au Bénin, les rites comprenaient des sacrifices humains.
►1500 - 11 novembre Traité de Grenade entre Louis XII et Ferdinand d'Aragon pour le partage du royaume de Naples. Par ce traité, les rois que sont Louis XII et Ferdinand d'Aragon se partagent le royaume de Naples. Le Traité de Grenade signé le 11 novembre 1500, par Louis XII et Ferdinand II d'Aragon prévoyaient d'agir de concert pour attaquer le royaume de Naples, puis, après la victoire, de se le partager, autant que possible à parts égales.
Le roi de France devait recevoir Naples, la Campanie, Gaète, Labour, les Abruzzes et la province de Campobasso avec les titres de roi de Naples et de Jérusalem. Le roi et la reine d'Espagne se réservaient l'extrême sud du pays, les Pouilles avec les titres de roi de Sicile, de duc de Calabre et d'Apulie. Deux provinces avaient été oubliées dans ce partage : la Basilicate et la Capitanate. Elles devinrent la cause du litige qui allait opposer les anciens alliés lorsque La Palice les occupa.
►1500 Giovanni Bellini peint 'La madone au pré’
►1500 vers - la langue française se constitue au point de vue linguistique et institutionnel.
►1501 à 1503 - Louis XII s'allie avec Ferdinand le Catholique, roi d'Espagne, pour faire la conquête du royaume de Naples dont il lui promet une part, par le traité de Grenade. Les deux souverains ont respectivement pour généraux le duc de Nemours (Louis d'Armagnac-Nemours) et Gonsalve de Cordoue. Le royaume de Naples (où restaient çà et là des éléments français depuis l'expédition de Charles VIII) est rapidement conquis. Cependant les Espagnols soulèvent des difficultés à propos de la délimitation de leur part de la conquête : ils sont plus nombreux que les Français et en profitent pour chasser du midi de l'Italie leurs alliés de la veille : ils restent maîtres du royaume.
C'est pour faire sauter les forts de Naples occupés par les Français, que l'on fait pour la première fois usage de la mine. Les faits d'armes les plus remarquables qui résultent de ces événements sont les défaites des Français à Seminara, Cérignole et sur le Garigliano. Dans cette campagne, se distinguèrent particulièrement les capitaines français: La Palice, le chevalier Bayard, le duc de Nemours (Louis d'Armagnac-Nemours) et Louis d'Ars. Ce dernier ayant été bloqué dans la ville de Venouse qu'il commandait, y soutint un siège d'une année, et ne l'abandonna qu'en 1504 sur l'ordre formel de Louis XII: il traversa alors toute l'Italie avec toute sa petite troupe, et ses armes et bagages, pour rentrer en France.
Jacques de La Palice, Jacques II de Chabannes dit Jacques de la Palice, seigneur de la Palice, de Pacy, de Chauverothe, de Bort-le-Comte et de Héron, est né en 1470 et mort en 1525. En 1511, il accède au titre de Grand maître de France. Maréchal de France, il sert François Ier et meurt pendant la bataille de Pavie (en 1525) qui l'oppose aux armées italiennes. Une chanson chantée par ses soldats après sa mort disait : "s'il n'était pas mort il ferait envie", mais elle fut déformée en "s'il n'était pas mort il ƒerait - serait - envie" ; de cette phrase est sortie le mot lapalissade qui designe une évidence ou tautologie.
Chevalier Bayard, Pierre Terrail, seigneur de Bayard (Château de Bayard, Pontcharra (Isère) 1475 - Romagnano Sesia (ou Rovasenda), Milanais 1524) Plus connu sous le surnom de Bayard ou chevalier Bayard, était un noble dauphinois, né à Pontcharra en 1476, mort à Romagnano en 1524, qui s'illustra notamment comme chevalier dans les guerres d'Italie (XVe – XVIe siècle).
►1501 Le gouvernement portugais envoie l'italien Amerigo Vespucci pour effectuer la reconnaissance des côtes du Brésil, de l'Uruguay et de l'Argentine. Il rapporte en Europe le bois de brasil (bois de brésillet) qui produit une teinture rouge qui sera très prisée et qui donnera son nom au nouveau territoire. Il prend conscience que le continent n'est pas l'Asie. Amerigo Vespucci (9 mars 1454–22 février 1512) était un marchand et navigateur originaire de Gênes en Italie. Il fut le premier à penser que la côte est de l'Amérique du Sud constituait un nouveau continent alors que tous les navigateurs de l'époque, y compris Christophe Colomb, pensaient débarquer en Asie.
Le rôle de Vespucci a beaucoup donné lieu à controverses, en particulier, en raison de deux lettres dont l'authenticité a été mise en doute : Mundus Novus (Nouveau monde) et la "Lettera" (des "quatre voyages"). Certains pensent que Vespucci a exagéré son rôle, d'autres pensent que ces deux lettres sont des faux écrits par d'autres à la même période. Il est probable que c'est la publication de ces lettres qui a poussé Martin Waldseemüller à nommer le nouveau continent "America" sur sa carte du monde de 1507. Vespucci se surnommait lui-même Americus Vespucius dans ses écrits en Latin. Waldseemüller prit donc la forme féminine du prénom de Vespucci et nomme alors le continent America.
►1502 Léonard de Vinci peint 'La Joconde'. 'La Joconde' (ou Portrait de Mona Lisa) est l'un des seuls tableaux attribués à Léonard pour lequel il est sans conteste reconnu être l'auteur. La Joconde est le portrait d'une jeune femme, sur fond d'un paysage montagneux aux horizons lointains et brumeux. Le flou du tableau est caractéristique de la technique du sfumato. Le sfumato, de l'italien enfumé, est un effet vaporeux, obtenu par la superposition de plusieurs couches de peinture extrêmement délicates qui donne au tableau des contours imprécis. Le modèle s'appelle Lisa Gherardini, née en 1479 à Florence.
La Joconde ne quitta jamais Léonard de son vivant. Il l'emporta probablement à Amboise où François Ier le fit venir. Ce dernier en fit l'acquisition - à Léonard lui même ou à ses héritiers après sa mort - et l'installa à Fontainebleau. Plus tard, Louis XIV en fit l'un des tableaux les plus en vue à Versailles, et l'exposait dans le Cabinet du Roi. Bonaparte, l'installa aux Tuileries en 1800 dans les appartements de Joséphine, puis l'offrit au Louvre en 1804.
'La Joconde' est devenue un tableau mythique car à toutes les époques les artistes l'ont prise comme référence. Elle constitue en effet l'aboutissement des recherches du XVe siècle sur la représentation du portrait. A l'époque romantique, les artistes ont été fascinés par l'énigme de la Joconde et ont contribué à développer le mythe qui l'entoure, en faisant de nos jours l'une des oeuvres d'art les plus célèbres du monde.
►1502 Parution d'un Dictionnaire latin-italien de Ambrogio Calepino. Ambrogio Calepino, ou Ambroise Calepin savant et religieux augustin italien (1435, Bergame - 1511). Savant de l'ordre des Augustins, issu de la famille des comtes de Calepio, il consacra toute sa vie à la composition d'un Dictionnaire latin-italien, qui a eu une vogue immense (répandu dans toute l'Europe) et qui est vulgairement connu sous le nom de Calepin.
Ce dictionnaire parut pour la première fois en 1502, in-folio ; l'auteur le compléta en 1509. Il en a été fait de nombreuses éditions et on y a ajouté la traduction des mots latins en huit, et même en onze langues. Le mot calepin désigna d'abord un dictionnaire, puis plus récemment un agenda et par extension un petit carnet. On a étendu depuis le nom de calepin à tous les registres de notes et de renseignements.
►1503 - 18 août Mort du pape Alexandre IV.
►1503 - 1er novembre : Élection au pontificat de Jules II (fin en 1513). Jules II, Giuliano della Rovere naquit à Albissola près de Savonne en 1443 et mourut à Rome en 1513. Il fut légat de France et cardinal d'Ostie et devient pape en 1503. Il réannexe la Romagne et les autres possessions de César Borgia, soumet Pérouse et Bologne. Prince temporel plutôt que guide des âmes, il restaure la puissance politique des papes en Italie. Le cinquième Concile du Latran qu'il réunit en 1512 ne réussit guère à réformer l'Église.
En 1510 il signe la paix avec Venise pour se consacrer à ce qui devait être la grande pensée de son pontificat : la libération de l'Italie des "barbares du nord" c'est à dire des Français. Jules II fut un fastueux mécène et sut utiliser le génie de Michel-Ange, Raphaël et Bramante. Il pose en 1506 la première pierre de la nouvelle basilique Saint-Pierre en faveur de laquelle il lança la campagne d'indulgences qui fut plus tard le prétexte de la révolte de Luther. César Borgia (1475-1507), prince de la Renaissance.
►1503 Jérôme Bosch peint 'le jardin des délices’
►1503 Albrecht Dürer peint 'Herbes’
►1504 - 1er janvier Capitulation de Gaète.
►1504 - 31 Mars Trêve de Lyon avec L'Espagne.
►1504 - 22 septembre Traités de Blois, qui consacrent la ruine des espérances des Français en Italie. Le royaume de Naples étant complètement perdu pour Louis XII, il lui reste le Milanais, sous réserve d'une redevance à payer à Maximilien Ier du Saint-Empire. Il décide alors de fiancer sa fille Claude de France, née en 1499, à Charles d'Autriche (futur Charles Quint, petit-fils de l'empereur d'Allemagne, Maximilien Ier du Saint-Empire, et du roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique) ; Claude de France recevra en dot le Milanais et les duchés de Bourgogne et de Bretagne.
Par un autre traité, est arrêté le mariage de Germaine de Foix, nièce de Louis XII, avec le roi d'Espagne, Ferdinand le Catholique, veuf de Isabelle de Castille. Claude de France, (13 octobre 1499 - 20 juillet 1524). Duchesse de Bretagne, reine de France en 1515, comtesse de Soissons, Blois, Coucy, Étampes et Montfort. Fille du roi Louis XII et d'Anne de Bretagne, elle épouse le 8 mai 1514, François d'Angoulême, futur François Ier de France.
►1504 Albrecht Dürer peint 'Adam et Eve’
►1504 Lucas Cranach peint 'Le repos de la Sainte Famille'. Lucas Cranach l'Ancien est un peintre et graveur de la Renaissance allemande, né à Kronach en 1472 et décédé à Weimar en 1553.
►1504 Jean Lemaire de Belges écrit 'Le Temple d'honneur et de vertu'. Jean Lemaire de Belges, après des études auprès de Jean Molinet, Jean Lemaire de Belges est tour à tour au service de Pierre de Bourbon, Louis de Luxembourg, Anne de Bretagne puis de Marguerite d'Autriche, pour laquelle il compose Les Épîtres de l'amant vert sur la mort de son perroquet. En 1508, il est "indiciaire" de la Maison de Bourgogne et écrit 'Les Illustrations de Gaules et singularités de Troie' (1511), fresque où il inscrit la Gaule dans la descendance d'Hercule de Lydie, père des Troyens et des Gaulois. Mais c'est avec 'La Concorde des deux langages' entrepris la même année qu'il donne un texte décisif pour cette période. Art poétique qui milite pour la langue française, cet ouvrage est souvent considéré comme l'une des "ouvertures" de la Renaissance française.
►1505 - 31 mai Louis XII revient sur sa décision et décide de marier Claude de France à François d'Angoulême (futur François Ier).
►1505 Raphaël peint 'La vierge dans la prairie’
►1505 mort de Jean Molinet.
►1506 - 18 avril : La première pierre de la basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican est posé par le pape Jules II. La construction de l'édifice actuel a débuté le 18 avril 1506 sous le règne de Jules II pour s'achever en 1626 sous celui de Paul V. De nombreux architectes et artistes prestigieux ont contribué à cette réalisation dont Michel-Ange pour le dôme ; le Bernin, concepteur de la place et ses fameuses colonnades ; Giacomo della Porta pour la calotte ou encore Carlo Maderno pour la façade. Bramante, Raphaël et Sangallo le Jeune ont également participé au dessin des plans.
Bramante (1444-1514) est un architecte italien de la Renaissance. Il est né près d'Urbin en Italie. Ses premières commandes en tant qu'architecte datent de 1479, alors au service de Ludovic Sforza, à Milan, où il travaille fréquemment avec Léonard de Vinci. Il part à Rome en 1500 et y dévoile sa conception du style classique avec le Tempieto de San Pietro in Montorio (1502-1510).
Cet édifice propose une synthèse entre art antique et art de la Renaissance : surélévation de 3 marches, composé d'une salle centrale circulaire, entouré d'un péristyle composé de colonnes toscanes qui sont surmontées d'une frise. Son oeuvre la plus célèbre est sans aucun doute la Basilique Saint-Pierre (commencée en 1506) à Rome, réalisée sur la demande du Pape Jules II. Il en traça le plan, en jeta les fondements (1513) et l'éleva jusqu'à l'entablement, mais il n'eut pas le temps de l'achever. L'édifice fut, après sa mort, continué et perfectionné par Michel-Ange.
►1506 - 14 mai Louis XII proclamé “Père du Peuple”. Ce sont les États généraux qui se sont ouverts à Plessis-lez-Tours qui proclament Louis XII “Père de son peuple”. Ce titre lui est donné parce qu'il a diminué les tailles, impôts qui sont payés essentiellement par les roturiers. Les "états généraux" de Tours, réunis en mai 1506, proclament Louis XII "Père du Peuple". Ils annulent, à la demande du roi, toutes les clauses du traité de Blois qui concernent le mariage projeté de sa fille Claude de France avec Charles de Luxembourg, le futur Charles Quint. Il fiance alors Claude de France à François d'Angoulême, l'héritier présomptif. L'intégrité du royaume de France est sauvegardée.
►1506 Jacques Lefèvre d'Étaples écrit 'Poétique d'Aristote'. Jacques Lefèvre d'Étaples, humaniste et théologien français, fut l'un des pères de la Réforme française et un des plus grands philologues de la Renaissance. Persécuté par les "docteurs" de la Sorbonne, il trouva chez la reine de Navarre, Marguerite d'Angoulême, une protectrice qui l'accueillit à Nérac de 1530 jusqu'à sa mort en 1536. Il fit paraître la première bible en français en 1534.
►1506 Johannes Reuchlin écrit 'Rudimenta linguae hebraïcae'. Johannes Reuchlin, grand philosophe et philologue allemand, kabbaliste et homme de grand savoir. Né à Pforzheim (Allemagne) en 1455, il fut diplomate alors qu'il était encore jeune. À une certaine période de sa vie, il reçut la haute charge de juge au tribunal de Tübingen, où il resta onze ans. Il fut aussi le précepteur de Mélanchton. Le clergé [dominicain] le harcela de persécutions pour sa glorification de la Kabbale juive, tandis qu'en même temps il était appelé le "Père de la Réforme". II mourut en 1522, dans un grand dénuement - sort commun réservé à tous ceux qui, à l'époque, s'élevaient contre la lettre morte de l'Église.
►1506 mort de Christophe Colomb.
►1507 Raphaël peint 'La vierge à l'enfant dite la belle jardinière’
►1508 États généraux de Tours. - Convoqués par Louis XII, ils annulent le traité de Blois (de 1504) relatif au mariage de Claude de France, qu'ils supplient Louis XII de donner de préférence pour femme à François d'Angoulême (lequel doit être son héritier). Ainsi le Milanais peut-être, et en tout cas sûrement la Bourgogne et la Bretagne resteront à la Couronne de France. Pour témoigner à Louis XII la gratitude de la Nation pour sa bonté, et pour les réductions d'impôts qu'il a ordonnées, les États lui décernent le titre de Père du Peuple.
►1508 quatrième guerre d'Italie (1508-1513) contre Venise puis la Sainte Ligue en Italie du Nord.
►1508 - 10 décembre Paix de Cambrai. Louis XII et Maximilien Ier du Saint-Empire s'allient contre Venise. En ce jour se constitue à Cambrai une ligue qui réunit Louis XII, le pape, Maximilien Ier du Saint-Empire, Ferdinand d'Aragon et Henri VII d'Angleterre contre la sérénissime république de Venise. Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, signe pour son père Maximilien. Un contemporain décrit la ligue par ces mots : “Les grands veneurs lâchés contre le lion de saint Marc”. C'est au printemps suivant que la guerre éclate, et seule la France aura alors à en supporter le poids.
►1508 Formation entre Louis XII, Maximilien Ier du Saint Empire, Ferdinand le Catholique et le pape Jules II de la Ligue de Cambrai contre la république de Venise dont les empiétements les inquiètent et dont les procédés équivoques les ont tous plus ou moins lésés. Louis XII est à la tête des Français. Ligue de Cambrai est la conséquence du traité de Cambrai du 10 décembre 1508.
C'est une coalition militaire, regroupant Louis XII, l'empereur Maximilien Ier du Saint-Empire et Ferdinand II d'Aragon, contre Venise destinée à lui enlever certains territoires. Le pape Jules II y adhéra en mars 1509. La ligue ouvre les hostilités le 1er avril 1509. Les Vénitiens sont défaits à Agnadel, le 14 mai 1509, par les Français, grâce à l'audace de Bayard. En 1510, inquiet des progrès de Louis XII, le pape Jules II se rallie à Venise et s'engage militairement à ses côtés. Le 4 octobre 1511, il constitue la Sainte Ligue contre la France.
►1508 à 1512 - Michel-Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine à Rome. La chapelle Sixtine est l'une des salles des palais pontificaux du Vatican. À l'heure actuelle, elle fait partie des musées du Vatican. C'est dans la chapelle Sixtine que les cardinaux, réunis en conclave, élisent chaque nouveau pape. La chapelle doit son nom de "sixtine" au pape Sixte IV, qui la fit bâtir de 1477 à 1483. La voûte était autrefois peinte en bleu et constellée d'étoiles.
En 1508, Jules II demanda à Michel-Ange, qui pourtant ne pratiquait pas à l'époque la peinture à fresque, de la recouvrir. Le travail dura quatre ans, dans des conditions particulièrement éprouvantes pour le peintre. La voûte est désormais divisée en 9 panneaux représentant la création du monde. Le centre est consacré aux scènes de la Genèse, dont la très célèbre "création de l'homme", où Dieu effleure la main tendue d'Adam pour lui donner la vie.
►1508 Giorgione peint 'La tempête’
►1509 - 14 mai Victoire des Français commandés par Louis XII, à Agnadel, sur les Vénitiens. Ceux-ci, après leur défaite, retirent dans leur territoire propre, toutes leurs troupes de la terre ferme qu'elles occupaient et ouvrent une campagne diplomatique dans le but de désunir les nouveaux alliés.
►1509 à 1564 - naissance et mort de Jean Calvin. Réformateur et théologien français. Il est, avec Martin Luther, l'un des initiateurs de la Réforme protestante, en opposition à certains dogmes et rites de l'Église catholique romaine. Il développe une doctrine relativement différente de celle de Luther, doctrine qu'il expose dans son Institution de la religion chrétienne, mais c'est surtout par la pratique du culte que le calvinisme se distingue du luthéranisme. On considère généralement la doctrine de Calvin comme une radicalisation de celle de Luther. Une génération après Luther, Jean Calvin est l'organisateur de la Réforme : organisateur de l'Église, de la doctrine, du rôle de l'Église dans l'État.
Il est un grand théologien protestant. Il reçoit une formation d'humaniste et adhère à la Réforme vers 1533, condamnée en France comme hérésie. Réfugié à Bâle, il publie son ouvrage majeur, 'l'Institution de la religion chrétienne'. Nommé pasteur à Genève, la place politique décisive qu'il donne à l'Église le fait bannir de la ville. Il part pour Strasbourg en 1538 et devient pasteur des réfugiés français. Rappelé à Genève en 1541 où il demeure jusqu'à sa mort, il organise théologiquement la nouvelle Église, lui donnant une image d'austérité. Calvin recourt parfois à la force pour réduire les opposants à l'exil ou au bûcher. Il est aussi l'un des premiers écrivains en français, langue qu'il choisit pour faciliter la propagation de ses idées caractérisées par la rigueur, la logique et la clarté. En 1559, son effort d'organisation religieuse aboutit au synode de Paris qui publia quarante articles résumant la doctrine réformée.
►1509 Construction du château de Gaillon. Georges d'Amboise entreprit, entre 1502 et 1509, la réalisation d'un palais, l'une des premières merveilles de la Renaissance en France. Vastes bâtiments accompagnés de galeries et de jardins dont le lydieu est alors la perle. Ces lieux paradisiaques reçoivent en 1508 la visite du roi Louis XII et de sa femme Anne de Bretagne. Gaillon ville dans l'Eure en Normandie. Georges d'Amboise, (1460-1510), cardinal en 1498 fut premier ministre de Louis XII. Né au château de Chaumont-sur-Loire, près d'Amboise, d'une famille d'ancienne extraction, il devint l'un des aumôniers de Louis, duc d'Orléans.
►1510 - 24 février Le pape, Jules II, lève l'interdit de Venise. Jules II veut faire de l'État pontifical une grande puissance, ce qui lui vaut le surnom de Jules César II pour ses admirateurs. Dans un premier temps (1503-1509), il rétablit son autorité sur les États de l'Église, oblige César Borgia à restituer ses forteresses, à se réfugier en France. Il enlève Pérouse aux Bagloni et Bologne à Bentivoglio. Dès 1509, il adhère à la ligue, formée contre Venise par le traité de Cambrai. Il fulmine une bulle d'excommunication contre Venise, le 27 avril 1509. Les Français sont victorieux à Agnadel, le 14 mai 1509. Inquiet des progrès de Louis XII, le pape, Jules II, manifeste sa volonté de chasser d'Italie les étrangers.
Il se réconcilie avec Venise après la restitution de Faenza et de Ravenne, en février 1510 ; s'allie avec le cardinal de Sion, Mathieu Schiner, adversaire des Français, qui agit sur les cantons suisses. Louis XII commence la lutte contre Jules II en suscitant contre lui toute une campagne de pamphlets et en convoquant un concile à Pise destiné à destituer le pape. Matthieu Schiner (né en 1465 à Mühlebach, près d'Aragnon dans le Valais, mort le 1er octobre 1522 à Rome) fut un évêque de Sion, cardinal et important homme politique de son temps. L'évêché de Sion est un des évêchés catholiques suisses. Le diocèse correspond plus ou moins au canton du Valais.
►1510 - 25 novembre Les Portugais prennent Goa. Le navigateur portugais Alfonso de Albuquerque prend possession de la cité de Goa, à 400 km au sud de Bombay. La ville devient la capitale de l'empire portugais des Indes orientales jusqu'à sa restitution à l'Inde de Nehru 12 décembre 1961. Goa est un État de l'Inde, située sur la côte de sud-ouest. La région fut une colonie portugaise connue, avec Daman et Diu, sous le nom de État Portugais de l'Inde. La capitale régionale est Panaji, également appelé Panjim. Après 450 ans de présence portugaise, Goa a été envahie par les troupes de Jawaharlal Nehru le 19 décembre 1961.
►1510 juin - ordonnance de Louis XII prescrivant le déroulement de certains actes judiciaires en 'vulgaire et langage des pays' (et non plus en latin, mais une alternative existe): 'Ordonnons [...] que doresnavant tous les procez criminels et lesdites enquestes, en quelque maniere que ce soit, seront faites en vulgaire et langage du pais [...] autrement ne seront d'aucun effet ni valeur'.
►1510 Peter Henlein invente la montre de poche.
► 1510 Le Titien peint 'Le concert champêtre’
► 1510 Jérôme Bosch peint 'L'enfer et le paradis’
►1510 Érasme écrit 'Éloge de la Folie’
►1510 à 1590 - naissance et mort de Ambroise Paré, chirurgien des champs de bataille, père de la chirurgie moderne, il est l'inventeur de nombreux instruments. Il sera entre autre le chirurgien de Henri II et de ses descendants: François II, Charles IX et Henri III. L'usage nouveau des armes à feu conduit à de nouvelles plaies que l'on cautérise au fer rouge ou à l'huile bouillante au risque de tuer le blessé. Il met au point la ligature des artères, qu'il substitue à la cautérisation, dans les amputations.
►1510 mort de Sandro Botticelli.
►1511 à 1513 - La nouvelle campagne d'Italie est pour l'armée française et ses chefs une suite de faits glorieux, mais le résultat en est déplorable. Gaston de Foix (neveu de Louis XII) s'illustre à Bologne, à Brescia, à Ravenne. Bayard renouvelle ses exploits. Mais les Français sont battus à Novare entre Turin et Milan. Entre temps les Anglais avaient envahi la France au nord, et infligeaient à la chevalerie française une sévère défaite à Guinegatte en une rencontre qui fut appelée "Journée des Éperons", à cause de la rapidité avec laquelle les français se sauvèrent du champ de bataille.
La France était envahie aussi dans le sud, en Navarre, et dans l'est, par les Suisses qui s'avancèrent jusqu'à Dijon. La guerre se faisait aussi contre les Anglais sur mer : la marine française, encore bien peu nombreuse, y perdit la Belle Cordelière, vaisseau d'un modèle alors tout nouveau, et que son capitaine Primoguet, fit sauter plutôt que de le rendre à la flotte ennemie supérieure en force.
►1511 Le pape Jules II, à qui les Vénitiens ont restitué les villes qu'ils lui avaient prises dans la Romagne (région d'Italie), se réconcilie avec la République et se retourne contre Louis XII. Il noue à son tour une ligue dans laquelle ne tardent pas à entrer ceux qui hier encore étaient les alliés du roi de France, puis Henri VIII d'Angleterre. Le but de cette ligue est de chasser complètement les Français d'Italie. Henri VIII d'Angleterre (28 juin, 1491 - 28 janvier, 1547), roi d'Angleterre, était le fils du roi Henri VII et de Élisabeth. Henri devint l'héritier du trône après la mort de son frère aîné, Arthur Tudor, en 1502. Il devint roi en 1509, à l'âge de dix-sept ans.
Il est connu pour sa prodigalité, et pour ses six mariages. L'acte politique peut-être le plus important de son règne fut le passage de l'Acte d'Union de 1536, par laquelle le Pays de Galles devint une partie constituante de l'Angleterre. Il fut aussi le fondateur de la première flotte permanente de l'Angleterre, la Navy Royal. Henri crut que son mariage avec Catherine d'Aragon ne produisait pas de fils parce qu'elle avait été mariée d'abord à son frère ; il essaya donc de divorcer. Le pape refusant, il en résulta une séparation de l'église d'Angleterre de celle de Rome, événement à l'origine de l'anglicanisme, dénoncé par Elizabeth Barton. Mais son mariage avec Anne Boleyn fut également malheureux. Seul son mariage avec Jeanne Seymour fut heureux et vit la naissance d'un héritier, Édouard, qui lui succéda.
►1511 mort de Commines, chroniqueur français, auteur de 'Mémoires’
►1511 - 4 octobre Le pape Jules II crée la Sainte Ligue contre la France. Excommunication de Louis XII. Sainte Ligue, la Ligue catholique ou Sainte Ligue est une coalition ouvertement dirigée contre la France de Louis XII, constituée le 4 octobre 1511 par le pape Jules II. Elle regroupait, outre le Saint-Siège, l'Espagne de Ferdinand d'Aragon, la République de Venise et les cantons suisses, tout en étant ouverte à l'Empereur Maximilien, resté l'allié théorique des Français, qui y fait son entrée le 17 mai 1512. L'Angleterre d'Henri VIII Tudor, rejoint la Saint Ligue le 13 novembre 1511. Sainte Ligue. Alliance militaire formée en 1511 par le pape Jules II, Ferdinand d'Aragon, Venise, les Suisses et Henri VIII d'Angleterre contre le roi de France Louis XII. Cette vaste coalition parvient à chasser les Français d'Italie.
►1511 - 1er novembre Louis XII réunit un concile à Pise qui suspend Jules II. Ouverture du concile schismatique profrançais de Pise, dont l'objectif est de déposer le pape Jules II et de brider l'"omnipotence" du Saint-Siège. Le pape réplique en rappelant le droit exclusif des papes à convoquer les conciles, excommunie les prélats qui ont accepté de se rendre à Pise et convoque un concile pour avril 1512. Cette politique crée un danger de schisme et éloigne la réforme de l'Église.
►1511 - 13 novembre Henry VIII d'Angleterre rejoint la Sainte Ligue.
►1512 - 15 février Victoire de Gaston de Foix contre les Vénitiens à Vallegio. Gaston de Foix (1489-1512) comte de Foix et de Bigorre, Duc de Nemours et Pair de France, Comte d'Étampes et Pair de France, Comte de Beaufort, Vicomte de Narbonne, Baron de Puisserguier. A la mort de Gaston de Foix, le Comté fait retour à la Couronne et le Roi Louis XII le donne à son épouse, Anne, Duchesse de Bretagne. La pairie de France est un groupe de grands féodaux, vassaux directs de la couronne de France.
Il y avait à l'origine douze pairs : six pairs ecclésiastiques et six pairs laïques. Ils avaient le privilège de ne pouvoir être jugés que par la cour des pairs. Ils avaient en contrepartie l'obligation d'un hommage lige au roi de France. À partir de 1180, ils furent associés à la cérémonie du sacre. Leur rôle devint cérémoniel à partir de la fin du XIIIe siècle. La pairie, qui est un office de la couronne et non un titre de noblesse, devint un moyen pour les rois de distinguer les nobles les plus importants du royaume. Le mouvement s'accéléra au XVIe siècle : le roi nomma alors de simples gentilshommes à la pairie, les hissant au sommet de la pyramide des titres en France. Il fallait, pour être pair, jouir d'un fief auquel était attachée une pairie et descendre de la personne à qui la première avait été attribué l'office.
Le rôle des pairs de France, à l'époque de l'Ancien Régime, à la différence des pairs britanniques, était seulement honorifique. Néanmoins, les pairs conservaient d'importants privilèges, comme celui de siéger au Parlement de Paris, plus grande cour de justice du royaume. En 1814, Louis XVIII créa sur le modèle anglais une chambre des pairs, participant au pouvoir législatif. Lors des Cent-Jours, Napoléon nomme lui aussi des pairs de France. La seconde Restauration de 1815 rétablit la chambre des pairs, qui sont nommés à titre héréditaire. Après la Révolution de Juillet en 1830, le roi Louis-Philippe conserve la chambre des pairs, mais supprime l'hérédité de la pairie.
►1512 - 19 février Prise de Ravenne par les Français.
►1512 - 11 avril Victoire française à Ravenne contre la Sainte-Ligue.
►1512 - 6 juin Défaite française à Ravenne.
►1512 - 3 mai Le pape réunit un concile à Latran annulant les décisions de celui de Pise. 3 mai : ouverture du concile du Latran (XVIIIe concile oecuménique et Ve du Latran), convoqué par le pape Jules II pour faire face aux initiatives gallicanes des conciles de Pise (1409 et 1511). Il frappe le royaume de France d'interdit. Il ne prend que des décisions de détail et échoue dans sa tentative de réforme de l'Église catholique. La suprématie romaine est réaffirmée (fin en 1517).
Le Ve concile du Latran se tient du 3 mai 1512 au 16 mars 1517 dans la basilique Saint-Jean de Latran, à Rome. Au terme de douze sessions, le concile condamne le schisme, soumet la parution des livres imprimés à l'autorité de l'Église et réforme la Curie romaine et le clergé. Le Ve concile du Latran est convoqué par Jules II (1503–1513) pour faire pièce à celui de Pise, tenu en 1511 sur l'initiative de Louis XII de France, soutenu par l'Empereur. La Curie romaine est l'ensemble des organismes administratifs du Saint-Siège, assistant le pape dans sa mission de gouvernement de l'Église catholique romaine.
Curie romaine. On désigne ainsi l'ensemble des administrations et des organismes judiciaires par l'intermédiaire desquelles le pape gouverne l'Église catholique. Cette institution remonte au IVe siècle. Remaniée plusieurs fois au cours de l'histoire, elle comprenait au Moyen Âge la Chambre apostolique (finances), la Chancellerie (lettres papales), l'administration judiciaire et la Pénitencerie. Aujourd'hui, la curie romaine compte vingt et un organismes différents.
►1512 - 17 mai Maximilien Ier du Saint-Empire rejoint la Sainte Ligue.
►1513 - 20 février Mort du pape Jules II.
►1513 - 11 mars Avènement du pape Léon X. Léon X, Jean de Médicis, second fils de Laurent de Médicis et de Clarisse Orsini, Jean de Médicis naquit le 11 décembre 1475 à Florence et mourut à Rome le 1er décembre 1521. Il fut pape sous le nom de Léon X de 1513 à 1521.
►1513 - 6 juin Défaite française à Novare; évacuation de l'armée française d'Italie. Novare est une ville d'Italie, située dans le Piémont.
►1513 - 16 août : Bataille de Guinegatte (Journée des Éperons), près de Saint-Omer : la cavallerie française s'enfuit devant les forces de Henry VIII d'Angleterre au cours de la "journée des Eperons" où le maréchal de La Palice est fait prisonnier. La Bataille de Guinegatte eut lieu le 16 août 1513 près de Saint-Omer dans l'actuel Pas-de-Calais et opposa les troupes françaises dirigées par Louis XII à la coalision anglo-germanique dirigée par Henri VIII d'Angleterre et par Maximilien Ier du Saint-Empire réunis sous la bannière de la Ligue catholique. Suite à la funeste bataille de Novare du 6 juin 1513, Louis XII dut evacuer son armée d'Italie et songer à défendre le territoire français.
Henri VIII d'Angleterre, débarqua le 30 juin 1513 à Calais et se joignit aux troupes menées par Maximilien Ier de Prusse. Six semaines plus tard, les français duc de Longueville (Louis de Longueville), le maréchal La Palice et leurs troupes) se laissèrent surprendre et se faire écraser par cette coalition de la Sainte Ligue à la Guinegatte ce 16 août 1513. Cette bataille fut aussi appelée Journée de éperons car la cavalerie française se servit plus de ces éperons pour manoeuvrer que de ces armes. Au cours de cette bataille, le maréchal La Palice fut fait prisonnier mais il put s'échapper et prendre part plus tard à la prise de Villefranche et à la bataille de Marignan (1515).
►1513 - septembre Les Suisses envahissent la Bourgogne.
►1513 - 14 septembre Traité de Dijon, perte de Milan et d'Asti, Louis XII ne le ratifiera pas. Le traité de Dijon du 14 septembre 1513 mis fin à la tentative de conquête par les Allemands, Suisses et Franc-comtois du Duché de Bourgogne, et fut signé du côté suisse par Jacques de Watteville, avoué de Berne et du côté français par Louis II de la Trémoille qui réalisa une habile négociation. Le traité prévoyait que: Le Roi de France rendrait ses terres italiennes au Pape (Ce qui était déjà fait avant la signature); Le Roi de France aurait à payer aux Suisses de Zurich, en deux termes, la somme de 400 000 écus d'or, dont 20 000 comptant, au moment où le siège serait levé.
Le Roi de France s'engageait à régler les nombreuses dettes de la couronne de France auprès des Suisses. Louis XII renonçait solennellement à tous ses droits sur le duché de Milan, sur la seigneurie de Gênes, sur le comté d'Asti, et abandonnait le tout à Maximilien Sforza. Il désavouait formellement le concile de Pise et adhérait sans réticence au concile de Latran. Louis XII refusa de ratifier ce traité, sous prétexte que le Général La Trémoille avait agi sans avoir reçu les pouvoirs suffisants (ce qui était faux) et que certaines clauses étaient attentatoires à sa royale majesté : l'abandon du duché de Milan et du comté d'Asti était tout à fait inacceptable.
En fait il semble que Louis II de la Trémoille ait signé ce traité pour mettre fin au siège de Dijon en ayant bien conscience qu'il ne serait jamais ratifié par le roi mais en estimant que c'était la seule façon d'éviter la prise de la ville. Les Suisses, les Allemands et les Franc-Comtois levèrent le siège en emmenant 5 otages dont Philippe de Maizière neveu de Louis de la Trémoille qui attendirent en vain et dans de piètres conditions le versement des sommes promises. Leurs familles durent finalement payer elles-mêmes une rançon de 13 900 écus pour obtenir leur libération le 3 Octobre 1514.
►1513 - 26 septembre Découverte de l'Océan Pacifique. L'espagnol Vasco Nunez de Balboa est le premier européen à voir l'océan Pacifique et à le faire savoir. Parti pour le nouveau monde en 1500, l'aventurier découvre depuis le sommet d'une montagne une mer inconnue qu'il nomme "mer du sud". Balboa, qui a franchi à pied l'isthme de Panama, prend possession de cette nouvelle mer au nom de la couronne espagnole. C'est le portugais Fernand de Magellan qui la baptisera "pacifique" en 1520, afin de rendre hommage à la clémence de ses eaux. Vasco Nunez Balboa (Jerez de Los Caballera, 1475 - Acla 1519). Explorateur espagnol. Balboa voyage avec Rodiguo de Bastidas en 1501 vers l'Amérique du Sud.
Ils comptent faire du commerce de perles selon les indications de Christophe Colomb. Ils atteignent et explorent le continent puis s'en retournent vers Saint Domingue. Balboa débarque et y passe plusieurs années, puis s'embarque à nouveau vers le continent sur un navire qui emporte des vivres à la colonie fondée par Ojeda. Le navire rencontre les rescapés de la colonie (parmi eux Pizarro) et Balboa en prend le commandement. Ils s'enfoncent alors dans le golfe d'Uraba vers l'ouest et fondent une ville, Santa Maria de la Antigua del Darien. Là, Balboa s'allie avec le roi indien de la région en prenant pour femme une de ses filles. L'aventure reprend en 1513 lorsqu'un des fils du roi indien conduit les espagnols au travers de la jungle combattre un royaume ennemi de son père en échange de promesses d'un riche butin.
La petite troupe espagnol et les indiens alliés défont et massacrent l'ennemi. Après cette victoire, Balboa montre sur une hauteur voisine et découvre émerveillé le Pacifique s'étendant à ses pieds. Il est le premier Européen à jeter son regard sur l'océan appeler ainsi pour son tranquilité. Deux jours plus tard, lui et ses compagnons (dont Pizarro) mettent pied sur le sable. Au retour, Balboa soumet d'autres chefs locaux, et une fois rentrée à Darien, il n'aura pas perdu un de ses soldats espagnols (nous ne pouvons hélas en espérer autant de ses alliés). L'exploit n'apportera pas le gloire attendu. Bien au contraire, le nouveau gouverneur de la région, De Avila, nommé par le roi Ferdinand en 1514 fait arrêter l'explorateur par Pizarro, le fait juger et condamner à mort.
►1513 Publication du 'Prince' de Nicolas Machiavel, traité de philosophie politique où il analyse la manière de garder le pouvoir.
►1514 - 9 janvier Mort d'Anne de Bretagne.
►1514 avril Fin des hostilités en Italie.
►1514 - 18 mai Mariage de Claude de France et de François d'Angoulême (futur François Ier).
►1514 - 7 août Traité de Londres prévoyant le mariage de Louis XII et Marie d'Angleterre. Marie d'Angleterre (18 mars1496 - 24 juin1533) : fille cadette d'Henri VII Tudor et d'Élisabeth d'York. D'abord promise en mariage à Charles (futur empereur romain germanique), elle épousa finalement Louis XII de France, qui la laissa veuve après quelques mois de mariage. Elle épousa en secondes noces Charles Brandon, duc de Suffolk, dont elle eut trois enfants : Henry, Frances et Eléanor.
►1514 Louis XII se réconcilie avec Henri VIII, dont il épousa la soeur (Traité de Londres). Cessation des hostilités contre la France par suite d'accords entre Louis XII et les confédérés encore agissants. II est remarquable que les revers militaires et diplomatiques essuyés par Louis XII n'ont pas nui à la prospérité intérieure de la France. La Couronne s'est vue à plusieurs reprises dans de grands embarras financiers, néanmoins au cours du règne, la population s'est accrue, le commerce s'est développé, le bien-être s'est étendu - et le roi est resté populaire.
Louis XII a été puissamment aidé dans la bonne conduite des affaires intérieures par son premier ministre, le cardinal Georges d'Amboise, auquel la population garde autant de reconnaissance qu'à lui-même. Le Cardinal Georges d'Amboise (issu de l'ancienne famille des Seigneurs d'Amboise) fut l'ami, le confident et le conseiller du Roi Louis XII. A l'avènement de ce dernier il devient le personnage le plus important du royaume après le Roi et le resta jusqu'à sa mort en 1510.
►1514 - 9 octobre Mariage de Louis XII et Marie d'Angleterre à Abbeville. Louis XII a cinquante-deux ans. Il est veuf. Et sans héritier direct. Il épouse en ce jour la belle, blonde et sensuelle soeur du roi Henri VIII d'Angleterre. Elle n'a guère que dix-sept ans.
►1514 Guillaume Budé écrit 'De Asse et partibus ejus'. Guillaume Budé (26 janvier 1468, Paris -1540), humaniste français né à Paris, est également connu sous le nom latin de Budaeus. Il est issu d'une grande famille de fonctionnaires royaux anoblie par Charles VI de France. Dès le début du règne de François Ier, il se rapproche de la cour royale pour y plaider la cause des belles-lettres et de la philologie.
Il est le père du Collège de France, en militant pour la création d'un collège où seraient enseignées les langues de l'antiquité, le latin, le grec, l'hébreu, fondé en 1530 par François Ier. C'est à la requête d'Érasme qu'il entreprend une compilation de notes lexicographiques sur la langue grecque qui fut pendant longtemps en France, l'ouvrage de référence pour celui qui voulait se lancer dans l'étude du grec. Il porte le titre de Maître de la Librairie du Roy. Il est lié avec Thomas More, Bembo, Étienne Dolet, Rabelais et surtout Érasme.
►1515 - 1er janvier Mort de Louis XII à Paris. La couronne passe au gendre de Louis XII, François d'Angoulême, fils de Charles d'Orléans et de Louise de Savoie, né en 1494, qui prend le nom de François Ier. L'année même de son avènement, impatient de venger les échecs militaires que la France vient de subir, et de reprendre le Milanais, François Ier rassemble en hâte une armée de près de 35 000 combattants, franchit hardiment les Alpes au col de l'Argentière et fond sur le Milanais où, la première surprise passée, les troupes suisses ennemies lui opposent une résistance héroïque. Néanmoins, elles sont taillées en pièces à Marignan (environs de Milan) dans une bataille de deux jours (13 et 14 septembre). Après cette victoire, François se fait armer chevalier par Bayard. La victoire de Marignan rend François Ier maître du Milanais et décide le doge de Gênes à lui faire la remise du territoire de cet État.
►1515 VALOIS - ANGOULÊME.
►1515 Le rameau d'Angoulême : Jean, comte d'Angoulême, fils de Louis Ier d'Orléans ; Charles, comte d'Angoulême ; François Ier de France (1515-1547) ; Henri II de France (1547-1559) ; François II de France (1559-1560) ; Charles IX de France (1560-1574) ; Henri III de France (1574-1589) ; Henri III est le dernier roi de la maison de Valois. Henri IV lui succède et amène sur le trône de France la maison de Bourbon.
►1515 FRANÇOIS Ier, le Père et Restaurateur des Lettres (1515-1547)
►1515 François Ier. Louis XII meurt sans descendance mâle son petit cousin et gendre François est appelé à règner sous le nom de François Ier. Il est l'arrière petit fils de Louis Ier d'Orléans frère de Charles VI et le fils de Charles comte d'Angoulême et de Louise de Savoie. Il brûle de reconquérir Milan, il s'assure l'alliance avec les Vénitiens et le duc de Milan celle des Suisses, l'armée franchit les Alpes au col d'Argentière et marche sur Milan. La bataille décisive se livre non loin de Milan à Marignan, le tir nourri de l'artillerie, la charge des gendarmes dirigée par le roi, la participation décisive du chevalier Bayard, l'arrivée des Vénitiens qui prennent les Suisses à revers assure la victoire (13 et 14 septembre 1515).
A la suite de cette bataille François Ier se fera armer chevalier par Bayard en signe de reconnaissance. Le nouveau pape Léon X signe avec lui le concordat de 1516 (le pape nomme les évêques français sur proposition du roi). Les Suisses concluent une paix perpétuelle et le roi de France à le droit de lever des soldats dans les cantons suisses. Le roi d'Espagne Charles Ier (futur empereur Charles Quint) garde le royaume de Naples et François Ier le Milanais. En 1519 Charles Quint est désigné empereur et devient maître de l'Allemagne.
François Ier candidat n'a pas été élu mais de ce fait la France est prise en tenaille entre l'Allemagne et l'Espagne. François Ier souhaite conclure une alliance avec l'Angleterre, c'est l'entrevue du camp du drap d'or au cours de laquelle François reçoit Henri VIII d'Angleterre dans un tel luxe que celui-ci est vexé et c'est un échec diplomatique. L'Angleterre s'allie à Charles Quint. Cette fois ci la France est encerclée. La guerre entre Charles Quint et François Ier durera tout le règne de celui-ci. La première guerre à partir de 1521 conduit à l'abandon du Milanais, Bayard est tué, François fait prisonnier au cours de la défaite de Pavie en 1525. Il n'est libéré qu'en laissant ses deux fils ainés en otage, et en signant le traité de Madrid en 1526 par lequel il s'engage à cèder la Bourgogne à Charles Quint et à renoncer à ses prétentions italiennes.
Une fois libre il refuse d'appliquer le traité et met sur pied une nouvelle expédition italienne qui ne donne rien. Une paix est signée en 1529, François Ier renonce à l'Italie et épouse la soeur de Charles Quint (Éléonore de Habsbourg) en 1530 alors que celui-ci laisse la Bourgogne à la France. Mais ses ambitions sur le Milanais sont toujours là, il se rapproche des princes protestants allemands et même du Turc Soliman. La guerre reprend, elle ne donne rien une trève est signée en 1538. Une dernière confrontation à lieu à partir de 1542, les Français seront vainqueurs à Cérisoles en 1544 et cette fois le traité de Crépy-en-Laonnais mettra fin définitivement à sa période belliciste mais renonce à l'Artois, la Flandre et au Milanais.
Sur le plan intérieur son règne marque l'avènement de l'absolutisme royal. La noblesse n'est plus qu'une noblesse de cour pensionnée par le roi. Par l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 il fait du français la langue officielle (abandon du latin pour les textes officiels) ce qui fera beaucoup pour l'unification du royaume, il institue les registres paroissiaux ancêtres de l'état civil. Il encourage les arts et les lettres, il fonde le collège des lecteurs royaux en 1530 (futur Collège de France) et l'imprimerie royale en 1539. Il attire et protège des artistes réputés: Léonard de Vinci, Della Robia, Benvenuto Cellini... Il fait ouvrir de nombreux chantiers, châteaux de Blois, de Chambord, de Fontainebleau, de Saint-Germain-en-Laye, Hotel de ville de Paris, nouvelles ailes du Louvre.
Il fonde le port du Havre. Sur le plan religieux, le protestantisme fait son entrée en France à partir de 1520. Il faut comprendre l'importance de la religion catholique de l'époque, c'est le ciment de la nation. Lorsque Jeanne d'Arc fait sacrer Charles VII à Reims elle amorce un retournement complet de la situation, se diviser sur le plan religieux c'est diviser le royaume. Au début François Ier se montre tolérant mais pendant qu'il est prisonnier, c'est sa mère Louise de Savoie qui assure la régence (sa femme Claude est morte l'année précédente) sous la pression du parlement, elle prend les premières mesures répressives, le prètre, Jacques Pauvent et l'humaniste Berquin périssent sur le bûcher.
Les protestants trouvent une plus grande bienveillance auprès de Maguerite de Navarre soeur du roi. Mais en 1534 les protestants affichent des textes que le roi ne peut admettre traitant notamment le pape d'antechrist, c'est l'affaire des Placards (du verbe placarder, afficher) et il décide de sévir il y aura 66 exécutions pendant le règne de François Ier. François Ier meurt en 1547, c'est son fils Henri II qui lui succèdera.
►1515 La France du roi François Ier compte sans doute 16 millions d'habitants en 1515, et 17 millions lorsque s'achève le règne de celui qui porte (comme aucun de ceux qui l'ont précédé) le titre de Majesté. Elle est le pays le plus peuplé d'Europe. Et malgré les années de guerres, malgré les invasions, malgré les impôts – celui de la taille qui triple entre 1515 et 1559, celui de la gabelle qui taxe le sel et qui ne cesse d'augmenter –, la France est riche. Elle l'est malgré des prix qui croissent, en partie à cause de l'afflux de l'or et de l'argent, rapportés des Amériques par les Espagnols, elle l'est malgré l'écart qui se creuse entre ceux qui s'enrichissent et les humbles, les compagnons et les ouvriers.
Leurs salaires ne suivent pas l'augmentation des prix et ces derniers se révoltent à Lyon, en 1529, à cause du prix du blé. Autour des villages qui se repeuplent, les friches et les landes commencent d'être changées en terre à céréales, les forêts sont défrichées. De nouveaux fruits et de nouveaux légumes, pour la plupart importés d'Italie, apparaissent dans les champs et les vergers. Si le melon et l'artichaut ne sont encore destinés qu'aux seigneurs, le sarrasin, le maïs, les choux-fleurs et les haricots commencent d'être cultivés. D'aucuns, rares, se singularisent en portant tel ou tel de ces légumes à leur bouche avec un instrument qui vient de faire son apparition et qui épargne que l'on mange avec ses doigts : la fourchette...
Certaines sont sans doute forgées dans l'une des 460 forges que compte le royaume. En dépit du manque d'argent, de cuivre ou de plomb qu'il faut importer, l'industrie prospère. L'accroissement de la population dans les villes, l'enrichissement de celles-ci permettent le développement du luxe. Lyon, qui est à la frontière du royaume et qui accueille des foires, devient la capitale de l'imprimerie comme de la banque. Nombreuses sont les sociétés financières qui se créent et dont les filiales vendent des créances, comme elles spéculent sur le change. Elles ne se privent pas de répondre aux emprunts d'État. Le premier d'entre eux, en 1522, gagé sur les impôts de l'Hôtel de Ville de Paris, propose 8% d'intérêt.
La soie, produite à Lyon à partir de 1536, par plusieurs milliers de métiers, comme auparavant à Tours, ne suffit pas à satisfaire les exigences de la cour... Angoulême est célèbre pour ses papeteries. A Saint-Étienne, c'est une fabrique de mousquets qui est fondée en 1516. Mais les routes pour aller de l'une à l'autre de ces villes sont loin d'être ce qu'elles devraient être. Les ports, en revanche, prennent plus d'ampleur. Le Havre est créé en 1517. Des navires sont armés pour Terre-Neuve à La Rochelle dès 1533. Rouen, grâce à son port, est devenue la deuxième ville de France. Et Marseille ouvre la route vers le Levant.
A Dieppe, où l'on dresse et où l'on corrige les cartes de mondes nouveaux que l'on découvre, l'armateur Jean Ango arme des navires qui atteignent Sumatra. C'est de Saint-Malo qu'à trois reprises Jacques Cartier part pour le Canada. L'iroquois, qu'il présente au roi à son retour, change moins la conscience que la France a alors du monde que les lectures et les études, faites par certains, des auteurs de l'Antiquité. Sur l'ordre du roi, Jacques Amyot traduit Plutarque. En dépit des réticences de la Sorbonne, le roi crée en 1530 le Collège royal qui compte cinq chaires : deux d'hébreu, deux de grec et une de mathématiques. Dès les années qui suivent l'éloquence latine, la médecine, la philosophie sont enseignées dans ce collège que l'on dit “des trois langues”.
Et c'est la langue française qui prend un autre essor. En 1539 l'ordonnance de Villers-Cotterêts impose que les actes judiciaires soient désormais écrits en français et non plus en latin. Dix ans plus tard, le titre seul de Défense et illustration de la langue française de Joaquim du Bellay, publié en 1549, suffit à montrer que les écrivains ont désormais foi dans leur langue. Les oeuvres des poètes de la Pléiade comme le succès du Pantagruel de Rabelais, publié en 1532, démontrent en quelques années que le français peut être la langue de l'élégance comme celle de la truculence, celle de la grâce et celle de l'invention.
Comme il donne à la langue française un nouveau statut, le roi impose une nouvelle architecture en France. Les châteaux d'Azay-le-Rideau, de Chenonceaux, de Blois, de Chambord, de Fontainebleau... plus tard ceux de Madrid, construit dans le Bois de Boulogne à côté de Paris, de Saint-Germain, d'Anet ou encore le Louvre mettent en évidence la singularité de la Renaissance française. L'équilibre et la symétrie des façades s'allient aux charmes et aux surprises de galeries, couvertes de fresques et de stucs, élaborées par des artistes venus d'Italie. La reconnaissance de la beauté, de l'intelligence, de l'invention, le soutien aux artistes constituent l'ultime argument d'un roi qui, en dépit des défaites et de la captivité, est conscient des changements d'une nouvelle époque et veut affermir son pouvoir.
Mais ce roi, en dépit d'un concordat signé en 1516 avec le pape Léon X, concordat qui lui accorde le droit de désigner les évêques, commence à perdre un pouvoir, jusqu'alors incontesté, sur la conscience de ses sujets. Dès 1512, le 'Commentaire sur les épîtres de Saint Paul' de Lefèvre d'Étaples assure que la doctrine du Christ est tout entière dans les Saintes Écritures. Il remet en cause les dogmes et affirme que nos oeuvres ne sont rien sans la grâce. Il devient vicaire général de Guillaume Briconnet, évêque de Meaux, qui commence en 1516 d'épurer les moeurs des prêtres de son diocèse, de mettre fin à la concussion. La Sorbonne est exaspérée par les thèses des biblistes de Meaux.
Mais les colères de Luther, qui a affiché ses 95 thèses sur les murs de l'église de Wittenberg en 1517, ses diatribes et ses invectives contre l'Église romaine sont autrement graves. Dès 1523, un autodafé de ses livres est ordonné. “On commence par brûler les livres, on finit par brûler les personnes !” Cette certitude d'Érasme de Rotterdam ne tarde pas à devenir une réalité. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, une affiche, “Articles véritables sur les horribles, grands et insupportables abus de la messe papale, inventée directement contre la Sainte Cène de Notre Seigneur”, est placardée sur la porte même de la chambre du roi à Amboise. Cette “affaire des placards” détermine le roi, qui jusqu'alors hésitait, à réprimer la réforme qui commence de diviser l'Europe autant que son royaume. Henri VIII d'Angleterre, excommunié en 1534 parce que le pape a refusé d'annuler son mariage, fait le choix de la Réforme comme d'autres en Suisse, aux Pays-Bas, comme les princes allemands de la ligue de Smalkalde.
A la voix de Luther se joint celle de Jean Calvin qui a fait ses études à Paris, à Bourges et à Orléans. En 1536, à vingt-cinq ans, il publie à Bâle (où il a dû se réfugier) l'institution chrétienne, qui sera publiée en français en 1541. Un an plus tôt le roi a fait publier une ordonnance dans laquelle il fait le voeu que "en son royaume très chrestien soit toujours continue, gardée, entretenue intégrité et sincérité de la foy catholique, qui est le principal fondement du royaume”. En dépit des bûchers, des massacres, des guerres, la vérité religieuse de la France ne sera plus jamais celle qu'espère le roi.
►1515 - 25 janvier Sacre de François Ier à Reims. Le sacre du roi qui est âgé de dix-neuf ans a lieu en l'absence de la reine qui est sur le point d'accoucher. Elle sera couronnée en 1517.
►1515 - 4 mars Alliance avec Venise pour reprendre le Milanais.
►1515 - 24 mars Traité de Paris avec Charles Quint, roi d'Espagne, roi de Sicile puis empereur germanique, prévoyant son mariage avec Renée de France. Charles Quint, Charles de Habsbourg ou Charles Quint, (né le 25 février 1500 à Gand - mort le 25 septembre 1558 au monastère de Yuste (Espagne) fut empereur germanique (1519-1555) sous le nom de Charles V d'Espagne officiellement sous le nom de Charles Ier mais surtout connu sous le nom de Carlos Quinto en Espagne et en Amérique latine et roi de Sicile sous le nom de Charles IV (1516-1558). Charles était le fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle et, par celle-ci, petit-fils de Ferdinand le Catholique et d'Isabelle Ière de Castille.
Charles Quint hérite successivement du royaume de Bourgogne à la mort de son père, Philippe Ier, roi de Castille en 1506, du royaume d'Espagne à la mort de son grand-père maternel Ferdinand V en 1516, et des possessions des Habsbourg en Europe centrale en 1519, à la mort de son grand-père paternel, l'empereur Romain-Germanique Maximilien Ier. Élu à la tête du Saint-Empire en 1519, il gouverne sur un immense territoire comprenant les royaumes espagnols d'Aragon et de Castille, les Pays-Bas, les États italiens de Naples, de Sicile et de Sardaigne, les territoires conquis en Amérique et en Afrique, ainsi que l'ensemble des possessions des Habsbourg.
Rival de François Ier, qui avait brigué la couronne impériale, il mène contre lui trois guerres (1521-29, 1536-38, 1539-44). Son accession au trône impérial coïncide avec la montée en puissance du luthéranisme. Il se consacre à la lutte contre le protestantisme et à la défense de l'Empire contre les Turcs qui, après avoir soumis la péninsule balkanique, ont déclaré la guerre à la Hongrie et assiégé Vienne. La période d'anarchie qui accompagne l'essor de la Réforme pousse les princes allemands à réclamer l'autonomie de leurs États.
Les paysans profitent des troubles pour se révolter. En 1530, Charles réunit la diète d'Augsbourg pour tenter de régler le problème religieux, mais les princes protestants lui opposent la Confession d'Augsbourg, qu'il juge inacceptable. Puis il poursuit la guerre contre la France sous Henri II. Épuisé par ces luttes constantes, Charles Quint cède entre 1555 et 1556 les Pays-Bas et l'Espagne à son fils Philippe II, abdique en 1556 en faveur de son frère Ferdinand Ier, pour se retirer dans un monastère en Espagne, où il meurt en 1558.
►1515 - 9 août L'armée française passe les Alpes.
►1515 - 14 septembre Victoire de François Ier (en partie grâce à l'aide de Venise) à Marignan contre les mercenaires Suisses des États italiens, et prise de Milan. La neutralité perpétuelle des Suisses date de cette époque. Le Milanais est ouvert et François Ier bénéficie d'une alliance avec les Suisses (engagement de mercenaires). La bataille fait 30 000 victimes. En ce 13 septembre commence une bataille décisive dans la reconquête du Milanais par un roi de France qui a vingt et un ans. François Ier, que le chevalier Bayard adoube avant la bataille, lance à ses soldats : “Je suis votre roi et votre prince…
Je suis délibéré de vivre et mourir avec vous. Voici la fin de notre voyage, car tout sera gagné ou perdu”. Le lendemain soir tout est gagné. A sa mère, Louise de Savoie, le roi écrit : “Et tout bien débattu, depuis deux mille ans n'a point été vue une si fière ni si cruelle bataille”. Au cours de ce que les chroniqueurs ont appelé une “bataille de géants”, 14 000 Suisses et 2 500 Français et Vénitiens sont morts. La bataille de Marignan, eut lieu pendant les guerres d'Italie, les 13 et 14 septembre 1515 et opposa François Ier de France et ses alliés Vénitiens aux Suisses qui défendaient le Milanais.
La bataille de Marignan, à l'aube du règne de François Ier, est devenue un symbole de la gloire du roi. La défaite des Suisses est un évènement, car ceux-ci ont acquis, par leur discipline, une réputation d'invincibilité. Elle évoque un autre grand chef de l'Antiquité, Jules César, qui fût l'un des rares à battre les Suisses. Elle s'inscrit ainsi dans le début de la Renaissance, avec pour la première fois l'utilisation décisive de l'artillerie. Les artistes italiens, dont Léonard de Vinci, vont alors s'ouvrir à la France.
►1515 - 13 octobre Traité de Viterbe, le pape accorde Milan à François Ier en contrepartie de sa protection. Viterbe est une ville italienne.
►1515 - 11 décembre Entrevue de Bologne entre François Ier et Léon X. La victoire que François Ier vient de remporter à Marignan lui assure un prestige incomparable dans toute l'Europe. Le pape Léon X préfère conclure une alliance avec lui. Il annule la pragmatique sanction, et la remplace par un concordat qui met fin à tous les différends entre la France et le Vatican. Concordat de Bologne supprimant la Pragmatique sanction de Bourges : le pape retrouve son influence sur la nomination des évêques de France.
►1515 Joachim Patinir peint 'La tentation de Saint Antoine'. Joachim Patinir (vers 1480-1524) peintre flamand, l'un des premiers grands maîtres européens de la peinture de paysage. Joachim Patinir se forme dans la riche ville d'Anvers, où il passera l'essentiel de sa carrière. Il travaille aux côtés de Quentin Metsys et Joos van Cleve et connaît rapidement une très grande renommée et la reconnaissance de ses contemporains, tel Albrecht Dürer.
►1515 Clément Marot écrit 'Le Temple de Cupido’
►1516 - 13 août Traité de Noyon prévoyant le mariage de Louise de France (1515 - 1517) avec Charles Quint et la France obtient le Milanais mais abandonne Naples. François Ier renonce à Naples. Charles Quint renonce à la Bourgogne. La victoire de Marignan a permis cet accord. Le Traité de Noyon est signé en 1516, à Noyon, entre Charles Quint et François Ier.
La paix est renouvelée, par la restitution de la Navarre à Henri d'Albret. On convient aussi que Charles épouse la princesse Louise, fille du roi, âgée d'un an. Maximilien Ier du Saint Empire rend Vérone au roi d'Espagne pour la remettre au roi, qui la restitue aux Vénitiens. Les deux princes Charles et François se donne mutuellement, l'ordre de la Toison pour François, celui de Saint-Michel pour Charles.
►1516 - 18 août Concordat de Bologne entre François Ier et Léon X, le clergé français cesse d'être un corps pour devenir un ordre et un rouage de la monarchie absolue. Léon X et François Ier signent un traité par lequel le pape obtient un droit de regard sur les élections canoniques majeures. le roi quant à lui obtient le droit de contrôler le haut clergé et de nommer les évêques. Ils espèrent ainsi disposer de moyens leur permettant de juguler l'hérésie protestante qui vient de naître.
Le concordat de Bologne est signé le 18 août 1516, lors du Ve concile du Latran, entre le pape Léon X et le chancelier Duprat qui représentait le Roi de France, François Ier. Ce concordat mit fin à la Pragmatique Sanction de Bourges et fonda le gallicanisme. Il permit la mise en place dans le Royaume de France du Régime de la commende. Les évêques et abbés ne sont plus élus comme il était coutume avant, mais choisis par le roi de France. Le pape investit ensuite spirituellement les candidats du monarque français. Les nommés jurent ensuite fidélité au roi de France qui leur donne leur charge temporelle. Le concordat de Bologne permet au roi de fidéliser la noblesse.
►1516 - 29 novembre Paix perpétuelle entre François Ier et les cantons suisses. Paix de Fribourg, paix “perpétuelle” que le roi de France François Ier signe avec les Suisses. Ceux-ci reçoivent près de 300 000 écus d'or pour leurs frais. Les Suisses s'engagent à ne plus apporter leur concours à des adversaires de la France.
►1516 à 1517 - Débuts de la Réforme religieuse; en 1516, Zwingle, curé de Zurich, prêche en Suisse contre l'adoration des reliques, les moeurs des moines et le luxe de la cour de Borne; en 1517, Luther, en Allemagne, prêche contre le trafic que fait des indulgences la cour de Rome pour remplir son trésor. L'indulgence, dans la religion catholique, l'indulgence est une rémission ou relaxation des peines temporelles, dues pour les péchés actuels, par l'application des satisfactions surabondantes de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et de tous les saints, qui sont renfermées dans les trésors de l'Église.
Au Moyen Âge, le clergé avait établi un véritable barème de ces bonnes actions, échangeant par exemple une participation aux croisades contre l'accès au paradis sous les réserves sus-nommées. On monnayait également des dispenses à diverses obligations, les sommes ainsi récoltées finançant des édifices religieux... ou permettant à certains prélats de mener grand train. Ainsi la Tour de beurre de la cathédrale Notre-Dame de Rouen doit son surnom à la vente des dérogations accordées pour consommer des matières grasses pendant le carême.
Le caractère particulièrement injuste de ces pratiques conduisit Martin Luther à se révolter contre la hiérarchie ecclésiastique de l'époque. C'est donc une des causes du schisme entre catholiques et protestants. Réforme, Le Moyen Âge a cédé sa place à l'époque moderne à la suite de deux révolutions. La première fut une révolution intellectuelle caractérisée par l'arrivée de l'humanisme et celle de la Renaissance. À l'intérieur de cette révolution, une nouvelle vision du monde et de l'homme est apparue. C'est avec cette révolution qu'un retour à l'Antiquité est survenu.
La deuxième révolution fut une réforme religieuse. Celle-ci a eu un impact considérable sur l'avenir de la religion. Historiquement, la Réforme est le nom donné à la remise en cause de l'Église catholique romaine par de nombreux théologiens tels que : Théodore de Bèze, Martin Bucer, Jean Calvin, Guillaume Farel, John Knox, Martin Luther et Ulrich Zwingli. Elle avait été préparée par d'autres théologiens comme : Jan Hus et John Wyclif. Elle a donné naissance au protestantisme. La tradition veut qu'elle ait commencé avec l'affichage par Martin Luther de 95 thèses contre les travers de l'Église, sur la porte de l'église du château de Wittenberg, le 31 octobre 1517.
Mais c'est sa nouvelle compréhension de l'Évangile qui en définit le contenu : un salut donné gratuitement à cause de Jésus-Christ, connaissable par la seule Bible mise à la disposition de tous sans intermédiaires humains. La Réforme. On utilise ce mot pour décrire le bouleversement majeur de la chrétienté, initié par Martin Luther au XVIe siècle, mais le mouvement s'apparente plus à une révolution religieuse qu'à une simple réforme. Elle débouche sur la création d'un nouvel ordre religieux qui divise l'Europe entre protestants et catholiques (qui restent fidèles au pape). Pour lever des fonds, le pape a favorisé la vente d'indulgences, promettant la rémission des péchés et du temps de purgatoire contre un simple paiement.
Luther, docteur en théologie à l'université de Wittenberg, s'élève contre le trafic des indulgences, puis contre leur principe même, dans ses 95 thèses (1517). Il est parfaitement sincère dans sa remise en question des pratiques de l'Église et a lui-même passé plusieurs années dans un monastère, tourmenté par le salut de son âme. Il refuse de se rétracter, brûle en public la bulle papale notifiant son excommunication et fonde une nouvelle Église qui reconnaît la Bible comme seule autorité sur la doctrine chrétienne, et le baptême et l'eucharistie comme seuls sacrements. Rapidement, les enseignements de Luther trouvent un écho important en Allemagne et ailleurs, notamment en France et en Suisse avec Calvin. L'Europe se divise alors sur la question religieuse, chacun étant fermement convaincu que le salut de son âme dépend de sa loyauté envers l'une ou l'autre des Églises.
►1516 à 1520 - En 1516, Charles d'Autriche est devenu roi d'Espagne par suite de la mort de son aïeul maternel Ferdinand : il a pris le nom de Charles V (Charles Quint). Ce prince devient le plus puissant de la chrétienté lorsque, en 1519, il succède à son aïeul paternel dans la possession des duchés d'Autriche : il possède alors les Pays-Bas, les Flandres, l'Espagne, le royaume de Naples et l'Autriche ; il a été élu empereur d'Allemagne, enfin il joint à ses possessions les immenses et riches territoires de l'Amérique dont on ne connaît pas encore à cette époque l'étendue.
La puissance de Charles Quint, sans égale au monde, est une menace permanente pour la France et pour le reste de l'Europe ; l'équilibre européen est rompu à son profit. C'est pour rétablir cet équilibre que vont s'engager de nouvelles guerres, premiers résultats de la rivalité entre la Maison de France et la Maison d'Autriche. François Ier ne soutiendra pas moins de quatre de ces guerres.
►1516 Thomas More écrit 'Utopia'. Thomas More (1478-1535), homme politique, surnommé "le Socrate chrétien", était le plus illustre représentant de l'Humanisme anglais. Philanthrope, son ouvrage majeur, Utopia, prône la tolérance et la discipline au service de la liberté, à travers un monde imaginaire et merveilleux, représentation du monde idéal de l'auteur. Mais ce fut aussi un homme politique, devint chancelier.
►1516 Érasme écrit 'Novum Instrumentum’
►1516 Raphaël peint 'Baldassare Castiglione’
►1516 François Ier accueille Léonard de Vinci.
►1516 Léonard de Vinci, un soupçon opportuniste, se place au service du roi de France. Après avoir passé deux ans à Rome, De Vinci quitte l'Italie pour la France. Il s'établit près d'Amboise, sous la protection du Roi de France, François Ier, qui le nomme "Premier peintre, architecte, et ingénieur du Roi" et l'installe au manoir du Clos-Lucé où il participe à des projets d'urbanisme.
►1516 mort de Jérôme Bosch.
►1516 mort Giovanni Bellini.
►1517 - 11 mars Traité de Cambrai entre François Ier, Maximilien Ier du Saint-Empire et Charles Quint.
►1517 - 21 mars Réforme de la monnaie. Désormais, dans tout le royaume sur lequel François Ier règne depuis deux ans, les pièces que l'on dit de “mauvais aloi” sont interdites. Les pièces ainsi appelées sont celles dont l'alliage des métaux ne correspond pas à la valeur annoncée.
►1517 Fondation de l'ordre des capucins par Matteo da Bascio. Les Frères mineurs capucins forment un ordre religieux de la famille franciscaine, approuvé comme véritable Ordre de Saint-François en 1517 par le pape Léon X. De nombreux frères provenant presque tous de la branche de l'Observance et séparée de celle des Conventuels ont rallié ce nouvel ordre. Ils sont ainsi nommés du capuce ou capuchon dont ils couvraient leur tête. Capucins. Moines franciscains. L'ordre est fondé au XVIe siècle par Matteo da Bascio qui souhaite restaurer la règle de saint François dans ses valeurs originelles : austérité, pauvreté et ardeur apostolique.
►1517 Thèses de l'allemand Martin Luther contre certaines pratiques de l'Église (critique des indulgences). Présentation sur les portes de l'église du château de Wittenberg des 95 thèses de Luther, à l'origine du Protestantisme. Aboutissement de son cheminement spirituel, elles lancent le mouvement de la réforme qui s'attaque au pouvoir pontifical. Les thèses suscitent l'enthousiasme chez les chrétiens allemands, mais la hiérarchie catholique réagit vivement. Sommé de se rétracter (mission de Cajetan), Luther refuse. D'un point de vue religieux, cet évènement à l'origine de la Réforme marque le passage à l'Époque moderne.
►1517 La Réforme et les guerres de religion. Martin Luther et Jean Calvin créent la Réforme au début du XVIe. En quelques années, l'Europe du Nord devient protestante, tandis que l'Europe du Sud reste catholique. Des guerres de religions meurtrières diviseront la France (Saint-Barthélemy), puis l'Europe. Entre 1562 et 1598, les guerres de Religion ensanglantèrent la plupart des provinces du royaume français; elles constituent l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de France.
►1518 - 22 mars 1518 Enregistrement du Concordat. Les négociations pour l'élaboration de ce Concordat qui donne au roi François Ier le droit de nommer les évêques ont duré des mois. Le Parlement met plus d'un an à l'accepter. En ce 22 mars, enfin, un lit de justice l'enregistre avec la mention : “De l'ordre exprès et réitéré du roi”. De ce conflit entre le Parlement et le roi, l'autorité et le prestige royal sortent grandis.
Le lit de justice, en France, sous l'Ancien Régime, le lit de justice est une séance particulière du Parlement, en présence du roi. Lit de justice. On nomme ainsi la présence exceptionnelle et solennelle du roi au parlement, où il se déplace pour enregistrer lui-même un édit ou une ordonnance que les députés réprouvent. Ainsi, c'est par un lit de justice que Henri IV fait adopter l'édit de Nantes. La plupart du temps, le roi utilise ce moyen pour faire proclamer sa majorité ou limiter les pouvoirs du parlement.
►1518 à 1594 - naissance et mort de Le Tintoret. C'est grâce à une absence de Titien, en 1548, que Tintoret réussit à pénétrer dans la chasse gardée des peintres de la Sérénissime. Tintoret fut un grand créateur d'images, il sut inventer des effets visuels et donner au geste du peintre une ampleur et une rapidité complètement nouvelles. Sur des toiles gigantesques, qui seront les premières à décorer les murs d'une église, la spiritualité incandescente de Tintoret se déploie jusqu'au vertige.
►1519 L'explorateur Hernan Cortés rapporte en Espagne le chocolat mexicain. Hernan Cortés est originaire de Medellin en Espagne. Fils d'un capitaine d'infanterie de famille noble, le gouverneur de Cuba lui confia la mission d'explorer l'Amérique centrale. C'est avec une flotte de 11 navires, d'une centaine d'hommes d'équipage et de 500 soldats qu'il appareilla le 18 février 1519. Il fonda sur la côte du golfe du Mexique la Villa Rica de la Vera Cruz, l'actuelle Veracruz qui est donc le 1er port colonial du Mexique. Beaucoup des hommes qui accompagnaient Cortés voulu reprendre la mer après avoir reçu de riches présents des envoyés du chef aztèque, Moctezuma II. Mais Cortés fit brûler 10 de ses 11 navires et engagea ses troupes vers l'intérieur du pays. Il entra dans Tenochtitlan le 13 novembre 1519 où il obtint la soumission de Moctezuma II.
Ce dernier voyait en effet en lui le dieu Quetzalcoatl réincarné. En mai 1520, Cortés quitta la capitale pour affronter et vaincre les troupes du gouverneur de Cuba, lancées en raison de la désobéissance de Cortés. A son retour, il vit que la population s'était soulevée contre lui après avoir massacrée les Espagnols restés sur place. Il dut attendre le 13 août 1521 pour reconquérir la cité et la détruire complètement. En 1522, Cortés fut nommé gouverneur et capitaine général de la Nouvelle-Espagne par l'empereur Charles Quint. Ses troupes parvinrent ensuite à soumettre la presque totalité des États indiens. De 1528 à 1532, Cortés séjourna en Espagne où il perd son poste de gouverneur mais obtient le titre de Marqués del Valle de Oaxaca à son retour au Mexique. Il entreprit alors encore quelques expéditions qui le menèrent entre autres en Honduras et sur la presqu'île de Californie. Il mourut en Espagne près de Séville après avoir pris part à la campagne d'Alger.
►1519 - 11 janvier Mort de Maximilien Ier du Saint-Empire.
►1519 - 31 mars Naissance de Henri II à Saint-Germain-en-Laye. Henri II de France, (Saint-Germain-en-Laye, 31 mars 1519 - 10 juillet 1559), deuxième fils de François Ier et de Claude de France fut reconnu duc de Bretagne en 1536 (sans couronnement), puis couronné roi de France en 1547 à Reims.
►1519 - 2 mai Léonard De Vinci, qui incarne le génie universel, s'éteint. Décès de Léonard De Vinci au manoir du Clos-Lucé, à l'âge de 67 ans.
►1519 - 28 juin à la mort de son grand-père Maximilien Ier du Saint Empire, Charles Quint hérita des territoires des Habsbourg en Autriche, Charles Quint est élu empereur du Saint-Empire romain germanique au détriment de François Ier. Le 28 juin 1519, Charles Quint est élu à la tête du Saint Empire romain de la nation germanique par la Diète germanique. Il succède dans cette fonction à son grand-père Maximilien Ier du Saint-Empire. Le destin extraordinaire de Charles Quint tient à une succession étonnante de successions et de mariages. C'est le résultat d'une habile politique matrimoniale conduite au siècle précédent par son grand-père, l'archiduc d'Autriche Maximilien Ier du Saint Empire, par ailleurs titulaire du Saint-Empire Romain Germanique (ou empire d'Allemagne).
La mort de son grand-père paternel Maximilien Ier du Saint-Empire lui apporte les domaines héréditaires des Habsbourg et le met en situation de concourir pour le titre électif d'empereur, devenu vacant. Les immenses héritages de Charles Quint relèvent de deux règles de succession : celle de son père, d'inspiration germanique, et celle de sa mère, d'inspiration latine. Son père Philippe le Beau appartient à la dynastie des Habsbourg. Il est le fils de Maximilien Ier du Saint-Empire et de Marie de Bourgogne, fille unique du duc Charles le Téméraire. Il a hérité de son père les États autrichiens des Habsbourg (capitale : Vienne) et de sa mère la Franche-Comté et les Pays-Bas.
Selon la tradition d'héritage collectif en vigueur dans le Saint Empire romain germanique, l'héritage des Habsbourg doit être géré en commun par Charles Quint et son frère cadet Ferdinand (celui-ci en héritera après l'abdication de son frère). - Les parents de Jeanne la Folle, mère de Charles Quint, ne sont autres que les Rois Catholiques d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille. Ils déposent dans la corbeille de naissance de Charles les Espagnes (Castille et Aragon) et le royaume des Deux-Siciles. Grâce aux Grandes découvertes, ils lui assurent aussi la promesse d'"un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais", du Mexique aux Philippines en passant par le Pérou. Selon la règle de primogéniture en vigueur à l'ouest, Charles Quint pourra transmettre l'héritage des "Reyes catolicos" à son fils Philippe, futur Philippe II d'Espagne.
L'élection du successeur de Maximilien Ier du Saint-Empire oppose au petit-fils de celui-ci le roi d'Angleterre Henri VIII d'Angleterre, le duc de Saxe Frédéric et surtout le roi de France François Ier (25 ans), qui se pique au jeu bien qu'il n'eût aucun motif politique de conquérir le titre essentiellement symbolique d'empereur d'Allemagne. Charles l'emporte essentiellement grâce à l'or des Fugger, marchands d'Augsbourg, qui lui permet d'acheter les votes des Grands Électeurs. Il prend ainsi le nom de Charles V ou Charles Quint. S'étant fait couronner empereur à Aix-la-Chapelle, l'heureux élu cultive le rêve illusoire de restaurer l'empire de Charlemagne.
Hélas, il sera loin du compte et les conséquences de son duel avec François Ier s'avèreront désastreuses à moyen comme à long terme pour les Français, les Autrichiens et les Allemands. Occupés à se combattre sur le champ de bataille, les deux rivaux vont laisser se développer le schisme protestant, d'où une rupture de l'unité religieuse de l'Occident. La rivalité entre la France et la maison des Habsbourg ne va pas pour autant s'éteindre avec Charles et François. Elle va durer très exactement quatre siècles, jusqu'aux traités de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye, par lesquels les Français détruiront à jamais l'héritage des Habsbourg.
►1519 à 1522 - Magellan fait le premier tour du monde. Ferdinand de Magellan était un navigateur portugais d'une famille de petite noblesse. Il combattit en Inde, sous Albuquerque, de 1505 à 1512, puis fut envoyé au Maroc mais il vit ses services mal récompensés et alla se mettre à la disposition de Charles Quint (1517). Comme l'arbitrage pontifical avait attribué à l'Espagne tous les territoires situés à l'est, Magellan proposa à Charles Quint de démontrer qu'on pouvait atteindre les riches îles des épices en prenant la route de l'or et ainsi ces îles pouvaient être légitimement revendiquées par l'Espagne.
Charles Quint ayant approuvé ce projet, Magellan partit de Sanluar de Barmeda le 20 septembre 1519 sur le navire Trinidad avec quatre autres vaisseaux afin de chercher, à l'extrémité méridionale de l'Amérique une entrée dans l'océan pacifique. Après avoir longé la côte orientale de l'Amérique du Sud, il découvrit, le 21 octobre, le détroit qui porte son nom. Il mit un peu plus de trois mois et demi à le traverser, fit escale à Guam et le 16 mars 1521, il découvrit les Philippines. Le mois suivant, il devait trouver la mort dans un combat avec les indigènes.
Deux de ses navires atteignirent les Moluques. Un seul, le Victoria, sous le commandement de Sébastien Elcano, réussit après avoir fait le tour de l'Afrique, à rentrer en Espagne, le 6 septembre 1522. Ce fut le premier voyage maritime autour du monde. L'expédition de Magellan eut des conséquences scientifiques très importantes. Elle démontra que la terre était ronde et que l'Amérique était un continent distinct de l'Asie. Le récit complet de l'expédition dont Magellan fut l'initiateur devait être rédigé par l'italien Antonio Pigafetta qui revint en Europe avec Elcano.
►1519 Dispute de Leipzig (Luther rompt avec Rome)
►1519 Début des travaux de Chambord (1519-1537). Le château de Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire. Construit entre 1519 et 1547 sur une courbe du Cosson, petit affluent de la Loire. Le nom de l'architecte nous est inconnu, mais des analyses montrent l'influence de Léonard de Vinci, qui travaillait alors comme architecte de la cour de François Ier, mais qui décéda quelques mois avant le début du chantier, ainsi que celle de Domenico da Cortona. En 1516, François Ier, revient d'Italie avec Léonard de Vinci et le désir de réaliser un grand édifice dans le style de la Renaissance italienne. En 1519, le site de Chambord est choisi pour ouvrir le chantier d'une résidence de chasse sur l'emplacement d'un ancien château fort.
►1520 - 2 mai Création à la Sorbonne d'une commission chargée d'examiner les thèses de Luther.
►1520 - 7-24 juin Entrevue du Camp du Drap d'Or. Henri VIII d'Angleterre reste neutre Face à Charles Quint. Dans le but de contracter alliance avec Henri VIII d'Angleterre, François Ier l'invite à une entrevue près de Gaines, et le reçoit dans un camp magnifique, qui fut appelé Camp du Drap d'or à cause de la magnificence qu'y déployèrent les seigneurs français. Ce déploiement de luxe froisse Henri VIII qui s'en retourne sans avoir conclu l'alliance désirée; mais peu après, il accorde à Charles Quint ce que n'a pas pu obtenir François Ier.
Le camp du Drap d'Or est un campement établi dans une vaste plaine des Flandres par François Ier, entre Ardres et Guines. Il accueille une entrevue célèbre entre François Ier de France, et Henri VIII d'Angleterre (1520) ; il était situé en Flandre, entre les châteaux d'Ardres et de Guines, dont le 1er appartenait à la France, et le 2ème à l'Angleterre. Son nom lui fut donné à cause du faste que les deux cours rivales y déployèrent à l'envi. François Ier, dont le but était de gagner le roi d'Angleterre et de déjouer les intrigues de Charles Quint, obtint par un traité la confirmation du mariage du Dauphin de France avec Marie d'Angleterre ; mais le cardinal Thomas Wolsey, ministre du roi d'Angleterre, acheté par Charles Quint, prévint les effets de cette entrevue. L'entrevue fut un échec pour François Ier, qui ne parvient pas à l'alliance souhaitée. La démonstration de puissance de François Ier y est sans doute pour quelque chose.
►1520 - 14 juillet Traité entre Charles Quint et Henri VIII d'Angleterre.
►1520 - Luther rompt avec le pape: La Réforme - Condamnation de Luther par Léon X puis par la Faculté de Théologie de Paris (1521)
►1520 Joachim Patinir peint 'la vierge et l'enfant endormi dans un paysage’
►1520 à 1530 - Premiers ouvrages qui traitent de l'orthographe: coïncide avec la parution des premiers textes imprimés français: G. Tory, correcteur et premier imprimeur royal, est aussi le premier réformateur de l'orthographe.
►1520 mort de Raphaël.
►1521 sixième guerre d'Italie (1521-1526) contre Charles Quint. La sixième guerre d'Italie, parfois appelée la guerre de quatre ans, est un conflit qui opposa la France de François Ier et son alliée la république de Venise à une coalition rassemblant l'empereur Charles Quint, Henri VIII d'Angleterre et les États pontificaux. Cette guerre, qui s'inscrit dans le contexte plus large des grandes guerres d'Italie du début du XVIe siècle, résulte des tensions suscitées par l'accession de Charles au trône impérial, mais aussi du besoin du pape Léon X de s'allier avec l'empereur pour contrer la montée en puissance du luthéranisme.
►1521 - 3 janvier Excommunication de Luther par le pape Léon X.
►1521 mars Début des hostilités entre François Ier et Charles Quint. - François Ier avait posé sa candidature à l'empire d'Allemagne, mais les électeurs lui avaient préféré Charles Quint. Autant par dépit de cet échec que pour ruiner la puissance impériale en Italie, François Ier arme contre son puissant voisin. Mais les Impériaux (troupes de toute origine au service de l'Empereur) envahissent la Champagne. Bayard les arrête par sa belle défense de Mézières. La lutte s'établit aussi sur la frontière du Nord et les Pyrénées.
Les Français commandés par Lautrec ont envahi l'Italie ; Lautrec se fait battre à La Bicoque en 1522. En 1523, le connétable français duc de Bourbon (Charles III de Bourbon), pour assouvir sa rancune contre Louise de Savoie, mère de François Ier et en ce moment régente du royaume, passe au service de Charles Quint et s'entend avec lui pour démembrer la France. Mais il faut d'abord la conquérir. Les Impériaux et autres troupes de Charles Quint envahissent la Guyenne, la Franche-Comté, la Champagne, mais sont repoussés partout. En Italie, le commandement de Lautrec a été donné à un protégé de la régente, Bonnivet, aussi incapable que lui ; en effet, il est battu à Biagrasso en 1524 et obligé de battre en retraite, pendant laquelle il subit deux nouvelles défaites, à la Sesia et à Romagnano.
Blessé, il donne le commandement à Bayard, qui assure la retraite mais est lui-même atteint mortellement. Les Impériaux, menés par le connétable de Bourbon, poussant vivement devant eux les restes de l'armée française, envahissent la Provence et viennent assiéger Marseille. Le siège dure depuis quarante jours lorsque François Ier, arrivant à la tête de troupes fraîches, force les assiégeants à se retirer; il les poursuit jusqu'en Italie, s'empare de Milan, et met le siège devant Pavie, mais il commet l'imprudence de se séparer d'une partie de son armée qu'il envoie faire la conquête du royaume de Naples.
Sur ces entrefaites, les Impériaux reçoivent des renforts et l'attaquent vigoureusement : c'est la bataille de Pavie (fév. 1525) que François Ier perd par son excès de témérité, et où, ayant eu son cheval tué sous lui, il est fait prisonnier. C'est un désastre pour les Français qui perdent là un grand nombre d'hommes et leurs meilleurs capitaines. François Ier est emmené à Madrid où, pendant une année de captivité, Charles Quint essaie vainement à plusieurs reprises de lui imposer un traité dont le résultat serait le démembrement de la France.
Il ne se résigne à le signer (Traité de Madrid, janvier 1526) que ne voyant aucun autre moyen de rentrer en France, mais avec l'intention de ne pas l'exécuter. Ce traité portait renonciation de François Ier à toute prétention sur l'Italie, la Flandre, l'Artois; la Bourgogne était rendue à la maison de Charles le Téméraire, le connétable de Bourbon était amnistié et François Ier (devenu veuf de Claude de France) devait épouser la soeur de Charles Quint.
►1521 - 17 avril : Martin Luther, convoqué par l'empereur Charles Quint, comparaît devant la diète de Worms pour être jugé. Il refuse de rétracter sa doctrine. Laissé libre, malgré sa condamnation par l'Église, il pourra poursuivre son activité réformatrice. La diète de Worms est une assemblée générale (une diète) des États du Saint-Empire romain germanique s'étant tenu à Worms, petite ville bordée par le Rhin et située en Allemagne. Elle se déroula du 28 janvier au 25 mai 1521, sous la présidence de l'empereur Charles Quint. Bien que beaucoup de thèmes y aient été traités, la diète est surtout restée célèbre pour avoir abordé le cas de Martin Luther et les effets de la Réforme protestante.
►1521 - 24 novembre Alliance entre Charles Quint, le pape et Henri VIII d'Angleterre.
►1522 - 27 avril Défaite de François Ier face à Charles Quint à La Bicoque, perte du Milanais. La bataille de la Bicoque (27 avril 1522), du nom d'un lieu-dit appelé Bicocca à 5km au nord du centre de Milan, est une bataille où s'affrontèrent les armées de François Ier, parti à la reconquête du Milanais, et celles de Charles Quint. L'empereur Charles Quint en sortit vainqueur. Bataille de la Bicoque. Dans ce village de Lombardie, les Français commandés par Lautrec sont battus le 27 avril 1522 par les armées impériales de Frundsberg. Cette défaite entraîne la perte définitive de Milan et de sa région. Lautrec, Odet de Foix (1485-1528), vicomte de Lautrec, maréchal de France en 1511.
►1522 - 29 mai L'Angleterre déclare la guerre à la France.
►1522 novembre L'Angleterre envahit la Picardie.
►1522 Guillaume Briçonnet rassemble les meilleurs prédicateurs à Meaux (Lefèvre d'Étaples, Guillaume Farel, etc.). C'est autour de Guillaume Briçonnet (1470-1534), évêque de Meaux, que se réunit un cercle composé de Guillaume Farel, François Vatable, Roussel, Mazurier, Caroli et Lefèvre d'Étaples. Le cénacle, qui vise une réforme évangélique et la traduction du Nouveau Testament, exercera une grande influence sur les humanistes et les écrivains de cette génération (Marot, Rabelais).
D'autant que la même année, Guillaume Briçonnet devient le directeur spirituel de Marguerite de Navarre, avec laquelle il entretiendra une importante correspondance. Foi et charité domine cet évangélisme, qui inquiète les autorités ecclésiastiques. Car la Sorbonne et les théologiens constituent un milieu réactif à ce programme. Attachés à la scolastique, veillant à l'orthodoxie des textes sacrés, ils useront de leur pouvoir de censure dès la diffusion des idées luthériennes, et mettent fin au cercle de Meaux en 1525.
►1522 Érasme écrit 'Colloques' (Bâle)
►1522 à 1560 - naissance et mort de Joachim Du Bellay. Poète français. Joachim du Bellay appartenait à une illustre famille angevine. Il étudia à Poitiers où il fit la connaissance des milieux humanistes et rencontra Ronsard en 1547, ce qui décida de sa vocation poétique. En 1549, il fit paraître 'Défense et illustration de la langue française' qui prenait le parti du mouvement de la Pléiade regroupé autour de Ronsard.
En avril 1553, du Bellay qui était d'une santé fragile, partit pour Rome afin de devenir le secrétaire de son oncle, le cardinal Jean Du Bellay. Ce séjour qui dura quatre ans fut un choix malheureux. Le poète s'ennuya et souffrit de l'éloignement de son pays et des membres de la Pléiade, de même qu'il ne s'accommoda pas de son emploi ni des moeurs de la cour pontificale. Il écrivit pour en témoigner 'Les regrets', beau recueil mélancolique. Il mourut à Paris à 37 ans, et fut enseveli à l'église Notre-Dame.
►1523 - 6 juin Gustave Ier Vasa roi d'une Suède indépendante. A la tête de la rébellion contre les Danois, Gustav Vasa est élu roi d'une Suède qui a retrouvée son entière souveraineté. Depuis l'Union de Kalmar, en 1397, la Suède dépendait de la couronne du Danemark mais les Suédois n'était guère enclins à admettre cette domination.
Le paroxysme de la crise fut atteint en 1520 quand le Danemark envahit la Suède. C'est alors à la tête d'une armée de paysans que Gustav Vasa repousse en 1523 les ennemis. La date du 6 juin reste inscrit dans les esprits puisque la première constitution libérale du pays fut proclamée le 6 juin 1806. C'est pourquoi cette date est depuis 1983 le jour de la fête nationale. Gustave Ier Vasa ou Gustav Vasa (né le 12 mai 1496 et mort le 29 septembre 1560) fut roi de Suède de 1523 jusqu'à sa mort.
►1523 - 9 octobre Charles III de Bourbon, connétable de France passe au service de Charles Quint. Charles III de Bourbon, né le 17 février 1490, mort à Rome en 1527, fut comte de Montpensier, de Clermont et dauphin d'Auvergne de 1501 à 1523, puis duc de Bourbon, d'Auvergne, comte de Forez, de la Marche et sire de Beaujeu de 1505 à 1521. Il fut également connétable de France de 1515 à 1521. On le nomme également le connétable de Bourbon. En 1521, sa femme mourut et Louise de Savoie, mère de François Ier, revendiqua les fiefs des Bourbons, en tant que petite-fille du duc Charles Ier de Bourbon.
Le procès qui s'ensuivit lui donna raison. Les affronts envers le connétable se multipliaient également. Le connétable engagea des négociation avec Charles Quint, mais le complot échoua et le connétable dut s'enfuir (1523). Ses biens furent confisqués et rattachés au domaine royal. Nommé lieutenant général de l'Empereur en Italie, il combattit les Français, remporta la bataille de Sésia où fut tué Bayard. Il envahit ensuite la Provence et assiégea Marseille, mais une armée de secours l'obligea à lever le siège. Il battit et fit prisonnier François Ier à Pavie en 1525. Abandonné par l'empereur, qui ne voulait pas satisfaire ses ambitions, il résolut de se créer une principauté en Italie, mit le siège devant Rome qu'il prit et fit piller, mais il mourut pendant l'assaut.
►1523 Annexion du Bourbonnais et de la majeure partie de l'Auvergne.
►1523 Réforme de Zwingli à Zurich. Le canton de Zurich est le premier État à se séparer de l'Église de Rome. À la demande du Conseil de ville, le prédicateur Ulrich Zwingli soutient 67 thèses en présence de plusieurs centaines de personnes et du vicaire général de Constance (29 janvier). Le Conseil de ville approuve ses idées (refus de la doctrine de la transsubstantiation et caractère strictement symbolique du pain et du vin dans la Cène) et décide la suppression des images dans les lieux de culte puis la sécularisation des biens du clergé. Ulrich Zwingli (1484-1531) est un réformateur religieux suisse. En étudiant la Bible, indépendamment de Martin Luther, il arrive à des conclusions analogues.
►1523 Lefèvre d'Étaples, suivant l'exemple de Luther, publie une traduction du 'Nouvreau Testament' en français (avec introduction insistant sur importance de développer l'enseignement religieux en langue vulgaire). Il sera suivi dans cette voie par Guillaume Farel.
►1524 Mort de Claude de France. Première femme de François Ier.
►1524 - 30 avril Mort de Pierre Thérail, Seigneur de Bayard près de La Sésia.
►1524 Guerre des Paysans (Révolte des rustauds) en Allemagne (1524-1525) est une jacquerie qui enflamma le Saint Empire romain germanique entre 1524 et 1526. On estime généralement qu'environ 300 000 paysans se révoltèrent, et que 100 000 furent tués. Cette révolte a eu des causes religieuses, liées à la réforme protestante, et sociales. La révolte, touche l'Alsace a la mi-avril 1525.
Rapidement les insurgés contrôlent une grande partie du territoire alsacien. La révolte s'étend ensuite en Lorraine. Des la fin avril le duc Antoine de Lorraine met en place une expédition militaire pour mater l'insurrection. Le 16 et 17 mai, les troupes du duc tuent environ 20 000 personnes à Lupstein, Saverne et Neuwiller. Le 20 mai, la bataille de Scherwiller fait plus 4 000 morts parmi les paysans. Le 24 mai, les troupes du Duc sont de retour à Nancy ou il est accueilli triomphalement. La repression se poursuit dans le sud de l'Alsace. A la fin de l'année 1525, la révolte est matée en Allemagne, puis en 1526 en Autriche.
►1524 à 1585 - naissance et mort de Pierre de Ronsard. Poète français. Il se tourne vers une carrière ecclésiastique pour s'assurer un revenu constant. Cela lui permet de se consacrer à la poésie. En 1544, il fonde avec d'autres amis poètes le groupe de la Pléiade afin de définir de nouvelles règles poétiques. Celles-ci sont énoncées dans le manifeste 'Défense et illustration de la langue française' rédigé par Joachim Du Bellay.
Se conformant à ces nouveaux principes, Ronsard, grand humaniste, compose des oeuvres inspirées des formes antiques telles que les 'Odes' (5 volumes, publiés en 1550 et 1552) et les élégies dans les recueils dédiés aux femmes ('Les Amours de Cassandre', les 'Sonnets pour Hélène'). En même temps, il participe activement à la vie de cour sous Charles IX, à l'activité des premiers salons et à l'académie de poésie et de musique avec Baïf. Il partage sa vie entre Paris et la Touraine où il décède en 1585.
►1525 - 24 février Défaite de Pavie, François Ier est fait prisonnier. Les troupes de François Ier, qui tente de reconquérir l'Italie, sont sévèrement défaites par les Impériaux. Le roi de France, François Ier, est fait prisonnier à Pavie par l'empereur Charles Quint (V), et est embarqué pour l'Espagne à Villefranche près de Nice. Durant sa détention, la régence du royaume est confiée à sa mère, Louise de Savoie. Le siège de Pavie verra la mort de nombreux cadres de l'armée française, dont Jacques de La Palice et aussi le duc d'Alençon (Charles IV d'Alençon).
Pavie est une commune italienne située sur les rives du Tessin près de son confluent avec le Pô. La bataille de Pavie (24 février 1525) est un événement décisif de la sixième guerre d'Italie (1521-1526). Elle marque la défaite des rois de France dans leur tentative de domination du nord de l'Italie. La déroute est totale. Les Français perdent environ 10 000 hommes (certaines sources donnent même des nombres très supérieurs); une grande partie des cadres de l'armée, dont Guillaume Gouffier de Bonnivet ou Jacques de La Palice, sont tués dans la bataille.
Clément Marot y est blessé au bras. François Ier est fait prisonnier grâce à l'intervention d'un chevalier italien, de la ville de Forlì, César Hercolani, qui sera nommé le "vainqueur de Pavie". Le prisonnier royal est embarqué à Villefranche près de Nice pour l'Espagne, où il sera détenu pendant un an en attente du versement d'une rançon par la France et la signature d'un traité l'engageant à abandonner la revendication de l'Artois, la Bourgogne et la Flandre et à renoncer à ses prétentions sur l'Italie.
►1525 Apparition du mousquet. Un mousquet est une arme à feu portative à canon long, crosse d'épaule et âme lisse, employée du XVIe au XIXe siècle. C'est l'ancêtre de notre fusil actuel. Introduit en France après la bataille de Pavie (1525), le mousquet était jusqu'en 1650 appuyé sur une fourche pour le tir. Les fantassins armés d'un mousquet étaient nommés mousquetaires.
►1525 à 1569 - naissance et mort de Pieter Bruegel l'ancien. Peintre flamand, est le peintre le plus authentique représentant de l'humanisme de la Renaissance Nordique sous son aspect érudit et sous son aspect social. De tous les artistes du XVIe siècle il a le mieux senti et utilisé les fécondes innovations italiennes et les leçons de l'antiquité. Alors que les peintres du XVIe siècle analysent les articulations, la musculature d'un corps, les nuances d'un mouvement, Bruegel, s'attache à la forme globale, à la ligne qui brièvement exprime une masse, suggère du mouvement la force dominante.
►1525 à 1590 - Le Maniérisme. Mouvement né en Italie qui s'inspire de la "Manière" des artistes de la Renaissance et se caractérise par un grand raffinement des formes et de la composition. D'abord symbole d'une rupture brutale avec les objectifs de la Renaissance, elle désignait une décadence et une dégénérescence en contradiction avec les idéaux d'harmonie des générations antérieures. De nos jours, le maniérisme apparaît davantage comme une continuation et une poursuite des recherches mises en oeuvre à l'époque de la Renaissance.
Le maniérisme, aussi nommé Renaissance tardive, est un mouvement artistique de la période de la Renaissance allant de 1520 (mort du peintre Raphaël) à 1580. Il constitue une réaction face aux conventions artistiques de la Haute Renaissance, réaction amorcée par le sac de Rome de 1527 qui ébranla l'idéal humaniste de la Renaissance. Contrairement aux précédents mouvements artistiques, la diffusion s'amorçant, il n'est plus circonscrit à l'Italie. Le terme maniérisme vient de l'italien maniera, style dans le sens de la touche caractéristique d'un peintre, c'est-à-dire de sa manière de peindre, et non pas de l'adjectif maniéré.
Il fait partie des rares dénominations de courant artistique qui ait été forgé et employé par ses contemporains. En réaction à la perfection atteinte durant la Haute Renaissance dans la représentation du corps humain et dans la maîtrise de l'art de la perspective, certains artistes, autour de Jules Romain et des élèves d'Andrea del Sarto, ont cherché à rompre délibérément avec l'exactitude des proportions, l'harmonie des couleurs ou la réalité de l'espace, de manière à atteindre un nouvel effet émotionnel et artistique. Maniérisme. Considéré longtemps comme un art décadent, le maniérisme se caractérise par l'élégance raffinée des formes, le goût de l'exagération, l'exaltation de la sensibilité de l'artiste.
Ce terme est employé par la critique moderne pour désigner l'école de peinture de la seconde moitié du XVIe siècle, développée principalement en Italie et France (École de Fontainebleau). Se détournant de l'esprit normatif de leurs prédécesseurs, les maniéristes créent une notion du Beau qui ne réside plus dans la vérité des formes imitées de la nature, mais dans une réinterprétation artistique personnelle. Leur sensibilité est davantage guidée par des exigences d'harmonie de rythme : éloignés des normes du réel, les personnages sont considérablement déformés ; la forme prime sur le fond, qui se réduit souvent à des éléments accessoires ; le nerf l'emporte sur le muscle comme chez leur précurseur Michel-Ange. Placé sous le signe de la subjectivité, le maniérisme reconstruit de l'intérieur, en toute liberté et au gré de la sensibilité du peintre.
►1526 septième guerre d'Italie (1526-1529) contre Charles Quint. La septième guerre d'Italie (1526-1530), également appelée guerre de la ligue de Cognac, vit s'affronter les territoires sous domination habsbourgeoise - en particulier l'Espagne et le Saint-Empire romain germanique - et les États coalisés de la ligue de Cognac, une alliance comprenant la France, le pape Clément VII, la République de Venise, l'Angleterre, le duché de Milan et Florence. Elle s'inscrit dans le contexte plus vaste des grandes guerres d'Italie du début du XVIe siècle. Le conflit, tout comme la sixième guerre d'Italie, se solda par la victoire du vaste empire de Charles Quint.
►1526 - 13 janvier Traité de Madrid prévoyant la libération de François Ier au prix de fortes concessions territoriales. Le traité de Madrid est un traité signé en 1526 le 13 janvier, par le roi François Ier alors qu'il est prisonnier de l'empereur Charles Quint suite à la défaite de la bataille de Pavie. Selon ce traité, François Ier devait ceder le Duché de Bourgogne et le Charolais, renoncer à toutes revendications sur Naples, le Milanais, Gènes, Asti, les Flandres et l'Artois, et épouser Éléonore de Habsbourg, soeur de Charles Quint. Mais, tombé malade pendant son emprisonement, et ayant peur de sa faiblesse, il demande le 16 août 1525 à Gilbert Bayard, notaire et secretaire du Roi de France, de rediger un texte selon lequel toutes les concessions faites en vue de retrouver sa liberté seraient considérées comme nulles. Ainsi, à son retour en France après sa liberation (le 17 Mars 1926), François rejette le traité.
►1526 - 17 mars Libération de François Ier en échange de ses deux fils. Fait prisonnier à Pavie où tout fut perdu fors l'honneur le 24 février 1525, transféré à Madrid où il est tombé malade, François Ier est enfin libéré par Charles Quint auquel il promet la signature d'un traité et donne en gage ses deux fils dont le Dauphin.
►1526 Fondation de l'Empire moghol en Inde: influence persane. L'Empire moghol est fondé par Bâbur, un descendant de Tamerlan, en 1526, lorsqu'il défait Ibrahim Lodi, le dernier sultan de Delhi à la bataille de Pânipat. Le qualificatif de Moghol semble avoir été donné à l'empire au cours du XIXe siècle et dérive de mongol, une autre partie de l'héritage de Bâbur.
►1526 à 1594 - naissance et mort de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Compositeur italien, l'un des plus grands compositeurs de la Renaissance.
►1526 Pontormo peint 'Déposition de croix'. Pontormo, Jacopo Carrucci, connu sous le nom de Jacopo da Pontormo, ou plus simplement il Pontormo, était un peintre florentin et un des représentants les plus importants du mouvement maniériste dans la peinture du XVIe siècle.
►1527 à 1529 - Deuxième guerre avec Charles Quint. - Le traité de Madrid constitue un danger non seulement pour la France, mais pour l'Europe. D'ailleurs, deux grandes assemblées : Assemblée de Cognac et États de Bourgogne en délient le roi, en proclamant qu'il n'était pas maître d'aliéner aucune province du royaume. Henri VIII d'Angleterre rompt son alliance avec Charles Quint pour se ranger à côté de François Ier, et les républiques italiennes, menacées dans leur indépendance par la puissance de l'Empereur, font cause commune avec eux.
La guerre recommence. Charles Quint jette en Italie des bandes de lansquenets allemands contre lesquelles les Italiens, mal organisés, ne peuvent se défendre. L'Italie est ravagée par ces pillards que commande l'ex-connétable de Bourbon. Ils mettent à sac la ville de Milan, et marchent sur Rome, qu'ils prennent d'assaut le 6 mai 1527. Le duc de Bourbon est tué en montant à l'assaut; mais sa mort n'arrête pas les Allemands, et la ville, livrée pendant huit jours au pillage, est complètement vidée des richesses artistiques et mobilières qu'elle renfermait.
En apprenant ces événements, François Ier envoie en hâte en Italie une armée commandée par Lautrec. Les Allemands se retirent devant elle jusqu'à Naples où ils s'enferment, tandis que les Français occupent le royaume. Lautrec assiège la ville et la fait bloquer par mer par l'amiral génois André Doria. Mais ce dernier, prenant acte de quelques vexations subies du fait de la cour de France par la république de Gênes, se retire avec sa flotte. D'ailleurs la peste se met dans les rangs des Français, Lautrec meurt. Le siège de Naples est levé et les troupes de François Ier regagnent la haute Italie (1528).
L'année suivante, une autre armée française est battue et détruite en Lombardie (à Landriano). L'Italie, cette fois, est définitivement perdue pour la France. François Ier est contraint de conclure la paix de Cambrai (dite Paix des Dames), parce qu'elle fut négociée par la mère du roi de France (Louise de Savoie) et la tante de Charles Quint (Marguerite d'Autriche). François Ier devra payer à Charles Quint deux millions d'écus d'or, et épouser Éléonore de Portugal (soeur de Charles Quint, mariage qui a lieu en 1530). Il conserve la Bourgogne et Charles lui rend ses fils (qu'il avait dû faire venir en Espagne comme otages, lors de la signature du traité de Madrid).
L'Italie tout entière reste sous la domination de Charles Quint, lequel se fait couronner en 1531 à Bologne, empereur d'Allemagne et roi d'Italie. Entre temps, François Ier a fait alliance avec le sultan des Turcs, Soliman le Magnifique et s'est ménagé le bon vouloir des protestants de Suisse et d'Allemagne. Les lansquenets étaient des mercenaires suisses opérant du XVe siècle au XVIIe siècle. Soliman le Magnifique est né le 27 avril 1495 à Trébizonde (Trabzon) et mort le 7 septembre 1566 à Zigetvar. Il est le neuvième sultan de la dynastie ottomane. Seul fils survivant de Selim Ier Yavuz, Soliman, monta sur le trône en 1520.
Avec l'aide de son grand vizir il imposa les réformes qui lui valurent son surnom turc de "Législateur" (Kanûnî). Sous son règne l'Empire ottoman devint une grande puissance mondiale, mais il continua à s'étendre pendant encore un siècle avant de commencer une longue phase de déclin. L'Empire ottoman. L'Empire ottoman s'étend de la Méditerranée aux rives de la mer Noire. Sa civilisation, expression d'un équilibre subtil entre différentes religions et cultures, est alors l'une des plus importantes au monde. Cependant, après le règne de Soliman le Magnifique, l'Empire, en butte à des difficultés intérieures, s'affaiblit et pose à la diplomatie européenne la "question d'Orient".
►1527 - 6 juin Capitulation du pape face à Charles Quint.
►1527 - 24 juillet Les attributions du Parlement sont réduites aux seules affaires de justice.
►1527 - 10 décembre Le Parlement annule la clause du traité de Madrid prévoyant la cession de la Bourgogne.
►1527 à 1593 - naissance et mort de Giuseppe Arcimboldo, peintre maniériste italien, mondialement connu pour ses portraits allégoriques composés de végétaux ou de minéraux. Cet aristocrate milanais (formé par son père) commença comme dessinateur de cartons, de tapisseries et de vitraux (notamment ceux de la cathédrale de Milan) avant de mettre ses talents au service des princes de Habsbourg, à la cour de Vienne, entre 1565 et 1587. Il se spécialisa dans les caprices picturaux. En effet, il fut l'inventeur d'un type de portrait bien précis : les "têtes composées".
Ce nouveau genre de peinture fantastique fut élaboré à partir d'assemblages d'animaux, de fleurs, de fruits ou d'objets, étudiés avec soin afin de suggérer des formes humaines en rapport avec des sujets précis ou des types de caractères. Parfois satiriques, toujours très décoratifs, ses tableaux à la fois ludiques et étranges, furent considérés comme de véritables curiosités. Les surréalistes redécouvrirent d'une part le jeu de mots visuels et d'autre part Arcimboldo.
►1527 Condamnation de l'usage de la langue vulgaire par la Sorbonne. L'Église catholique a condamné l'usage de la langue vulgaire par la Sorbonne, et s'est obstinée dans son latin ; la lecture de la Bible en français a été interdite.
►1528 - 22 janvier François Ier déclare la guerre à Charles Quint. Une fois encore François Ier déclare la guerre à son éternel rival, l'empereur Charles Quint. Cette guerre prendra fin en 1529 avec la Paix des Dames.
►1528 à 1588 - naissance et mort de Véronèse. Peintre classique, l'un des plus grands avec Le Titien et Le Tintoret. Il s'installe dans la lagune en 1557. Il reçoit sa première grande commande du Conseil des 10, pour décorer le palais des doges. Il peint par la suite de nombreuses toiles pour des congrégations bénédictines dont plusieurs ont pour thème le banquet biblique. En 1573, l'Inquisition le condamne pour les licences qu'il prend dans le traitement des scènes religieuses (notamment le 'Repas chez Levi'). Cependant cette condamnation ne concerne pas 'Les noces de Cana'.
'Les noces de Cana' sont peintes pour le réfectoire des bénédictins de Saint Giorgio (en face du palais des doges) en 1563, alors que Véronèse à 35 ans. Le couvent est un haut lieu intellectuel disposant de gros moyens financiers. Le tableau est commandé dans le cadre d'une reconstruction du couvent. Dans le réfectoire, il surplombait la chaire d'où l'abbé faisait la lecture pendant le repas, ce qui obligeait les regard à converger vers lui. Il est peint sur toiles car les fresques se conservait très mal à Venise en raison du haut degré de salinité. La représentation d'un banquet semble tout à fait logique dans le cadre d'un réfectoire.
►1528 mort de Giorgione.
►1528 mort d'Albrecht Dürer.
►1529 - 3 août : Paix de Cambrai ou paix des Dames, négociée par Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche. François Ier doit épouser Éléonore de Habsbourg (juillet 1530), céder le Tournésis et le bailliage de Hesdin, abandonner sa suzeraineté sur la Flandre et l'Artois et renoncer à ses droits sur l'Italie tandis que Charles Quint rend les enfants de France retenus en otage contre rançon, renonce à la Bourgogne, aux comtés d'Auxerre et de Mâcon, à la seigneurie de Bar-sur-Seine et aux villes de la Somme. La Paix des Dames, ou Paix de Cambrai, met fin à la deuxième guerre entre les deux souverains François Ier et Charles Quint.
Elle est signée à Cambrai le 5 août 1529 en l'Hôtel Saint-Pol. François Ier renonce à ses prétentions italiennes et récupère la Bourgogne, mais il cède l'Artois et les Flandres. La Paix des Dames est signée par Louise de Savoie (mère du roi François Ier) et Marguerite d'Autriche (tante de l'empereur Charles Quint). Ce traité négotie également la libération des enfants royaux, François et Henri (futur Henri II), qui étaient emprisonnés à Madrid. Louise de Savoie, née en 1476 à Pont-d'Ain, morte en 1531 à Grez-sur-Loing, princesse de la maison ducale de Savoie. Elle était la fille duc de Savoie Philippe dit Sans Terre (1438-1497) et de Marguerite de Bourbon (1438-1483).
Elle épousa, en 1490, Charles de Valois (1460-1496), comte d'Angoulême, dont elle eut deux enfants : Marguerite d'Angoulême (1492-1549), x 1527 Henri II d'Albret, roi de Navarre, mère de Jeanne III d'Albret et grand-mère du roi de France Henri IV ; François Ier (1494-1547), roi de France (1515-1547). Après son veuvage, elle se consacra à leur éducation, aidée par son confesseur, Cristoforo Numai de Forlì. Elle fut titrée duchesse d'Angoulême, duchesse d'Anjou et comtesse du Maine après l'accession de son fils au trône de France en 1515. Elle fut deux fois régente de France pendant les campagnes italiennes de son fils : en 1515 puis à nouveau en 1525-1526, ce qui fut de première importance après la capture du roi lors de la bataille de Pavie.
Elle organisa la continuité de l'État et une contre-offensive contre Charles Quint. Elle eut encore l'occasion de s'illustrer en négociant, au nom de son fils, avec Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, tante de Charles Quint, la paix des Dames, signée à Cambrai le 5 août 1529, qui ne fut toutefois qu'une accalmie dans l'affrontement (1521-1546) entre François Ier et Charles Quint. Marguerite d'Autriche, Marguerite, archiduchesse d'Autriche, (née le 10 janvier 1480 à Bruxelles, morte le 1er décembre 1530 à Malines) était duchesse de Savoie et gouvernante des Pays-Bas. Elle était le second enfant (venue au monde après un garçon, le futur Philippe le Beau) de Marie de Bourgogne (1457-1482) et de l'empereur Maximilien Ier du Saint-Empire et la petite-fille du duc de Bourgogne Charles le Téméraire.
►1529 Geoffroy Tory écrit 'Champ fleury'. Art et science de la proportion des lettres. Geoffroy Tory, sa vie et son oeuvre s'intègrent une Renaissance qui donne un élan incroyable aux activités culturelles et artistiques. La mise au point de l'imprimerie impliqua les imprimeurs dans ce mouvement irrésistible. Tory est un homme de culture au sens large : d'abord imprimeur ou libraire, il est aussi un penseur de la langue française et un artiste de talent. Deux voyages en Italie, des activités variées font de lui un personnage important de son époque, qui est malgré tout, assez peu connu. Il fut pourtant, en son temps, l'un des précurseurs de la grammaire et de l'orthographe de la langue française.
►1529 Guillaume Budé écrit 'Commentaires sur la langue grecque’
►1529 Albrecht Altdorfer peint 'La Bataille d'Alexandre'. Albrecht Altdorfer (*vers 1480 à Ratisbonne (?), † le 12 Février 1538 à Ratisbonne, Allemagne) est un peintre et graveur allemand de l'époque de la Renaissance, contemporain d'Albrecht Dürer. Il est considéré comme le plus important représentant de l'école du Danube. Altdorfer fut l'un des premiers peintres européens à placer le paysage comme thème autonome au centre de son travail. En entremêlant les plans, les figures humaines et le décor, Altdorfer donne une perspective cosmique à ses peintures.
'La Bataille d'Alexandre' (1529, Alte Pinakothek de Munich) est considérée comme l'un de ses chef-d'oeuvres. Le prétexte de la victoire d'Alexandre sur Darius illustre une vision du monde radicalement neuve. Les peintures d'Altdorfer datant de cette période, faisant écho aux découvertes de Nicolas Copernic qui lui sont contemporaines, présentent pour la première fois un monde convexe, où le centre de l'Univers n'est plus la Terre, mais le Soleil.
►1530 - 25 juin : La Confession d'Augsbourg, rédigée par Philippe Melanchthon (qui remplace Luther) et Camerarius, est présentée à Charles Quint à la diète d'Augsbourg, mais elle est rejetée par les théologiens catholiques (Confessio tetrapolitana). La confession d'Augsbourg est le texte fondateur du luthéranisme. C'est une profession de foi que les Protestants présentèrent à la diète d'Augsbourg en 1530. Martin Luther, qui l'avait préparée, était alors au ban de l'empire et ne put se trouver à la diète; Philippe Melanchthon son disciple y fut le principal représentant de la religion nouvelle. Elle fut présentée à l'empereur Charles Quint à Augsbourg le 25 juin 1530.
►1530 - 1er juillet Libération des princes. A la suite de la défaite de Pavie (1525), François Ier fut emprisonné en Espagne. Un an plus tard, le traité de Madrid lui rendit la liberté en échange de celle de ses deux fils aînés. Le 17 mars 1526, sur la Bidassoa, eut lieu l'échange du roi contre ses deux enfants. Les débuts de la captivité furent conformes au mode d'existence d'enfants royaux, mais François Ier ayant dénoncé le traité de Madrid, qu'il considérait n'avoir accepté que sous la contrainte, Charles Quint fit renforcer les conditions de détention du dauphin et de son frère.
Leurs proches français furent incarcérés et les enfants eux-mêmes se retrouvèrent en forteresse. Ils ne furent libérés qu'après les négociations de la paix des Dames (1529) et le paiement d'une rançon de deux millions d'écus d'or, soit environ quatre tonnes et demie de métal. Henri (futur Henri II) et son frère (François de France) rentrèrent en France le 1er juillet 1530, au terme de plus de quatre ans de captivité. François de France, né au château d'Amboise en 1517, mort à Lyon en 1536, dauphin de France, duc de Bretagne (François III), fils aîné de François Ier de France, et de Claude de France, duchesse de Bretagne.
►1530 - 7 août Mariage de François Ier avec Éléonore de Habsbourg. Éléonore de Habsbourg, née à Louvain le 15 novembre 1498, morte à Talavera en février 1558 (le 13, 18 ou 25), fut une infante d'Espagne, puis reine de Portugal de 1518 à 1521, reine de France de 1530 à 1549, et duchesse de Touraine de 1547 à 1558.
►1530 François Ier crée l'Institution des lecteurs royaux (deviendra le Collège de France). Collège de France. A l'initiative de Guillaume Budé, François Ier fonde en 1530 le Collège des trois langues consacré à l'enseignement du latin, du grec et de l'hébreu. Quinze ans plus tard, de nouvelles chaires sont créées en sciences, mathématiques, littérature… et l'institution prend le nom de Collège royal.
Au gré des révolutions, il sera tour à tour Collège national, Collège impérial et finalement, sous la Restauration, Collège de France. Les programmes et les cours, dispensés par des personnalités éminentes en chacune des matières, sont libres. Aucun examen ni diplôme ne les sanctionne. Parmi les grands professeurs, tous nommés par le gouvernement, on trouve des figures aussi diverses que Cuvier, Ampère, Bergson, Paul Valéry ou Merleau-Ponty.
►1530 Fondation, sans doute sous l'influence de Budé et malgré le refus d'Érasme, du futur Collège de France (Collège des Trois langues [latin, grec, hébreu] puis Collège Royal), indépendant de la Sorbonne, où l'enseignement pouvait se faire en français (Louis le Roy, Forcadel, Ramus). C'est le signe d'un rapprochement entre le pouvoir politique et le pouvoir intellectuel.
► 1530 Lucas Cranach peint 'Cupidon se plaigant à Venus’
►1530 le Parmesan peint 'La conversion de Saint Paul'. Le Parmesan (Parme 1503-1540), de son vrai nom Francesco Mazzola, était un peintre et un alchimiste italien de la renaissance.
►1531 27 février Ligue de Smalkalde des princes protestants contre Charles Quint. Smalkalde, ville d'Allemagne, les protestants y formèrent une ligue contre la politique catholique de Charles Quint. Malgré les succés qui permirent de dissoudre la ligue en 1547, l'empereur ne put imposer un accord durable sur les problèmes religieux.
►1531 Francisco Pizarro, explorateur et conquérant espagnol, conquiert l'Empire inca. Francisco Pizarro est un conquistador espagnol, né vers 1475 ou 1478 à Trujillo, province espagnole de Caceres et mort à Lima, capitale du Pérou, en 1541. Il fut un des plus fameux conquistadors venus d'Espagne, pour le compte de laquelle il parvint à soumettre et conquérir le Pérou des Incas. Fils naturel, analphabète, du navigateur Gonzalo Pizarro, il s'engagea dans l'armée, avec son père, et fit la campagne d'Italie puis gagna l'Amérique avec Nicolas de Ovando en 1502. Nommé lieutenant de Alonso de Ojeda à San Sebastian de Uraba en 1510, il accompagnait Balboa dans l'expédition qui découvrit l'océan Pacifique en 1513.
►1531 Marguerite de Navarre écrit 'Le Miroir de l'âme pécheresse'. Marguerite de Navarre, Marguerite de France, surnommée aussi Marguerite de Navarre ou encore Marguerite d'Angoulême, née Marguerite d'Orléans le 11 avril 1492 à Angoulême, morte en 1549 à Odos (Hautes-Pyrénées, France), était une princesse de la première branche d'Orléans de la dynastie capétienne. En 1509, elle épousa en premières noces le duc d'Alençon, Charles IV d'Alençon. En 1527, après son veuvage, elle se remarie à Henri II d'Albret, roi de Navarre, dont elle aura une fille, Jeanne III d'Albret, reine de Navarre et mère du roi de France Henri IV.
Elle est également renommée pour le bon accueil qu'elle fit aux premières vagues de la Réforme. Un poème : 'Miroir de l'âme pêcheresse' (1531), qui sera attaqué par la Sorbonne lors de sa réédition en 1533, et nécessitera l'intervention de François Ier. Le livre est empreint des idées évangélistes qui font de la foi et de la charité les voies du salut. Il sera suivi par de nombreux autres poèmes dont les 'Chansons spirituelles' où Marguerite de Navarre utilise la structure poétique de chansons profanes en leur substituant des textes religieux.
►1531 André Alciat écrit 'Emblematum'. Avec la parution de l''Emblematum liber' d'André Alciat à Augsbourg (traduit en français dès 1536), le livre d'emblèmes, tant en latin qu'en langue vulgaire, va connaître un destin européen jusqu'au siècle suivant. A l'origine, l'emblème réunit un intitulé (notion à illustrer), une image souvent allégorique et un bref commentaire. De nombreux auteurs publieront à la suite d'Alciat des livrets d'emblèmes réduisant souvent ce dispositif à deux éléments. André Alciat ou Andrea Alciato, aussi connu comme Alciati (8 mai 1492 – 1550, Pavie) est un jurisconsulte et écrivain italien, émule d'Ulrich Zasius (1461-1535) et de Guillaume Budé (1467 - 1540). Il compte parmi les humanistes influents de la renaissance.
►1532 François Ier apporte son soutient à la Ligue de Smalkalde, ligue de protestants contre la politique catholique de Charles Quint. La ligue de Smalkade ou Ligue de Schmalkalden est une union militaire, contre Charles Quint, de prince protestant allemand du Nord avec principalement Philippe de Hesse et de l'électeur Jean Frédéric de Saxe en 1531. Elle demande l'aide du grand rival de l'Empereur, le roi de France François Ier. La ligue est écrasée par Charles Quint à Mühlberg le 24 avril 1547.
►1532 - 8 décembre Rattachement de la Bretagne à la France. Le duché subit des défaites militaires face au puissant royaume de France en 1488 et 1491, qui menèrent à l'union en deux étapes. D'abord une union personnelle entre souverains (3 mariages entre souverains bretons & français) puis en 1532 l'union perpétuelle entre le duché et le royaume est sollicitée à Vannes par des États de Bretagne sous forte pression et sanctionnée par l'édit royal signé dans la foulée au Plessis-Macé. Édit du Plessis-Macé, c'est au Plessis-Macé (autrefois appelé Plessix-Macé) qu'eut lieu la signature du dernier des trois documents unissant la Bretagne et la France en 1532.
►1532 François Rabelais édite "Gargantua". Le premier livre de François Rabelais paraît sous le titre entier des "Horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel". L'ouvrage porte le pseudonyme anagramme Alcofribas Nasier, ce qui ne suffira pas à éviter une condamnation de la Sorbonne. C'est ainsi que vient au monde le célèbre géant, dans un roman où se mêlent traditions populaires et langages savants.
Deux ans plus tard, Rabelais publiera la "Vie inestimable du grand Gargantua", où il raconte la vie du père de Gargantua. Sous couvert d'humour, ces deux oeuvres révèlent un certain sérieux dans leur composition (langage et allusions savants). L'auteur apportera de nouvelles aventures de Pantagruel dans "Tiers livre" (1546), "Quart Livre" (1552) et le "Cinquième livre" (1564).
►1532 Clément Marot introduit le sonnet italien dans la poésie française.
►1533 25 janvier : Henry VIII d'Angleterre épouse Anne Boleyn. Anne Boleyn (~1507 - 19 mai 1536) est la seconde femme d'Henry VIII et certainement l'une des reines les plus connues de l'histoire d'Angleterre. Le roi s'en éprit et, sa femme Catherine d'Aragon ne lui ayant pas donné d'enfant mâle, demanda au Pape Clément VII l'annulation de son mariage. Devant le refus de celui-ci, le roi abandonna la religion catholique et se déclara chef de l'Église d'Angleterre. Ce schisme est à l'origine de l'Église anglicane.
L'anglicanisme ou Communion anglicane, est un corps ecclésial chrétien épiscopal, dont l'identité est issue au XVIe siècle, en Angleterre, lorsque le roi Henri VIII a rompu avec le pape de Rome, donc avec le catholicisme romain. L'Église anglicane se dit à la fois catholique et réformée : catholique, parce qu'elle a conservé la succession apostolique, et réformée parce qu'elle s'est renouvelée selon la réforme protestante. Des anglicans sont souvent réticents à se voir appelés "protestants".
►1533 - 7 septembre Naissance d'Élisabeth Ière d'Angleterre. Henri VIII d'Angleterre, désireux d'avoir un héritier mâle, épousa en grande hâte Anne Boleyn. L'année suivante, le 7 septembre, Anne met au monde un enfant. À la grande déception de Henri, c'est une fille, Élisabeth. Trois ans plus tard, sa mère est victime des intrigues de Cromwell : accusée sans preuves d'adultère et d'inceste, elle est exécutée et sa fille Élisabeth déclarée illégitime. Dix ans plus tard, l'Acte de succession la placera au troisième rang, derrière son demi-frère Édouard (fils de Henri VIII et de sa troisième femme) et sa demi-soeur Marie Tudor.
Vive et intelligente, élevée dans la religion protestante, Élisabeth bénéficie néanmoins d'une excellente éducation. En 1558, après la mort d'Édouard VI d'Angleterre puis de Marie Ière dite "la sanglante", Élisabeth est rétablie dans ses droits et proclamée reine d'Angleterre. Son règne dure 44 ans, jusqu'en 1602. Élisabeth Ière d'Angleterre (1533-1603) est la reine - et peut-être le monarque - la plus connue de toutes celles qui régnèrent en Angleterre. Fille du roi Henri VIII d'Angleterre par son mariage avec Anne Boleyn, Élisabeth était la troisième de ses enfants dans l'ordre de succession, à la mort du roi Henri.
Les morts successives de son frère, Édouard, et de sa soeur aînée, Marie, l'amenèrent à accéder au trône en novembre 1558 - commencement d'une époque majeure dans l'histoire anglaise. Élisabeth, qui avait été élevée protestante, tenta de suivre une via media dans la religion. Mais elle rencontra des ennemis dans le royaume lui-même, les partisans de sa cousine et héritière, la catholique Marie Stuart, reine d'Écosse, qu'elle fit mettre à mort. Ce fut pourtant le fils de Marie Stuart, le roi Jacques VI d'Écosse, qui lui succéda sous le nom de Jacques Ier d'Angleterre.
►1533 Catherine de Médicis épouse Henri II; elle sera régente de 1560 à 1580 : la cour marquée par l'influence italienne. Catherine de Médicis, née le 13 avril 1519 à Florence, morte le 5 janvier 1589 à Blois, fut, par mariage, reine de France. Elle était fille de Laurent II de Médicis (1492-1519), duc d'Urbino, et de Madeleine de la Tour d'Auvergne (1495-1519), comtesse d'Auvergne (1501-1519), morte quinze jours après sa naissance. Catherine de Médicis fut elle-même, jusqu'à sa mort, comtesse d'Auvergne. En 1533, elle épousa Henri II (1519-1559), second fils du roi de France François Ier (1494-1547) et de Claude de France (1499-1524), duchesse de Bretagne.
Par ce mariage, elle fut successivement titrée duchesse d'Orléans (1533-1536) puis, après la mort de son beau-frère, dauphine de Viennois et duchesse titulaire de Bretagne (1536-1547) et enfin, après la mort du roi, reine de France (1547-1559). Elle vécut d'abord dans l'ombre de la maîtresse de son mari Henri II, Diane de Poitiers, puis après la mort de celui-ci, devint régente de François II, et continua d'exercer un pouvoir important sous les règnes de ses autres fils Charles IX et Henri III. Sur le plan religieux, elle tenta de concilier les catholiques et les protestants, notamment par le mariage de sa fille Margot avec le prince bourbon Henri de Navarre (futur Henri IV).
Mais devant l'intransigeance des deux camps, elle se résolut à faire abattre les principaux chefs huguenots montés à Paris pour les noces. Le massacre, dit de la Saint-Barthélemy, commença dans la nuit du 24 au 25 août 1572. Huguenot ancienne appellation donnée aux protestants français d'obédience calviniste pendant les guerres de religion. Le plus célèbre des huguenots est certainement Henri de Navarre, fils de Jeanne d'Albret et futur Henri IV. Il fut forcé d'abjurer pour sauver sa vie lors du massacre de la Saint-Barthélemy (24 août 1572), puis son trône en 1593. Huguenot. Nom dérivé du terme suisse signifiant "confédérés" (Eidgenossen) et sans doute rapproché plus tard du "roi Hugon", fantôme de légendes populaires. Ce terme est utilisé en France à partir de 1550 pour désigner de manière péjorative les protestants calvinistes.
►1533 à 1592 - naissance et mort de Michel de Montaigne. Écrivain français Michel. Eyquem de Montaigne est magistrat à Bordeaux lorsqu'il fait la rencontre d'Étienne de La Boétie, avec qui il se lie d'une profonde amitié et dont il gardera toute sa vie le souvenir. En 1571, il prend la décision de se retirer du monde et commence à composer une première mouture des 'Essais'. Affaibli et sans doute malade, il part en voyage et prend les eaux dans diverses villes d'Europe. Élu maire de Bordeaux en 1581, Montaigne révise les 'Essais', et en fait publier une seconde édition. Une quatrième édition augmentée paraîtra en 1588. A l'âge de cinquante neuf ans, Montaigne meurt au cours d'une messe. Il est enterré dans l'église des Feuillants à Bordeaux.
►1533 Hans Holbein peint 'Les Ambassadeurs'. 'Les Ambassadeurs' (le tableau s'appelle en réalité Jean de Dinteville et Georges de Selve) est une peinture de Hans Holbein le Jeune, actuellement à la National Gallery de Londres. C'est un des chefs-d'oeuvre du peintre et de la peinture en général. Triplement important, par ses résonances historiques, par sa richesse symbolique et par son excellence plastique, il comporte un étrange objet au premier plan resté longtemps mystérieux. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'un historien de l'art, Jurgis Baltrusaitis, redécouvrira que cette forme qui occupe le premier plan de la peinture, et que l'on nommait souvent os de seiche, était en fait l'anamorphose d'un crâne humain : cette peinture est une vanité.
►1534 - 20 avril Première expédition de Jacques Cartier au Canada. Encouragé par François Ier, Jacques Cartier part pour la première de ses expéditions qu'il mènera dans le Saint-Laurent au Canada jusqu'en 1542. Jacques Cartier (31 décembre 1491, Saint-Malo France - 19 janvier 1557) est le premier explorateur français en Amérique du Nord. Il est à l'origine de la découverte de la Nouvelle-Angoulême (région de New York). En 1532, il est présenté à François Ier par Jean Le Veneur, abbé du Mont-Saint-Michel. Bientôt, le roi le choisit afin de trouver "certaines îles et pays où l'on dit qu'il se doit trouver grande quantité d'or et autres riches choses". Il effectue trois voyages vers l'Amérique du Nord entre 1534 et 1542, espérant trouver un passage du Nord-Ouest pour l'Asie.
►1534 - 24 juillet Ordonnance prévoyant la création d'une infanterie permanente.
►1534 - 24 juillet Prise de possession du Canada. Jacques Cartier vient de découvrir le golfe du Saint-Laurent, il prend officiellement, au nom du roi François Ier qui a commandité l'expédition, possession des terres de ce qu'il appelle la Nouvelle-France.
►1534 - 5 septembre Le retour de Jacques Cartier. L'explorateur jette l'ancre à Saint-Malo après un voyage de cent trente-sept jours. Il revient du Canada avec deux Hurons-Iroquois, “preuves vivantes” de sa découverte d'une nouvelle terre. Les Hurons ou Wendat (souvent appelés aux États-Unis les Wyandots) sont une Première Nation de langue iroquoienne, originaire du sud de l'Ontario, au Canada. Le nom Huron leur a été donné par les premiers arrivants français à cause de la coiffure des hommes, semblable à celle des Mohawks, qui rappelait la "hure" du sanglier.
►1534 - 18 octobre Affaire des placards. Dans la nuit des protestants français placardent des proclamations contre la messe en différents lieux du pays et jusque sur la porte de la chambre de François Ier, à Amboise. “Articles véritables sur les horribles, grands et insupportables abus de la messe papale inventée directement contre la Sainte Cène de Notre Seigneur”. C'est ce texte qu'au matin du 18 octobre le roi de France François Ier découvre “placardé” sur la porte même de sa chambre au château d'Amboise.
L'affiche a aussi été apposée sur les murs de plusieurs villes de France. Mais ce qui est intolérable au roi, qui jusque-là n'a pas voulu devenir l'ennemi des huguenots, c'est ce placard posé sur la porte de sa chambre qui le met en cause. Le roi ne peut tolérer cet affront et se doit d'être le roi très catholique qui devra réduire l'hérésie. L'affaire des Placards, qui éclate en ce jour, marque le début d'implacables guerres de religion. A la suite de laquelle François Ier prend position contre la Réforme.
►1534 Les Turcs prennent Tunis. Barberousse pénètre les terres tunisiennes et envahit la capitale. Le roi hafside Moulay Hassan est secouru par Charles Quint qui en profite pour imposer son autorité sur lui et sur la région. Toutefois, les Turcs ne s'en tiendront pas là, ils prendront le dessus sur les Espagnols et récupèreront Tunis, asseyant ainsi leur domination sur le pays. Arudj Barberousse, Arudj Reïs (1474, Mételin - 1518) (ou Horuk) dit Baba-Oruç (turc : baba, père prononcé baba-oroutch) qui par déformation donna Barberousse.
►1534 Martin Luther traduit la Bible en Allemand.
►1534 Le Parmesan commence "la Vierge au long cou". Le peintre italien surnommé Le Parmesan entreprend l'une de ses principales réalisations picturales. Il s'agit en fait d'un retable commandé par Elena Baiardi pour l'église Santa Maria de Servi, à Parme. Intitulée "la Vierge au long cou", la toile marque par son raffinement et par l'irréalisme des proportions utilisées. Elle s'inscrit ainsi dans la forme artistique du maniérisme, souvent caractérisée par l'élongation élégante des membres et du corps. Le Parmesan y travaillera jusqu'en 1540, mais n'achèvera jamais son oeuvre. La toile sera plus tard exposée à Florence.
►1535 - 13 janvier François Ier censure les livres. Se sentant menacé par les idéologies luthériennes, le roi de France fait interdire toute impression de livres. Il annule sa décision quelques jours plus tard mais conserve le principe de la censure qu'il confie à une commission du parlement de Paris.
►1535 21 janvier Premières exécutions d'hérétique. Une journée d'expiation solennelle se clôt par la mort sur le bûcher de six nouveaux hérétiques protestants.
►1535 mai Seconde expédition de Jacques Cartier au Canada.
► 1535 Thomas More, auteur de 'L'utopie', est décapité pour avoir refusé de reconnaître Henri VIII d'Angleterre comme le chef suprême de l'église. Utopie est un terme inventé en 1516 par Thomas More dans son livre 'Utopia', provenant du grec : le préfixe ou (de sens privatif et noté à la latine, au moyen de la seule lettre u, prononcée comme ou) et topos (lieu) et signifiant donc "qui n'est en aucun lieu". Il est aussi possible d'y voir un préfixe eu, "bon" c'est à dire "bon lieu". Cependant, cette interprétation reste minoritaire. On peut considérer l'Utopie de More comme l'origine du genre littéraire du même nom.
L'une de ses sources d'inspiration est Platon, et notamment La République. En un sens plus général, l'utopie désigne tout projet d'une société idéale et parfaite ; laquelle est tenue par ses auteurs pour chimérique ou, au contaire, contient le principe de progrès réels, un ferment et un stimulant pour un avenir meilleur. Il existe aussi des contre-utopies ou dystopies mais ce terme d'origine anglaise est peu utilisé en français. De nos jours, l'utopie a un caractère social très marqué. Cependant, de façon marginale, par le passé, l'utopie a pu également englober le champ de la science, de la médecine…
►1535 - 15 juin - Impression de la Bible de Neufchâtel de Robert Olivétan (en français): s'appuie sur la version de Lefèvre d'Étaples.
► 1536 François Ier s'allie avec les Ottomans de Soliman le Magnifique pour combattre son ennemi Charles Quint. Aucun traité n'est signé entre la France et les Ottomans, mais une coopération étroite permet aux deux puissances de combattre efficacement la flotte espagnole en Méditerranée.
►1536 huitième guerre d'Italie (1536-1542)
►1536 à 1538 - Troisième guerre avec Charles Quint. - Celle-là eut pour prétexte l'assassinat à Milan d'un agent politique que le roi de France y entretenait secrètement. La vraie raison en fut, comme pour les précédentes, la nécessité de combattre l'extension de la puissance de Charles Quint. Une armée française s'empare sans coup férir du Piémont, mais doit bientôt se retirer devant les Impériaux qui, en la poursuivant, envahissent la Provence. Partout les populations se défendent bravement, et poussent l'abnégation jusqu'à aider les troupes royales à ravager le pays, afin que les ennemis n'y trouvent pas de quoi vivre.
En effet, celles-ci ne pouvant subsister dans les campagnes où tout a été détruit, abandonnent le pays. Pendant ce temps, une armée allemande a échoué dans sa tentative d'envahir la Picardie. Enfin, Soliman le Magnifique en envahissant la Hongrie, a créé de nouveaux embarras à Charles Quint. L'Empereur est bien aise de pouvoir signer avec François Ier une trêve de dix ans (trêve de Nice, 1538). La Région du Piémont est une région d'Italie du nord. Le Piémont tire son nom de sa situation, au pied des Alpes. Il est traversé par le Pô.
►1536 - 19 mai Henri VIII fait décapiter son épouse. Le roi d'Angleterre Henri VIII d'Angleterre, ne supportant plus les soupçons d'adultère qui portent sur sa deuxième épouse, Anne Boleyn, l'a fait décapiter. Le roi aura quatre autres épouses, dont Catherine Howard qui sera exécutée en 1542 pour infidélité. La fille d'Anne Boleyn et d'Henri VIII d'Angleterre régnera tout de même sur le pays à partir de 1558 sous le nom d'Élisabeth Ière d'Angleterre.
►1536 2 juin Charles Quint attaque la Provence. Dès le début de l'année 1536, la guerre entre Charles Quint et François Ier a repris. Les populations de Provence où les troupes impériales pénètrent, ce 2 juin, pour apporter leur soutien au roi de France, opposent une résistance acharnée et vont jusqu'à ravager elles-mêmes leur pays, pour que les troupes de Charles Quint ne puissent trouver de quoi vivre. Ce n'est qu'en juin 1538 qu'une trêve conclue à Nice mettra fin aux affrontements.
►1536 - 10 août Mort du Dauphin François de France.
►1536 Victoire de François Ier sur Charles III de Savoie.
►1536 Oronce Finé écrit 'Commentaires sur la géométrie d'Euclide'. Oronce Fine (1494 - 1555) était un mathématicien et cartographe français qui réalisa la première carte de France imprimée dans ce pays. Sa protomathésis est un cours de mathématiques pures et appliquées.
►1536 Décès à Basel en Suisse de Desiderius Erasmus (dit Érasme) à l'âge de 69 ans.
►1537 - 29 mai : publication de la bulle pontificale Sublimus Dei condamnant l'esclavage. Sublimis Deus est une bulle pontificale de Paul III, du 29 mai 1537, qui interdit l'esclavage des Indiens d'Amérique. Paul III, Alexandre Farnèse, né à Rome ou à Canino, le 29 février 1468, élu le pape 12 octobre 1534. Il prend le nom de Paul III (en latin Paulus III, en italien Paolo III) et règne jusqu'à sa mort, à Rome, le 10 novembre 1549.
►1537Traduction en français du 'Courtisan' de Baldassare Castiglione. Baldassare Castiglione, comte de Novellata est un écrivain et diplomate italien né le 6 décembre 1478 à Mantoue, mort le 8 février 1529 à Tolède (Espagne). En 1528, l'année précédant sa mort, son livre le plus célèbre, le 'Livre du courtisan' est publié à Venise. Il décrit la cour d'Urbin, au temps du duc Guidobaldo de Montefeltro et son courtisan idéal, au travers de dialogues philosophiques et culturels dont il a été le témoin. Son livre est traduit en français dès 1537, puis en espagnol, en anglais, en allemand et en latin. Ce livre deviendra vite un manuel de savoir-vivre dans les cours européennes.
►1537 Décret à l'origine du dépôt légal imposant le dépôt d'un exemplaire à la Bibliothèque royale de toutes les publications imprimées en France.
►1537 Bonaventure des Périers écrit 'Cymbalum mundi'. Bonaventure des Périers, né vers 1510, mort vers 1544, écrivain français. Bonaventure des Périers était secrétaire de Marguerite de Navarre ou de Valois. Il travailla en 1534 à la traduction de la Bible de Lefèvre d'Étaples, et écrivit de nombreux vers. Son oeuvre la plus connue est le 'Cymbalum mundi' (Carillon du monde), en français, avec quatre dialogues poétiques, faits antiques, joyeux et facétieux. Publié à Lyon, en 1537, cet ouvrage fut saisi par ordre du Parlement, et détruit. Le Cymbalum était supposé adressé par Thomas du Clénier (l'incrédule) à Pierre Tryocan (anagramme de Croyant) ; dans une série d'allégories, des Périers ridiculisait à la fois catholiques et protestants. Des Périers est un conteur au style charmant, plein d'esprit et de finesse.
►1538 - 18 juin Le pape Paul III fait signer une trêve à Nice entre François Ier de France, installé au château de Villeneuve et Charles Quint (Charles V) qui se tient dans une galère dans la rade de Villefranche-sur-Mer. Il les encourage à lancer une croisade contre l'Angleterre et les Turcs. Trêve de Nice de dix ans entre François Ier et Charles Quint. Celle-ci, signée entre Charles Quint et François Ier, conclut une trêve de dix ans et sera suivie par le traité d'Aigues-Mortes qui garde la Savoie au roi de France et donne le Milanais à l'empereur.
►1538 - 14-15 juillet Rencontre de François Ier et Charles Quint à Aigues-Mortes. Charles Quint et François Ier ont conclu une trêve de dix ans. En ce jour, à Aigues-Mortes, ils se réconcilient et signent un traité qui garde la Savoie au roi de France et donne le Milanais à l'empereur. Charles Quint obtient du roi de France l'autorisation de traverser ses États pour réprimer la révolte de Gand.
►1538 François Ier crée l'Imprimerie du Roi.
►1538 Hans Holbein peint 'Anne de Clèves’
►1539 - 10 août Édit de Villers-Cotterêts instituant le français comme langue officielle du royaume. Dans un pays où les clercs et les érudits pétrarquisent, latinisent et pindarisent (parler, écrire d'une manière recherchée), l'ordonnance du roi François Ier impose l'usage de la langue française pour tous les arrêts judiciaires du royaume, qui doivent désormais être “prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement”. La même ordonnance intime aux curés l'obligation de tenir un registre des baptêmes et des sépultures. L'état civil est né.
L'Édit de Villers-Cotterêts, promulgué par François Ier, fait du français la langue officielle de l'État. Il n'est nullement dirigé contre les autres langues ou dialectes du royaume, mais contre le latin qui était jusque-là la langue principale des lois et de la chancellerie royale. C'est l'acte de consécration du français comme langue officielle de la France. L'ordonnance de Villers-Cotterêts est un document signé à Villers-Cotterêts entre le 10 et le 15 août 1539 par le roi de France François Ier. Forte de 192 articles, elle porte réforme de la juridiction ecclésiastique, réduit certaines prérogatives des villes et rend obligatoire la tenue des registres de baptêmes.
Elle est surtout connue pour être l'acte fondateur de la primauté et de l'exclusivité du français dans les documents relatifs à la vie publique ; en effet, pour faciliter la bonne compréhension des actes de l'administration et de la justice, elle leur impose d'être rédigés dans cette langue. Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l'administration, en lieu et place du latin et des autres langues du pays. Cette ordonnance, intitulée exactement "Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances" a été rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, avocat et membre du Conseil Privé du roi. Elle s'est longtemps appelée Guillemine ou Guilelmine en référence à son auteur. Hors des Archives nationales, il n'existe que deux exemplaires originaux sur parchemin : l'un aux Archives d'Aix-en-Provence, l'autre aux Archives départementales de l'Isère.
►1539 Robert Estienne écrit 'Dictionnaire françois-latin' (il avait publié en 1531 un Dictionarium Latino-gallicum complété en 1538). Révisé et augmenté jusqu'en 1607. C'est le premier dictionnaire de la langue française, mais le latin est encore présent (le premier dictionnaire vraiment français sera celui de Nicot en 1606). Robert Estienne (Paris 1503 - Genève 7 septembre 1559) était un grand imprimeur français du XVIe siècle.
►1540 Révolte de Gand. Révolte des Gantois, accablés d'impôts par Charles Quint. La couronne y perd ses privilèges. Charles Quint entre dans Gand avec une armée, supprime les privilèges de la ville et les jurandes, détruit les fortifications.
►1540 Création de la Compagnie de Jésus d'Ignace de Loyola. Ignace de Loyola (1491 en Espagne- 1556), né dans une famille de la petite noblesse basque. Jusqu'à l'âge de trente ans, il vécut la vie d'un homme comme les autres. Mais, en 1521, lors du siège de Pampelune, il fut blessé ; et, pendant sa convalescence, se "convertit". Il mena alors une vie d'ermite de 1522 à 1523, au cours de laquelle il commença la rédaction des 'Exercices spirituels'. Puis, pendant onze ans, il parcourut le monde comme "pélerin de Dieu", se rendant à Jérusalem en 1523 et fréquentant les universités espagnoles d'Alcala et Salamanque, et celle de Paris.
En France, Ignace de Loyola regroupa autour de lui des étudiants de qualité, issus d'horizons divers, comme Pierre Favre, François Xavier, Jacques Lainez ; bientôt, les nouveaux amis décidèrent de ne plus se séparer et s'engagèrent, par le voeu de Montmartre du 15 août 1534, à demeurer pauvres et chastes et à se rendre à Jérusalem pour y convertir les infidèles ou, si le voyage n'était pas possible, à se mettre à la disposition du pape. Ignace de Loyola fut en 1537 ordonné prêtre à Venise. Dès lors, commença l'ébauche de la Compagnie de Jésus ou Ordre des jésuites.
En 1539, il écrira la Formula instituti, esquisse des constitutions finales de la Compagnie, dont la création sera acceptée par le pape Paul III en septembre 1540. À sa mort, le 31 juillet 1556 à Rome, la Compagnie de Jésus comptait plus de mille membres, soixante-douze résidences et soixante-dix-neuf maisons et collèges ; Saint-Joseph de Tivoli (Bordeaux), Caousou (Toulouse), Provence (Marseille) et Saint-Joseph (Avignon) sont les actuels établissements fondés par la compagnie de Jésus. Ignace de Loyola a été canonisé le 12 mars 1622, en même temps que François-Xavier et Thérèse d'Avila. Jésuites ou La Compagnie de Jésus est un ordre catholique fondé par Ignace de Loyola et reconnu depuis 1540.
On appelle ses membres les jésuites. Tous les membres de la Compagnie professent les trois voeus habituels des religieux catholiques : ceux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance à leur supérieur. À cela, les profès prononcent un quatrième voeu, celui d'obéissance au pape. Jésuites. Membres de la Compagnie de Jésus fondée par Ignace de Loyola en 1540. Cet ordre, très hiérarchisé, devient au XVIe siècle un foyer actif de la Contre-Réforme, se présentant comme "une véritable équipe volante au service de la chrétienté menacée". Après des voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance au pape, le jésuite suit une formation d'une dizaine d'années et part exercer sa mission d'évangélisation et d'enseignement dans le monde entier.
►1540 Traduction d''Amadis de Gaule' par Herberay des Essarts. Amadis de Gaule, dit le Chevalier du Lion, le Beau Brun, le Beau ténébreux, héros des romans de chevalerie, était fils de Périon, roi fabuleux de France. Amadis joue en Espagne un rôle analogue à celui du roi Arthur en Angleterre et de Charlemagne en France. Les aventures de ce prince n'ont rien d'historique; on ne sait même précisément à quelle époque les rapporter.
►1540 Gilles Corrozet écrit 'Blasons domestiques'. Gilles Corrozet (1510-1568), important libraire parisien, fut aussi un auteur prolifique et à succès, qui occupa par là une place tout à fait exceptionnelle dans le monde de l'édition parisienne du XVIe siècle. Compilateur et chroniqueur inlassable, il se passionna pour les "antiquitez" des villes de France. Son ouvrage le plus connu reste aujourd'hui son livre sur Paris, oeuvre multiforme qu'il remania tout au long de sa vie et qui est à la fois un éloge des origines mythiques de la ville, une description historique et monumentale et un exemple précoce de guide "touristique".
►1540 Étienne Dolet écrit 'Traité de la ponctuation de la langue françoise plus des accents d'ycelle; préconise usage des accents et de l'apostrophe'. Étienne Dolet est un écrivain, poète, imprimeur et humaniste français (Orléans, 3 août 1509–Paris, 3 août 1546). En 1535, il participe aux listes contre Érasme dans la controverse de Cicéron en publiant grâce à l'imprimeur Sébastien Gryphe le 'Dialogus de imitatione Ciceroniana'; et dans les années qui suivent les deux volumes de 'Commentariorum linguae Latinae'. Ce travail est dédicacé à François Ier qui lui donne le privilège d'imprimer pour 10 ans tout travail de sa propre plume ou avec sa supervision.
Il obtient aussi une grâce pour son homicide accidentel du peintre Compaing qui dit-il voulait l'assassiner. Il peut ainsi commencer son travail et édite Galien, Rabelais, Marot. Il n'ignore pas les dangers auxquels il est exposé à cause de la bigoterie de son temps. On le voit non seulement par le ton de ses textes mais également par le fait qu'il a essayé d'abord de se concilier ses adversaires en éditant un christianus de Caton, dans lequel il faisait se profession de foi. Cette catholicité de façade, malgré son ultra-ciceronisme, transparaît à travers les travaux sortis de ses presses, antiques et modernes, sacrés et séculiers, du Nouveau Testament en latin aux textes français de Rabelais.
Mais avant que son autorisation d'imprimer n'expire, son travail est interrompu par ses ennemis qui réussissent à l'emprisonner en 1542 sous la charge d'athéisme. Après un premier emprisonnement de 15 mois il est relâché grâce à l'intervention de l'évêque de Tulle Pierre Duchatel. Remis en prison une seconde fois en 1544, il s'échappe par ses propres moyens et fuit dans le Piémont, en Italie. Cependant, il revient imprudemment en France en pensant qu'il pourrait imprimer à Lyon des lettres pour appeler à la justice du roi de France, de la reine de Navarre et du Parlement de Paris. Il est à nouveau arrêté et jugé athée évadé par la faculté de théologie de la Sorbonne et ramené à Paris. Le 3 août 1546, il est torturé, étranglé et brûlé avec ses livres sur la Place Maubert.
►1541 - 13 mai Nouvelle expédition de Jacques Cartier au Canada.
►1541 Jean Calvin s'installe à Genève.
►1541 à 1614 - naissance et mort de Le Greco (Domenikos Theotokopoulos). Peintre grec. Avant la découverte de La dormition de la Vierge, les premiers travaux du Greco étaient complètement inconnus. Ils suivent le modèle byzantin médiéval tardif, avec ses figures stylisées peintes dans des couleurs brillantes sur un fond d'or. Les peintres d'icône avaient pour but d'incarner le monde de l'esprit dans leur art, et cette approche sera celle du Greco dans toute sa carrière. Le Greco était fier de son héritage grec et durant toute sa vie il a signé ses peintures en Grec: Domenikos Theotokopoulos.
►1541 - 25 décembre Inauguration de la fresque du Jugement dernier de la chapelle Sixtine. La Fresque du "Jugement dernier" de la chapelle Sixtine est inaugurée. Mesurant environ 13 mètres sur 12 et réalisée par Michel-Ange, l'oeuvre tourmentée donne une vision dramatique et douloureuse du jugement dernier et rompt ainsi avec la tradition. La représentation de plus de quatre cents personnages, tous nus, provoque de vives critiques. Certains personnages seront même "habillés" en 1566.
►1541 Réédition en français de 'Institution de la religion chrétienne' de Jean Calvin (écrit d'abord en latin), doctrine du calvinisme. Le calvinisme est une doctrine théologique chrétienne, protestante, élaborée par Jean Calvin dans son Institution de la religion chrétienne, et développée par Théodore de Bèze. Le Calvinisme prit naissance vers 1536 à Genève, où il n'a pas cessé de dominer jusqu'au XIXe siècle. Il se répandit bientôt dans plusieurs cantons de la Suisse, en France, en Hollande, en Angleterre, en Écosse, aux États-Unis, etc. Calvinisme.
Doctrine du réformateur Calvin, qui s'inspire de l'oeuvre de son prédécesseur Luther, père du protestantisme. Ses grands principes religieux reposent sur la reconnaissance de la Bible comme seule source de la foi, l'admission de certains dogmes originels (prédestination, grâce) et du baptême et de la communion comme seuls sacrements. Le calvinisme reconnaît en outre la valeur du travail et autorise le prêt d'argent, ce qui permettra aux huguenots (calvinistes français) d'exercer des métiers interdits aux chrétiens.
►1541 La Réforme adopte la langue française: publication à Genève de l'Institution de la religion chrétienne du picard Jean Calvin, 'composée en latin [Christianae religionis institutio, 1536] par Jean Calvin, et 'translatée en françois, par luysmesme'.
►1542 - 12 février Exécution de la cinquième femme d'Henri VIII d'Angleterre. Trompé par sa cinquième épouse, Catherine Howard, le roi d'Angleterre Henri VIII d'Angleterre la fait décapiter. En 1536, il avait aussi fait exécuter sa première femme Anne Boleyn, accusée d'inceste. En 1543, Henri VIII d'Angleterre épousera la protestante Catherine Parr. Elle sera sa dernière épouse.
►1542 - 12 juillet François Ier déclare la guerre à Charles Quint.
►1542 à 1544 - Quatrième guerre avec Charles Quint. - En 1540, la ville de Gand se révolte contre Charles Quint qui, pour aller la châtier, est obligé de traverser le territoire de la France. Il en obtient l'autorisation de François Ier qui, d'autre part, donne de grandes fêtes en son honneur, mais lui demande en échange le Milanais pour son fils. Charles Quint promet tout ce qu'on lui demande, tant qu'il est en territoire français, mais une fois rentré dans ses États, refuse de tenir ses promesses. Du reste, il essuie un grave revers en s'attaquant aux pirates barbaresques. Un envoyé du roi de France au sultan est assassiné à point pour justifier la reprise de la guerre.
François Ier prend l'offensive, sur toutes les frontières de France à la fois, pendant qu'une flotte turque vient aider la flotte française à bombarder Nice (1544). En Italie, l'armée française du comte d'Enghien couronne une série de succès partiels, par la victoire de Cérisoles. Mais Charles Quint a proclamé une sorte de croisade contre François Ier, coupable de faire la guerre avec l'appui des mahométans à un prince chrétien, et Henri VIII d'Angleterre, bien qu'il ait rompu avec le pape et qu'il soit un chrétien des plus tièdes, se découvre des convictions qui l'entraînent dans le parti de l'Empereur. Pendant que ce dernier envahit la Picardie et la Champagne où il s'avance jusqu'à Château-Thierry, le roi d'Angleterre fait une descente sur les côtes du Pas-de-Calais; il s'empare de Boulogne, mais se borne ensuite à guerroyer dans le pays.
Cependant les Impériaux ont été arrêtés en Champagne par une partie des troupes rappelées d'Italie, et aussi par l'éclosion de troubles suscités en Allemagne par les protestants, troubles que Charles Quint juge assez menaçants pour lui faire abandonner la partie en France. En effet, il consent à signer avec François Ier le traité de Crépy-en-Laonnois qui termine (sept. 1544) cette quatrième guerre dont la France ne recueille aucun avantage. Quant à Henri VIII d'Angleterre, il continue à occuper le Boulonnais sans faire de grands efforts pour élargir sa conquête momentanée: cette situation prend fin en 1546 par le Traité d'Ardres.
►1542 - 21 juillet Le Saint-Office succède à l'Inquisition médiévale. Face à la diffusion du protestantisme, Paul III décide de mettre en place la congrégation de la Suprême et Universelle Inquisition. Le Saint-Office naît sur les cendres d'une Inquisition médiévale qui n'a pas résisté au XVème siècle. Sa mission est de veiller au respect de la doctrine et de la foi catholiques, même chez les évêques.
Cette nouvelle Inquisition, moins virulente et moins puissante que son ancêtre médiéval, marquera les esprits avec quelques procès, comme celui de Galilée et grâce aussi à l'Index, repertoire de livres interdits. Saint-Office, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est la plus ancienne des neuf congrégations de la curie romaine. Elle a été fondée sous le nom de Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine et universelle par le pape Paul III dans la bulle Licet ab initio, le 21 juillet 1542. Elle avait pour mission de lutter contre les hérésies. Elle était donc responsable de l'inquisition.
►1542 - 30 août Nouvel édit contre les Luthériens.
►1542 Antoine Héroët écrit 'La Parfaite amie'. Antoine Héroët, évêque de Digne, pensionné de Marguerite de Navarre, a connu dans l'entourage de la reine les poètes du temps, surtout Clément Marot. Poète lui-même et fin lettré, il a publié en France l''Androgyne' de Platon traduit par Marsile Ficin : on le considère souvent comme l'introducteur du platonisme en France.
►1542 Clément Marot écrit 'L'Enfer’
►1542 Marguerite de Navarre écrit l''Heptaméron'. Il a pour modèle les dix journées du 'Décaméron' de Boccace, texte traduit en France dès 1414. Mais, interrompu en 1549 par la mort de Marguerite, l''Heptaméron' ne rassemble que 72 nouvelles se déroulant en sept journées. Comme dans l'ouvrage de Jean Boccace, les nouvelles s'inscrivent dans une histoire-cadre. Dix voyageurs sont réunis dans une abbaye, alors qu'un violent orage a coupé toute communication. Pour passer le temps, cette société écoute des histoires vraies dans des registres divers. La réussite de cet ouvrage tient au fait qu'il privilégie aussi la conversation, car chaque nouvelle est suivie des commentaires tenus par l'ensemble des auditeurs.
►1543 neuvième guerre d'Italie (1543-1545)
►1543 - 24 mai, Révolution copernicienne : Andreas Osiander publie les théories de l'astronome polonais Nicolas Copernic 'Des révolutions des sphères célestes' (De revolutionibus orbium coelestium) et montre que la théorie héliocentrique simplifie les calculs astronomique. Cet ouvrage ne sera accepté que cent ans plus tard. Révolution copernicienne, on désigne sous l'expression révolution copernicienne la transformation des méthodes scientifiques et des idées philosophiques qui a accompagné le changement de représentation de l'univers du XVIe au XVIIIe siècle, faisant passer les représentations sociales accompagnant les représentations mentales de l'univers, d'un modèle géocentrique, selon Ptolémée (IIe siècle, déjà adopté au IVe siècle av. J.-C. par la plupart des Grecs), au modèle héliocentrique défendu par Nicolas Copernic, perfectionné par Johannes Kepler, Galilée, et Isaac Newton. La révolution copernicienne, au sens propre, consistait à expliquer le monde, et les objets qui le composent, par la gravitation, appelée loi universelle de la gravitation en raison de son caractère considéré comme général à l'époque.
►1543 - 6 septembre Prise de Nice. Siège de Nice par les troupes françaises du duc d'Enghien (François de Bourbon-Condé) et la flotte turque de Barberousse, bey de Tunis. La ville se rend sauf la citadelle. Suivant la tradition niçoise, l'héroine et lavandière Catherine Ségurane repousse les Turcs en levant sa robe et montrant ses fesses.
►1543 Traduction de 'Roland furieux' de Ludovico Ariosto. Ludovico Ariosto, dit L'Arioste est un poète italien né le 8 septembre 1474 à Reggio d'Émilie et mort le 6 juillet 1533 à Ferrare. Auteur notamment de 'Roland furieux'.
►1543 André Vésale écrit 'De humani corporis fabrica, libri VII'. André Vésale (31 décembre 1514, Bruxelles - 1564, île de Zante) était un anatomiste belge considéré par de nombreux historiens des sciences comme le plus grand anatomiste de la Renaissance, voire le plus grand de l'histoire de la médecine. Ses travaux, outre qu'ils feront entrer l'anatomie dans la modernité, mettront fin au dogme du galénisme (de Claude Galien) qui bloquait l'évolution scientifique depuis plus de mille ans aussi bien en Europe que dans l'Islam. André Vésale est né le 31 décembre 1514 à Bruxelles (alors sous la dépendance de l'Espagne).
Sa maison se situait juste en face de la colline des exécutions, ce qui l'a amené à voir de nombreux cadavres et des squelettes nettoyés par les oiseaux durant son enfance. Ce fait a dû jouer un grand rôle dans sa vocation. En 1530, il s'inscrit à l'université de Louvain, puis continue ses études à Paris sous la direction du grand Jacques Dubois (Jacobus Sylvius), un des médecins les plus réputés de l'époque, mais également farouche partisan du galénisme. De fait Sylvius sera le plus farouche adversaire de Vésale lorsqu'il publiera ses oeuvres. La guerre entre la France et le Saint-Empire oblige Vésale à s'exiler au bout de trois ans.
Après un court service dans l'armée impériale, il rentre à Louvain où il passe sa thèse en 1537. Puis il se rend à l'université de Padoue, l'école de médecine la plus réputée d'Europe. Au bout de deux jours d'examen, l'université de Padoue lui offre un poste de lecteur en chirurgie, preuve de ses capacités intellectuelles hors du commun. Le rôle de lecteur consistait à lire les oeuvres de Galien en direct tandis qu'un barbier effectuait la dissection et montrait aux élèves les organes décrits par Galien. Vésale préfèrera effectuer la dissection lui-même. Par ailleurs, n'ayant pas toujours de cadavres à disposition pour ses cours, il fera faire six grandes planches anatomiques représentant le squelette et les organes internes. Pour faire face au risque de plagiat, il publie ces planches en 1538 (Tabulae anatomicae sex).
Dès 1539, la célébrité de Vésale est telle que le juge Marcantonio met à sa disposition les cadavres des condamnés à mort allant même jusqu'à retarder leur exécution de façon à ce que les corps soient frais lorsqu'il en aurait besoin. Dès lors, Vésale constate rapidement des erreurs dans les descriptions de Galien et comprend qu'elles s'appliquent au singe et non à l'homme. Il va entreprendre la rédaction d'un traité d'anatomie destiné à corriger les erreurs. En 1540, il confirme son hypothèse en disséquant à Bologne le cadavre d'un singe et d'un homme et montre que l'appendice tel que le décrit Galien n'existe que chez le singe.
En 1543, après quatre ans de travaux incessants, il publie ses découvertes dans 'De humani corporis fabrica', couramment appelé la 'fabrica' le plus grand traité d'anatomie (663 pages) depuis Galien, l'année-même ou Copernic publie son 'De revolutionibus' qui devait révolutionner l'astronomie. Les déchaînements des galénistes l'écoeurent et en 1546, il abandonne l'étude de l'anatomie pour devenir médecin personnel de l'empereur Charles Quint puis de Philippe II d'Espagne. Pour le reste de sa vie, il deviendra le médecin des grands, il tentera même de soigner le roi de France Henri II, blessé à l'oeil par une lance lors d'un tournoi. En 1563, pour échapper à des problèmes judiciaires, il quitte Madrid pour effectuer un pèlerinage à Jérusalem. Lors du voyage de retour son bateau fait naufrage, il mourra d'épuisement sur les côtes de l'île de Zante le 2 octobre 1564. Ambroise Paré reconnaît avoir largement puisé dans l'ouvrage de Vésale dans ses travaux.
►1543Robert Estienne écrit 'Dictionnaire français-latin'.Robert Estienne (Paris 1503 - Genève 7 septembre 1559) était un grand imprimeur français du XVIe siècle. Son nom a été donné à l'École Supérieure Estienne des Arts et des Industries Graphique, à Paris, spécialisée dans les arts graphiques et l'imprimerie. En 1550, il fuit à Genève, son frère Charles Estienne doit reprendre la direction de l'imprimerie familiale.
►1543 mort de Nicolas Copernic.
►1544 - 19 janvier Naissance de François (futur François II), fils de Henri II et Catherine de Médicis. François II de France (Fontainebleau, le 19 janvier 1544 - Orléans, le 5 décembre 1560), roi de France de 1559 à 1560. François II est le fils aîné d'Henri II de France et de Catherine de Médicis.
►1544 14 avril Victoire française contre les Impériaux à Cérisoles (Italie). La bataille de Cérisoles eut lieu le 11 avril 1544 près de la ville italienne de Cérisoles (Ceresole Alba). Elle opposa les français aux troupes de Charles Quint commandées par Alfonso de Avalos. Ce fut une victoire française.
►1544 18 septembre Signature d'un Traité de Paix avec Charles Quint à Crépy-en-Laonnois. Charles Quint récupère la Flandre, l'Artois, le Piémont et la Savoie. Pour sa part, François Ier obtient que l'empereur reconnaisse ses droits sur la Bourgogne. Tous deux s'allient contre les Turcs. Ce traité termina la dernière de ces guerres, François Ier abandonna le Milanais à Charles Quint, mais non sans contrepartie. Contre son dangereux adversaire, il avait réussi jusqu'au bout, et ce n'est pas un médiocre succès, à sauvegarder l'intégrité de son royaume. Mieux encore, il le laissait agrandi.
►1544 Maurice Scève écrit 'Délie, object de plus haulte vertu'. Maurice Scève, né vers 1501 à Lyon et mort vers 1560, Maurice Scève fut docteur en droit, et reconnu poète officiel. Humaniste passionné par l'Antiquité, l'Italie, Platon, Pétrarque. Auteur de 'Délie, objet de plus haute vertu'.
►1544 mort de Clément Marot.
►1545 - 13 décembre : Début du Concile de Trente (1545 - 1563) qui rappelle la nécessité du respect de la règle de Saint Benoît. L'Église romaine y tente, sans succès, de rétablir l'unité de la chrétienté. Contre-Réforme : le concile de Trente redéfinit la plupart des points du dogme catholique, réaffirme les pratiques du culte, prend de nombreux décrets disciplinaires, prépare une version officielle de la Bible (Vulgate), un Catéchisme (1566), un Bréviaire (1568), un Missel romain (1570)... De nombreux théologiens espagnols (Francisco de Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto, Bartolome Carranza, Diego Laynez, Alfonso Salmeron) participent aux travaux. Sessions 1 à 8 du 13 décembre 1545 au 3 mars 1547 : les Pères précisent le texte du symbole de la Foi, déterminent les livres canoniques de l'Ancien et du Nouveau Testament, les règles à suivre pour éditer des textes canoniques, et imposent l'usage obligatoire de l'édition latine de Saint Jérôme (Vulgate). Ils établissent la doctrine de la justification, rappellent que l'Église reconnaît sept sacrements.
Ils précisent les conditions de choix des évêques, rappellent l'interdiction du cumul des évêchés et des cures, précisent les règles de sacre des prélats, les règles d'établissement et d'entretien des institutions scolaires, et celles de la désignation des prédicateurs. Le concile de Trente est le 19ème concile oecuménique reconnu par l'Église catholique romaine. Il est convoqué par le pape Paul III en 1542, en réponse aux demandes formulées par Martin Luther dans le cadre de la Réforme protestante. Il se déroule en 18 ans, sur 25 sessions, quatre pontificats et trois villes. Contre les thèses protestantes, il définit l'autorité de la Bible, le péché originel et la justification et confirme les sept sacrements, le culte des saints et des reliques ainsi que le dogme de la transsubstantiation.
Sur le plan disciplinaire, il créée les séminaires diocésains, destinés à former les prêtres. Trente est l'un des conciles les plus importants de l'histoire du catholicisme ; il est le plus abondamment cité par le concile Vatican II. Le concile de Trente organise la contre-Réforme. 220 prélats signent l'acte final. La Contre-Réforme est un mouvement de réaction de l'Église catholique romaine, amorcée dès le XVe siècle dont Anna Bijns fut le fer de lance et accélérée par la Réforme protestante. L'expression vient de l'historiographie allemande du XIXe siècle. Les historiens lui préfèrent désormais le terme de "Réforme catholique". Le concile de Trente (1545–1563) mit fin aux abus les plus criants, comme les trafics d'indulgences ou la vie dissolue d'une partie du clergé (décrets rappelant le célibat des prêtres ou le devoir de résidence des évêques).
Il réorganisa la Curie romaine. Par ailleurs, il redéfinit et renforça les positions traditionnelles de l'Église catholique concernant la théologie et l'organisation de l'Église. Il fixa définitivement le canon de la Bible catholique. Il répandit la doctrine ainsi réaffirmée par le biais d'un Catéchisme (1566), d'un bréviaire (1568) et d'un Missel romain (1570). La nouvelle liturgie conçue par le concile (messe tridentine, dite "messe de saint Pie V") dura jusqu'à Vatican II. La Réforme ainsi conçue fut répandue dans l'Église par des personnalités comme Robert Bellarmin, Charles Borromée, Ignace de Loyola, Philippe Néri ou encore François de Sales. Paul III, Alexandre Farnèse, né à Rome ou à Canino, le 29 février 1468, élu le pape 12 octobre 1534. Il prend le nom de Paul III et règne jusqu'à sa mort, à Rome, le 10 novembre 1549.
Lorsque, âgé de 66 ans, Alessandro Farnèse fut élu au pontificat à l'unanimité, il était cardinal et évêque d'Ostie (1524). Né dans une ancienne et puissante famille, ce prince humaniste de la Renaissance, père de deux enfants, amateur des fastes et du luxe, mécène des lettres et des arts - il fut le protecteur de Michel-Ange, à qui il confia la direction des travaux de la basilique Saint-Pierre et l'exécution de la fresque du Jugement dernier dans la chapelle Sixtine. Il fut aussi le souverain pontife qui donna l'impulsion à la Contre-Réforme catholique : après avoir renouvelé la Curie par l'élection de cardinaux acquis au renouveau de l'Église romaine, et créé une commission pontificale chargée de proposer et de mettre en oeuvre cette réforme, il approuva la création d'ordres nouveaux et de congrégations missionnaires - entre autres, les barnabites et la Compagnie de Jésus - qui devaient rapidement apporter un concours décisif dans la propagation de la Réforme catholique.
L'apogée de son pontificat, marqué en Italie par le rétablissement de l'Inquisition (1542) et, en politique extérieure, par la neutralité de l'Église dans les conflits territoriaux, fut la convocation d'un concile qui, après plusieurs tentatives (Mantoue, 1536 ; Vicence, 1537) parvint à s'ouvrir à Trente (1545), avant de se poursuivre à Bologne en 1547. Anna Bijns est une écrivain néerlandaise, né à Anvers en 1493 et décédée dans cette ville en 1575. Considérée comme le fer de lance de la Contre-Réforme aux Pays-Bas, elle fut comparée à Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde.
►1545 avril Destruction de villages Vaudois. Le Parlement d'Aix-en-Provence ordonne le massacre des Vaudois de Provence, les déclarant hérétiques. Plusieurs villages sont détruit (Mérindol, Cabrières…).
►1545 Ambroise Paré écrit 'La methode de traicter les playes faictes par hacquebutes, et autres bastons à feu... '
►1545 Jacques Cartier écrit 'Bref récit et succincte narration de la navigation faites ès îles de Canada’
►1545 Pernette du Guillet écrit 'Rimes'. Pernette du Guillet reçoit une éducation soignée, parlant l'italien et l'espagnol. A seize ans, elle est l'élève de Maurice Scève et l'inspiratrice de son recueil 'Délie, objet de plus haute vertu'. Mais l'amour entre eux se révèle impossible, Pernette étant promise à M. du Guillet qu'elle épouse en 1538. Elle meurt à 25 ans, le 7 juillet 1545, emportée par une épidémie de peste. A la demande de son mari, l'érudit Antoine du Moulin examine les feuillets où elle consignait ses poésies et les fait éditer dans leur confusion originelle.
►1545 Traduction du 'Décaméron' de Jean Boccace par Antoine Le Maçon.
►1546 - 7 juin Traité d'Adres entre François Ier et Henri VIII d'Angleterre restituant Boulogne-sur-Mer.
►1546 - 3 août Exécution d'Étienne Dolet. En ce 3 août, Dolet monte sur le bûcher. Humaniste, il fait un jeu de mots en latin, “Non dolet ipse Dolet, sed pia turba dolet”, autrement dit “Ce n'est pas Dolet qui s'afflige mais la foule généreuse”. Il ajoute encore à l'adresse du bourreau avant d'être étranglé puis brûlé : “Ma chair vous appartient, mais ma pensée inviolable vous échappe. Entre nous, la postérité décidera”.
L'imprimeur, qui n'a que trente-sept ans, vient d'être victime d'un arrêt du Parlement de Paris, qui interdit d'introduire, d'imprimer ou de vendre des livres de Calvin, quand bien même ils auraient été imprimés à Genève. Son procès a duré deux ans, après une perquisition au cours de laquelle on a trouvé, entre autres, une traduction de l'Axiochus de Platon. A la phrase “Après la mort tu ne seras plus rien”, Dolet avait rajouté pour plus de clarté “du tout”. Ces seuls mots, jugés hérétiques, lui ont été fatals.
►1546 Épidémie de peste.
►1546 Début de la reconstruction du Louvre. Pierre Lescot est chargé par François Ier de France des travaux du nouveau Louvre. C'est en 1546 que le projet de l'architecte Pierre Lescot moins ambitieux mais plus concret que les autres présentés, est adopté. Le plan consiste en une cour quadrangulaire (l'actuelle cour carrée), l'aile principale séparée par un escalier monumental au centre, et les deux ailes des côtés ne comportant qu'un étage. La mort de François Ier interrompt cependant le projet. Pierre Lescot est un architecte français né à Paris en 1515 et mort dans cette même ville le 10 septembre 1578. Il eut comme ami le poète Pierre de Ronsard. Il reste fidèle au style de la Renaissance, mais il représente la transition vers le classicisme français.
►1546 François Rabelais écrit 'Le Tiers Livre des Faits' et 'Dits Héroïques de Pantagruel'
►1546 à 1601 - naissance et mort de Tycho Brahé. Astronome danois. Tycho Brahé vient d'un famille noble danoise qui le destinait à la diplomatie mais Tycho préfèra les sciences. Ces intérêts allaient des mathématiques, à l'astronomie en passant par l'alchimie et l'astrologie. La couronne danoise lui fournit l'appuie financier nécéssaire pour construire un laboratoire d'alchimie et un observatoire (vers 1580).
En 1599, il devint mathématicien attitré du Saint-Empire Germanique et résida à Prague. Képler fut alors son assistant. Il mit au point dans ces années son système astronomique avec la Terre au centre avec la lune et le soleil tournant autour d'elle. Les autres planètes étaient des satellites du soleil. Son système avait l'avantage de satisfaire à la plupart des observations de l'époque et de laisser la terre immobile, ce qui allait aussi de soi à l'époque. Son système s'opposait donc au système de Copernic, antérieur de près d'un demi-siècle.
1546mort de Martin Luther.
►1547 - 16 janvier Sacre d'Ivan le Terrible. A 16 ans, le prince de Moscou Ivan IV est sacré tsar de toutes les Russies dans la cathédrale de l'Assomption, à Moscou. Le titre de tsar, déformation de "César", était utilisé autrefois pour désigner les empereurs byzantins et tartares. La politique d'Ivan IV sera marquée par de nombreuses réformes et par un affaiblissement de la puissance des princes russes. Quand son régime et la répression se feront de plus en plus durs à la fin de son règne, Ivan sera surnommé "le Terrible" ou "le Redoutable". Ivan le Terrible, Ivan IV Vassiliévitch, dit Ivan le Terrible (Иван Грозный), né le 25 août 1530 à Kolomenskoïe, mort le 18 mars 1584 à Moscou, grand-prince de Vladimir et Moscou de 1533 à 1584, premier tsar de Russie de 1547 à 1584.
►1547 - 28 janvier Mort de Henri VIII d'Angleterre alias "Barbe-bleue". Le roi d'Angleterre Henri VIII d'Angleterre meurt dans son palais de Westminster après 38 ans de règne et 6 mariages. Son époque aura été marquée par l'exécution de deux de ses épouses pour adultère, Anne Boleyn et Catherine Howard, par le rattachement à la couronne d'Angleterre du pays de Galles et enfin par la Réforme anglicane et le schisme avec l'église catholique romaine. Agé de 9 ans, le fils qu'il a eu avec sa quatrième femme Jeanne Seymour lui succède sur le trône sous le nom de Édouard VI.
►1547 dizième guerre d'Italie (1547-1556)
50 - De 1547 (mort de François Ier) à 1569
► 1547 Mort de François Ier (mars) et de Henri VIII d'Angleterre (janvier). “J'ai vécu ma part et, maintenant que je sais que je laisse pour mon successeur un prince aussi sage que vous l'êtes, je meurs l'homme le plus content du monde”, confie, au château de Rambouillet, le roi François Ier à son fils, le futur Henri II, juste avant de rendre l'âme à cinquante-deux ans. Le règne de François Ier a été marqué par deux grands et considérables événements, qui intéressaient l'ensemble du monde civilisé : la Réforme et la Renaissance. Bien que presque continuellement occupé par les nombreuses guerres qu'il a soutenues, François Ier donna aux Lettres et aux Arts un essor considérable.
Il réorganisa et disciplina l'armée : on lui doit la création du Havre, et le développement de la marine ; il encouragea les découvertes maritimes et favorisa le commerce ; de son règne date l'établissement de l'état civil. Les guerres qu'il entreprit étaient nécessaires et sauvèrent l'Europe de la domination de Charles Quint. Ses victoires, et même ses défaites, qui furent toujours glorieuses, intimidèrent l'Europe et lui imposèrent le respect du nom français. Sous le règne de François Ier, les divers éléments de la nationalité française achevèrent de se souder, si bien que la France était le seul grand État de l'Europe dont les populations étaient complètement unifiées.
François Ier se montra habile politique dans ses alliances et par l'encouragement qu'il donna (pour créer des difficultés à Charles Quint) au protestantisme naissant. Par contre, il se montra à l'intérieur intolérant, en permettant le massacre des Vaudois, secte hérétique, mais inoffensive, qui habitait le versant des Alpes. De Claude de France, François Ier eut plusieurs enfants : François, dauphin, qui mourut empoisonné vers l'âge de vingt ans ; Henri, duc d'Orléans, qui lui succéda sous le nom de Henri II ; Charles, duc d'Orléans à l'avènement de son père, et qui mourut sans enfants ; Madeleine, qui épousa Jacques V, roi d'Écosse, et Marguerite, duchesse de Berry, qui épousa Emmanuel-Philibert, duc de Savoie. - Avènement de Henri II, fils de François Ier et de Claude de France, né en 1519. Il a épousé en 1533 Catherine de Médicis (née aussi en 1519), fille de Laurent de Médicis, duc d'Urbin et de Madeleine de La Tour d'Auvergne (princesse française).
► 1547 HENRI II (1547-1559)
► 1547 Henri II. Deuxième fils de François Ier et de Claude de France, il est prisonnier en Espagne à l'âge de 7 ans pendant 3 ans, gage pour la libération de son père. En 1536 son frère aîné meurt, il devient le Dauphin. En 1536, il a 17 ans, il doit épouser Catherine de Médicis alors qu'il aime une jeune veuve Diane de Poitiers (de 19 ans son aînée quand même). En 1547 il succède à son père et poursuit sa politique contre Charles Quint et l'Angleterre. Le duc François de Guise (maison de Lorraine) assiège Boulogne aux mains des Anglais ce qui permet à Henri II de négocier sa restitution (1550) puis il se rapproche des princes allemands luthériens (alors qu'il les combats en France), renforce l'alliance avec les Turcs puis il engage la guerre contre Charles Quint en 1552 occupant les trois évêchés Metz, Toul et Verdun, qui défendus par François de Guise résiste victorieusement aux assauts de Charles Quint qui échouera aussi en Artois en 1554.
Mais les Français capituleront à Sienne en Italie en 1555. Une trêve est signée à Vaucelles en 1556. En 1556 Charles Quint abdique son autorité sur l'Espagne en faveur de son fils Philippe II et de son titre d'Empereur en faveur de son frère Ferdinand Ier. Henri II reprend la guerre contre Philippe II qui est allié à l'Angleterre par son mariage avec la reine Marie Tudor. Cette dernière, mariée au roi d'Espagne et ayant exercé une répression contre les protestants en Angleterre avait comme surnom Marie la Sanglante, elle était peu appréciée de son peuple. Quand elle déclare la guerre à Henri II et que François de Guise, qui commande l'armée française, reprend Calais en 1558, son prestige tombe complètement, elle meurt l'année suivante.
En septembre 1558 Henri II pressé d'en finir avec cette guerre, poussé par les problèmes intérieurs causés par les protestants, accepte l'ouverture de négociations avec l'Espagne. Les négociations traînent en longueur mais à la cour de France le clan de la paix (Montmorency, Diane de Poitiers) l'emporte sur celui de la guerre (les Guises et la reine Catherine de Médicis). Les négociations finalement aboutissent au traité de Cateau-Cambrésie en 1559 dans lequel la France conserve les trois évêchés (Metz, Toul et Verdun) et Calais et renonce au Milanais. Ceci mettra fin définitivement aux guerres d'Italie.
Le roi peut alors se consacrer à la lutte contre les protestants, il avait déjà promulgué l'édit de Chateaubriant en 1551, il promulgue l'édit d'Ecouen en 1559 qui est plus répressif, il condamne de mort l'exercice du culte protestant. Il y aura 88 exécutions de protestant sous le règne d'Henri II. Mais la réforme continue à s'étendre et pas seulement dans le petit peuple. Sur le plan intérieur Henri II crée une juridiction intermédiaire, les présidiaux. Il instaure les secrétariats d'état au nombre de quatre, le conseil des affaires. Catherine de Médicis sa femme n'eut pas une très grande influence sur Henri II. Il n'en fut pas de même de sa favorite Diane de Poitiers à laquelle le roi donna le château de Chenonceau et fit construire le château d'Anet, il la fit duchesse de Valentinois.
Pour sceller la paix avec l'alliance Espagne-Angleterre, deux mariages sont décidés, la fille du roi Henri II (Élisabeth de France) avec Philippe II d'Espagne et la soeur du roi Henri II (Marguerite de France, duchesse de Berry) avec Emmanuel-Philibert de Savoie. Au cour de réjouissances organisées à l'occasion de ces deux mariages, des joutes sont organisées, Henri II est blessé à l'oeil par la lance cassée de son adversaire Montgomery capitaine de la garde écossaise. Le roi meurt 10 jours après, le 10 juillet 1559. C'est son fils François II qui lui succèdera. Un an après, Henri de Bourbon (Roi de Navarre et père du futur Henri IV) sera également victime d'un tournois, l'ardeur des nobles avait été refroidie par la mort de Henri II mais cette fois les tournois cessèrent définitivement en France.
Catherine de Médicis fera rendre les bijoux de la couronne qu'Henri II avait donnés à Diane de Poitiers, elle lui laissera le château d'Anet ou Diane s'exilera, elle mourra en 1566. Le Présidial est un tribunal de justice de l'Ancien Régime créé au XVIe siècle. C'est en janvier 1552 que le roi Henri II de France, désireux de renforcer son système judiciaire, a institué par édit royal les présidiaux. Il en créait un par bailliage et sénéchaussée. Selon l'édit de mars 1552, 60 présidaux étaient créés, dont 32 du ressort du Parlement de Paris. En fonction des besoins et des nécessités (ressources du Trésor, annexion de nouveau territoire, etc.), le nombre des présidiaux a atteint le nombre de 100 en 1764.
► 1547 - 2 avril Henri II limoge les conseillers de son père.
►1547 Coup de Jarnac, duel judiciaire célèbre s'étant déroulé à Saint-Germain-en-Laye, opposant Guy Chabot de Saint-Gelais, baron de Jarnac à François de Vivonne, seigneur de La Châtaigneraie. Le Dauphin Henri II a tenu des propos injurieux à l'égard de Guy Chabot, sire de Jarnac. La Châtaigneraie, une fois les paroles répétées au vieux roi François Ier, a repris à son compte les médisances. Le “jugement de Dieu” a été différé. En ce 10 juillet, en présence du roi Henri II qu'accompagnent la reine Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, la maîtresse du roi, le duel oppose enfin La Châtaigneraie à Chabot.
Tous deux sont réputés pour être d'excellents bretteurs. Tout à coup, Chabot porte à La Châtaigneraie un coup inédit. La Châtaigneraie, le jarret coupé, s'écroule. Ce “coup de Jarnac” qui, malgré la mort quelques jours plus tard de La Châtaigneraie, n'est pas puni, est le dernier duel autorisé. Coup de Jarnac se dit en référence à un coup violent, imprévu et considéré, à tort, comme déloyal ou pernicieux. Dans son sens premier et d’escrime, il s’agit d’un coup à l'arrière du genou ou de la cuisse. A l'époque où il devint célèbre, le coup était imprévu et c'est ce qui lui a donné sa signification.
Guy Chabot de Saint-Gelais, septième baron de Jarnac, s'était marié en mars 1540 à Louise de Pisseleu, soeur de la duchesse d'Étampes, maîtresse de Francois Ier. Le dauphin, le futur Henri II, avait fait courir le bruit, à l'instigation sans doute de sa maîtresse Diane de Poitiers, que Chabot devait à sa belle-soeur des faveurs de toutes sortes. La duchesse d'Étampes, outragée, demanda à son royal amant justice de ces bruits calomnieux, et Francois Ier ne put qu'accéder à sa demande. Le coupable, le dauphin, craignait la colère de son père, et ce fut La Châtaigneraie, ami du dauphin et redoutable bretteur, qui se dévoua pour dire que c'était lui l'auteur de ces bruits, et qu'il n'avait d'ailleurs fait que répéter ce que Guy Chabot lui avait dit.
Chabot ne put, à son tour, que demander au roi la permission de venger son honneur, mais Francois Ier la refusa toute sa vie, bien conscient qu'il ne s'agissait là que de "querelles de femmes jalouses". En 1547, à l'avènement de Henri II, Chabot renouvela sa demande, qui fut alors accueillie favorablement. Mais la réputation de La Châtaigneraie en tant qu'escrimeur était telle que Chabot prit dans l'intervalle des leçons avec un spadassin italien qui lui enseigna un coup de revers inconnu jusque-là (Jarnac n'est donc pas l'inventeur du coup qui porte son nom). Ce maître d'escrime avait également prévu d'exploiter une faiblesse de La Châtaigneraie : une vieille blessure reçue au genou, en choisissant une arme lourde, l'épée à deux mains, afin de le fatiguer, et de le ralentir dans ses déplacements.
Le duel eu lieu le 10 juillet 1547. Le début de la rencontre fut en faveur de La Châtaigneraie, grand favori, jusqu'au moment où Chabot put placer ce coup de revers, qui fendit le jarret de son adversaire. Le coup était régulier, et, à la surprise générale, Chabot fut déclaré vainqueur. On dit que La Châtaigneraie, s'attendant à remporter facilement le duel, avait prévu de donner un superbe repas le jour même du duel. En tout cas, il fut tellement humilié de cette défaite qu'il arracha le soir venu les pansements de sa blessure, et il mourut dans la nuit.
► 1547 - 26 juillet Sacre de Henri II à Reims. Second fils de François Ier, Henri II que son père a marié à Catherine de Médicis en 1533, est sacré à Reims par Charles de Guise, cardinal de Lorraine et frère de François de Guise, chef de la Ligue catholique. Pendant la cérémonie du sacre, il engage le roi qui a vingt-huit ans à combattre l'hérésie. Un engagement que le roi confirmera en octobre suivant par la création d'une Chambre ardente qui rendra plus de cinq cents arrêts contre l'hérésie en trois ans. Exclamation du président du tribunal chargé des affaires calvinistes : “Jésus ! Jésus ! qu'a donc cette jeunesse pour vouloir ainsi se faire brûler pour rien ?”.
Une Chambre ardente était une cour de justice investie d'un pouvoir extraordinaire pour juger des faits exceptionnels. La salle des audiences était tendue de noir et éclairée par des flambeaux, même de jour. Chambre ardente. Nom de plusieurs cours de justice extraordinaires réunies à certains moments de l'histoire pour juger des faits exceptionnels. Ces commissions officient dans des lieux tendus de noir et éclairés de flambeaux, d'où l'adjectif "ardente". Les empoisonneuses La Brinvilliers et La Voisin ou les opérations de la banque de Law ont été jugées par une chambre ardente.
Charles de Guise, Charles de Lorraine, (17 février 1524, Joinville - 26 décembre 1574, Avignon), duc de Chevreuse, archevêque de Reims, évêque de Metz de 1550 à 1551, puis cardinal de Lorraine. Il est le second fils de Claude de Lorraine, premier duc de Guise et Seigneur de Joinville, qui se distingua sous François Ier dans les guerres contre Charles Quint, et d'Antoinette de Bourbon-Vendôme. Archevêque de Reims à l'âge de quatorze ans par la démission de son oncle Jean (1538), il prit le titre de cardinal de Lorraine après la mort de son oncle (1547). Il sut, avec son frère aîné, François de Guise, gagner la faveur d'Henri II. Lui et ses frères exercèrent une grande influence et jouèrent un grand rôle dans les affaires du pays.
► 1547 - 25 septembre : Ivan IV, dit Ivan le Terrible est sacré tsar (caesar) et inaugure son règne personnel. Ivan IV Vassiliévitch, né le 25 août 1530 à Kolomenskoïe, mort le 18 mars 1584 à Moscou, grand-prince de Vladimir et Moscou de 1533 à 1584, premier tsar de Russie de 1547 à 1584.
► 1547 - 8 octobre Le Parlement institue la Chambre Ardente pour lutter contre l'hérésie. Henri II renforcera les pouvoirs des secrétaires d'État afin d'asseoir son autorité. Il imposera une stricte observance de la religion catholique à tous ses sujets de crainte de voir son pouvoir s'affaiblir. Il créera la "Chambre ardente" en 1547, afin de punir les Réformés du ressort du Parlement de Paris. Douze habitants de Langres seront brûlés en 1548 et sept parisiens en 1549. L'Édit de Châteaubriant instaurera la création d'une "Chambre ardente" dans tous les Parlements de Province. Les Édits de Compiègne (1557) et celui d'Écouen (1559) ordonneront d'envoyer au bûcher les hérétiques qui ne pourront présenter des certificats d'orthodoxie.
► 1547 à 1616 - naissance et mort de Miguel de Cervantes. Écrivain espa-gnol, celui qui allait rester dans l'Histoire de la littérature universelle comme l'auteur du célèbre 'Don Quichotte de la Manche' : Miguel de Cervantes y Saavedra. Ancien soldat qui avait cherché fortune dans le métier des armes, il finit par se consacrer à la littérature. Si Cervantes est un mythe, Don Quichotte est à lui seul une vaste littérature. Un auteur dont la reconnaissance ne fut pas immédiate - il a 57 ans lorsque paraît la première partie de Don Quichotte -, qui publia des romans et des nouvelles, mais aussi des poèmes, et se risqua au théâtre.
Né avec le Siècle d'or, Cervantes a consacré les dernières années de sa vie à l'écriture après avoir combattu au nom du Catholicisme et avoir servi en tant que commissionnaire. Il eut une longue vie errante. Il fréquenta l'université, accompagna à Rome le cardinal Acquaviva, légat du pape. Puis il devint soldat. Il participa à la bataille de Lépante (1571) au cours de laquelle la flotte de la Sainte-Ligue (Espagne, Venise, Saint-Siège) battit les Turcs, mettant fin à la légende de l'invincibilité ottomane.
Il y perdit un bras. Il fut fait prisonnier et passa cinq ans au bagne d'Alger. De retour en Espagne, il se maria et trouva un emploi de fonctionnaire. Il se lança ensuite dans différents trafics qui le conduisirent en prison. Il commença sa carrière littéraire en 1585 avec un roman pastoral dans le goût du temps. S'il n'a pas été totalement reconnu en son temps, il est, des auteurs de l'époque, celui qui eut le plus d'influence sur la littérature. Poète, dramaturge et romancier il a réinventé la nouvelle, créé le roman moderne et donné naissance au héros problématique. Son 'Don Quichotte de la Mancha' a ouvert les voies de l'absurde et reste un modèle de littérature burlesque.
► 1547 Guillaume Budé écrit 'De l'Institution du Prince’
►1547 Marguerite de Navarre écrit 'Les Marguerites de la Marguerite des Princesses’
► 1547 Noël du Fail écrit 'Propos rustiques'. Noël du Fail, seigneur de La Hérissaye (1520-1591), écrivain français : 'Les Propos rustiques' (1547) et 'Les Baliverneries d'Eutrapel' (1548).
► 1547 Traduction de Vitruve, 'l'Architecture' par Jean Martin. Vitruve (Marcus Vitruvius Pollo) est un architecte romain qui vécut au Ier siècle av. J.-C. Après avoir été soldat en Gaule, en Espagne et en Grèce, il enseigne l'architecture à Rome. On lui doit l'invention du module quinaire dans la construction des aqueducs. Il est l'auteur d'un célèbre traité d'architecture, 'De Architectura' (Dix livres d'architecture en français), probablement écrit entre -27 et -23 et qu'il dédie à l'empereur Auguste.
C'est le seul écrit d'architecture qui nous soit parvenu de l'Antiquité, et les architectes de la Renaissance artistique comme l'italien Palladio s'en inspirent beaucoup, jusqu'à l'architecture classique et baroque, où Claude Perrault (1613-1688) commence à remettre en question l'interpétation de ses principes. Il y met en évidence la remarquable harmonie de la proportion basée sur le Nombre d'or. Selon lui, l'architecture est science qui s'acquiert par la pratique et la théorie. L'architecte doit avoir de nombreuses connaissances en géométrie, en dessin, en histoire, en mathématiques, en optique.
► 1548 Marie Stuart, fille du roi d'Écosse, Jacques V et de Marie de Guise, est envoyée en France et fiancée au dauphin, fils de Henri II (futur François II). Marie Stuart, Marie Ière d'Écosse (8 décembre 1542 - 8 février 1587) fut reine d'Écosse du 14 décembre 1542 au 24 juillet 1567. Elle est probablement la mieux connue des souverains écossais, en partie à cause de la tragédie de sa vie. Elle se maria 3 fois : le 24 avril 1558, elle épousa à Paris François de France qui devint le 10 juillet 1559, François II roi de France ; le 29 juillet 1565, elle épousa à Edimbourg Henry Stuart, Lord Darnley qui devint par son mariage duc d'Albany et roi consort d'Écosse ; le 14 mai 1567, elle s'unit à James Hepburn, comte de Bothwell qui devient duc d'Orkney.
► 1548 - Mariage de Jeanne d'Albret, fille de Henri II, roi de Navarre, avec Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, descendant de Robert de Clermont, cinquième fils de Saint Louis; de ce mariage naîtra Henri IV. Jeanne d'Albret, Jeanne III de Navarre, couramment appelée Jeanne d'Albret, née le 7 janvier 1528 à Pau, morte le 9 juin 1572 à Paris, fut reine de Navarre de 1555 à 1572. Elle était fille d'Henri II (1503-1555) dit Henri d'Albret, roi de Navarre (1517-1555) et de Marguerite de France (1492-1549), dite Marguerite d'Angoulême, soeur aînée du roi de France François Ier. Antoine de Bourbon, (1518 † 1562), fils de Charles, duc de Vendôme, et de Françoise d'Alençon. De l'héritage paternel : duc de Vendôme et de Bourbon (1537-1562). Par son mariage avec Jeanne d'Albret : roi de Navarre, comte de Foix, de Bigorre, d'Armagnac et de Périgord, vicomte de Béarn (1555-1562).
► 1548 C'est à partir de cette année que les monnaies en France portent l'effigie du souverain (jusqu'alors, elles étaient marquées d'une croix, ce qui en rendait l'imitation trop facile).
► 1548 François Rabelais écrit 'Le Quart Livre’
► 1548 Joachim du Bellay écrit 'L'Olive’
► 1549 - 8 août Henri II déclare la guerre à l'Angleterre. Parce qu'il veut que Marie Stuart épouse son fils le dauphin François, Henri II a envoyé François de Guise en Écosse avec 6 000 hommes afin de ramener sa nièce à peine âgée de huit ans Marie Stuart, fille de Jacques V d'Écosse et de Marie de Lorraine, qui, depuis la mort de son mari, assure la régence. Le régent d'Angleterre a le même projet. Il veut que la même Marie Stuart épouse son neveu, le futur Édouard VI d'Angleterre. Ces projets contradictoires amènent le roi de France à déclarer la guerre à l'Angleterre.
François de Guise, François Ier de Lorraine, (24 février 1519, Bar-le-Duc - 18 février 1563, Orléans), 2e Duc de Guise (1520-1563), comte, puis Duc d'Aumale et Pair de France, Marquis de Mayenne, baron, puis Prince de Joinville, grand chambellan et grand veneur.
► 1549 Début de La Brigade (devient La Pléiade): Du Bellay, Ronsard, Jodelle, Antoine de Baïf, Guillaume des Autelz, Étienne Jodelle, Belleau, Pontus de Tyard, Jean de la Péruse. La Pléiade (d'abord nommée "la Brigade") est un groupe de sept poètes français du XVIe siècle rassemblés autour de Ronsard. Le nom du groupe est emprunté à sept autres poètes d'Alexandrie qui avaient choisi, au IIIème siècle, le nom de cette constellation pour se désigner. Les membres de la Pléïade entrent dans une logique de rupture avec leurs prédécesseurs, ils rompent avec la poésie médiévale et cherchent à éxercer leur art en francais ("la poésie doit parler la langue du poête").
Il constatent cependant que la langue française est pauvre et non adaptée à l'expression poétique. Ils décident donc d'enrichir la langue par la creation de néologismes issus du latin, du grec et des langues regionnales. Ils défendent en même temps l'imitation des auteurs gréco-latins dans le but de s'en inspirer pour pouvoir les dépasser. Ils imposent l'alexandrin, l'ode et le sonnet comme des formes poétiques majeures. À la demande de François Ier, ils participent au développement et à la standardisation du français.
La Pléiade. Nom donné aux groupes de sept poètes (par allusion aux sept filles d'Atlas, les Pléiades) qui ont jalonné l'histoire littéraire, de la Grèce antique au XVIe siècle. La Pléiade la plus célèbre – d'abord appelée la Brigade – est celle constituée au XVIe siècle par les poètes Ronsard, Joachim du Bellay, Pontus de Tyard, Jean Antoine de Baïf, Étienne Jodelle, Rémi Beleau et Jacques Pelletier du Mans (auquel se substitua Jean Dorat).
► 1549 Joachim du Bellay écrit 'défense et Illustration de la langue française' (devient le manifeste de la Pléiade).
►1549 Pontus de Tyard écrit 'Les Erreurs amoureuses'. Pontus de Tyard (1531-1603) Poète français lyonnais, ou plus précisément du Maconnais. Son modèle est plutôt Maurice de Scève et Pétrarque bien que Ronsard l'inclut dans la Pléiade. Il publie les "Erreurs amoureuses" (1549). Tyard apporte une certaine "fureur poétique" dans la poésie française.
► 1550 Bernard Palissy perfectionne les techniques de la céramique. Bernard Palissy, ce polémiste, autodidacte, céramiste, potier, écrivain apprendra la technique de cuisson des glaçures à partir de 1530. De 1536 à 1556, il consacrera vingt ans de sa vie à découvrir le secret des émaux. Sa vie géniale et tumulteuse est à l'origine d'un véritable "mythe palisséen". Les Lumières et les révolutionnaires verront en lui le type même "du génie persécuté par l'Église". Si Palissy est mentionné dans de nombreux documents du XVIe siècle ; aucun de ses confrères, scientifiques et artisans, ne formulera un quelquonque avis sur son travail.
► 1550 - 24 mars Traité entre la France et l'Angleterre restituant Boulogne contre 400 000 écus.
► 1550 - 27 juin Naissance de Charles (futur Charles IX), second fils de Henri II et Catherine de Médicis. Charles IX de France, né Charles-Maximilien de France, né le 27 juin 1550 au château royal de Saint-Germain-en-Laye, mort le 30 mai 1574 au château de Vincennes, fut roi de France de 1560 à 1574, quatrième roi du rameau dit de Valois-Angoulême de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne.
► 1550 août : Controverse de Valladolid qui porta sur le statut des Indiens d'Amérique (appartiennent-ils à l'humanité ? Quel traitement leur accorder ?) et qui opposa Bartolomé de Las Casas et le théologien Sepulveda devant l'empereur Charles Quint. Sepulveda fait valoir que la guerre aux Indiens est non seulement licite mais recommandable car elle est légitime au regard de quatre arguments : la gravité des délits des Indiens (idolâtrie, péchés contre nature), la grossièreté de leur intelligence, les besoins de la foi, leur sujétion facilitant la prédication, les maux qu'ils s'infligent les uns aux autres (sacrifices).
La controverse tourne à l'avantage de Las Casas (ses arguments sont dans l'intérêt du monarque qui souhaite dessaisir les conquérants de la capacité de traiter les Indiens à leur guise, pour pouvoir les soumettre directement, au nom de l'Église). Les rois d'Espagne ne veulent plus qu'on appelle les découvertes "conquêtes". A la tête du Conseil des Indes, ils placent des hommes qui doivent conduire les populations "pacifiquement et charitablement". Controverse de Valladolid, Charles Quint, après avoir autorisé l'esclavage en 1517, l'avait interdit en 1526 sur une recommandation du Conseil des Indes, institué par lui en 1524. Rome avait déjà soutenu cette seconde position le 2 juin 1537 (Veritas ipsa) et le 9 juin 1537 (Sublimis Deus) sous l'autorité du pape Paul III.
Elle condamnait l'esclavage des Indiens et affirmait leur droit en tant qu'êtres humains à la liberté et à la propriété. Mais Charles Quint, en pleine expansion de la Réforme en Europe, ne souhaitait pas s'en remettre à l'autorité de Rome sur un tel sujet. Le verdict du Légat du Pape est très finement énoncé. En déclarant qu'il est décidé (tel est le terme utilisé, distinct de "reconnu" ou "admis") que les amérindiens ont une âme, le visage de Sepulveda s'obscurcit, signe de la victoire d'une Église humaniste. Mais la décision est immédiatement suivie d'une solution au problème économique de la nature humaine des autochtones : un homme ayant une âme ne peut être exploité sans rémunération ou tué sans raison.
L'envoyé du Pape ouvre alors une perspective qui fera ses preuves : la main d'oeuvre gratuite doit être recherchée parmi les noirs d'Afrique qui eux n'auraient pas d'âme de par leur absence de civilisation. Sepulveda et Las Casas sont tous deux vaincus. Bartolomé de Las Casas (Séville, 1474–Madrid, 1566), théologien dominicain espagnol, évêque de Chiapas (Mexique), écrivain et voyageur, il est considéré comme l'un des premiers défenseurs des droits des peuples originaires d'Amérique et une figure historique de la lutte pour les droits de l'Homme.
Juan Ginés de Sepulveda (Cordoue, v. 1490 - id., 1573) est un théologien espagnol. Lors de la controverse de Valladolid, il s'opposa aux théories humanitaires du moine Bartolomé de Las Casas visant à limiter l'utilisation des Amérindiens comme esclaves. Plutôt calme et posé, il s'oppose au caractère tumultueux du moine dominicain lors de la Controverse de Valladolid. Maîtrisant la logique du philosophe grec Aristote, il réussit à mener qui l'entend sur "le chemin brumeux de la compréhension" qui devient alors claire comme de l'eau de roche.
► 1550 à 1557 - Construction de la mosquée Süleymaniye. La plus grande mosquée d'Istambul fut érigée de 1550 à 1557 pour le plus grand des sultans, Soliman le Magnifique, sur la troisième colline du vieux Stamboul d'où elle domine majestueusement la Corne d'or. Mosquée Süleymaniye, pour Soliman le Magnifique, l'architecte Sinan construisit notamment, entre 1550 et 1557, la mosquée Süleymaniye (Süleymaniye Camii) d'Istanbul, tenue par les poètes turcs comme la sublime expression de la "splendeur et de la joie". Cette mosquée "selatin" (pluriel de "sultan") – on appelle ainsi les mosquées à plusieurs minarets uniquement construites par les sultans ou leurs familles – est incontestablement l'une de ses plus grandes réussites et est considérée comme la plus belle des mosquées impériales d'Istanbul.
Chaque détail contribue à la rendre exceptionnelle : ses proportions harmonieuses – les dimensions intérieures de la mosquée sont de 70 m de long sur 61 m de large ; la lumière qui pénètre par les 138 fenêtres ; le dôme en cascade – de 27,5 m de diamètre et de 47,75 m de hauteur depuis le sol jusqu'à la clé de voûte –, percé de 32 fenêtres, supporté sur les côtés par des demi-coupoles. La mosquée est dotée d'un parvis à portiques couronnés de 28 dômes supportés par 24 colonnes monolithes antiques (2 en porphyre, 10 en marbre blanc et 12 en granit). Au centre de la cour se trouve un "şadırvan" (fontaine d'ablutions).
► 1550 Théodore de Bèze écrit 'Abraham sacrifiant', tragédie française. Théodore de Bèze, né en 1519 à Vézelay et décédé en 1605 à Genève, fut un théologien protestant du XVIe siècle. Réformateur français, converti au calvinisme en 1548, il devient l'adjoint de Jean Calvin à Genève en 1558, qu'il remplace à la tête de la Compagnie des pasteurs après sa mort en 1564. Il dirigea également la délégation protestante au colloque de Poissy en 1561 et fut recteur de l'Académie de Genève.
► 1550 Pierre de Ronsard écrit 'Les quatre premiers livres des Odes’
► 1550 Barthélémy Aneau écrit 'Le Quintil Horatian'. BarthélémyAneau (1500-1561) fut ami de Marot, principal du collège de la Trinité, suspecté d'appartenance à la religion réformée et assassiné par des catholiques extrémistes. Il avait traduit la République d'Utopie de Thomas More.
► 1550 Ambroise Paré écrit 'La briesve collection de l'administration anato-mique’
► 1551 Henri II a fait sienne la politique de son père à l'égard de la maison d'Autriche. Il est du plus haut intérêt pour la France d'empêcher cette monarchie de consolider sa puissance en Europe. Dans cette vue, Henri II entre dans une ligue formée contre Charles Quint par les protestants d'Allemagne (il est à remarquer d'ailleurs que cela ne l'empêche pas de se montrer fort intolérant envers les protestants français).
► 1551 - 17 juin Édit de Châteaubriant contre les hérétiques.Châteaubriant est une commune française, située dans le département de Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire. Elle fait partie de la Bretagne historique.
► 1551 - 19 septembre Naissance de Henri (futur Henri III), troisième fils de Henri II et Catherine de Médicis. Henri III de France (1551-1589) fut roi de Pologne quelques mois sous le nom d'Henri de Valois, avant de prendre le titre de roi de France. Le 11 mai (jour de la Pentecôte) 1573, il est élu roi de Pologne. Il règne sur la Pologne du 24 janvier au 18 juin 1574. Le 30 mai 1574, Charles IX étant mort, il quitte la Pologne en catimini pour le trône de France. Il est sacré à Reims le 13 février 1575 sous le nom d'Henri III et le 15 février il épouse Louise de Lorraine.
► 1551 Guillaume Postel écrit 'Les Raisons de la monarchie'. Guillaume Postel, visionnaire et philologue né à Dolerie (Manche) en 1510, mort à Paris en 1581. D'une famille très pauvre, il apprit seul le grec, l'hébreu et l'arabe; Marguerite de Valois (Marguerite de France) décida François Ier à l'envoyer en Orient pour chercher des manuscrits, et à son retour on le nomma professeur au Collège de France (1539).
Cependant l'idée lui était venue de travailler à la conversion des musulmans en répandant chez eux une traduction arabe du Nouveau Testament; on préparerait ainsi l'union de tous les humains sous la monarchie universelle, qui devait appartenir an roi de France; Postel se rendit à Rome pour exposer ses vues à Ignace de Loyola, mais après un long noviciat on refusa de le recevoir dans la Compagnie de Jésus.
► 1552 Hostilités contre Charles Quint. - Une armée française, pénétrant à l'improviste sur les terres soumises à l'Empereur, s'empare successivement de Metz, Toul et Verdun: les Trois Évêchés. Comme conséquence de ce succès, elle occupe la Lorraine et le Luxembourg. - Henri II avait profité, pour mener cette attaque, des difficultés que suscitaient les protestants d'Allemagne à Charles Quint. Ce dernier, en apprenant la perte des Trois Évêchés, se hâte de composer avec ses sujets, et jette en France une armée de 60 000 hommes, pourvue de 100 canons; les Impériaux viennent mettre le siège devant Metz, qui est défendu par François de Guise.
François de Guise, François de Lorraine, duc de Guise, François Ier de Lorraine, (1519, Bar-le-Duc - 18 février 1563, Orléans) 2ème duc de Guise (1519-1563), fils aîné de Claude de Guise. Né au château de Bar en 1519. Il prend part en 1545 au siège de Boulogne contre les Anglais, au cours duquel il est grièvement blessé. Chef de guerre d'une grande audace, nommé gouverneur de Metz par Henri II de France, il résiste victorieusement dans Metz assiégée à Charles Quint empereur du Saint Empire romain germanique et l'oblige à lever le siège de Metz en 1552. En 1556-1557, il prend la tête de l'expédition qui, en Italie, essaie vainement de reprendre Naples aux Espagnols. À son retour, il est nommé lieutenant général du royaume et reprend Calais aux Anglais en 1559.
À la mort d'Henri II de France, François II de France, époux de sa nièce, Marie Stuart, fille de Marie de Guise, monte sur le trône : mais François de Guise et son frère, le Cardinal de Lorraine (Charles de Guise) véritable tête politique de la famille, deviennent les maîtres du royaume. Fervent défenseur du catholicisme, il fait réprimer dans un bain de sang, en 1560, la conjuration protestante d'Amboise, soutenue par Louis Ier de Bourbon, prince de Condé, et encouragée secrètement par l'Angleterre. Mais la mort de François II, en décembre 1560, l'écarte de la cour et du pouvoir.
Violemment opposé à la nouvelle politique de tolérance menée par Catherine de Médicis, autorisant officiellement le culte réformé, il provoque un massacre en Champagne, au cours duquel 80 protestants qui célébraient leur culte dans une grange sont exterminés par ses gens. Vainqueur des huguenots à Rouen, en octobre 1562, et à Dreux, en décembre de la même année, il tente de reprendre Orléans lorsqu'il est assassiné le 18 février 1563 d'un coup de pistolet par un gentilhomme protestant, Jean de Poltrot de Méré, sans doute commandité par Gaspard de Coligny, un chef influent du parti protestant. Après sa mort, le calme revient pour quelque temps sur le royaume.
► 1552 - 15 janvier Traité de Chambord entre Henri II et les princes allemands contre Charles Quint. Par le traité de Chambord (15 janvier 1552), les princes allemands s'engagèrent à attaquer Charles Quint et à tenter de le faire prisonnier, pendant qu'Henri II se porterait sur les Pays-Bas. Henri II déclara la guerre en février 1552 ; la campagne militaire fut d'abord dirigée vers l'Allemagne puis vers les Pays-Bas ; la France remporta d'importants succès initiaux, qui lui permirent d'occuper la Lorraine et les Trois-Évêchés ; Charles Quint échoua à reprendre Metz, défendue par le duc de Guise. Traité de Chambord, le 15 janvier 1552, Henri II roi de France, conclut une alliance avec les Turcs et les protestants allemands contre Charles Quint.
Les princes allemands s'engagèrent à attaquer Charles Quint et à tenter de le faire prisonnier, pendant qu'Henri II se porterait sur les Pays-Bas. Henri II déclara la guerre en février 1552 ; la campagne militaire fut d'abord dirigée vers l'Allemagne puis vers les Pays-Bas ; la France remporta d'importants succès initiaux, qui lui permirent d'occuper la Lorraine et les Trois-Évêchés. Les Trois-Évêchés désigne collectivement les territoires relevant des évêques de Metz, de Toul et de Verdun qui, alors appartenant au Saint Empire romain germanique, furent occupés par Henri II en 1552 et placés sous tutelle française jusqu'à leur annexion définitive par la France en 1648 en vertu des Traités de Westphalie. Ces territoires et les duchés de Bar et de de Lorraine formaient une mosaïque territoriale source de conflit.
► 1552 Alliance de la France et des princes allemands protestants en échange de l'annexion de Toul, Metz et Verdun.
► 1552 -11 novembre Gaspard de Coligny nommé amiral de France. Gaspard de Coligny, Gaspard de Châtillon, comte de Coligny, baron de Beaupont & Beauvoir, Montjuif, Roissiat, Chevignat & autres lieux, plus connu sous le nom de Gaspard de Coligny (Châtillon-sur-Loing, 16 février 1519–Paris, 24 août 1572), amiral de France. Neveu du connétable Anne de Montmorency, Coligny doit sa fortune à son illustre oncle. Quand Henri II rappelle ce dernier de l'exil où l'avait confiné François Ier, Coligny reçoit la charge de colonel général de l'infanterie, puis d'amiral de France, et devient gouverneur de Picardie.
► 1552 Pontus de Tyard écrit 'Solitaire premier’
► 1552 Pierre de Ronsard écrit 'les Odes, les Amours'.
► 1552 à 1630 - naissance et mort de Agrippa d'Aubigné. Poète et diplomate français, témoigne d'une précoce intelligence. Il apprend le latin, le grec et l'hébreu. Très jeune, il est témoin du martyre des suppliciés d'Amboise et des atrocités du siège d'Orléans et, après des études à Genève et Lyon, s'enrôle à quinze ans dans les troupes protestantes. Écuyer d'Henri de Navarre (futur Henri IV), il le sert jusqu'à ce qu'il abjure le calvinisme. D'Aubigné se retire ensuite sur ses terres, avant de se réfugier à Genève au moment de la conspiration contre Luynes (1620). Considéré comme le grand poète de la période baroque, Agrippa d'Aubigné débute en poésie sous l'influence de la poétique de la Pléiade.
Il compose 'le Printemps' inspiré par Diane Salvati, nièce de la Cassandre de Ronsard. Mais ce recueil imprégné de pétrarquisme et d'une certaine violence ne sera édité qu'au XIXe siècle. Dès 1577, il entreprend la rédaction des Tragiques, dont la première édition ne paraîtra qu'en 1616. Composée en sept livres: "Misères", "Princes", "Chambre dorée", "Feux", "Fers", "Vengeances", "Jugement", l'oeuvre renvoie aux sept sceaux de l'Apocalypse. Un violent réquisitoire retrace les persécutions subies par les protestants.
Suit une mise en accusation de leurs responsables, la cour et le Palais de justice de Paris, l'évocation des martyrs protestants, la fresque des massacres des guerres de religion et l'ouvrage se referme sur le jugement dernier. Prosateur abondant, d'Aubigné a publié une ample 'Histoire universelle' (1619-1620) et de nombreux pamphlets, notamment 'Les Aventures du baron de Faeneste'.
► 1553 Naissance de Henri (futur Henri IV) à Pau. Henri IV de France, né Henri de Bourbon (°13 décembre 1553 à Pau /-14 mai 1610 à Paris) fut roi de Navarre (1572-1610) puis roi de France (1589-1610), premier roi de la branche dite de Bourbon de la dynastie capétienne. Contemporain d'un siècle ravagé par les Guerres de religion, il y fut d'abord impliqué en tant que protestant avant d'accéder au trône de France. En tant que roi, il se convertit au catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, qui autorisa la liberté de culte pour les protestants et mit fin aux guerres de religion. Bien qu'aimé par une grande partie de la population, il fut assassiné en 1610 par un fanatique, Ravaillac.
► 1553 Olivier de Magny écrit 'Les Amours'. Olivier de Magny est un poète français (1529-1561) né à Cahors. Il fut un ami de Joachim Du Bellay qu'il rencontra à Rome lorsqu'il y accompagna en tant que secrétaire, le cardinal d'Avençon. Son oeuvre poétique est importante mais oubliée.
► 1553 Naissance de la tragédie humaniste avec 'la Cléopâtre captive' d'Étienne Jodelle. Étienne Jodelle (1532-1573) Poète français. Bien que faisant partie de la Pléiade, il est surtout l'homme d'une pièce qui fit scandale, 'Cléoparte' (1554). C'est un ardent révolté contre le courant paganiste de certains poètes et contre le pétrarquisme. Après sa mort, un de ses amis publie ses "Oeuvres et mélanges poétiques" (1574).
La tragédie humaniste est une déploration passive d'une catastrophe. Le personnage est une victime, cette tragédie est essentiellement statique et linéaire voire pathétique. La tragédie met en scène des passions nobles et fortes. Elle a des principales règles en point de départ qui sont : - la division en cinq règles ; - pas plus de trois personnages parlant en même temps ; - le début de la pièce doit être le plus près possible du dénouement.
► 1553 Décès à Paris de l'écrivain François Rabelais.
► 1554 François de Guise bat les troupes de Charles Quint à Renty en Artois.
► 1554 Les Chérifs saadiens, maîtres du Maroc. Les Saadiens, peuple arabe descendant du Prophète, prennent le pouvoir. Ils parviendront à reconquérir quelques comptoirs portugais et choisiront Marrakech pour établir leur capitale. Après la victoire de Ksar el-Kébir au Portugal, le territoire rayonnera à nouveau sous le sultan Ahmed Al-Mansour. Ce dernier prendra Tombouctou en 1591 et apportera richesse et prospérité au royaume.
Lors de sa mort, en 1603, le pays sera à nouveau affaibli par les querelles de succession. Saadiens, dirigeants des tribus venus de la vallée du Draâ, exaspérés par les offensives chrétiennes, se révoltent contre les wattassides et chassent ceux-ci du pouvoir. Fondant leur propre dynastie, ils entament une guerre sainte contre les Portugais. C'est ainsi qu'Agadir est reprise en 1541… Dans le même temps, les Saadiens s'allient aux Espagnols pour faire face à la menace turque !
► 1554 - 25 juillet : le futur Philippe II d'Espagne épouse Marie Tudor, reine d'Angleterre (1553-1558). Il reste en Angleterre de juillet 1554 à août 1555. L'Angleterre est entraînée dans la guerre des Habsbourg contre les Valois. Marie Tudor, Marie Ière ou Marie Tudor (18 février 1516 - 17 novembre 1558), reine d'Angleterre, est aussi connue sous le nom de "la Sanglante" (Bloody Mary), à cause des persécutions envers les protestants pendant son règne de 1553 à 1558. Elle naquit au Palais de Greenwich, près de Londres, fille du roi Henri VIII d'Angleterre et de sa femme, Catherine d'Aragon. Après le divorce de ses parents, elle perdit sa place dans la succession, et fut déclarée illégitime.
Mais la mort de son père en 1547 la laissa encore en faveur et, après la mort prématurée de son frère Édouard VI d'Angleterre, elle devint reine. Il fut d'abord nécessaire d'évincer sa cousine lady Jeanne Grey, soutenue par les protestants. En 1554, elle épouse Philippe II d'Espagne (1527-1598), mais ce ne fut pas un mariage populaire. Avec l'aide des Espagnols, elle tenta de restaurer la religion de sa mère, et beaucoup de protestants furent mis à mort. Marie n'ayant pas eu d'enfants, c'est sa demie soeur, Élisabeth Ière d'Angleterre, qui lui succéda.
► 1554 - 8 décembre Ambroise Paré nommé docteur en chirurgie.
► 1554 André Thevet écrit 'Cosmographie du Levant'. Frère André Thévet, voyageur et écrivain né à Angoulême en 1502, mort à Paris le 23 novembre 1590. Entré jeune dans l'ordre des cordeliers, il obtint de ses supérieurs, en 1549, l'autorisation de visiter l'Italie, passa à Constantinople, puis parcourut l'Asie Mineure, la Grèce, la Terre Sainte, et, de retour en France en 1554, repartit dès l'année suivante pour le Brésil, où il ne demeura que quelques mois. II devint par la suite aumônier de Catherine de Médicis, puis fut nommé, avec des appointements considérables, historiographe et cosmographe du roi.
► 1555 Expédition de Villegagnon au Brésil. Les Portugais ayant fondé la capitale du Brésil à Salvador de Bahia en 1549, ce sont les Français, qui en 1555, menés par l'Amiral Villegagnon, fondèrent les premières fortification sur le site. Le site sera disputé entre Français, Espagnols et Portugais, qui finalement gagneront en 1564. Nicolas Durand de Villegagnon (1510, Provins - 9 janvier 1571) fut un militaire et explorateur français.
► 1555 - 17 avril Capitulation des armées françaises à Sienne devant les Impériaux. 2 août 1554, les français sont battus à Marciano en Toscane et le 17 avril 1555, ceux qui défendent la ville de Sienne capitulent. Pendant l'été 1555, les français connaissent des succès dans le Piémont.
► 1555 - 14 octobre Alliance entre Paul IV et Henri II contre Charles Quint. Paul IV, Pietro Carafa, né à Sant'Angelo della Scala en 1476, pape de 1555 à 1559 sous le nom de Paul IV. Il est le fondateur de l'ordre des Théatins.
► 1555 - 26 septembre Signature de la Paix de Augsbourg. Le Saint-Empire romain germanique est partagé en deux confessions, catholique et luthérienne. Chaque prince a dorénavant le droit de faire appliquer la religion de son choix dans ses États ("cujus regio, ejus religio" : "la religion du prince est la religion des sujets"). Les habitants doivent accepter de se soumettre à la confession choisie par leur souverain sans quoi ils sont contraints de quitter l'état et ils perdent tous leurs biens. Cette paix est signée au terme du conflit religieux et politique opposant l'empereur Charles Quint, catholique, aux princes protestants d'Allemagne.
Paix d'Augsbourg, pour combattre la Réforme, Charles Quint promulgue en 1521 l'édit de Worms qui interdit strictement l'exercice de la religion protestante. Il recommence en 1529 en réunissant une diète à Spire qui décide que la messe doit être célébrée selon le rite catholique même dans les territoires protestants, les partisans de Luther protestèrent. Depuis, ils portent le nom de Protestants. En 1546, l'Empereur opte pour l'action militaire, combattant les princes luthériens unis dans la ligue dite de Schmalkalden. Malgré une victoire militaire, une négociation s'impose: Les protestants comptent trop d'adeptes parmi les puissants princes allemands. Une négociation commence à Augsbourg. Le 25 septembre 1555, la Paix d'Augsbourg suspend les hostilités entre les États luthériens et les États catholiques en Allemagne. C'est un compromis qui n'a pu voir le jour qu'en éludant un grand nombre de questions litigieuses.
Elle repose sur un principe fondamental : cuius regio, eius religio soit tel prince, telle religion. Les princes et les seigneurs étaient désormais libres de choisir, pour eux et leurs vassaux, entre les deux religions chrétiennes. Les sujets en désaccord avec la religion de leur suzerain avaient le droit d'émigrer. Elle permet aux princes protestants de conserver les biens de l'Église qu'ils ont sécularisés. Le luthérianisme en tire d'importants avantages et se retrouve à égalité avec les catholiques. Cette paix relative prendra fin en 1618 avec la défenestration de Prague qui est à l'origine de la guerre de Trente Ans.
► 1555 Nostradamus écrit 'Vraies Centuries et Prophéties'. Nostradamus, Michel de Nostredame plus connu sous le nom de Nostradamus était un médecin de la Renaissance, pratiquant l'astrologie comme tous ses confrères du XVIe siècle. Il est né le 14 décembre 1503, vers midi, à Saint-Rémy-de-Provence. Souffrant d'épilepsie psychique, de la goutte et d'insuffisance cardiaque, il mourut le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence d'un oedème cardio-pulmonaire. 'Les Propheties' (comprenant dix Centuries – ensembles de cent quatrains) seront rééditées plusieurs fois de son vivant, avec, jusqu'à sa mort, de nouveaux ajouts.
La première édition compte trois cent cinquante-trois quatrains, la dernière neuf cent quarante... Il est très possible qu'avec cet ouvrage particulièrement soigné et rempli de références savantes Nostradamus escomptait toucher un public cultivé, formé d'humanistes, de lettrés et de puissants. 'Les centuries' de Nostradamus ont donné lieu à près de dix mille ouvrages ! Aujourd'hui encore, malgré des travaux sérieux, nul ne peut dire exactement ce qu'elles signifient...
Comme toujours avec Nostradamus, il faut faire preuve d'une certaine réserve. Son style obscur et son vocabulaire, mélange de vieux français, de latin, de provençal et (selon certains) d'hébreu donne aux exégètes une grande liberté d'interprétation. Nostradamus est un "virtuose de l'ambiguïté", qui a multiplié les anagrammes, les symboles, les références mythologiques, crypté tous ses quatrains à l'aide de figures de style.
► 1555 Guillaume Le Testu écrit 'Cosmographie universelle selon les navigateurs tant anciens que modernes'. Guillaume Le Testu (1509-1573) était un explorateur et cartographe français, né au Havre. Il explore le littoral brésilien en 1551. Il est l'auteur d'un atlas de 56 cartes ('Cosmographie Universelle selon les navigateurs, tant anciens que modernes', 1555 -1556).
► 1555 Louise Labé écrit 'Les Sonnets et Les Soupirs'. Louise Labé (1525 à Lyon, France - 25 avril 1566 à Parcieux-en-Dombes, France). Surnommée "La Belle Cordière", elle fait partie des poètes fameux en activité à Lyon à la Renaissance.
► 1555 Ramus écrit 'Dialectique'. Ramus, Pierre de La Ramée, dit Ramus, érudit et logicien, né à Cuth, en Vermandois, vers 1515. Humaniste français, professeur de philosophie et de mathématiques au collège du Mans, puis de l'Ave Maria, et enfin au Collège Royal à partir de 1551; il est condamné par la Sorbonne en 1544, à cause de son hostilité à la tradition aristotélicienne et scolastique; ayant embrassé la Réforme, il est persécuté et assassiné après la Saint-Barthélemy.
► 1555 à 1628 - naissance et mort de François de Malherbe. Poète français. On a dit de nos jours avec un grain de malice et un coin de vérité: "La poésie française, au temps de Henri IV, était comme une demoiselle de trente ans qui avait déjà manqué deux ou trois mariages, lorsque, pour ne pas rester fille, elle se décida à faire un mariage de raison avec M. Malherbe, lequel avait la cinquantaine". Mais ce ne fut pas seulement un mariage de raison que la poésie française contracta alors avec Malherbe, ce fut un mariage d'honneur. Elle trouvait un honnête homme et sensé, et qui, s'il ne lui donna pas tous les agréments, la mit hors d'état désormais de déchoir et l'ennoblit.
► 1556 onzième guerre d'Italie (1556-1559)
► 1556 Charles Quint, aigri par les revers qu'il ne cesse d'essuyer depuis quelque temps, fatigué du pouvoir, abdique en faveur de son fils, Philippe II et de son frère Ferdinand d'Allemagne. Philippe II régnera sur l'Espagne, les Pays-Bas, le Nouveau-Monde ; Ferdinand a en partage l'Allemagne et les possessions de la Maison d'Autriche. Cette abdication et ce partage réalisés, Charles Quint, âgé seulement de cinquante-six ans, se retire dans le monastère de Juste (ou saint Juste, Estrémadure), où il prend le froc (il y mourra en 1558). - Philippe II a épousé Marie Tudor, reine d'Angleterre. Il n'est pas moins menaçant pour le repos de l'Europe et de la France que son père.
Aussi la lutte engagée par la France contre Charles Quint se poursuit-elle contre lui. - Henri II entre dans une ligue formée avec le pape Paul IV et le duc de Ferrare, Hercule II, gendre de Louis XII et beau-père du duc de Guise, contre Philippe II. Il s'agit de libérer l'Italie du joug des Impériaux. Malheureusement les conjurés d'Italie ne sont pas en état de tenir tête au représentant de Philippe II, le duc d'Albe. Philippe II d'Espagne, (né en 1527 à Valladolid - mort en 1598 au palais de l'Escurial), était un prince espagnol de la maison de Habsbourg.
Il était le fils de Charles Quint (1500-1558), roi de Castille et de Leon (1506-1555) et roi d'Aragon (1516-1556), sous le nom de Charles Ier, et empereur romain germanique (1519-1556), sous le nom de Charles V, et d'Isabelle de Portugal (1503-1539). Ferdinand Ier de Habsbourg (1503-1564), élu roi des Romains en 1531, puis empereur romain germanique de 1558 à 1564, archiduc d'Autriche et terres adjacentes. Frère cadet de l'empereur Charles Quint, il prend la succession de ce dernier dans les possessions héréditaires des Habsbourgs (Autriche, Styrie, Hongrie, etc) et à la tête de l'empire germanique. Il est à l'origine de la branche des Habsbourgs d'Autriche dits aussi Habsbourgs de Vienne.
►1556 - 16 janvier Abdication de Charles Quint pour l'Espagne en faveur de son fils Philippe II. Après l'abdication de son père et sa retraite au monastère de Juste, Philippe devint roi d'Espagne (1558-1598), sans compter de nombreux autres titres, tandis que les princes-électeurs du Saint Empire romain germanique portaient à leur tête le frère cadet de Charles Quint, Ferdinand Ier (1503-1564).
► 1556 - 15 février Traité de Vaucelles entre Henri II et Charles Quint insti-tuant une trêves de cinq ans.
► 1557 François de Guise, lieutenant général, invoquant des droits sur le royaume de Naples, pénètre en Italie à la tète d'une armée française; mais il ne reçoit pas (et pour cause) de secours appréciable des associés de Henri II, pour lesquels il ne peut rien d'utile. Sa campagne contre Naples avorte. Il est rappelé en France. - Les Anglais s'allient aux Espagnols et envahissent la Picardie et l'Artois sous la conduite du duc de Savoie, Emmanuel-Philibert ; ils battent les Français devant Saint-Quentin où le chef français (Henri Ier de Montmorency, connétable) est fait prisonnier, et s'emparent de la ville, défendue par Gaspard de Coligny, après un siège de quelques jours.
François de Guise prend le commandement des troupes françaises et les réorganise rapidement. Emmanuel-Philibert, né à Chambéry en 1528 et mort à Turin en 1580, est le 10ème duc de Savoie. Il accède au trône en 1553 et épouse en 1559, Marguerite de Valois, fille de François Ier de France (Marguerite de France). En 1653, il transfère sa capitale de Chambéry à Turin. Son fils Charles-Emmanuel lui succède à sa mort. Henri Ier de Montmorency, né le 15 juin 1534, mort le 2 avril 1614, duc de Montmorency, fils du connétable Anne de Montmorency et de Madeleine de Savoie, était un militaire français de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Il fut Connétable de France.
► 1557 - 3 janvier Henri II déclare la guerre à Philippe II d'Espagne.
► 1557 - 23 mai l'amiral de Gaspard de Coligny s'empare de Lens.
► 1557 - 7 juin Philippe II d'Espagne déclare la guerre à la France.
► 1557 - 24 juillet L'édit de Compiègne décrète la peine de mort contre les hérétiques. Le roi Henri II, ennemi implacable des protestants, renforce les pouvoirs de la juridiction laïque par des édits où il est stipulé que le jugement des hérétiques est réservé aux tribunaux du roi. Il prévoit leur condamnation à mort.
► 1557 - 10 août Défaite des troupes françaises à Saint-Quentin. Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, allié de Philippe II d'Espagne, vient de commencer le siège de Saint-Quentin. En ce 10 août, le connétable de Montmorency tente de porter secours à l'amiral Gaspard de Coligny, qui est enfermé dans la ville avec seulement sept cents hommes. Les munitions, que l'on cherche à porter par bateaux jusqu'à la ville, s'enlisent dans la boue des marais de la Somme.
Une charge brutale de la cavalerie espagnole écrase devant les murs les troupes du connétable, qui est blessé et fait prisonnier par les impériaux. Malgré ce désastre, Coligny tient encore plus de deux semaines. Le 27 août, la ville est prise. Pillage, viols, massacres. Coligny est fait prisonnier. Si la route de Paris lui est ouverte, le roi d'Espagne Philippe II doute de ses forces et préfère se retirer à Bruxelles.
► 1557 - 27 août Reddition de Saint-Quentin, Gaspard de Coligny est fait prisonnier. La bataille de Saint-Quentin (Août 1557) est une victoire espagnole sur la France. La résistance des habitants Saint-Quentinois sous la conduite du héros immortel Gaspard de Coligny, comte de Coligny, seigneur de Chastillon-sur-Loing, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur et lieutenant-général de la ville de Paris, de l'Isle de France, de Picardie et d'Artois, colonel général de l'infanterie et Amiral de France (on l'appelait aussi Gaspard II de Coligny), parvenu dans la ville dans la nuit du 2 au 3 aôut 1557, avec 500 hommes armés et avec l'aide du baron d'Armerval, Monsieur Théligny, Monsieur de Gibercourt et de Jean V, duc de Caulaincourt et avec l'aide des habitants, ils résistèrent dix-sept jours et dix-sept nuits.
► 1557 septembre Tentative d'assassinat de Henri II.
► 1557 André Thevet écrit 'Les singularitez de la France Antarctique’
► 1558 François de Guise a porté ses troupes devant Calais pendant que les Espagnols s'attardaient au siège de Saint-Quentin. En huit jours, il reprend aux Anglais cette ville, qui était leur dernière possession sur le sol français et la seule base qu'ils eussent pour des opérations contre la France. La perte de Calais rend l'alliance anglo-espagnole inopérante. Marie Tudor, reine d'Angletrre, meurt du chagrin que lui cause cet événement.
► 1558 - 8 janvier François de Guise s'empare de Calais. Investie par les Anglais durant la guerre de Cent Ans, en 1347, le port retombe dans le royaume français de Henri II après un siège de six jours mené par François de Guise.
► 1558 - 21 janvier François de Guise s'empare de Guines puis de Ham.
► 1558 - 24 avril Mariage du Dauphin François (futur François II) avec Marie Stuart, reine d'Écosse et de France.
► 1558 mai François de Guise s'empare de Thionville.
► 1558 - 13 juillet Défaite française à Gravelines face aux Espagnols.
► 1558 - 22 septembre Mort de Charles Quint. A la fois Empereur d'Allemagne, Prince des Pays-Bas et Roi d'Espagne, Charles Quint s'éteint à 58 ans à Yuste en Espagne. Depuis son abdication en faveur de son fils Philippe II, il vivait reclus dans le couvent de l'ordre de Saint-Jérôme en Estrémadure. Fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, il hérita de l'Espagne et de l'Amérique Latine par sa mère et des territoires du Saint-Empire Romain Germanique par son père. Il régna de 1519 jusqu'à 1556 sur cet immense empire "où le soleil ne se couchait jamais" tout en menant des luttes incessantes pour imposer son hégémonie et assurer le triomphe de la catholicité.
► 1558 - 17 novembre Élisabeth Ière accède au trône. Après la mort de sa demi-soeur Marie Ière Tudor, Élisabeth arrive sur le trône et fait rentrer l'Angleterre dans une nouvelle ère. Anglicane et prônant la tolérance religieuse au début de son règne, elle devient progressivement un monarque absolu et s'attire les foudres des pays catholiques, ce qui amène notamment l'épisode de "l'Invincible Armada". Dernière des Tudor, son règne coïncidera avec une prospérité économique ainsi qu'une littérature et un théâtre resplendissant, dont la meilleure illustration reste Shakespeare.
► 1558 Joachim Du Bellay écrit Le Premier livre des Antiquités de Rome ; 'Les Regrets’
► 1558 La nouvelle (alors appelée "conte") accède au rang de genre littéraire. Une nouvelle est un genre littéraire basé sur un récit de fiction court en prose, pouvant aller jusqu'à une trentaine de pages (mais il n'y a pas de règle absolue). Contrairement au roman, il est centré sur un seul événement. Les personnages sont peu nombreux et sont doués de réalité psychologique bien que celle-ci soit moins développée que dans le roman. La fin du récit ou chute, souvent inattendue ou surprenante, est en général particulièrement mise en relief, voire dramatique.
La nouvelle naît en France à la fin du Moyen Âge. Elle vient s'ajouter, et en partie se substituer, à une multitude des récits brefs : fabliaux, lais, dits, devis, exempla, contes, etc. Directement inspiré du 'Décaméron' (1349-1353) de l'Italien Boccace, le premier recueil de nouvelles françaises, anonyme, 'Les Cent Nouvelles Nouvelles', date de 1456-1457. Mais c'est le XVIe siècle qui verra le véritable essor du genre. En 1558, avec son Heptaméron, Marguerite de Navarre, soeur de François Ier, donne au genre ses premières lettres de noblesse.
► 1558 Jules César Scaliger écrit 'Poetices libri septem'. Jules César Scaliger, célèbre érudit né en 1484 à Vérone, mort en 1558, était fils de Benoît Bordoni, peintre en miniature, mais prétendait descendre de la noble maison della Scala (d'où le nom qu'il prit). Après avoir beaucoup voyagé, il suivit en France Antoine de La Rovère, évêque d'Agen (1525), se fixa auprès de lui comme médecin, et obtint des lettres de naturalisation. Il écrivit d'abord contre les savants les plus illustres de son siècle, et commença ainsi à se faire une réputation que sa science réelle et ses nombreux travaux classiques augmentèrent bientôt. Il visait au renom d'homme universel, et effectivement il savait de tout, mais c'est principalement comme grammairien qu'il mérite sa célébrité.
► 1559 - 3 avril Traité de Cateau-Cambrésis entre Henri II et Philippe II d'Espagne ; ce traité met fin aux Guerres d'Italie. Il laisse à la France les conquêtes de Henri II, et par conséquent les Trois Evêchés et Calais; mais il lui enlève la Savoie et les principales places fortes du Piémont. Comme conséquence de cette paix, le duc de Savoie (Emmanuel-Philibert de Savoie, qui commandait à Saint-Quentin), rentre en possession de ses États; il épouse Marguerite, soeur de Henri II; et Philippe II, veuf de Marie Tudor, épouse Élisabeth de Valois, fille de Henri II et de Catherine de Médicis, née en 1545.
Ainsi se terminent ces guerres d'Italie. Elles n'auront que peu de résultats politiques positifs. Dernière aventure moyenâgeuse, elle verra évoluer au cours des différents conflits les techniques de guerre, avec notamment l'apparition des armes à feu. C'est dans le domaine des arts que ses apports seront le plus bénéfiques. En effet, que ce soit en peinture, sculpture, architecture ou littérature, l'esprit de la Renaissance va souffler sur la France. Mais pas toujours pour le meilleur, la France allant connaître dans les années qui suivent bien des tourments qui ont failli provoquer sa perte. Traités du Cateau-Cambrésis, le premier traité du Cateau-Cambrésis, fut conclu en deux temps, les 12 mars et 2 avril 1559, entre Henri II de France, et Élisabeth Ière, reine d'Angleterre.
Il permit notamment à la France, en contrepartie d'un versement de 500 000 écus, de conserver Calais, reprise sur les Anglais le 8 janvier 1558, après un siège de seulement 8 jours (Édouard III d'Angleterre avait mis 11 mois à prendre la ville, en 1347) par des forces françaises sous les ordres du lieutenant-général du royaume François de Guise. Le second traité, également appelé paix du Cateau-Cambrésis, fut signé le 3 avril 1559 entre le roi de France Henri II et Philippe II d'Espagne. Elle mit fin à 65 années de conflit pour le contrôle de l'Italie (les guerres d'Italie). Elle était devenue nécessaire aux deux parties qui s'étaient épuisées financièrement et en particulier pour la France qui, déjà affaiblie par les défaites de Saint-Quentin (1557) et Gravelines (1558) était aussi en proie à des troubles religieux entre partisans de l'Église romaine et Huguenots.
La France put conserver les Trois-Évêchés : Metz, Toul et Verdun qu'elle avait conquit en 1552, mais elle dut rendre la Savoie et les principales places du Piémont, le Charolais, le Bugey et la Bresse à Emmanuel-Philibert de Savoie, allié de l'Espagne. Elle dut aussi rendre la Corse à Gênes et renoncer à ses prétentions sur le Milanais. L'Espagne retrouva sa position dominante sur l'Italie, même si elle laissa à la France cinq forteresses, dont Turin. Le traité prévoyait aussi le mariage de la soeur d'Henri II (Marguerite de France), avec le duc de Savoie (Emmanuel-Philibert de Savoie) et celui de sa fille aînée Élisabeth de France avec le roi d'Espagne Philippe II d'Espagne, veuf depuis la mort de Marie Tudor.
► 1559 - 26 mai Les églises réformées tiennent leur premier synode national secret à Paris, organisé par Jean Calvin.
► 1559 - 2 juin Édit d'Écouen ordonnant l'expulsion des Huguenots. le roi signe l'édit d'Écouen pour dit-il "extirper l'hérésie". Cet édit interdit d'appliquer aux hérétiques d'autres peines que le feu. Deux conseillers au Parlement, Anne du Bourg et Laporte sont arrêtés, ils seront exécutés quelques mois plus tard.
► 1559 30 juin : Tournoi pendant la fête des noces de la soeur du roi, Marguerite de France avec le duc Emmanuel-Philibert de Savoie, et de la princesse Élisabeth de France avec Philippe II d'Espagne. Le roi Henri II de France est blessé à l'oeil par Gabriel de Montgomery. Montgommery, Gabriel de Lorges, comte de Montgommery (Calvados), seigneur de Ducey (Manche) (Lorges, Beauce ou Ducey, Normandie, 1526 ou 1530 - Paris, 1574) était un homme de guerre français.
Fils de Jacques Ier de Lorges, comte de Montgommery, originaire d'Écosse, capitaine distingué de la Garde écossaise attachée au service de François Ier et de Claude de La Bouxière, dame de Ducey, il est l'auteur du coup fatal à l'oeil qui coûta la vie à Henri II le 1er juillet 1559. Bien qu'Henri II l'ait absous de tout blâme sur son lit de mort, Catherine de Médicis ne cessa jamais de le pourchasser de sa vindicte : banni de la cour dès le lendemain, il dut s'enfuir en Angleterre, où il adhéra à la Réforme dont il devint, de retour en France, l'un des fers de lance en Normandie ainsi que l'un des commandants les plus capables de l'amiral de Coligny.
► 1559 - 10 juillet Mort de Henri II, A l'occasion des fêtes auxquelles donne lieu à Paris les noces de la soeur du roi, Marguerite de France avec le duc Emmanuel-Philibert de Savoie, et de la princesse Élisabeth avec Philippe II d'Espagne et pour célébrer la paix du Cateau-Cambrésis et le mariage de sa fille au roi d'Espagne, le roi a organisé de grandes fêtes. Lui-même, en ce 10 juillet, malgré le rêve prémonitoire de la reine Catherine de Médicis, monte en selle pour le tournoi. Son cheval porte le nom de Malheureux. En face du roi, âgé de quarante ans, trois adversaires : le duc de Savoie, le duc de Guise et le jeune Gabriel de Montmorency. Quoique les trois assauts aient été des victoires du roi, celui-ci invite Montmorency à une dernière joute.
Les chevaux se mettent en place. Le roi s'élance sans rabattre sa visière. La lance de Montmorency se brise sur l'armure du roi et la pointe qui glisse sur l'acier entre dans l'oeil droit du roi. Le roi est désarçonné et tombe sans connaissance. En dépit des essais qu'Ambroise Paré a été autorisé à faire sur les têtes de quatre condamnés décapités en hâte, le roi agonise pendant dix jours, puis meurt. François II, qui ne régnera que quelques mois, lui succède. L'adversaire du roi, devenu malgré lui son assassin, est emprisonné, puis libéré. Une mort accidentelle au cours d'un tournoi qui oppose des chevaliers ne saurait être considérée comme un meurtre.
Gabriel de Montmorency n'est pas régicide. En 1574, alors que, huguenot, il est fait prisonnier, Catherine de Médicis le fait, en dépit des règles, condamner à mort. Sous le règne de Henri II, la Renaissance a continué à s'affirmer ; la France occupe avec l'Italie le premier rang entre les nations de l'Europe au point de vue des arts, des lettres et des sciences. Les succès des Français sur les Espagnols ont accru leur prestige ; d'ailleurs, l'armée aguerrie, reconstituée, réorganisée est maintenant la première de l'Europe. Par contre, l'administration financière de Henri II a été médiocre et s'il laisse la France brillante, il ne la laisse pas riche. - Avènement de François II (fils de Henri II et de Catherine de Médicis), né en 1544. Les oncles de sa femme Marie Stuart (duc et cardinal de Guise) s'imposent comme régents en attendant sa majorité.
Prince sans valeur, sans énergie, il est complètement dominé par les Guise. En ce court règne s'annoncent les Guerres de religion qui désoleront la France jusqu'en 1598. Les principaux personnages dont le nom reste attaché à l'histoire de ce temps appartiennent à la famille de Guise, à celle de Bourbon et à celle de Châtillon. Famille de Guise : François de Guise (duc de Guise), Charles de Guise (cardinal de Lorraine et frère de François de Guise), Marie Stuart (reine de France et d'Écosse et cousine de François de Guise). François de Guise a trois fils, qui seront célèbres sous les noms de Henri Ier de Guise dit le Balafré, Charles de Guise, duc de Mayenne et Louis II de Lorraine de Guise, dit le cardinal de Guise. Branche cadette de la branche de Vaudémont de la maison de Lorraine, la famille des ducs de Guise descend de la maison de Vaudémont des ducs de Lorraine.
Elle fut particulièrement impliquée dans les guerres de religion, prenant la tête du parti ultra-catholique et de la Sainte Ligue. Leurs ambitions constituant une menace pour son pouvoir, Henri III les combattit et fit assassiner Henri Ier dit le Balafré. La famille de Bourbon : Antoine de Bourbon, (roi de Navarre et père de Henri IV) qui a été un moment calviniste, mais mourra catholique, sa femme Jeanne d'Albret (qui a embrassé la Réforme), Louis Ier de Bourbon-Condé (prince de Condé et frère de Antoine de Bourbon) qui se fera calviniste par haine des Guise, Charles Ier de Bourbon (cardinal de Bourbon).
La maison de Bourbon est la famille qui dirigea la seigneurie de Bourbon-l'Archambault jusqu'à ce que cette dernière passe par mariage à la maison de Dampierre (v.1227) puis à la maison de France (en 1287 à la branche de Bourgogne, puis en 1310 à la branche de Clermont, branche qui reprendra dès lors le nom de Bourbon, jusqu'à son accession au trône de Navarre en 1555). La famille Châtillon : les neveux du connétable Anne de Montmorency, à savoir: le cardinal de Châtillon (Odet), l'amiral de Gaspard de Coligny, et François de Coligny (François d'Andelot). Cette dernière famille sera le plus ferme soutien de la Réforme.
► 1559 FRANÇOIS II (1559-1560) qui charge sa mère Catherine de Médicis du gouvernement avec les Guise.
► 1559 François II. Il succède à l'âge de 15 ans à son père mort accidentellement. L'année précédente il avait épousé Marie Stuart reine d'Écosse nièce des Ducs de Guise. En raison des troubles en Écosse causés par les protestants, elle avait été élevée à la cour de France. François II règne sous la tutelle de sa mère Catherine de Médicis mais ce sont surtout les Guises qui gouvernent. Très fortement catholiques, ils mènent une politique répressive à l'égard des protestants. En réponse, les Protestants décident de soustraire le roi de cette influence néfaste. Une conjuration, conjuration d'Amboise, est montée par Antoine de Bourbon, roi de Navarre (époux de Jeanne d'Albret et père du futur Henri IV), le prince de Condé, son frère (Louis Ier de Bourbon-Condé) et les Coligny.
Le chef avoué de la conjuration était Georges Barré de la Renaudie, trahis par l'un des leurs, La Renaudie fut tué ainsi que de nombreux participants, Condé n'eut la vie sauve qu'en désavouant les conjurés. Craignant la guerre civile, la reine mère qui essayait de maintenir un équilibre entre catholiques et protestants nomme Michel de l'Hospital chancelier et promulgue l'édit de Romorantin qui atténue les peines. Devant la volonté des Guises de résoudre le problème dans le sang, elle envisage de réunir les états généraux. Atteint d'une grave affection des oreilles d'origine tuberculeuse, François II meurt sans descendant le 5 décembre 1560, il a 16 ans. C'est son frère Charles IX qui sera son successeur. Quelques mois plus tard Marie Stuart qui n'aura été reine de France que 2 ans (1559-1560) quitte la France pour tenter de reconquérir son royaume d'Écosse.
► 1559 - 18 septembre Sacre de François II à Reims.
► 1559 Le pape Paul IV, par l'Index, interdit les écrits hostiles à l'Église. La congrégation de l'Index publie la liste des ouvrages interdits.
►1559 Jacques Amyot, traduction des 'Vies des Hommes illustres' de Plutarque. Jacques Amyot, dès la fondation du Collège des Lecteurs Royaux, il reçoit les leçons de l'helléniste Danes. Grace à l'appui de Marguerite de Navarre, soeur de François Ier, il devient ensuite professeur à l'université de Bourges. Mais depuis longtemps, il rêvait de consulter les manuscrits de la bibliothèque du Vatican. Il se rend à Venise, à Rome... Un an plus tard, il retourne en Italie chargé de porter au Concile de Trente une lettre de François Ier, qui s'élevait contre les prétentions temporelles du Saint-Siège.
Sur la recommandation de Michel de l'Hospital, Henri II le choisit comme précepteur de ses fils, les futurs Charles IX et Henri III. Jacques Amyot devient en 1560, grand aumônier de France, et en 1570 évêque d'Auxerre. Il fait de sa ville épiscopale un centre important d'Humanisme. Mais son attitude pacifique, en ces temps de guerre de religion, lui vaut en 1588 de pénibles déboires; une émeute, fomentée par les ligueurs, éclate; on lui reproche d'avoir approuvé l'assassinat du duc de Guise, et il est contraint de s'enfuir d'Auxerre. Dès que les passions se calment un peu, il y revient et se consacre désormais à des travaux sur la Bible et les Pères de l'Église.
► 1560 8 mars Édit d'Amboise suspendant les poursuites pour cause de religion. L'édit d'Amboise rapportait l'édit d'Écouen (1559) et accordait le pardon royal aux protestants. Quelques jours plus tard se produisait la conjuration d'Amboise.
► 1560 - 17 mars Échec de conjuration d'Amboise. - Elle est nouée par les protestants dans le but d'enlever Charles IX afin de le soustraire à l'influence (catholique) des Guise. L'âme de cette conjuration est le prince de Condé, mais il a pris un "homme de paille", un gentilhomme périgourdin nommé La Renaudie. Les Guise, prévenus à temps, font avorter le complot, dont les chefs sont arrêtés. La conjuration d'Amboise (mars 1560) est un coup de force manqué par les protestants pour s'emparer de la personne du roi, François II et le délivrer de la tutelle des Guise. Il s'agit du premier épisode sanglant et tragique des guerres de Religion. Il prélude le terrible conflit qui se déroulera en France de 1562 à 1598.
Prince de Condé, Louis Ier de Bourbon, prince de Condé (Vendôme, 1530 – Jarnac, 1569) est à l'origine de la maison de Condé. C'était le frère du roi de Navarre (Antoine de Bourbon) et donc l'oncle d'Henri IV. Converti au protestantisme, il s'imposa comme le chef du parti calviniste pendant les guerres de religion. Condamné à mort après la conjuration d'Ambroise, il fut sauvé in extremis par la mort du roi François II. Il fut l'un des initiateurs des deux premières guerres de religion. Il fut vaincu à Dreux puis à Jarnac, où il fut assassiné par le capitaine de Montesquiou. La maison de Condé est une branche de la maison de Bourbon, issue de Louis Ier de Bourbon, prince de Condé, cinquième fils de Charles IV de Bourbon. Il était le frère d'Antoine de Bourbon, roi consort de Navarre et père du futur Henri IV.
► 1560 - 19 mars Exécution des responsables de la conjuration.
► 1560 - 7 mai Michel de L'Hospital proclame l'Édit de Romorantin qui arrête l'installation de l'inquisition en France. Les assemblées de protestants sont proscrites. Les calvinistes continuent à s'assembler et se saisissent d'édifices pour célébrer leurs cérémonies. A l'automne, l'armée royale entre en campagne pour les empêcher de s'assembler et les forcer à restituer les édifices : le comte de Villars, lieutenant-général du gouverneur, opère en Languedoc.
Il force les ministres à fuir dans la montagne, rétablit le culte catholique et frappe de lourdes amendes ceux qui participent aux réunions. C'est dans son souci d'établir une forme de tolérance religieuse, notamment à l'égard des protestants que Michel de l'Hospital conseille au roi François II cet édit qui empêche l'instauration des tribunaux de l'Inquisition en France. Les procès en hérésie sont jugés directement par les évêques.
► 1560 - 5 juin Massacre de protestants à Lyon.
► 1560 - 30 juin Michel de l'Hospital nommé chancelier par Catherine de Médicis. La place de chancelier du royaume est vacante depuis que François Olivier est mort de chagrin ; en effet, il avait dû juger les conjurés d'Amboise qui avaient voulu soustraire le roi à l'influence du très catholique François de Guise. Les partisans de Condé qui ont participé à cette conjuration ont été pendus, décapités, noyés dans la Loire. Catherine de Médicis, parce qu'il est temps d'apaiser les esprits, impose à son fils, François II, Michel de L'Hospital pour cette charge. Il est catholique. Il est modéré. Il est humaniste. Il ne tarde pas à en faire la preuve. Lors des États généraux qui se tiennent à Orléans en décembre 1561 il déclare : “Otons ces mots diaboliques, noms de partis, de factions, de séditions, luthériens, huguenots, papistes : ne gardons que le nom de chrétiens”.
Michel de l'Hospital est un écrivain et homme politique français, né à Aigueperse, Puy-de-Dôme, vers 1505, mort à Vignay, près d'Étampes, en 1573. Conseiller au parlement de Paris, ambassadeur au concile de Trente, surintendant des finances et enfin chancelier de France. Il s'employa de toutes ses forces à calmer les haines religieuses et arrêter l'effussion du sang. Le Chancelier de France est un important personnage de l'Ancien Régime, le premier des grands officiers de la monarchie, depuis la suppression en 1627 du connétable et de l'amiral de France. Le Chancelier garde les sceaux de France et les offices royaux. Il exerce la surintendance de la justice du royaume.
► 1560 - 21-30 août Réunion à Fontainebleau à l'instigation de Michel de l'Hospital des catholiques et des protestants. Il revient à cette assemblée, à la demande de la reine Catherine de Médicis, de rechercher les possibles conciliations entre catholiques et huguenots. L'assistance approuve, en dépit de la colère du cardinal de Lorraine (Charles de Guise), la proposition de Gaspard de Coligny, qui a demandé la libre pratique de la religion réformée. Michel de l'Hospital préconise en outre des mesures pacifiques. Propos de tolérance de ce dernier : “Qu'y a-t-il besoin de tant de bûchers et de tortures ? C'est avec les armes de la charité qu'il faut aller à tel combat. Le couteau vaut peu contre l'esprit”.
► 1560 - 31 octobre Arrestation du Prince de Condé, Louis Ier de Bourbon, à Orléans.
► 1560 - 26 novembre Condamnation à mort du Prince de Condé, Louis Ier de Bourbon.
► 1560 - 5 décembre Mort de François II. C'est un roi âgé de seize ans, amoureux de son épouse et cousine Marie Stuart, qui meurt en ce jour à Orléans d'une infection à l'oreille. Charles IX lui succède. Commentaire de Calvin qui apprend la mort du roi de France : “Dieu, qui avait frappé le père à l'oeil, a frappé le fils à l'oreille”. - Sa veuve retourne en Écosse (où elle trouvera plus tard une mort tragique). Le règne qui vient de s'écouler ne laisse dans l'Histoire d'autre souvenir que celui des orages d'où sont sorties les Guerres de religion. Son frère Charles lui succède.
► 1560 CHARLES IX (1560-1574) régence de Catherine de Médicis.
► 1560 Charles IX. Il n'a que 10 ans lorsque son frère meurt en 1560. Sa mère, Catherine de Médicis, assurera la régence jusqu'en 1563 mais son influence restera prépondérante pendant tout le règne de Charles IX. Catherine chercha toujours, aidée de Michel de l'Hospital, à concilier les uns avec les autres. Elle tenta de concillier les deux églises en organisant le colloque de Poissy (septembre 1561) mais celà ne fit qu'empirer les choses. Pour les "Guise", la France ne pouvait être que catholique. En mars 1562 le hasard fit tomber les Guises et leur escorte sur une grange dans laquelle les protestants étaient réunis pour célébrer leur culte dans le village de Wassy en Champagne.
Ils les passèrent au fil de l'épée (plusieurs dizaines de morts et cent blessés). Cet évènement inaugure une période de 36 années de guerre de religion. Au massacre de Wassy les protestants répondent par l'assassinat du duc François de Guise en 1563, ce qui suscita des troubles. Lorsqu'ils se calmèrent, Catherine de Médicis promulgue l'édit d'Amboise en 1563. Cet édit accorde aux nobles la liberté de culte dans leur domaine mais la refuse toujours aux gens du peuple. La majorité de Charles IX est proclamée le 17 août 1563. Le 13 mars 1564, Catherine de Médicis et le roi Charles IX accompagnés d'une suite de mille personnes, entreprennent un tour de France qui durera plus de 2 ans pour tenter de renforcer la cohésion du royaume.
En 1567 les protestants tentent de s'emparer du roi, la guerre reprend, les catholiques en sortent vainqueurs à Saint Denis et la paix est signée à Longjumeau en 1568. Le renvoi de Michel de l'Hospital rallume la guerre, les protestants sont battus à Jarnac et Moncontour en 1569. Au cours de ces batailles, Condé est tué. Catherine de Médicis traite avec les protestants en 1570 elle leur accorde des "places de sûreté": Montauban, La Rochelle, Cognac, La Charité-sur-Loire et l'on prépare le mariage de Henri de Navarre et Marguerite soeur du roi.
C'en est trop pour les catholiques, ils préparent une riposte elle viendra en août 1572 à la faveur du mariage le jour de la saint Barthélémy que le roi ne put empêcher et que Catherine de Médicis laissa faire. Le massacre se propagea à la province. Le nombre des victimes est probablement situé entre 20 à 30 000. Ceci eut pour effet d'insiter les protestants à fortifier leurs places. Les catholiques essayèrent de s'emparer de La Rochelle en vain. L'édit de Boulogne met fin à cette guerre en juillet 1573. Le roi Charles IX atteint par la tuberculose meurt en 1574. C'est son frère Henri III qui prendra sa succession.
► 1560 Avènement de Charles IX (frère de François II) né en 1550. - Il est trop jeune pour occuper le trône; sa mère Catherine de Médicis prend la régence. Le premier acte de la régente est de bonne politique: croyant travailler à l'apaisement du pays, elle remet en liberté le prince de Condé, Louis Ier de Bourbon, et fait la paix avec le roi de Navarre (Antoine de Bourbon) qu'elle nomme lieutenant général du royaume. En réalité, elle cherche à contrebalancer l'influence menaçante des Guise en leur opposant les Bourbons. D'ailleurs les Guise, en France, sont peu populaires: on les regarde comme des étrangers et on les appelle les princes lorrains. Les Bourbons, au contraire, sont du sang royal de France.
► 1560 13 décembre 1560 - 31 janvier 1561 : réunion des États généraux, à Orléans, qui confient la régence à Catherine de Médicis pendant la minorité de Charles IX, au détriment d'Antoine de Bourbon. Les partisans de la répression de l'hérésie et ceux de la tolérance s'opposent. Catherine veut éviter la guerre civile en tenant la balance égale entre les partis. Elle s'appuie sur des officiers tolérants, comme le chancelier Michel de L'Hospital.
États généraux de 1560, les états généraux s'ouvrent à Orléans, le 13 décembre 1560, dans une salle construite à cet effet sur la place de l'Etat. Le Chancelier Michel de l'Hospital va alors obtenir que les questions religieuses soient débattues lors d'un prochain Concile. La reine va, quant à elle, empêcher la noblesse et le tiers de discuter des limites du pouvoir royal en leur ordonnant. Ils préparèrent aussi des lois commerciales qui furent en vigueur jusqu'en 1789.
► 1560 - 21 décembre Catherine de Médicis et Antoine de Bourbon sont nom-més régents par le Conseil d'État.
►1560 Étienne Pasquier écrit 'Des Recherches de la France'. Étienne Pasquier (1529-1615), écrivain. Fait rare, on publia du vivant même d'Estienne Pasquier plusieurs éditions de sa correspondance. La première en 1586. Ces lettres traitent de sujets très variés mais surtout des affaires du temps (mort du Roi, colloque de Pontoise, protestantisme.) De littérature aussi et d'histoire de la langue. Elles sont adressées à Ronsard, Taboureau, Belleau, de Thou, Ramus. Pour Luce Giard (En français dans le texte) : "Sa plume est ferme, son style alerte, sa langue sûre. Pasquier se place au tout premier rang des grands prosateurs qui ont forgé la capacité de la langue française à l'analyse historique et politique, au maniement des idées".
► 1560 mort de Joachim Du Bellay.
► 1561 - 31 janvier Fermeture des États Généraux d'Orléans.
► 1561 - 5 mai Sacre de Charles IX à Reims. Le roi n'a que onze ans le jour de son sacre. Sa mère, Catherine de Médicis, s'arroge le sceau royal et se déclare non régente mais “reine de France et mère du roi”.
► 1561 - 8 mai Le prince de Condé, Louis Ier de Bourbon, est officiellement innocenté des accusations d'instigation de la conjuration d'Amboise.
► 1561 - 13 juillet Un édit du Conseil d'État interdits assemblées et prédica-tions des protestants.
► 1561 - 1er Août Ouverture de nouveaux États Généraux à Pontoise qui donneront naissance au colloque de Poissy.
► 1561 - 9 septembre Ouverture du colloque de Poissy. Le chancelier Michel de L'Hospital intervient au colloque de Poissy. D'après lui, la tolérance n'est pas une fin en soi mais le meilleur moyen pour rétablir la concorde entre les sujets en attendant la réconciliation des chrétiens. Colloque de Poissy, on a donné ce nom à un débat qui eut lieu entre dirigeants catholiques et protestants à l'instigation du chancelier Michel de l'Hospital, lequel espérait qu'il aboutirait à une entente entre ces deux grands partis, et par-là à la pacification des esprits dans le royaume.
Le cardinal de Lorraine (Charles de Guise) y était l'un des principaux représentants des catholiques; le théologien Théodore de Bèze, celui des protestants. - Cette conférence eut un résultat contraire à celui qu'en attendait son instigateur; elle ne fit qu'envenimer les haines religieuses. Colloque de Poissy (9 septembre-9 octobre 1561). Catherine de Médicis et Michel de l'Hospital réunissent une assemblée composée de théologiens catholiques (cardinal de Lorraine) et protestants (Théodore de Bèze) dans le dessein de parvenir à une conciliation. Si le colloque est un échec, il prépare néanmoins l'édit de tolérance accordant la liberté de culte, qui sera publié en janvier 1562.
Charles de Guise, Charles de Lorraine, 1524-1574, cardinal de Guise, duc de Chevreuse, et archevêque de Reims, plus connu sous le nom du cardinal de Lorraine. Il était le second fils de Claude de Lorraine, premier duc de Guise et grand veneur de France, qui se distingua sous François Ier dans les guerres contre Charles Quint. Archevêque de Reims à l'âge de quatorze ans par la démission de son oncle Jean (1538), il prit le titre de cardinal de Lorraine après son oncle (1547). Il sut, avec son frère aîné, François de Guise, gagner la faveur d'Henri II, qui mit le pouvoir dans leurs mains.
Ils exercèrent une grande influence et jouèrent un grand rôle dans les affaires du pays. François était un grand capitaine, d'une force d'âme extraordinaire, capable de générosité dans la victoire. Charles, au contraire, était lâche dans le péril et insolent dans le succès, sans foi et sans moeurs, mais adroit, éloquent, plein de ressources et de séductions. Sous François II, il eut entièrement l'administration des finances et joua un rôle important lors du colloque de Poissy et du concile de Trente. Il négocia aussi le mariage de Charles IX et d'Élisabeth d'Autriche (1569).
► 1561 - 18 octobre Échec de la tentative de réconciliation du colloque de Poissy.
► 1561 à 1626 - naissance et mort de Francis Bacon. Philosophe et homme d'État anglais. La philosophie de Bacon représente une des grandes ruptures avec la scolastique. Après Thomas More et Montaigne, qu'il admire, avant Descartes qui le lira et reprendra plusieurs de ses idées, Bacon cherche à dégager la connaissance humaine de l'autorité accordée à Aristote par les universités : "Le savoir dérivé d'Aristote, s'il est soustrait au libre examen, ne montera pas plus haut que le savoir qu'Aristote avait". Il reproche aux hommes de l'École de s'être enfermés à la fois dans des cellules de monastères et dans l'étude d'un tout petit nombre d'auteurs, en tout état de cause, dans un savoir livresque, au lieu d'explorer et étudier la nature.
Francis Bacon étudie la philosophie et le droit à Cambridge et entame une carrière diplomatique. Il devient avocat à la mort de son père pour faire face à des problèmes financiers et est élu à la chambre des communes en 1524. Il publie des 'Essais de morale et de politique' en 1597, puis se dirige vers la politique après la mort de la reine Élisabeth en 1603. Il poursuit son ascension, acquiert des privilèges et écrit. Mais la corruption serait à l'origine de sa fortune et c'est le chef d'accusation qui sera retenu contre lui en 1621. Il évite la prison, se retire de la Cour et profite de cet échec pour se consacrer au projet philosophique de sa vie: la 'Grande Restauration'.
► 1562 - 17 janvier Édit de Saint-Germain, qui permet aux protestants l'exercice public de leur religion, hors de l'enceinte des villes. Rédigé par Michel de l'hospital, cet "édit de janvier" autorise la liberté de culte en France, notamment pour les protestants, hors des enceintes des villes et de jour. Mais le parlement de Paris refuse de le signer, ce qui entraîne le massacre des huguenots à Wassy et le début de sanglantes guerres de religion.
► 1562 - 18 janvier 1562 - 4 décembre 1563 : Troisième session (17 à 25) du concile de Trente. Les décrets et canon pris par les Pères concernent les pouvoirs des évêques, le caractère de la messe sacrifice (dite en latin avec explications en langue vulgaire, le canon de la secrète doit être dit à voix basse). Le concile organise la collation du sacrement de l'ordre et organise les séminaires pour l'éducation des jeunes clercs. Le concile remet au Saint-Siège le pouvoir de procéder à la publication du missel, du bréviaire et du catéchisme préparés par les congrégations du concile.
►1562 - 1er mars Massacre de Wassy - Le duc de Guise passant par cette ville un dimanche, avec ses gens, entend des protestants, réunis dans une grange, célébrer en chantant leur office ; une rixe s'engage entre les gens du duc et les protestants dont 650 de ceux-ci sont massacrés et 200 blessés. Le duc lui-même reçoit une blessure. Cette affaire est le premier acte des Guerres de religion. De part et d'autre, on s'arme et on s'organise. Les protestants mettent à leur tête le prince de Condé, Louis Ier de Bourbon : d'ailleurs il y a dans chaque parti autant de chefs que de groupes. La guerre civile s'étend bientôt à tout le territoire, et les belligérants s'y signalent par une égale cruauté.
Commencement des Guerres de religion, qui dureront jusqu'au règne de Henri IV ; elles sont divisées dans l'Histoire en huit guerres distinctes. Wassy est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne. Les guerres de religion sont une série de huit conflits -opposant catholiques et protestants - qui ont ravagé la France dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le développement de l'humanisme à la Renaissance, d'une pensée à la fois critique et individualiste, provoque la naissance d'un courant de Réforme qui a remis en cause les principes traditionnels de la religion chrétienne enseignée par l'Église de Rome.
Au catholicisme traditionnel s'oppose ainsi le protestantisme, opposition qui débouche sur une terrible guerre civile. Les premières persécutions contre les protestants commencent dans les années 1520, et la discorde débute dans les années 1540 et 1550 autour des destructions iconoclastes commises par les protestants sur les objets du rituel romain considérés comme sacrés par les catholiques ; reliques, Saint-Sacrement et statues de dévotion. À la fin du règne d'Henri II, le conflit se politise et à la mort du roi en 1559, les partis religieux s'organisent pour mettre à point leur réseau militaire. Les guerres de religion commencent en 1562 et se poursuivent entrecoupées de périodes de paix jusqu'en 1599, avec la mise en place de l'Édit de Nantes.
Les guerres de religion trouvent un prolongement aux XVIIe (siège de La Rochelle, révocation de l'Édit de Nantes) et XVIIIe siècles (guerre des Camisards), jusqu'à l'arrêt des persécutions sous Louis XVI (Édit de tolérance en 1788). Ces guerres sont particulièremment difficiles à étudier, du fait de leur complexité. Aux affrontements religieux se superposent des ambitions politiques, des différends culturels et enfin des interventions étrangères. Ces troubles coïncident à un affaiblissement de l'autorité royale. Les rois François Ier et Henri II n'avaient permis aucune contestation de leur pouvoir.
Lorsque ce dernier meurt accidentellement le 10 juillet 1559, les rois François II et Charles IX sont trop jeunes pour pouvoir régner par eux-mêmes. Les différents camps politiques tentent donc de s'imposer pour contrôler le pouvoir royal. Trois grandes familles vont s'opposer: les Montmorency et Châtillon ; les Guise, meneurs du parti catholique ; les Bourbons, meneurs du parti protestant. Des leaders s'illustrent, Henri Ier de Guise, chef de la Ligue, association de catholiques intransigeants, les princes de Condé, Gaspard de Coligny et Henri de Navarre (le futur Henri IV) du côté protestant. Chacun profite de l'affaiblissement du pouvoir royal en France, pour s'imposer tant les nobles et les bourgeois que les souverains étrangers.
L'Angleterre soutient les protestants, l'Espagne les catholiques. Entre ces deux camps, quelques-uns essaient de maintenir la continuité de l'État par la mise en place de la tolérance religieuse notamment Catherine de Médicis, mère de Charles IX et d'Henri III, et son chancelier Michel de l'Hospital. Les rois étant trop jeunes pour régner, différents camps politiques tentent de s'imposer pour contrôler le pouvoir royal. Ce sont trois grands clans familiaux qui vont ainsi s'opposer :* les Montmorency : il s'agit d'une des familles les plus anciennes et les plus puissantes de France. La raison en est l'extraordinaire fortune du connétable Anne de Montmorency qui exerçait une influence très importante sur le roi Henri II. Dans cette famille, s'illustrent François de Montmorency et les frères Châtillon (le cardinal de Châtillon, François d'Andelot, Gaspard de Coligny).
Partagés entre catholiques et protestants, les Montmorency s'unissent contre l'influence croissante des Guise, leurs rivaux. Leur concurrence dans la course au pouvoir, font des guerres de religion une guerre privée entre ces deux familles. Celle de Montmorency est la grande perdante du conflit (ses membres sont morts au combat, assassinés, embastillés et exilés). Elle connaît cependant une renaissance au côté d'Henri IV avec Montmorency-Damville.* les Guise : ce sont les meneurs du parti catholique. Cousins du duc de Lorraine, ils connaissent leur ascension politique grâce à Claude de Lorraine et François de Lorraine, les deux premiers ducs de Guise et aussi grâce à Marie Stuart qui devient reine de France de 1559 à 1560. Dans cette famille s'illustrent également le cardinal de Lorraine (Charles de Guise), Henri Ier de Guise et Charles de Mayenne.
Très souvent mis à l'écart par la reine-mère, à cause de leur intransigeance les Guise reviennent triomphalement sur le devant scène par leur popularité. Ils sont les grands gagnants des guerres de religion. En 1588, ils parviennent à chasser le roi Henri III de la capitale et à le destituer l'année suivante. Malgré leur défaite et leur soumission à Henri IV, leur puissance est assez importante pour obliger le roi à les ménager.* les Bourbon : descendant de Saint Louis en ligne direct, ce sont des princes de la maison de France. C'est une famille dont certains membres sont les meneurs du parti protestant parmi lesquels Louis de Condé et son fils Henri de Condé et Antoine de Bourbon et son fils Henri IV. C'est une famille divisée qui a du mal à se trouver un chef véritable. Face à ses cousins et à son oncle le cardinal de Bourbon, Henri IV parvient péniblement à s'imposer. La mort du dernier des Valois l'amène à prendre la couronne de France.
► 1562 première phase (1562-1563) des guerres de Religion (1562-1598). Du massacre de Wassy à la paix d'Amboise. Première guerre de religion (1562–1563), la rupture est consommée le 18 mars 1562, lorsque le duc François de Guise, revenant de négociations en Alsace, affronte et tue à Wassy, dans des circonstances peu claires, 37 protestants regroupés dans une grange pour célébrer leur culte. Ce sont les protestants qui passent les premiers à l'offensive.
La lutte s'organise pour le contrôle de l'espace urbain. L'attaque protestante est fulgurante. Au bout d'un mois, les protestants parviennent à s'emparer d'un grand nombre de villes dont de très importantes comme Lyon, Orléans ou encore Rouen la deuxième ville du pays. A chaque prise, les protestants passent méthodiquement au saccage des églises, voir à leur destruction. Les pertes sont immenses mais les protestants échouent à Toulouse et à Bordeaux. Pour l'armée catholique commence la longue campagne de siège qu'il faut mettre en place pour récupérer les villes prises.
► 1562 Manifeste de Condé. Le chef des huguenots, Louis Ier de Bourbon, appelle les protestants à prendre les armes et à venger les villageois de Wassy. Le conflit prendra fin en mars 1563 quand catholiques et protestants signeront la Paix d'Amboise.
► 1562 - 12 avril Massacre de protestants à Sens. Sens est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne.
► 1562 mai Révolte de protestants à Toulouse sévèrement réprimée.
► 1562 - 6 mai Prise d'Orange par les catholiques. Orange est une commune française de Vaucluse.
► 1562 juillet Prise de Beaugency par les protestants. Beaugency est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre.
► 1562 - 4 juillet Prise de Blois par les catholiques.
► 1562 - 1er août L'armée royale (catholiques) prend Bourges.
► 1562 août Prise de Monségur, Bazas et Marmande par les Espagnols. Monségur est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Aquitaine. Bazas est une commune française, située dans le département de la Gironde et la région Aquitaine. Marmande est une commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne et en région Aquitaine sur la Garonne.
► 1562 - 20 septembre Traité de Hampton Court : Élisabeth Ière d'Angleterre accorde une aide financière à la France en contrepartie du Havre. Jean de Ferrières, seigneur de Maligny, vidame de Chartres, et son beau-frère Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir, furent accrédités par le prince de Condé (Louis Ier de Bourbon-Condé) pour obtenir l'aide militaire et financière de la reine Élisabeth d'Angleterre lors de la première guerre de religion.
Les négociations des réformés français aboutirent le 20 septembre 1562 au traité de Hampton Court qui prévoyait que l'Angleterre leur fournirait 6000 hommes et la somme de 100 000 couronnes contre le port du Havre que Condé devrait livrer à l'Angleterre qui pourrait le tenir comme gage d'un futur échange avec Calais. Le Havre fut repris par l'armée royale le 28 juillet 1563 et le traité de Hampton Court annulé par celui de Troyes signé le 11 avril 1564. Le traité d'Hampton Court est un traité signé entre les Huguenots et la reine Élisabeth Ière le 20 septembre 1562.
► 1562 - 6 octobre Siège de Rouen par l'armée royale (30 000 hommes) qui veut empêcher la jonction des calvinistes avec les Britanniques. Antoine de Bourbon y est mortellement blessé. Rouen est prise par les catholiques le 26 octobre. Antoine de Bourbon, roi de Navarre est blessé.
► 1562 - 17 novembre Mort d'Antoine de Bourbon.
► 1562 - 19 décembre Bataille de Dreux entre catholiques et protestants. La guerre de religion entre catholiques et protestants, déclenchée par le massacre des huguenots à Wassy, fait rage. Après avoir pris Rouen en octobre, les catholiques sont vainqueurs à Dreux. Dreux est une commune française, située dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre.
Bataille de Dreux, le 19 décembre 1562, le sud de la ville de Dreux est le théâtre du premier choc véritable de la guerre de religion entre les troupes protestantes du prince de Condé (Louis Ier de Bourbon-Condé) et de l'amiral de Coligny et l'armée catholique et royale dirigée par le "triumvirat" composé du connétable de Montmorency, du duc de Guise et de Jacques d'Albon de Saint-André, favori d'Henri II, maréchal de France et premier gentilhomme de la chambre. À l'issue de cet affrontement particulièrement sanglant qui laissa plus de 8 000 victimes sur le terrain, les Catholiques l'emportèrent sur les Protestants par une ruse qui, selon certains historiens, inspira Napoléon dans sa conquête de la Russie. La bataille rompit également le "triumvirat" lorsque Jacques d'Albon de Saint-André, tombé aux mains des Protestants lors de la bataille, fut assassiné par un Catholique.
► 1562 Pierre de Ronsard écrit 'Discours des misères de ce temps’
► 1562 à 1635 - naissance et mort de Lope de Vega. Écrivain et poète espagnol. Il aurait écrit environ 2000 pièces, mais seules 425 sont parvenues jusqu'à nous, parmi lesquelles 'El Perro del Hortelano'.
► 1562 Paul Véronèse peint 'Les Noces de Cana'. Les Noces de Cana est un tableau de Paul Véronèse actuellement situé au musée du Louvre, à Paris. Commandé le 6 juin 1562 par les bénédictins de San Giorgio Maggiore, à Venise, qui voulaient voir le tableau égayer leur réfectoire, les Noces de Cana firent scandale en leur temps. Insistant sur la fête que constituent des noces plus que sur la lourde symbolique qu'impose l'illustration de textes issus de l'évangile, Véronèse semble se complaire dans une ivresse toute vénitienne (on disait des Vénitiens qu'ils croyaient ;énormément en saint Marc, assez en Dieu et peu ou pas du tout au pape"), ultra-moderne (certains éléments d'architecture sont empruntés à des bâtiments crées par Palladio l'année même) et cosmopolite (sont mêlés vêtements orientaux et occidentaux).
► 1563 Orléans qui s'est donnée aux protestants est assiégée par l'armée royale (catholique). Pendant le siège, le duc François de Guise (chef des catholiques) est assassiné par Poltrot de Méré (protestant). Catherine de Médicis, la régente conclut avec les protestants la paix d'Amboise (mars 1563) en vertu de laquelle Orléans est rendue au roi. Peu après, l'armée royale reprend Le Havre aux Anglais.
► 1563 - 24 février Assassinat de François de Guise par Poltrot de Méré. Un fanatique protestant, Poltrot de Méré, frappe à plusieurs reprises François de Guise pendant le siège d'Orléans. Le duc meurt des coups de couteau qui lui ont été portés. Son assassin est écartelé. Jean de Poltrot (1537-1563), seigneur de Méré or Mérey, était un gentilhomme de l'Angoumois. Il est celui qui a assassiné François, duc de Guise, chef de l'armée catholique royale durant les guerres de religion. Poltrot a vécu un certain temps en Espagne dont il est connaissait la langue. Il sert alors comme espion dans le contexte de la guerre contre l'Espagne.
Devenu un protestant zélé, il se décide à tuer le duc de Guise. Il déserte alors son camp pour rejoindre celui des Catholiques occupés à assiéger Orléans. Dans la soirée du 18 février 1563, il se cache derrière le long d'une route par lequel doit passer le duc de Guise, tire avec un pistolet et s'enfuit. Il est capturé le jour suivant. Torturé, il est condamné à être écartelé. Il agonise le 18 mars 1563. Mis à la torture, Poltrot aurait déclaré avoir eu pour commettre son assassinat le soutien et la complicité de l'amiral de Coligny chef des huguenots. La controverse va animer la cour pendant de très longues années car Coligny a toujours protesté contre l'accusation.
► 1563 - 19 mars Paix d'Amboise accordant liberté de culte et de conscience aux protestants chez eux. L'édit de paix d'Amboise que publie Catherine de Médicis reconnaît aux protestants la liberté de conscience et une liberté de culte limitée à leurs demeures et à une seule ville par territoire, à l'exception de Paris.
► 1563 - 28 juillet Les français prennent Le Havre aux Anglais.
► 1563 - 17 août Charles IX est déclaré majeur par le Parlement de Rouen.
► 1564 Catherine de Médicis éloigne les Guise (ultra-catholiques) et les Châtillon-Coligny (huguenots) du Conseil au début de l'année. Elle s'entoure de fidèles modérées (Michel de L'Hospital, les évêques Monluc et Morvilliers) renforcé par de grands seigneurs (le cardinal de Bourbon, Montmorency).
► 1564 - 24 janvier : Voyage de la Cour à travers la France (fin en juillet 1566) ; Troyes, Bar-le-Duc, vallée du Rhône, Montpellier, Carcassonne, Toulouse (hiver 1565), Bayonne, Charente, Vallée de la Loire, Bourbonnais.
►1564 - 11 avril Traité de Troyes entre la France et l'Angleterre qui renonce à Calais. Signature du traité de Troyes entre la France et l'Angleterre, cette dernière renonce à toute prétention territoriale sur le continent.
► 1564 - 27 mai Calvin meurt à Genève. Il dispose alors d'une puissance spirituelle rare. Modeste sous des dehors autoritaires, il ne veut, jusqu'au bout, connaître d'autre gloire que celle de ce Dieu à qui il n'a cessé de rapporter l'ensemble de son oeuvre. Il a été le principal promoteur du protestantisme en France (né à Noyon en 1509). Les protestants sont aussi appelés calvinistes, du nom de cet apôtre.
► 1564 - 20 juin Déclaration de Lyon interdisant aux protestants l'exercice de leur culte dans les lieux où se trouve le roi.
► 1564 - 24 août Édit de Roussillon instituant le début de l'année au 1er janvier. Édit de Roussillon est un édit de 1564 qui fait débuter l'année en France le 1er janvier. Lors d'un voyage dans différentes parties de son royaume, le roi de France Charles IX constata que selon les diocèses, l'année débutait soit à Noël (à Lyon par exemple), soit le 25 mars (à Vienne par exemple), soit le 1er mars ou encore à Pâques. Afin d'uniformiser l'année dans tout le royaume, il ajouta un article à un édit donné à Paris en début janvier 1563 qu'il promulgua à Roussillon le 9 août 1564. Les 42 articles qui composaient cet édit concernaient la justice exceptés les 4 derniers, ajoutés lors du séjour du roi à Roussillon. L'article 39 annonce que l'année commencerait désormais le 1er janvier.
► 1564 à 1642 - naissance et mort de Galilée. Physicien et astronome italien, né d'un fils de musicien, à Pise en 1564. Il y étudia la médecine et les mathématiques, puis devint professeur de mathématique à l'université de Pise puis de Padoue en 1592. Son apport à la physique fut majeur et à biens des égards, il peut être considéré comme le père de la physique moderne. Ses grandes découvertes seront fondamentales pour la compréhension de la gravitation. Elles se répartissent en deux champs: - L'observation du ciel avec la première lunette astronomique de l'histoire lui fait découvrir les richesses insoupçonnées du monde "céleste", et lui donne l'intuition de la profonde unité du monde terrestre et céleste.
L'étude du mouvement des corps à l'aide d'expériences avec des plans inclinés lui fait découvrir la notion de Force et surtout lui permet la première formulation du principe d'inertie. Ces deux contributions révolutionneront totalement la physique et l'astronomie, elle feront basculer la vision du monde Aristotélicienne et imposeront finalement le système Copernicien. Il défend les idées de Copernic et de l'héliocentrisme (c'est le soleil qui est au centre de l'univers, et non la terre), ce qui lui vaut d'être attaqué par l'Église. Son 'Dialogue concernant les deux principaux systèmes du monde', ceux de Ptolémée et de Copernic, le fait condamner pour hérésie par l'Inquisition. Il passera alors neuf ans en résidence surveillée, jusqu'à sa mort. Galilée apparaît comme le fondateur de la physique moderne puisque pour lui les lois physiques doivent être établies sur des expériences. Il inventa notamment la lunette astronomique et le thermomètre...
► 1564 à 1616 - naissance et mort de William Shakespeare. Poète et dramaturge anglais. Fils d'un gantier devenu bailli de Stratford, Shakespeare put étudier, mais des revers de fortune familiaux et un jeune mariage semble l'avoir conduit à arrêter. On le suppose établi à Londres dès 1588, mais sa réputation dramaturgique naît en 1592. Son premier mécène est le comte de Southampton à qui il dédie des poèmes, genre dans lequel il excelle au vu de ses 'Sonnets' (1609). Il joue ses pièces à la cour d'Élisabeth Ière d'Angleterre, puis de Jacques Ier d'Angleterre, ensuite il devient successivement actionnaire du théâtre du Globe et du Blackfriars (1608).
En 1612, il rentre à Stratford. Auteur d'une oeuvre unique et intemporelle, il s'attacha à décrire les jeux du pouvoir et les passions humaines, mêlant joie et douleur, emprisonnant la vie dans ses vers. Les premières oeuvres furent marquées par leur caractère historique ('Richard III'). A partir de 1594, il développa ses comédies ('Beaucoup de bruit pour rien') et délivre sa première tragédie majeure, 'Roméo et Juliette', qu'il fera suivre d''Hamlet', d''Othello' et du 'Roi Lear'. Sa dernière pièce, 'La tempête', est une oeuvre remarquable, baignée d'ésotérisme.
►1564 à 1638 - naissance et mort de Pieter Bruegel le Jeune. Peintre flamand. Né à Bruxelles, mort à Anvers, était un peintre flamand de la Renaissance, fils de Pieter Bruegel l'Ancien et frère de Jan Bruegel. Il était surnommé "Bruegel d'Enfer" à cause d'un de ses thèmes favoris (thèmes d'incendie). Il se forme à Anvers ou il est reçu franc-maître en 1585. Il se retrouve vite à la tête d'un atelier très productif et a de nombreux élèves (dont son fils Pieter III). Il est imitateur de l'oeuvre de son père, dont il réalise nombre de copie pour répondre à la demande des collectionneurs (pas moins de 13 dénombrements répertoriés). C'est d'ailleurs à travers les excellentes copies du fils que l'on connaît certains originaux disparus du père. Il conserva tout sa vie le style du réalisme flamand.
► 1564 Commencement de la construction du palais des Tuileries. Le palais des Tuileries est un palais dont la construction commença en 1564 sous l'impulsion de Catherine de Médicis, à l'emplacement occupé auparavant par des fabriques de tuiles. Ses plans furent sans doute confiés à Philibert Delorme, toutefois Catherine de Médicis laissa la construction inachevée. Philibert Delorme (1515-1570) architecte, il éleva les Tuileries et le Château d'Anet, qui est son oeuvre la plus remarquable. Le palais des Tuileries fut incendié pendant la Commune les 23 et 24 mai 1871. Après maintes tergiversations, le Parlement décida de démolir les ruines, qui furent rasées en 1880; ne subsistèrent que deux pavillons, les pavillons de Flore (côté Seine) et de Marsan (côté rue de Rivoli), ainsi que deux ailes jusqu'aux guichets du Louvre.
► 1564 mort de Michel-Ange.
► 1565 Pierre de Ronsard écrit 'Abrégé de l'Art Poétique français’
► 1566 - 7 janvier L'inquisiteur Ghisleri est élu pape sous le nom de Pie V. Pie V, Michele Ghislieri, né à Bosco Marengo (Lombardie) le 17 janvier 1504, mort le 1er mai 1572 à Rome, 223ème pape, de 1566 à 1572, sous le nom de Pie V.
► 1566 Grande ordonnance de Moulins par Michel de L'Hospital, qui réorganise l'administration. Grande Ordonnance de Moulins, visant à réformer la justice et à étendre les pouvoirs du roi.
► 1566 - 6 septembre Décès de Soliman le Magnifique à 72 ans. Sûleyman ou Soliman dit "le Magnifique" meurt à Szigetvar, à 72 ans pendant une campagne militaire en Hongrie. Il était monté sur le trône ottoman à 26 ans, déjà à la tête d'un vaste empire. Il a entrepris pourtant une grande politique de conquêtes. En 1521, le jeune sultan prend Belgrade, puis Rhodes. En 1529, il attaque l'Autriche et assiège Vienne, sans succès.
Il se retourne alors contre la Perse. En 1562, la puissance navale ottomane devient très importante. Les corsaires, dont Khayr Al-Din dit Barberousse, occupent Tunis, Djerba, Nice et Aden. C'est sous Soliman, protecteur des arts et des lettres, que l'empire ottoman a connu la période la plus riche de son histoire. A la fin de son règne, ses fils entrèrent en conflit pour prendre sa succession. Il en fit exécuter deux et désigna le troisième comme héritier.
► 1566 Jean Bodin écrit 'Méthode pour la facile connaissance de l'histoire'. Jean Bodin (né en 1529 à Angers, dans le Maine-et-Loire - mort en 1596, à Laon, dans l'Aisne) était un économiste, un juriste, un philosophe et un théoricien politique français, qui influença l'histoire intellectuelle de l'Europe par la formulation de ses théories économiques et de ses principes du "bon gouvernement". Il est considéré comme l'initiateur du concept moderne de souveraineté. En outre, il se fit l'avocat de la tolérance religieuse dans une époque particulièrement intolérante.
► 1567 - 10 septembre Condé et Gaspard de Coligny attaquent Paris.
► 1567 - 2 septembre Retour du roi à Paris.
► 1567 à 1568 - Deuxième guerre de religion. - Les protestants, alarmés de projets que la cour laisse deviner contre eux, tentent d'enlever à Meaux, le jeune roi Charles IX (qui a été déclaré majeur en 1563) dans le but de s'en faire un otage. De nouveau, les hostilités éclatent. Les catholiques sont commandés par le connétable de Montmorency, Anne de Montmorency; il livre bataille aux protestants à Saint-Denis (1587) et est victorieux, mais il y périt assassiné. La paix est signée une fois de plus par Catherine de Médicis, à Longjumeau (1568). Deuxième guerre de religion, après avoir connu la paix pendant quatre ans, le royaume est de nouveau la proie des armes. La reprise des hostilités en 1567 s'explique pour trois raisons : l'échec de l'Édit d'Amboise dans les provinces, le contexte international tendu et la rivalité de cour entre le prince de Condé (Louis Ier de Bourbon-Condé) et le jeune frère du roi, Henri duc d'Anjou (futur Henri III de France), à peine âgé de seize ans.
L'ascension du jeune prince a rendu jaloux, l'ambitieux Condé qui a quitté la cour pour manifester son mécontentement. À l'extérieur du pays, la situation est plus grave. En 1566, une violente vague iconoclaste a deferlé sur les églises et les couvents de Flandre. Cette ample émeute populaire connue sous le nom de révolte des gueux a été très rapidement maîtrisé par les espagnols qui gouvernent les Pays-Bas, mais la noblesse du pays en a profité pour réclamer au roi d'Espagne davantage de liberté. Bien que le calme soit revenu en 1567 et que la situation ait été rétablie à la normale, le roi d'Espagne Philippe II a expedié une armée pour punir ses sujets rebelles. L'armée espagnole envoyée depuis le Milanais se dirige vers les Pays-Bas en longeant la frontière française.
La proximité de cette armée catholique ravive les craintes des protestants français, mais aussi celle du roi de France qui pour se protéger d'une éventuelle attaque espagnole fait lever plusieurs bataillons suisses. La deuxième guerre éclate précisément le 28 septembre 1567 lorsque le prince de Condé (Louis Ier de Bourbon-Condé) tente de s'emparer de la famille royale (Surprise de Meaux). Cette cassure dans la politique de concorde est une surprise et l'attaque du prince de Condé (Louis Ier de Bourbon-Condé), en qui Catherine de Médicis avait placé ses espoirs de conciliation, est une trahison. C'est à la suite de cet événement que la régente du royaume se résout à faire usage de la violence pour le maintien de la paix. Deux armées s'affrontent à nouveau et les calvinistes connaissent une nouvelle défaite cuisante le 10 novembre 1567.
L'affaiblissement de leurs troupes conduit à la signature d'une nouvelle paix à Longjumeau le 22 mars 1568. Anne de Montmorency est né à Chantilly le 15 mars 1492 et meurt à Paris, le 12 novembre 1567. Sa participation à plusieurs batailles dont celles de Ravenne (1512), Marignan (1515); Mézières (1521) lui valut le titre de maréchal de France. La surprise de Meaux (1567-1568). Sentant monter les périls, Condé décida de monter une action préventive malgrè les réserves de Coligny. Prenant prétexte que le roi de France était menacé par les Italiens qui envisageaient de le capturer, il fit investir, le 28 septembre 1567 le château de Montceaux en Brie, près de Meaux pour s'emparer de la personne du roi. Celui-ci et sa mère ne parvinrent à échapper aux protestants que d'extrême justesse et purent s'enfuir à Meaux puis gagner Paris.
► 1567 - 30 septembre Émeutes protestantes à Nîmes.
► 1567 - 7 octobre Rencontre à Saint-Denis entre le roi et les chefs protes-tants.
► 1567 - 10 novembre Les troupes royales chassent les troupes protestantes de Saint-Denis. Bataille de Saint-Denis, le 10 novembre 1567 eu lieu la bataille de Saint-Denis entre catholiques et protestants. Ces derniers furent vaincus mais eurent le temps de dépouiller les châsses de leurs joyaux et profanèrent les sépultures ; le connétable Anne de Montmorency y trouva la mort.
► 1567 à 1643 - naissance et mort de Claudio Monteverdi. Compositeur italien, figure la plus importante de la transition de la Renaissance au baroque, dont l'oeuvre influença l'évolution de l'histoire de l'opéra. Monteverdi se situe à la croisée de deux siècles, de deux mondes musicaux, dont il hérita une écriture polyphonique et contrapuntique complexe qui annonçait l'harmonie tonale et la monodie accompagnée.
► 1567 Philibert Delorme écrit 'Premier tome de l'Architecture'.
► 1568 Aux Pays-Bas, amorce de la guerre de Quatre-Vingts Ans : exécu-tion par le duc d'Albe des comtes de Hoorne et d'Egmond, alliés de Guillaume le Taciturne, pour leur trop grande tolérance. 1er juin : Louis de Nassau délivre des lettres de marque à des équipages pour leur permettre d'attaquer légalement les vaisseaux espagnols. La guerre de Quatre-Vingts Ans, aussi appelée révolte des Pays-Bas, fut le soulèvement armé mené de 1568 à 1648 - sauf pendant une trève de 12 ans de 1609 à 1621 - contre la monarchie espagnole par les provinces s'étendant aujourd'hui sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le nord de la France.
Au terme de ce soulèvement, les sept provinces septentrionales gagnèrent leur indépendance sous le nom de Provinces-Unies, indépendance actée en 1581 par l'Acte de La Haye et reconnue par l'Espagne par un traité signé en 1648 en marge des traités de Westphalie. Durant le règne de Charles Quint, les Pays-Bas espagnols virent disparaître quelques-unes de leurs libertés économiques. Avec l'apparition et l'essor du protestantisme dans les Provinces, celles-ci souffrirent de l'Inquisition. La violence et les abus des pouvoirs espagnols créa des tensions non seulement avec les protestants persécutés mais aussi avec les catholiques. À noter également, la présence de nombreuses armées espagnoles dans la région, suite aux conflits opposant leur roi à la France, entre autres ennemis.
► 1568 - 9 janvier Soulèvement protestant contre les Catholiques à La Rochelle.
► 1568 - 11 février La Rochelle ouvre ses portes aux Protestants.
► 1568 - 23 mars Paix de Longjumeau mettant fin à la deuxième guerre de religion en confirmant l'édit d'Amboise. Cette paix est signée après la victoire que le duc de Guise a remporté à Calais sur les Anglais, pendant le règne de Charles IX.
► 1568 - 24 mai Catherine de Médicis limoge Michel de l'Hospital.
► 1568 - 23 août Les protestants reprennent les armes, début de la troisiè-me guerre de religion.
► 1568 à 1570 - Troisième guerre de religion. - Elle est déchaînée par la disgrâce du chancelier Michel de l'Hospital qui s'opposait à l'application, par la cour, d'un régime de rigueur aux protestants. Cette guerre, bien plus acharnée que les deux précédentes, a pour principaux épisodes: la défaite des protestants à Jarnac (1569) et en même temps l'assassinat de leur chef, le prince de Condé, Louis Ier de Bourbon, par un officier catholique, Montesquiou ; l'adoption des protestants, pour leur chef, à La Rochelle, de Henri de Béarn (le futur Henri IV, fils d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, et de Jeanne d'Albret) ; un succès des protestants commandés par Gaspard de Coligny, à la Roche-Abeille ; enfin une nouvelle défaite des protestants à Moncontour.
Elle se termine par la paix de Saint-Germain (1570), par laquelle la couronne reconnaît aux protestants, comme places de sûreté, les quatre villes de La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité ; les protestants sont admis aux fonctions publiques et Catherine de Médicis donne en mariage sa fille Marguerite de Valois (la reine Margot) à Henri de Béarn (futur Henri IV). Troisième guerre de Religion, la paix de Longumeau est fragile car le pouvoir royal ne fait plus confiance au prince de Condé.
Quelques mois après le début de cette nouvelle trêve, ce sont les catholiques qui vont anticiper sur une nouvelle surprise en tentant de capturer le prince de Condé (Louis Ier de Bourbon-Condé), au château de Noyers, le 29 juillet 1568. Les armées protestantes sont de nouveau mises à mal et subissent de lourdes pertes à la bataille de Jarnac, le 15 mars 1569. Le prince de Condé est exécuté et un autre dirigeant émerge dans l'organisation calviniste, l'amiral de Coligny. Celui-ci reprend les lambeaux de l'armée, descend dans le sud à la rencontre de nouvelles troupes et remonte sur Paris. Les troupes de Coligny menaçant la ville mènent à la signature d'une nouvelle trêve, l'édit de Saint-Germain, le 8 août 1570. Ce traité garantit 4 places de sûreté aux protestants.
► 1568 - 27 septembre Suppression des libertés du Traité de Longjumeau. C'est le 23 mars que le traité de Longjumeau a été signé. Les libertés qu'il garantissait aux huguenots sont remises en cause par Catherine de Médicis en ce jour.
► 1568 Palladio construit la villa Rotonda. Andrea Palladio, né à Padoue le 8 novembre 1508, mort à Vicence en 1580, est un architecte de la Renaissance italienne. Son père l'inscrit, à l'âge de 13 ans, pour six ans dans l'atelier de l'architecte et sculpteur Bartolomeo Cavazza da Sossano à Padoue. En avril 1523 Palladio s'enfuit à Vicence, mais est contraint de revenir pour rupture de contrat. Un an plus tard il s'inscrit à la corporation des sculpteurs de Vicence. Lors de plusieurs séjours à Rome, il étudie les édifices antiques et les écrits de Vitruve. Ces études de l'antiquité ont eu une influence déterminante sur ses propres édifices. Son art a eu un impact considérable.
Sous le nom de Palladianisme il contribua à l'élaboration du Néoclassicisme. Le palladianisme est un style architectural qui s'inspire des oeuvres et du style de l'architecte italien Andrea Palladio. Le palladianisme naît au XVIIIe siècle en Angleterre sous l'impulsion de l'architecte Christopher Wren. Il succède au baroque et s'inscrit dans le renouveau des formes de l'Antiquité dans les constructions appelé néoclassicisme. Le palladianisme privilégie les formes géométriques et cherchent à créer une harmonie des volumes tout en utilisant le vocabulaire antique et plus spécifiquement romain : construction de portiques, emploi de la coupole, galerie de colonnes. On a souvent critiqué sa froideur et son manque de fantaisie. D'autres y ont vu un style international et rationaliste. Il s'applique en particulier aux villas rurales des pays anglo-saxons.
► 1568 Jean Bodin énonce la théorie quantitative de la monnaie. Il est, de ce fait, considéré comme un précurseur du mercantilisme. Le mercantilisme est une conception de l'économie qui prévaut entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIIe siècle en Europe. Les penseurs mercantilistes prônent le développement économique par l'enrichissement des nations grâce au commerce extérieur qui permet de dégager un excédent de la balance commerciale. L'État a un rôle primordial dans le développement de la richesse nationale, en adoptant des politiques protectionnistes établissant notamment des barrières tarifaires et encourageant les exportations.
La doctrine mercantiliste est l'une des toutes premières écoles de pensée en économie. Elle marque la fin de la prééminence de l'idéologie économique de l'Église (la chrématistique), inspirée d'Aristote et Platon et condamnant l'accumulation des richesses et le prêt. Le mercantilisme apparaît à une époque où les rois souhaitent obtenir un maximum d'or. Les théories mercantilistes sous-tendent cet objectif et développent une problématique basée sur l'enrichissement. Ce courant se fonde sur un système d'analyse des flux économiques très simplifiée où par exemple le rôle du système social n'est pas pris en compte.
► 1569 - 13 mars Défaite protestante à Jarnac où le prince de Condé, Louis Ier de Bourbon est exécuté. Catholiques et protestants s'affrontent. A la tête des premiers, le duc d'Anjou, futur Henri III. En face de lui, Louis Ier de Condé, premier prince du nom. Les protestants sont défaits. Contre toutes les lois de l'honneur et de la chevalerie, le prince de Condé, blessé et prisonnier, est achevé d'un coup de pistolet tiré par le baron de Montesquiou, capitaine des gardes du duc d'Anjou. Bataille de Jarnac entre l'armée royale et les Huguenots français conduit par Condé qui est assassiné à la fin de la bataille, sans doute à l'instigation du duc d'Anjou. Son cadavre est promené à dos d'ânesse par les royaux et exposé sur une table pendant deux jours au château de Jarnac.
► 1569 - 3 septembre Le Parlement condamne à mort Gaspard de Coligny.
► 1569 - 3 octobre Défaite protestante à Montcontour. Le duc d'Anjou (futur Henri III de France), qui a déjà battu les protestants à Jarnac le 13 mars, remporte à Montcontour une nouvelle victoire. L'amiral de Coligny, à la tête des huguenots, redoutant que les mercenaires qui n'ont pas été payés se révoltent ou désertent, engage le combat. Parce que ses lansquenets allemands tardent, parce que, lorsqu'il est blessé, sa cavalerie prend la fuite, et qu'au centre du champ de bataille son infanterie est prise en tenaille par les Suisses de l'armée royale qui la massacre, la défaite est sans appel.
Agé de dix-huit ans, celui qui sera bientôt le roi Henri III déclare au soir de la bataille à l'attention de Coligny : “Qu'il se souvienne qu'il est périlleux de heurter contre la fureur française !”. Bataille de Moncontour, en 1569 durant les guerres de religion, dans la plaine de Moncontour, les troupes huguenotes de Gaspard de Coligny affrontent l'armée royale du duc d'Anjou. L'amiral de Coligny, venant du sud, avait mis le siège devant Poitiers. Près de prendre la ville, il doit lever le siège devant l'avance de l'armée royale, qu'il rencontre au nord-ouest de Poitiers. Son armée est battue, et les catholiques triomphent.
► 1569 Le géographe flamand Gerardus Mercator produit la première carte avec la projection qui porte son nom; il publie aussi la première section de son Atlas. Gerardus Mercator (souvent traduit en français par Gérard Mercator), est un mathématicien et géographe flamand (Rupelmonde, 1512 - 1594). Mercator, de son vrai nom Gérard de Cremere (ou Kremer), est à l'origine de la première projection du globe pour les navigateurs qui révolutionna la cartographie. Mathématicien et géographe, Mercator commence ses études à l'Université de Louvain en 1530 sous la direction de l'astronome Frisius qui l'initie à la construction et représentation du globe. En 1538, il fait paraître sa première carte du monde après celle de la Terre Sainte, sortie l'année précédente.
À partir de 1552, il travaille à l'élaboration d'une projection de la Terre qui le conduit à publier en 1569, les 18 feuilles de "La projection de Mercator" qui fournit enfin aux navigateurs une réelle description des contours des terres. L'originalité de Mercator repose sur la projection de la surface terrestre sur un cylindre tangent à l'équateur ce qui présente l'avantage de ne pas déformer les angles. On parle aussi de représentation cylindrique tangente, où les méridiens sont espacés régulièrement tandis que la distance entre les parallèles augmente avec la latitude. Ce qui exagère beaucoup les surfaces au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur. À la fin du XVIe siècle, la géographie du monde est enfin exprimée dans sa forme et ses proportions véritables. Avec l'imprimerie, l'europe devient un centre d'information et de diffusion de cartes géographiques fiables, utilisant des critères rationnels.
► 1569 mort Pieter Bruegel l'ancien.
51 - De 1570 à 1590 (invention du microscope)
► 1570 - 27 juin Bataille d'Arnay-le-Duc. Henri de Navarre, futur Henri IV, alors âgé de seize ans, remporta sa première victoire sur les catholiques du maréchal de Cossé-Brissac. Alors qu'il n'était encore qu'Henri de Navarre, un jeune homme de 17 ans affrontait pour la première fois la mitraille au pied d'Arnay-le-Duc. C'était en 1570 et "le bon roi Henri" ne devait jamais oublier son baptême du feu en terre bourguignonne.
► 1570 - 8 août Paix de Saint-Germain mettant fin à la troisième guerre de religion et accordant des places fortes aux protestants. Cette “paix” est un édit royal de Charles IX, qui ramène la paix civile. Pour la première fois, il autorise sans restriction le culte réformé en France. Cognac, La Rochelle, Montauban, et La Charité-sur-Loire sont consenties comme places de sûreté aux huguenots.
Paix de Saint-Germain-en-Laye, après une troisième guerre entre catholiques et protestants de 1568 à 1570, qui voit la défaite des protestants à Jarnac, l'assassinat de leur chef, le prince de Condé (Louis Ier de Bourbon-Condé), en 1569 et la nomination d'Henri de Bourbon (futur Henri IV) comme chef des protestants, la Paix de Saint-Germain, signée entre le roi Charles IX et l'amiral Gaspard de Coligny, octroie aux protestants quatre places fortes que sont La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité. De plus, les protestants sont admis aux fonctions publiques et Catherine de Médicis, mère de Charles IX, donne en mariage sa fille Marguerite de Valois (la Reine Margot) à Henri de Navarre (futur roi de France Henri IV). Elle fut signée le 5 août 1570 au château royal de Saint-Germain-en-Laye. Cette paix sera de courte durée puisque deux ans plus tard a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy qui y met un terme.
► 1570 - 27 novembre Charles IX épouse Élisabeth d'Autriche. Élisabeth d'Autriche (1554, Vienne - 1592, Vienne) est la fille de l'empereur Maximilien II et de Marie d'Autriche.
► 1570 Création de l'Académie et Compagnie de Poésie et de musique par Jean Antoine de Baïf et Thibaud de Courville. Jean Antoine de Baïf, né à Venise en 1532 et décédé à Paris en 1589, était un poète français. Membre de la Pléiade, tente d'acclimater en France le vers de la poésie antique et de réformer l'orthographe.
► 1570 Publication de l'Atlas d'Ortelius ('Theatrum Orbid Terrarum'), premier atlas moderne. Abraham Ortelius (° 1528 - † 1598). Cartographe des Pays-Bas (Dix-sept Provinces). Ortelius est avec Gerardus Mercator le grand fondateur de la cartographie flamande. Après avoir étudié le grec, le latin et les mathématiques, il s'établit à Anvers, le grand port des Dix-Sept Provinces, en tant que libraire et cartographe. Il voyagea beaucoup et publia en 1564 une carte du Monde en 8 feuilles, qui connut un grand succès. Sa façon de travailler était sensiblement différente de son rival et ami Mercator : Ortelius rassemblait des cartes issues de contacts professionnels ou amicaux parmi les cartographes européens. Vingt-cinq ans avant l'Atlas de Mercator, il fit graver par Hogenberg sa collection de cartes à une même échelle (1570), qui fut publiée sous le titre de 'Theatrum Orbis Terrarum', qui constitue en fait le premier "atlas".
Au cours des dix premières années suivant la parution, il connut quatre réimpressions. Au total, le Theatrum a été publié en sept langues au cours de trente-six éditions. Ortelius fut également le premier à citer ses sources par carte, mentionnant les noms des cartographes à l'origine des informations cartographiées. Ortelius publia également plusieurs cartes historiques, dont certaines firent également partie du Theatrum. Entre 1579 et 1606 fut publié son Parergon Theatri, contenant notamment une reproduction de la Table de Peutinger. En 1570 Ortelius obtint le monopole pour les "atlas", ce qui empêcha notamment Gerard de Jode (qui avait publié la carte du monde de 1564) de publier son propre atlas avant 1578.
► 1570 Le Titien peint 'Le supplice de Marsyas’
► 1571 - 2-15 février Massacre de protestants à Orange.
► 1571 - 7 octobre Victoire de la Ligue à Lépante contre les Turcs. Bataille de Lépante, le 7 octobre 1571, une grande bataille navale se déroule près de Lépante, à proximité du golfe de Patras en Grèce. Elle fut l'occasion de l'affrontement des forces navales ottomanes et des flottes combinées du Pape, de l'Espagne et de Venise avec des contributions mineures de Gênes, d'autres États italiens, les États de Savoie y envoyèrent les trois galère de Nice, et les chevaliers de Malte sous le nom de Sainte Ligue.
La flotte européenne était dirigée efficacement par Don Juan d'Autriche, fils naturel de Charles Quint. Ali Pacha, aidé des corsaires Scirrocco et Euldj Ali (qui dirige l'aile gauche), commandait les Ottomans. L'Infant Don Juan d'Autriche, (né en 1545 à Ratisbonne, Allemagne - mort le 1er octobre 1578 à Namur, Belgique), fut un prince espagnol de la famille des Habsbourg – fils illégitime de Charles Quint – qui fit une carrière militaire dans les armées de son demi-frère Philippe II et fut gouverneur des Pays-Bas de 1576 à 1578.
► 1572 - 11 avril Signature d'un contrat prévoyant le mariage de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois (la reine Margot). Pour tenter une réconciliation entre protestants et catholiques, Jeanne d'Albret et Catherine de Médicis décident de marier leurs enfants, Henri de Navarre et Marguerite de Valois (Reine Margot). Reine Margot, Marguerite de France, couramment appelée Marguerite de Valois ou la Reine Margot, née le 14 mai 1553, morte le 27 mai 1615, était une princesse française de la branche dite de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne. Par son mariage avec le roi Henri de Navarre (futur roi de France Henri IV), elle devint reine de Navarre puis reine de France.
► 1572 - 19 avril Alliance franco-anglaise contre l'Espagne.
► 1572 - 4 juin Mort de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, son fils Henri (futur Henri IV) lui succède.
► 1572 - 10 août Massacre de protestants à Troyes.
►1572 - 18 août Mariage de Henri de Navarre (futur Henri IV) avec Marguerite de Valois (la reine Margot), soeur du Roi, à Notre-Dame. Dans l'espoir de réconcilier les catholiques et les protestants, le huguenot Henri de Navarre (futur Henri IV) épouse la soeur du roi, fille d'henri II et de Catherine de Médicis, qui sera connue sous le nom de la reine Margot. Loin d'apaiser les esprits, cette union envenime le climat et déclenche la Saint-Barthélemy.
► 1572 - 22 août La régente et Henri Ier de Guise obtiennent l'assentiment de Charles IX au projet qu'ils ont formé de profiter de cette circonstance pour faire tuer l'amiral de Gaspard de Coligny et les principaux chefs protestants. (Le massacre a sans doute outrepassé les projets de Catherine de Médicis). Henri de Navarre (futur Henri IV) et le jeune prince de Condé, Henri Ier de Bourbon, ne sauvent leur vie qu'en abjurant le protestantisme.
Henri est retenu presque captif par la Cour. Henri Ier de Guise, dit le Balafré (né le 31 décembre 1550 - mort le 23 décembre 1588 au château de Blois), prince de Joinville, puis duc de Guise (1563) et Pair de France, comte d'Eu et pair de France Grand Maître de France. Henri de Guise était le fils aîné de François de Guise, deuxième duc de Guise, assassiné en 1563 par un gentilhomme protestant. Il fut placé sous le tutelle de son oncle Charles de Guise, cardinal de Lorraine. Henri Ier de Bourbon, deuxième prince de Condé (La Ferté-sous-Jouarre, 1552 - Saint-Jean-d'Angély, 1588), fut un des chefs protestants pendant les guerres de religion, aux côtés d'Henri de Navarre, futur Henri IV.
► 1572 - 24 août Massacre de la Saint-Barthélemy, en faisant aux protestants de larges concessions, Catherine de Médicis n'a eu pour but que de les amadouer. Le mariage de sa fille (Marguerite de France ou Marguerite de Valois, surnommée la Reine Margot) avec Henri de Navarre (Henri de Béarn, devenu roi de Navarre en juin par suite de la mort de Jeanne d'Albret, et futur Henri IV) a attiré à Paris la fleur de la noblesse protestante. Les catholiques profiteront du rassemblement des protestants pour les noces à Paris, pour ordonner le massacre de la Saint-Barthélemy.
Le massacre de la Saint-Barthélemy est une suite de massacres des protestants (huguenots) par les catholiques. Charles IX ordonne après avoir été convaincu par sa mère, Catherine de Médicis, qu'un complot huguenot le menace : “Tuez-les tous ! Mais tuez-les tous, pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher”. La liste de ceux qui doivent mourir est dressée. Henri de Navarre (futur Henri IV), qui vient quelques jours plus tôt, le 18 août, d'épouser Marguerite de Valois (la Reine Margot), doit être, comme Condé, épargné. Ils peuvent revenir au catholicisme. Les portes de Paris sont fermées. Des bateaux enchaînés barrent la Seine.
Aux premières heures du 24 août, les cloches de Saint-Germain-l'auxerrois sonnent. C'est le signal. La tuerie commence. Il y a au soir dans les rues de Paris 3 000 morts peut-être, peut-être 7 000… Dans les jours qui suivent, 10 000 huguenots encore sont tués en province. La tuerie commença le 24 août 1572 à Paris, puis elle s'étendit dans toute la France dans les mois suivants. Il s'agit d'un évènement dramatique qui fut dans le déroulement des guerres de religion d'une importance capitale. Le massacre de la Saint-Barthélemy se place à la suite d'une série d'évènements dont il est la conséquence: la paix de Saint-Germain qui met fin à la troisième guerre de religion, le 8 août 1570 ; le mariage de de Henri de Navarre (futur roi de France Henri IV), et de Marguerite de Valois (la Reine Margot), le 18 août 1572 ; l'assassinat raté de l'amiral de Coligny, le 22 août 1572.
► 1572 Quatrième guerre de religion (1572–1573). Quatrième guerre de religion, cette quatrième guerre s'ouvre par l'affreux massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. L'échec du siège de la Rochelle, par l'armée royale met un terme très rapide à cette guerre.
► 1572 - 28 août Déclaration royale interdisant l'exercice du culte réformé dans tout le royaume.
► 1572 - 30 août Fin des massacres de la Saint-Barthélemy.
► 1572 - 3 octobre Massacre des protestants à Toulouse.
► 1572 François de Belleforest écrit 'Histoire universelle du monde'. François de Belleforest (1530-1583), auteur majeur de la littérature française de la fin du XVIe siècle. Il est connu par la variété de ses domaines d'intérêts : cosmographie, classicisme. Il traduit en français les pensées de Cicéron et Démosthène.
► 1572 à 1631 - naissance et mort de John Donne. Poète anglais. Poète et prédicateur anglais du règne de Jacques Ier d'Angleterre, considéré comme le chef de file de la poésie métaphysique, a produit une oeuvre, variée comprenant des sonnets, des poèmes religieux, des traductions du latin, des épigrammes, des élégies, des chansons et des sermons. Les poètes métaphysiques sont un groupe assez hétérogène de poètes lyriques britanniques de la première moitié du XVIIe siècle, qui partageaient le même intérêt pour les grandes questions métaphysiques et avaient la même manière de les traiter. Leurs poèmes rigoureux et énergiques font davantage appel à l'intellect du lecteur plutôt qu'à ses émotions, rejettant ainsi l'intuition ou le mysticisme au profit d'un discours rationalisé.
► 1573 Les Espagnols rapportent du Pérou un légume nouveau, la tomate.
► 1573 Février-juillet : siège de La Rochelle par les catholiques, sans suc-cès. Le siège de La Rochelle, ordonné par Charles IX et commandé par le duc d'Anjou, (le futur Henri III) commence le 11 février 1573 et se termine par la suspension des armes le 26 juin 1573. Le Massacre de la Saint-Barthélemy a porté un coup fatal au protestantisme. C'est pour profiter du désarroi qui règne chez les protestants, que le roi et la reine-mère Catherine de Médicis entendent soumettre définitivement les protestants à leur autorité. Leur cible est La Rochelle, ville de tête du protestantisme français, dont la chute entraînerait automatiquement celle des autres villes protestantes. Le roi espère y parvenir par des négociations, mais les protestants ayant refusés de se soumettre, le siège fut décidé.
► 1573 - 11 mai Élection de Henri d'Anjou (futur Henri III), frère du roi (Charles IX) au trône de Pologne.
► 1573 - 6 juillet Levé du siège de La Rochelle.
► 1573 - 11 juillet : Paix de Boulogne où sont remises en vigueur les clauses d'Amboise. Les protestants obtiennent La Rochelle, Montauban et Nîmes, perdent Cognac et La Charité.
► 1573 à 1610 - naissance et mort de Le Caravage. Peintre italien. La vie de Michelangelo Merisi, dit il Caravaggio, reste obscure. On ignore, par exemple, s'il est né à Caravaggio (Lombardie) ou à Milan, car bien qu'il ait passé son enfance dans la première de ces villes, son père (contremaître aisé) travaillait dans la seconde à l'époque où il est né, le 29 septembre 1571. Entré en 1584 à l'atelier Pertanzano, le jeune peintre part à Rome et reçoit plusieurs commandes, pour décorer notamment l'Église Saint-Louis des Français (chapelle Cantarelli) par un ensemble de tableaux illustrant la vie de Saint Matthieu.
En 1607, accusé d'avoir tué un certain Tomasi au cours d'une rixe, il est condamné à mort et doit fuir Rome. Il part pour Malte, où il est fait chevalier de grâce de l'ordre de Malte. Mais sa réputation le rattrape, il est emprisonné et radié de l'ordre, et il fuit en Sicile. Dès lors, il cherche à obtenir la grâce papale. Il meurt sur une plage italienne. Il a fallu attendre les travaux de Roberto Longhi à la fin du XIXe pour redécouvrir en lui un des grands réformateurs de la peinture. Initiateur du clair-obscur, il donna son nom à un mouvement, le caravagisme, qui s'étendit à l'ensemble de l'Europe, particulièrement en Espagne et dans les Pays-Bas.
► 1573 Ambroise Paré écrit 'Traité des monstres et des prodiges’
► 1573 Jean Antoine de Baïf écrit 'Oeuvres en rimes’
►1573 Philippe Desportes ecrit 'Premières oeuvres'. Philippe Desportes (1546 - 1606) est un poète français né à Chartres. L'abbé, Philippe Desportes, poète renommé et très bien en cours sous les règnes de Charles IX et Henri III, fut pourvu de bonne heure de bénéfices écclésiastiques importants. Il était abbé de l'abbaye bénédictine de Bonport en Normandie, de Tiron, de Josaphat, des Vaux de Cernay et d'Aurillac, chanoine de la cathédrale de Chartres et de la Sainte Chappelle. Il fut remarqué pour ses sonnets, ses élégies, ses chansons. Henri III en fit son poète officiel, en le préférant à Ronsard. Il fut surtout remarquable, par la clarté de sa langue.
► 1574 - 20 février Sacre de Henri III au trône de Pologne.
► 1574 - 10 avril Arrestation de la Molle (Joseph de Boniface). Joseph de Boniface, sr de La Molle, et Annibal, comte de Coconnat, gentilshommes de François duc d'Alençon, avaient été en mars et avril 1574, les principaux artisans d'une conspiration visant à faire évader leurs maîtres, le roi de Navarre (futur Henri IV) et le prince de Condé (Henri Ier de Bourbon-Condé), retenus à la cour depuis la Saint-Barthélémy. Arrêtés, ils furent condamnés à mort et décapités le 30 avril 1574.
► 1574 - 30 avril Exécution de La Molle.
► 1574 30 mai Mort de Charles IX, son frère Henri lui succède. Il a vingt-quatre ans et meurt d'une broncho-pneumonie tuberculeuse au château de Vincennes, après s'être livré à des excès de toutes sortes qui ont précipité sa fin. Il avait ordonné la Saint-Barthélemy et s'en souvient au moment de mourir, lorsqu'il dit à sa vieille nourrice huguenote : “Ah ! ma nourrice ! Que de sang ! Que de meurtres ! Ah ! que j'ai suivi un mauvais conseil !” Henri III lui succède.
► 1574 Mort de Charles IX. - Le règne de ce souverain est un des plus tristes que la France ait subis: les guerres civiles l'ont presque entièrement occupé. On y relève cependant quelques actes intéressants pour l'avenir du royaume: création du corps des gardes françaises (1563), réforme de l'administration de la justice (1584-1566); l'assemblée des notables à Moulins déclare le domaine royal inaliénable (1586).
C'est sous ce règne que les architectes Philibert Delorme et Jean Bullan commencent les Tuileries. - Avènement de Henri III (troisième fils de Henri II, né en 1519). Il était déjà élu roi de Pologne depuis l'année précédente. En apprenant que la mort de son frère le fait héritier de la couronne de France, il quitte clandestinement la Pologne et vient prendre possession du trône: durant le court interrègne, sa mère Catherine de Médicis gouverne. Henri III n'apporte aucune des qualités d'un souverain; par contre, il est débauché et cruel.
► 1574 HENRI III (1574-1589)
► 1574 Henri III. Troisième fils de Henri II et de Catherine de Médicis, il fut d'abord duc d'Anjou et participa aux batailles de Jarnac et de Moncontour. Il fut "élu" roi de Pologne en 1573. Lorsque son frère meurt en 1574, il devient roi de France. Alors que dans sa jeunesse il eut de nombreuses conquêtes, en septembre 1574, il apprend le décès de Marie de Clèves qu'il aimait profondément. A partir de ce jour il se détourna des femmes et vira à l'homosexualité. Il se maria cependant avec Louise de Vaudémont-Lorraine en février 1575 le lendemain de son sacre.
La guerre entre catholiques et protestants reprend dés le début de son règne. Les catholiques sont vainqueurs à Dormans en octobre 1575, mais le roi par la paix de Beaulieu en mai 1576 accorde des avantages aux protestants ce qui entraîne la formation d'une ligue des catholiques menée par les Guises. Le roi en prend la tête pour mieux la contrôler mais les états généraux de Blois l'oblige à reprendre la lutte c'est la sixième guerre de religions en 1577 les catholiques sont vainqueurs à la Charité sur Loire et à Issoire la paix de Bergerac limite le culte des protestants, la ligue est dissoute. Mais les protestants reprennent les hostilités en 1580 dans le Languedoc où Henri de Navarre (futur Henri IV) prend Cahors, la paix de Fleix confirme la paix de Bergerac.
En 1584 le plus jeune fils de Henri II, François meurt, ce qui fait que, comme Henri III n'a pas d'enfant, l'héritier de la couronne devient Henri de Navarre. Ceci est insupportable pour les catholiques en général et les Guises en particulier. Les catholiques font une nouvelle ligue, s'allient au roi d'Espagne et forcent Henri III à annuler toutes les concessions faites aux protestants. C'est la guerre des trois Henri, Henri III, Henri Ier de Guise et Henri de Navarre (futur Henri IV). Elle tourne à la confusion, Henri de Navarre bat les catholiques à Coutras en 1587, Henri Ier de Guise bat les renforts allemands des protestants et fait une entrée triomphale à Paris.
Une émeute oblige le roi à quitter Paris. Les états généraux réunis à Blois sont dominés par les Guises mais Henri III les fait assassiner (décembre 1588). Les ligueurs maîtres de Paris prononcent la déchéance du roi. Henri III s'allie alors à Henri de Navarre et assiège Paris en juillet 1589. Quelques jours plus tard le moine fanatique Jacques Clément assassine le Roi. C'est le dernier roi de la dynastie capétienne Valois. Sur le plan intérieur il installe dans tout le royaume des bureaux des finances, réorganise le conseil royal et promulgue la grande ordonnance de Blois en 1579 (363 articles). Il lance le projet de construction du Pont Neuf sur la Seine.
► 1574 - 18 juin Henri III s'enfuit de Pologne.
► 1574 Cinquième guerre de religion (1574–1576). Cinquième guerre de religion, ouverte par l'évasion des leaders protestants (Condé et Henri de Navarre) de la Cour où ils étaient en résidence surveillée depuis la Saint-Barthélemy, cette cinquième guerre s'achève par l'édit de Beaulieu, qui accorde une plus grande liberté de culte aux protestants.
► 1574 Théodore de Bèze écrit 'Du droit des magistrats'.
► 1574 François Hotman écrit 'Franco Gallia' (traduction française). François Hotman, né en 1524 (Paris), mort en 1590 (Bâle, Suisse) à l'âge de 66 ans. Sa première oeuvre a été publiée en 1574 (il avait 50 ans). Il a été et s'est occupé de : justice, professeur de droit civil et de droit Romain, conseiller d'État, agent politique à Heidelberg, historiographe du Roi. François Hotman, l'un des plus savants jurisconsultes du XVIe siècle, fut attiré à la religion réformée par la vue de l'héroïque fermeté des luthériens qui subirent à Paris le supplice du feu.
Il entra de bonne heure en relation intime avec les chefs du parti protestant, et adopta leurs principes politiques, mélange des vieilles traditions d'indépendance de l'aristocratie française avec l'esprit démocratique de la Bible et l'esprit républicain de la Grèce et de Rome. Hotman se passionna pour ces doctrines comme pour la foi nouvelle, et répudia les théories de droit public que les hommes de sa profession puisaient dans l'étude journalière des lois romaines impériales.
► 1574 André Thevet écrit 'La cosmographie universelle'.
► 1574 Amadis Jamyn écrit 'oeuvres poétiques'. Amadis Jamyn (1540-1585), ami de Ronsard et traducteur d'Homère, fut un spécialiste des poèmes d'amours.
► 1574 Pierre de Ronsard écrit 'Les Sonnets à Hélène’
► 1574 Blaise de Montluc écrit 'Commentaires'. Blaise de Montluc, Blaise de Lasseran de Massencome, seigneur de Montluc, dit Blaise de Montluc, né à Saint-Puy, près de Condom, vers 1500 et décédé à Estillac, près d'Agen, le 26 juillet 1577 est une figure française de l'époque des guerres de religion, à la fois homme de guerre et homme de lettres. Maréchal de France et gouverneur de la Guyenne, il exécutera pour le compte du roi une féroce répression des huguenots.
► 1574 à 1637 - naissance et mort de Robert Fludd. Éminent rosicrucien, physicien paracelsien, astrologue, et mystique anglais. Il est considéré comme un des plus grands hommes de la Renaissance. C'était un vrai humaniste : ses connaissances portaient sur l'ensemble des sciences humaines. Ses écrits volumineux furent consacrés à défendre la réfome des sciences. En tant que médecin et alchimiste, il s'intéresse aux idées de Paracelse. En matière de médecine, Fludd est reconnu comme un précurseur. On lui doit la description du premier baromètre et des découvertes sur la circulation du sang, formulées plus tard avec plus d'exactitude par son confrère William Harvey.
Ces livres sont de véritables chefs-d'oeuvre, magnifiquement ornés de gravures qui en résument le propos. Fludd était avant tout spiritualiste, établissant une distinction entre la partie physique mortelle et la partie animique immortelle de l'homme. Pour lui, l'âme est liée à Dieu, tandis que le corps physique est une partie de la nature. L'esprit de la vie, la force essentielle de la vie ou force vitale, éthérée et reliée à l'âme, constitue à la fois la conscience et l'esprit animal en nous. Cette force vitale est la cause de toutes les fonctions vitales.
Fludd pratiquait la guérison à distance avec l'aide d'un système décrit auparavant par Paracelse et que Fludd nomme dans ses traités l'onguent de sympathie. Cette méthode était utilisée par divers médecins rosicruciens de l'époque, notamment Jan Baptist van Helmont et Kenelm Digby. Dans ses livres, Robert Fludd s'attache aussi à présenter l'harmonie entre le macrocosme (le monde) et le microcosme (l'homme). Poursuivant une connaissance universelle, il s'intéresse aux correspondances harmoniques qui existent entre les planètes, les anges, les parties du corps humain, la musique.
► 1575 - 13 février Sacre de Henri III à Reims. Henri III succède à son frère Charles IX, mort sans descendance mâle. Le sacre a lieu la veille de son mariage avec Louise de Lorraine.
► 1575 - 15 février : Mariage, dans la cathédrale de Reims du roi de France Henri III avec Louise de Vaudémont, princesse lorraine. Louise de Lorraine-Vaudémont (née le 30 avril 1553 au château de Nomeny - décédée à Moulins le 29 janvier 1601), est issue de la branche de Vaudémont, branche cadette de la prolifique maison de Lorraine et est cousine des Guise. Elle fut reine de France de 1575 à 1589, à la suite de son mariage avec Henri III de France.
► 1575 - 15 septembre Le duc d'Alençon, François de France, s'enfuit du Louvre. En 1575, François continue d'être à la cour le chef du parti d'opposition. Il subit les brimades et les moqueries dont il fait l'objet de la part des mignons de son frère. Catherine de Médicis tente de calmer le jeu mais en vain car un soir de bal, François se fait directement insulter et prend la résolution de s'enfuir. Il s'échappe à travers un trou creusé dans les remparts de Paris. Sa fuite crée la stupeur. Les mécontents de la politique royale et les protestants s'unissent derrière lui. En septembre, il est rejoint par le roi de Navarre qui est parvenu lui aussi à s'enfuir. La guerre qui s'ouvre est prometteuse pour François.
Henri III doit baisser les armes. François reçoit l'Anjou en apanage et une indemnité extraodinaire. Il se réconcilie avec le roi et reprend triomphalement sa place à la cour. Mignon est le nom donné au XVIe siècle aux favoris des rois de France. C'est un terme dont le sens est devenu péjoratif et rabaissant. Au XIXe et XXe siècle, il désigne plus particulièrement les favoris d'Henri III (1551-1589). Henri III écarte des affaires de l'État les nobles des grandes familles qui n'ont cessé, depuis le début des guerres de religion, de se quereller pour le pouvoir. Il va au contraire promouvoir à la cour des hommes de petite noblesse, à qui il va donner de très hautes responsabilités. Il entend s'appuyer sur ces hommes neufs pour gouverner.
Sa cour voit donc apparaître un cercle très restreint de favoris qui connaissent, grâce à leur protecteur, une fortune fulgurante. On va les appeler ironiquement "les mignons". François de France (1555-1584), duc d'Alençon et d'Anjou, est un fils de Henri II et de Catherine de Médicis. Presque nain à la naissance, il fut pourtant baptisé Hercule. On le débarassa ensuite de ce prénom. On lui donna celui de son frère ainé le roi François II. Il joua un rôle considérable, au début du règne de son frère Henri III, provoquant des troubles à la cour et dans le royaume. François est un prince revêche, taciturne et ambitieux. Il est le dernier de la famille royale et souffre des grands égards qu'on porte à son frère ainé, le duc d'Anjou (le futur Henri III). François jalouse à l'extrême ce frère, à l'ombre duquel il a grandi. Sa mort le 10 juin 1584 à Château-Thierry de la tuberculose permet à Henri de Navarre (futur Henri IV) de devenir roi de France à la mort d'Henri III.
► 1575 - 10 octobre Victoire du duc de Henri Ier de Guise à Dormans sur les Impériaux. La bataille de Dormans eut lieu autour du village de Dormans, dans la Marne, plus précisément entre Tréloup et Verneuil, le 10 octobre 1575, au cours de la cinquième guerre de religion en France. Elle oppose les troupes de la première Ligue pour le compte d'Henri III commandées par le 3ème duc de Guise (Henri Ier de Guise), à un corps de reîtres allemands recrutés par les protestants notamment anglais et les Malcontents (de François de France, duc d'Alençon) dirigés par Thoré, le frère cadet du maréchal de Montmorency (François de Montmorency) et de Henri comte de Damille (Henri Ier de Montmorency).
De Guise mit en déroute les protestants, capturant Philippe de Mornay parmi d'autres. Henri de Guise y reçut le surnom de "Balafré", comme son père, suite à une blessure par un coup d'arquebuse qu'il reçut à la joue droite. Les conséquences de cette victoire furent réduites à néant avec l'attaque du fils du comte palatin qui vint menacer Paris. Philippe de Mornay, Seigneur du Plessis–Marly, également appelé Philippe Mornay Du Plessis (né le 5 novembre 1549 à Buhy, dans le Val-d'Oise - décédé le 11 novembre 1623 à La Forêt-sur-Sèvre, près de Cerizay, dans les Deux-Sèvres) était un théologien réformé, un écrivain et un homme d'État français, ami d'Henri IV, qui fut l'un des hommes les plus éminents du parti protestant à la fin du XVIe siècle.
► 1575 - 21 novembre Trêve de Champigny entre Catherine de Médicis et François d'Alençon dit François de France.
► 1576 - 25 février Henri de Navarre s'enfuit du Louvre. Le futur Henri IV s'évade et abjure le catholicisme qui lui a été imposé à la Saint-Barthélemy.
► 1576 - 7 mai Paix de Monsieur à Beaulieu accordant des facilités de cultes et 8 places fortes aux protestants. C'est la fin de la cinquième guerre de religion. Henri III se voit contraint d'accorder aux protestants de larges concessions par l'édit de Beaulieu. Parmi celles-ci, outre des places de sûreté et des Chambres mi-parties dans les parlements, la liberté de culte. Ces concessions exaspèrent la colère des catholiques qui fondent une ligue catholique. Monsieur, sous l'Ancien Régime, on désignait communément le frère cadet du roi de France sous le nom de Monsieur, avec une majuscule.
L'édit de Beaulieu est une paix signée par Henri III de France durant les guerres de religion françaises. Le 6 mai 1576, mettant fin à la cinquième guerre de religion, l'édit accorde aux protestants une plus grande liberté de culte dans le royaume de France. Inacceptable pour les ultra-catholiques, ceux-ci s'organisèrent en une Ligue pour faire front commun contre Condé et Henri de Navarre. La paix ne dure pas et dans la même année, la Ligue force la reprise des combats dans la sixième guerre de religion.
► 1576 - 13 juin Henri de Navarre (futur Henri IV) abjure le catholicisme et reprend la tête du parti protestant.
► 1576 - 8 juin Création de la Sainte Ligue. La première Ligue se constitue à la suite du refus de voir s'installer en Picardie un gouverneur protestant, le prince de Condé (Henri Ier de Bourbon-Condé). La Sainte Ligue choisit pour chef Henri de Guise, dit le Balafré. Henri III règne sur un royaume que déchirent des fois chrétiennes. La Cour avait dû faire aux protestants, par la paix de Beaulieu, des concessions dont s'indignèrent les catholiques qui se décident à s'unir, en une ligue pour la défense de la religion. La Ligue, née en Picardie, à Péronne, recrute bientôt dans tout le royaume des adhérents. Les Guise, en particulier Henri le Balafré (Henri Ier de Guise), en sont les dirigeants.
Plus tard, il se formera à Paris, dans le sein de la Ligue, un comité, dit des Seize. Ces seize seront les plus ardents ligueurs. En 1576, les États Généraux de Blois provoquent une nouvelle rupture entre catholiques et protestants, et déclarent le roi chef de la Ligue. La Ligue catholique ou Sainte Ligue ou Sainte Union est le nom donné à un regroupement de catholiques, créé en France par Henri de Guise, en 1576. Il est appuyé par le pape Sixte V, les Jésuites, Catherine de Médicis et Philippe II d'Espagne. Ce parti ultra-catholique se forme en réaction à l'Édit de Saint-Germain (1570) et à l'Édit de Beaulieu (6 mai 1576) jugés trop favorables aux protestants ; il a pour but d'extirper définitivement le protestantisme de France. Ligue ou Sainte Ligue. Confédération de catholiques français formée par Henri Ier de Guise pour lutter contre les avantages accordés aux protestants par la "paix de Monsieur" en 1576.
Si la guerre religieuse, inspirée spirituellement par le cardinal de Lorraine (Charles de Guise), réunit les ligueurs, certains poursuivent le but politique de renverser le roi Henri III. Lorsque le protestant Henri IV devient l'héritier du trône, la Ligue entre en guerre contre la famille royale, appuyée par les Espagnols et le pape Grégoire XIII. Malgré les manoeuvres d'Henri III pour se rapprocher des ligueurs, il est chassé de Paris lors de la journée des Barricades (12 mai 1588). Sept mois plus tard, il fait assassiner le duc de Guise, provoquant un soulèvement général. Henri III lui-même est tué, tandis que le duc de Mayenne (Charles de Mayenne), nouveau chef de la Ligue, poursuit le combat contre Henri IV ; le cardinal de Bourbon est proclamé roi sous le nom de Charles X. La guerre de religion entre la Ligue catholique et le roi cesse suite à l'abjuration d'Henri IV (1593) et à son entrée dans Paris soumis (1594).
► 1576 La Ligue ouvre la sixième guerre, qui s'achève par l'édit de Poitiers, qui restreint les conditions du culte protestant.
►1576 - 13 août Le prince de Condé, Henri Ier de Bourbon, nommé gouver-neur de Peronne s'empare de la ville qui lui resistait.
► 1576 novembre Nouvelle réunion des États Généraux à Blois. États géné-raux de 1576-1577, les états généraux se tiennent à Blois : l'édit de pacification accordé par Henri III aux Huguenots fut révoqué, et le roi, après avoir inutilement tenté de s'opposer à la Ligue, s'en déclara lui-même le chef.
►1576 Jean Bodin écrit 'Les Six livres de la République'.
► 1576 Bernard du Haillan écrit 'Histoire de France'. Bernard du Haillan, Bernard de Girard, Sieur du Haillan (1535-1610) Historiographe et Généalogiste. Deuxième fils de Louis, Bernard naît à Bordeaux en 1535, étudie au collège de Guienne sous la direction d'Élie Vinet et en compagnie de son cousin Pierre de Brach. Très bien introduit dans la haute bourgeoisie bordelaise, grâce à ce cousin, Bernard fréquente les meilleurs salons et cercles poétiques où il fait la connaissance de Montaigne et La Boétie. En 1555 il abjure le protestantisme et remarqué par la famille de Noailles apparentée aux de Brach, devient secrétaire de François de Noailles, évêque de Dax, qu'il accompagna à Londres (1556) et à Venise (1557). Il fut, par la suite, secrétaire des finances du duc d'Anjou, François de France, frère du roi, et historiographe de France en 1571.
► 1576 - 27 août Mort de Titien. Au terme d'une longue et riche carrière, le peintre Titien s'éteint à Venise, âgé de près de 90 ans. Certains diront qu'il a été emporté par la peste, et d'autres qu'il est simplement mort de vieillesse. Peintre à la renommée européenne, il a placé ses talents au service des plus grands noms de l'époque. Les maisons d'Este, de Gonzague et de Ferrare, mais aussi Charles Quint, le pape Paul III ou encore Philippe II d'Espagne lui ont passé commande. Des siècles après sa mort, ce formidable portraitiste et artiste de la Haute Renaissance apparaîtra comme le maître du Cinquecento vénitien.
► 1577 - 1er mai Victoire de la Ligue sur les protestants à La Charité, début de la sixième guerre de religion. La Charité-sur-Loire, place protestante, est prise et saccagée par les troupes de Monsieur (François de France, duc d'Alençon et d'Anjou).
► 1577 Sixième guerre. - Elle résulte de l'inobservation de la paix de Beaulieu. Succès des catholiques à La Charité et à Issoire. La guerre se termine par la paix de Bergerac (dite aussi de Poitiers). Sixième guerre de religion, la Ligue ouvre la sixième guerre, qui s'achève par l'édit de Poitiers, qui restreint les conditions du culte protestant.
► 1577 - 12 juin Victoire de la ligue sur les protestants à Issoire.
► 1577 - 17 septembre Paix de Bergerac restreignants les concessions faites aux protestants. Signature de la paix de Bergerac. La liberté de culte est limitée aux faubourgs d'une seule ville par bailliage.
► 1577 à 1640 - naissance et mort de Pierre Paul Rubens, peintre baroque flamand, était l'artiste européen nordique le plus renommé de son jour; il est maintenant largement reconnu en tant qu'un des premiers peintres dans l'histoire de l'art occidental. En accomplissant la fusion de la tradition réaliste de la peinture flamande avec la liberté imaginative et les thèmes classiques de la peinture italienne de la Renaissance, il a fondamentalemt.
Rubens est le plus grand peintre européen de la première moitié du XVIIe siècle. Né en Allemagne, formé en Flandres, puis en Italie, il a travaillé non seulement pour les Pays-Bas du Sud, mais pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Son oeuvre immense n'aurait pu se concevoir sans l'existence d'un vaste atelier, et son talent fut de gérer cet atelier de sorte que chaque tableau pût apparaître comme un chef-d'oeuvre unique.
► 1578 Création par Henri III de l'ordre du Saint-Esprit. L'Ordre du Saint-Esprit fut pendant les deux siècles et demi de son existence, l'Ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie française, et l'un des plus brillants d'Europe. C'est le 31 décembre 1578, en pleine guerre de religions, qu'Henri III fonda l'Ordre du Saint-Esprit, dont le but était de protéger le Roi de France, en tant que personne sacrée. Le monarque choisit le nom de Saint-Esprit pour cet Ordre, en référence à sa propre naissance, à son couronnement sur le trône de Pologne et plus tard sur celui de France, tous trois survenus le jour de la Pentecôte.
► 1578 Henri III interdit les combats en champ clos.
► 1578 à 1657 - naissance mort de William Harvey. Médecin anglais. Il fut le premier à décrire de façon exacte la grande circulation sanguine dans 'Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus' (1628). Il fut également l'un des premiers à mettre en doute la théorie de la génération spontanée dans 'Exercitationes de Generatione Animalium' (1651)
► 1578 Début de la construction du Pont-Neuf. Lettres patentes du roi de France Henri III autorisant la construction du Pont Neuf sur la Seine à Paris. Le roi Henri III pose la première pierre du Pont Neuf à Paris, en présence de la reine-mère Catherine de Médicis. Le Pont Neuf est, malgré son nom, le plus ancien pont de Paris qui traverse la Seine et qui soit toujours intact. Il est classé monument historique. Son nom vient du fait que c'est le premier pont en pierres de Paris (auparavant les ponts étaient construits en bois). C'est un pont en arc construit en pierres.
Sa construction a été décidée en 1577, et le 2 novembre de cette année-là, Henri III désigne une commission chargée d'assurer la bonne construction du pont et le suivi des travaux. La construction est autorisée par lettres patentes du roi le 16 mars 1578. Lettre patente, dans le domaine de la diplomatique, une lettre patente est un document officiel attestant d'un droit, d'un état, ou d'un privilège.
► 1579 Ordonnance de Blois, par laquelle la possession d'un fief ne suffit plus pour créer l'état de noble. A la suite des États Généraux assemblés à Blois en 1576, le roi Henri III allait rendre à Paris, en mai 1579, une ordonnance de 363 articles relative à la police générale du royaume, dite ordonnance de Blois.
► 1579 - 28 février Traité de Nérac entre Catherine de Médicis et Henri de Navarre, moins favorable aux huguenots que la paix de Monsieur. Les protestants obtiennent quinze places de sûreté pour six mois. Six mois plus tard, ils refusent de les rendre. La guerre éclate. Nérac, centre du duché d'Albret, rattaché à la France seulement en 1607, est une des grandes capitales du protestantisme.
Marguerite d'Angoulême devenue reine de Navarre y établit sa cour. Elle y meurt en 1549. Dans le château dont subsiste l'aile Nord, elle accueille Lefèvre d'Étaples qui y meurt en 1536. Elle accorde asile à d'illustres réformateurs qui ne pouvaient plus résider en France sans danger. C'est à Nérac qu'en 1579 Henri III de Navarre, futur Henri IV, signera avec Catherine de Médicis le traité de paix mettant fin à la sixième guerre de religion.
►1579 Septième guerre. - Elle est marquée par les succès de Henri de Navarre (le Béarnais, futur Henri IV), l'un des chefs des protestants: il s'empare de Cahors; mais les catholiques s'emparent de La Fère. La paix est signée cette même année au Fleix. Septième guerre de religion, déclarée par une minorité de protestants, cette guerre fut l'une des plus courtes et des moins suivies. Elle se finit dans l'indifférence avec la prise de Cahors par Henri de Navarre et la paix de Fleix (près de Bergerac) accordant des baux de six ans aux places de sûreté protestantes.
Cette guerre est aussi appelée guerre des Amoureux en raison des intrigues de galanterie qui y donnèrent lieu. En effet, le protestant Henri de Navarre (futur Henri IV) et sa femme Marguerite de Valois (la reine Margot) menèrent joyeuse vie à Nérac au milieu d'une cour composée de jeunes seigneurs frivoles, et que leurs continuelles galanteries avaient fait surnommer les Amoureux.
► 1579 - 29 novembre le prince de Condé, Henri Ier de Bourbon, prend La Fère, début de la septième guerre de religion. La Fère est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Picardie.
► 1580 - 29 mai Victoire de Henri de Navarre à Cahors sur les catholiques.
► 1580 - 19 septembre Les États Généraux des Pays-Bas propose leur trône à François duc d'Anjou et d'Alençon, dit François de France.
► 1580 - 26 novembre Paix de Fleix, négociée par François-Hercule, frère du roi, qui confirme les concessions de Nérac. Les quinze places de sûreté sont conservées pour six ans. L'autorité royale est réduite face aux gouverneurs : Henri de Navarre, roi en Navarre, seigneur en Rouergue et en Quercy, est gouverneur de Guyenne. Condé est gouverneur en Picardie. Les Guise contrôlent la Bretagne (Mercoeur), la Bourgogne (Mayenne), la Champagne (Guise), la Normandie (Elbeuf) et la Picardie, en concurrence avec Condé (Aumale). En Provence, les deux lieutenants du roi animent chacun un parti : le comte de Suze (les razats, huguenots et anti-seigneuriaux) et le comte de Carces (les carsistes, catholiques et seigneuriaux).
En Languedoc, le gouverneur Henri de Montmorency-Damville est catholique politique, allié au protestants et contrôle le Bas-Languedoc. Joyeuse, catholique royal, contrôle le Haut-Languedoc. Luynes, chef des troupes royales, tient Pont-Saint-Esprit, clé du Languedoc. Les protestants ont désigné Châtillon comme chef militaire en Languedoc. La Paix du Fleix, connue aussi sous le nom de convention ou conférence du Fleix, qui fut signée le 26 novembre 1580 a mis fin à la septième guerre de Religion. Le nom lui vient du village du Fleix en Périgord où le traité fut signé dans le château du marquis de Trans Germain Gaston de Foy (cousin du roi de Navarre), en présence notamment du frère du roi de France, François, duc d'Anjou, représentant les intérêts de son frère le roi Henri III, et de Henri roi de Navarre (futur Henri IV) représentant du parti des huguenots.
► 1580 Michel de Montaigne écrit 'Essais' (1580-1595): inauguration d'un nouveau genre littéraire, l'essai. Un essai est une oeuvre débattant d'un sujet donné selon le point de vue de l'auteur. Contrairement à l'étude, l'essai peut être polémique ou partisan. L'auteur d'un essai est appelé essayiste. Mais plus concrétement, un essai est une réflexion sur soi-même ou sur le monde extérieur par lequel vit l'essayiste.
Le genre des essais a été inventé (rendu célèbre) par Michel de Montaigne. Dans "Les Essais", il aborde de nombreux sujets d'étude du point de vue strictement personnel. On a souvent remarqué qu'il accordait une telle importance à cet angle d'approche qu'il y décrit par le détail ses propres sensations, perceptions et, parfois, ses maladies. Mais cette approche lui permet de fonder une réflexion philosophique extrêmement féconde.
► 1581 - 26 juillet Acte de La Haye. L'Acte de la Haye, aussi appelé l'Abjuration de la Haye est un acte rédigé par les États généraux des Pays-Bas le 26 juillet 1581, proclamant formellement l'indépendance des Provinces-Unies. Il suivit l'Union d'Utrecht de 1579. Au cours de la guerre de Quatre-Vingts ans, la Flandre fut presque entièrement reconquise par les espagnols, ainsi qu'une grande partie du Brabant et une petite partie de la Gueldre. Les Provinces-Unies sont le nom que prirent les sept provinces du nord des Dix-sept Provinces ou Pays-Bas espagnols en 1581 jusqu'à la création par les français de la République batave (1795) et du Royaume de Hollande (1806).
Le 2 juillet 1581, par l'Acte de La Haye, ces provinces, alors sous l'autorité du roi d'Espagne, prenaient leur indépendance et constituaient une fédération. Les causes de cette sécession étaient la volonté d'autonomie à l'égard du roi et le problème religieux, les habitants de ces provinces ayant majoritairement choisi la Réforme protestante. Depuis 1586 les États généraux des Pays-Bas ont cessé de chercher un nouveau souverain et l'union confédérale est pratiquement devenue une république.
► 1582 Bulle Inter Gravissimas du pape Grégoire XIII sur la réforme du calendrier Julien. Grégoire XIII, Ugo Boncompagni, né à Bologne le 7 janvier 1502, mort à Rome le 10 avril 1585. Il succède au pape Pie V le 14 mai 1572 sous le nom de Grégoire XIII. Son oeuvre principale est l'institution du calendrier grégorien par la bulle Inter gravissimas, en 1582, fixant le premier jour de l'année au 1er janvier. Le calendrier grégorien (du nom du pape Grégoire XIII qui l'introduisit en 1582) est le calendrier actuellement utilisé en Europe, ses anciennes colonies et dans une bonne partie du reste du monde. La structure du calendrier grégorien est analogue à celle du calendrier julien de la Rome antique.
C'est un calendrier solaire, se basant sur la révolution de la Terre autour du Soleil en 365,2422 jours de 24 heures de 60 minutes de 60 secondes métriques. Le calendrier grégorien donne un temps moyen de l'an de 365,2425 jours ; pour assurer un nombre entier de jours par année, on y ajoute régulièrement un jour bissextile, le 29 février. Le cycle complet du calendrier grégorien dure 400 ans : trois siècles constitués de 24 cycles juliens (trois ans de 365 jours, puis une année de 366 jours) suivis de 4 années de 365 jours, puis un siècle constitué de 25 cycles juliens. Le passage du calendrier julien au calendrier grégorien n'eut pas lieu au même moment partout dans le monde, ce qui n'a pas manqué de causer des confusions.
En 1582, le pape Grégoire XIII décida dans la bulle Inter gravissimas que le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi par le vendredi 15 octobre pour compenser le décalage accumulé au fil des siècles. Imposé par le pape Grégoire XIII dans les États dont il était le souverain, le calendrier grégorien fut aussi immédiatement adopté par l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Pologne. En France, Henri III enlèvera ces jours en décembre. La Grande-Bretagne et les pays protestants n'adoptèrent le calendrier grégorien qu'au XVIIIe siècle, préférant, selon l'astronome Johannes Kepler, "être en désaccord avec le soleil, plutôt qu'en accord avec le pape".
L'adoption du nouveau calendrier en Grande-Bretagne en 1752 fut prétexte à des émeutes car certains prétendaient qu'on devrait payer un loyer mensuel complet avec seulement 21 jours ouvrés réels. Les pays de tradition orthodoxe ne l'adoptèrent qu'au début du XXe siècle. En Russie, il faudra passer la Révolution d'octobre de 1917, qui selon le calendrier grégorien s'est déroulée en novembre, pour que la toute jeune URSS adopte le calendrier grégorien en 1918.
► 1583 Matteo Ricci entre en Chine. Matteo Ricci (Macerata 1552- Pékin 1610), est un prêtre et missionnaire jésuite italien ayant inspiré la réalisation du dictionnaire de sinogrammes 'le Grand Ricci'. Il est ordonné novice jésuite à Rome en 1578 puis prêtre à Cochin (en Inde) en 1580. Il entre en Chine en 1583 et s'installe à Zhaoqing près de Canton et parvient à se mettre en contact avec des mandarins grâce à ses grandes connaissances en mathématiques et en astronomie.
Il reste dix-huit ans dans le sud de la Chine à proximité de Macao et apprend à lire et écrire le chinois. En 1601 il se fait inviter a la cour impériale de Pékin, en tant qu'ambassadeur des Portugais auprès de l'empereur Wanli, porteur d'une épinette, d'une mappemonde et de deux horloges à sonnerie. Premier missionnaire chrétien à entrer en contact aussi proche avec l'empereur depuis les nestoriens, il parvient à fonder l'Église chinoise, mais ses efforts sont partiellement ruinés, plus tard, lors de la querelle des Rites chinois. Il est enterré à proximité de la Cité interdite.
►1583 Joseph Juste Scaliger imaginé une "période julienne" (Ainsi nommée par analogie avec le calendrier julien. Étant protestant, il refuse l'adoption du calendrier grégorien instauré le 24 février de l'année précédente par... un pape : Grégoire XIII). Joseph Juste Scaliger, fils de Jules César Scaliger, est né en 1540 à Agen, et mort en 1609. Il surpassa de loin son père comme philologue, et se fit en outre un nom comme chronologiste et historien.
Il fut quelque temps précepteur dans une famille noble près de Tours, puis parcourut la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Écosse, et embrassa la religion réformée (1562); il fut appelé à l'Académie de Leyde en 1593, comme successeur de Juste-Lipse. On le regarde comme le véritable créateur de la science chronologique. Plein de vanité comme son père, il prétendit, dans une lettre intitulée : De vestutate gentis Scaligerae, faire remonter sa noblesse jusqu'aux rois Alains. Il eut aussi, comme son père, de vives querelles avec plusieurs de ses contemporains, notamment avec Scioppius.
► 1583 Robert Garnier écrit "Les Juives". Dans un contexte de Renaissance tournée vers l'art grec et l'apparition de la langue française, Robert Garnier donne, avec "les Juives", les premières lettres de noblesse à un genre dramatique qui va devenir essentiel en France : la tragédie. Si Garnier a souvent repris les mythes grecs, il s'inspire ici de l'Ancien Testament et retrouve tout le sens religieux et politique du registre tragique. La réalité des guerres de religion transparaît en effet dans une oeuvre qui pose la question des responsabilités face aux massacres religieux. Robert Garnier est un poète et dramaturge français né en 1545 à La Ferté-Bernard (Sarthe) et mort en 1590.
►1584 - 10 juin Mort de François d'Anjou et d'Alençon, dit François de France, quatrième fils de Henri II, frère puîné de Henri III. Il était devenu duc d'Anjou à l'avènement de Henri III; il avait porté jusqu'alors le titre de duc d'Alençon. Henri III n'ayant pas d'héritiers, le droit à la couronne passe à Henri de Navarre (futur Henri IV). Les Ligueurs considérèrent Charles Ier de Bourbon comme l'héritier du trône de France, excluant de la succession tous les protestants. Charles Ier de Bourbon, archevêque de Rouen (1523 † 1590), fils de Charles IV de Bourbon et de Françoise d'Alençon, également cardinal, frère puîné d'Antoine de Bourbon, père d'Henri IV.
Evêque de Nevers à l'âge de 17 ans (1540-1545), il est par la suite archevêque de Rouen de 1550 à 1590, évêque de Nantes de 1550 à 1554 et légat du pape en Avignon de 1565 à 1590. En 1584, à la mort du duc d'Alençon, les Ligueurs le considérèrent comme l'héritier du trône de France, excluant de la succession tous les protestants. Henri III le fit arrêter et, en 1589, lorsque les Ligueurs le proclamèrent roi de France sous le nom de Charles X, il était toujours emprisonné à Fontenay-le-Comte. Il finit par renoncer lui-même à cette royauté, et reconnut la légitimité de son neveu Henri IV. C'est là qu'il mourut l'année suivante.
► 1584 - 31 décembre Traité de Joinville scellant l'alliance des Guises avec Philippe II d'Espagne. Philippe II d'Espagne, (né en 1527 à Valladolid - mort en 1598 au palais de l'Escurial), était un prince espagnol de la maison de Habsbourg. Il était le fils de Charles Quint ((1500-1558), roi de Castille et de Leon (1506-1555) et roi d'Aragon (1516-1556), sous le nom de Charles Ier, et empereur romain germanique (1519-1556), sous le nom de Charles V, et d'Isabelle de Portugal (1503-1539)).
En 1556, après l'abdication de son père et sa retraite au monastère de Yuste, Philippe devint roi d'Espagne (1558-1598), sans compter de nombreux autres titres, tandis que les princes-électeurs du Saint-Empire romain germanique portaient à leur tête le frère cadet de Charles Quint, Ferdinand Ier (1503-1564). En 1580, après la mort du roi de Portugal Henri Ier (1512-1580), dit Henri le Cardinal, Philippe II d'Espagne devint à son tour roi de Portugal (1580-1598) sous le nom de Philippe Ier. Son règne représente le sommet de la puissance de l'Espagne, pour laquelle il est le siècle d'or. Les richesses affluent d'Amérique.
► 1585 - 30 mars Déclaration de Péronne. Elle est faite par le cardinal Charles Ier de Bourbon, oncle d'Henri de Navarre, et constitue un manifeste qui dénie au Béarnais (futur Henri IV) tout espoir de succéder à Henri III. Formation de la Ligue catholique sous le patronage des Guise. La Ligue veut faire adopter la catholicité comme condition de légitimité. Les Guise, d'ascendance carolingienne, voient le moyen d'accéder au trône.
► 1585 à 1598 - Huitième et dernière guerre de religion dite aussi Guerre des Trois Henri (Henri III, Henri de Navarre, Henri Ier de Guise). Cette dernière guerre a été la plus longue des guerres de religion. Commencée sous Henri III, elle se poursuit jusqu'à l'abjuration de Henri IV. En 1585, Henri III a révoqué tous privilèges accordés jusqu'alors aux protestants. Toutefois, il regarde Henri de Navarre comme l'héritier de la couronne et ne se cache pas d'éprouver de la sympathie pour lui. La noblesse catholique est indignée à la pensée que le trône pourrait être occupé par un prince hérétique : elle oppose au Béarnais (futur Henri IV) Henri Ier de Guise et conclut avec le roi d'Espagne, Philippe II, le traité de Joinville par lequel ce souverain s'engage à soutenir Henri Ier de Guise et la Ligue.
Cette époque se marque par une recrudescence du fanatisme catholique contre les protestants. Une nouvelle guerre éclate, au cours de laquelle Henri III, dominé par la Ligue, combattra à son corps défendant son futur successeur. Huitième guerre de religion, l'affrontement entre catholiques et protestants prend une tournure plus importante avec l'alliance des Protestants aux Néerlandais en révolte contre l'Espagne et celle des Catholiques de la Ligue avec Philippe II d'Espagne. Détesté par les Ligueurs, Henri III ne peut maintenir son autorité et est chassé de Paris lors de la "Journée des Barricades" en 1588. Il tente d'éliminer la Ligue en faisant assassiner ses chefs, le duc de Guise (Henri Ier de Guise) et son frère le cardinal de Lorraine (Louis de Lorraine) à Blois en 1588.
Il est assassiné l'année suivante par un moine fanatique, faisant ainsi de Henri de Navarre, chef des Protestants, le roi de France sous le nom d'Henri IV. Henri IV doit lutter pour reconquérir son royaume tenu par la Ligue, qui refuse de reconnaître un roi protestant ; mais le ralliement des personnes fidèles à la dignité royale, et surtout sa conversion au catholicisme en 1593 lui ouvrent les portes de Paris. Henri IV éloigne les ambitions de Philippe II d'Espagne par une guerre entre 1595 et 1598 qui aboutit à la paix de Vervins. Le problème religieux est réglé par l'adoption d'un édit de tolérance, l'Édit de Nantes en 1598.
► 1585 - 10 juin Le duc de Guise, Henri Ier de Guise, et Charles Ier de Bourbon (cardinal de Bourbon) envoient un ultimatum au roi.
► 1585 - 7 juillet Henri III signe la paix de Nemours avec les ligueurs accordant pensions, places fortes et gouvernements.
► 1585 - 18 juillet Henri III interdit le culte réformé. Le roi de France Henri III est contraint de signer avec les Guise la Paix de Nemours, qui annule toutes les mesures de tolérance à l'égard des Protestants, et prend la tête des armées catholiques. Navarre et Condé sont déclarés inapte à la succession.
► 1585 - 9 septembre Le pape Sixte V excommunie Henri de Navarre (futur Henri IV) et le prince de Condé (Henri Ier de Bourbon). Sixte V, Felice Peretti, né à Montalto le 13 décembre 1520, mort à Rome le 27 août 1590, élu pape le 1er mai 1585 sous le nom de Sixte V.
► 1585 - 9 octobre Les Espagnols prennent Cambrai.
► 1585 à 1672: naissance et mort de Heinrich Schütz, compositeur allemand. Il est, avec Claudio Monteverdi, l'un des plus grands musiciens de tous les temps. Né exactement un siècle avant Bach, élève de Gabrieli puis de Monteverdi, il va concilier les éléments du génie allemand et italien dans une synthèse jamais réalisée avant et, en dépit de Bach, que l'on a plus revue depuis.
► 1585 à 1638 - naissance et mort de Cornelius Jansen, Corneelius Jansen, plus connu sous le nom de Jansenius (28 octobre 1585 - 6 mai 1638) était prêtre à Ypres et est le père du Jansénisme. Le jansénisme s'inspire de la pensée de Saint Augustin. Il a été développé par Cornélius Jansen (1585-1638) dit Jansénius, évêque d'Ypres dans l'Augustinus, publié en 1640. Le jansénisme s'inscrit en réaction contre l'humanisme et le molinisme. Le jansénisme se diffusa en France grâce à Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, disciple de Jansénius. Il se développa d'abord au couvent de Port-Royal. Il se répandit ensuite dans d'autres milieux ecclésiastiques et gagna les villes de province.
Le jansénisme revêt une forme doctrinale, celle de Jansénius, et une forme appliquée, celle de Port-Royal, et en cela il fait partie de la Réforme catholique française. L'homme est totalement déchu par suite du péché originel, il tend vers le Mal de façon naturelle. Cette vision de l'homme est proche de celle du calvinisme. Seule la grâce de Dieu peut le pousser vers le Bien et le détourner de la "délectation terrestre". Cette grâce exige de ceux qui la reçoivent, une foi à toute épreuve et un combat quotidien contre le Mal : "à la morale de l'honnête homme, les jansénistes opposent celle de la sainteté" (René Taveneaux). Les jansénistes exigent de leurs pénitents, une contrition parfaite pour leur donner l'absolution. On retrouve ici l'idéal d'intransigeance de Calvin, dans la pratique de la foi.
Néanmoins le jansénisme n'est pas une doctrine statique, il s'est uni à des influences diverses. Il existe, en fait non pas un jansénisme mais des jansénismes. Jansénisme. Mouvement religieux animé par la doctrine de Jansénius, évêque hollandais qui prône au début du XVIIe siècle la conception de la grâce (toute-puissante devant l'incapacité de l'homme à mériter son salut) exposée par saint Augustin. En France, les jansénistes dispensent leur enseignement à l'abbaye de Port-Royal, fréquentée notamment par Pascal et Racine.
Au-delà des querelles dogmatiques, les jansénistes forment un groupe hostile à l'arbitraire royal et à la morale mondaine des jésuites, idées qui séduisent la bourgeoisie parlementaire. Face à ce danger, Louis XIV entreprend de les soumettre par la signature d'un formulaire par lequel ils reconnaissent les condamnations de certaines de leurs propositions par l'Église. Les religieuses de Port-Royal, qui refusent de signer, assistent en 1661 à l'expulsion de leurs novices. Elles finissent par accepter la "paix clémentine" de 1669. De nouvelles agitations politiques mettant en conflit le Saint-Siège et la royauté aboutissent à l'expulsion des religieuses (1709) et à la destruction de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs (1711).
► 1585 mort Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard, poète devenu sourd et “perclus dedans un lit” depuis dix mois, meurt à Saint-Cosme dont il est prieur, tout près du lieu de sa naissance.
► 1586 - 25 octobre Marie Stuart condamnée à mort. Au terme de 18 ans de prison, la reine d'Écosse est reconnue coupable de conspiration contre la reine d'Angleterre, Élisabeth Ière et condamnée à mort. La reine mettra plusieurs mois avant de signer son acte d'exécution qui aura finalement lieu le 8 février 1587. Épouse du roi de France François II, Marie Stuart est rentrée en Écosse à la mort de son mari en 1560. Profondément catholique, elle ne peut accepter que le protestantisme devienne la religion d'état en Écosse. Prétendante au trône d'Angleterre, elle complota un assassinat contre la reine avec son page, Anthony Babington.
► 1586 Le Greco peint 'L'enterrement du conte d'Orgaz’
► 1586 Simon Stevin publie 'Statique et hydrostatique' (De Beghinselen der Weeghconst) dans lequel il expose le théorème du triangle des forces. Simon Stevin (1548/49 à Bruges - 1620) fut un mathématicien hollandais. On connait peu de choses sur sa vie sauf qu'il a laissé une veuve et deux enfants. Il semble qu'il ait commençé sa vie comme commis d'un marchand à Anvers. Il voyagea en Pologne, au Danemark et en d'autres lieux du nord de l'Europe et fut un intime du prince Maurice de Nassau, qui le consulta souvent et en fit un officier public – le premier directeur des affaires hydrauliques – puis un quartier-maître. Stevin fut le premier à montrer comment modeler un polyèdre en définissant ses bords dans un plan.
Il distingua aussi un équilibre stable et instable. Il prouva la loi de l'équilibre sur un plan incliné. Il démontra avant Pierre Varignon la résolution de forces, laquelle, simple conséquence de la loi de cette composition, n'avait pas été remarquée précédemment. Il découvrit le paradoxe hydrostatique : la pression vers le bas d'un liquide est indépendante de la forme du vaisseau, et dépend seulement de son poids à la base. Il donna aussi la mesure de la pression sur n'importe quelle portion d'un côté d'un vaisseau. Il eut l'idée d'expliquer les marées par l'attraction de la lune. En 1506, il démontra que deux objets de poids différents tombaient avec la même vitesse. Stevin semble avoir été le premier qui fit un axiome de la défense des forteresses par l'artillerie. Auparavant elle se basait surtout sur les armes de petit calibre. Il fut l'inventeur de la défense par un système d'écluses, ce qui fut de la plus haute importance pour les Pays-Bas.
► 1587 - 20 octobre L'armée royale (catholique) commandée par le duc de Joyeuse (Anne de Joyeuse) est battue à Coutras par Henri de Navarre. Mais Henri Ier de Guise bat à Montargis et à Anneau des troupes suisses et allemandes qui cherchent à faire leur jonction avec celles du roi de Navarre à l'aide duquel elles sont destinées. Anne de Joyeuse, baron d'Arques, vicomte puis duc de Joyeuse fut l'un des mignons du roi Henri III.
► 1587 Élisabeth Ière d'Angleterre ordonne l'exécution de Marie Stuart pour complot.
► 1587 - 26 octobre : Bataille de Vimory, lors de la huitième guerre de religion, au cours de laquelle Henri de Lorraine duc de Guise (Henri Ier de Guise), dit le Balafré, à la tête des troupes catholiques, vainquit les protestants aidés de mercenaires allemands calvinistes.
► 1587 - 24 novembre : Bataille d'Auneau, pendant la huitième guerre de religion, qui voit la victoire des troupes catholiques, menées par Henri Ier de Guise, dit le Balafré, 3ème duc de Guise, sur les protestants.
► 1588 mars Mort du prince de Condé, Henri Ier de Bourbon.
► 1588 - 8 mai Entrée triomphale du duc de Guise (Henri de Guise) à Paris malgré l'interdiction du roi.
► 1588 - 12 mai Journée des barricades, insurrection des Parisiens. Le duc de Guise (Henri de Guise), chef de la Ligue catholique, est entré dans Paris le 8 mai, malgré l'interdiction du roi. Paris reproche à Henri III d'avoir laissé s'enfuir ceux des protestants qui ont réussi à échapper à Guise, à Vimory et à Auneau à la fin de l'année précédente, comme elle reproche au roi la cherté du pain, comme le clergé raille les prières et les pénitences du roi. Le roi reçoit Henri de Guise avec froideur. Le lendemain, Henri de Guise revient avec 400 amis armés. Pour se protéger, le roi fait appel à 4 000 Suisses et à 2 000 gardes français.
Paris, dont seule la municipalité a le droit de lever des troupes dans la ville, ne tolère pas cet affront et se couvre de barricades. Seul Guise qui répond à ceux qui le saluent d'un “Vive Guise !” par “Criez aussi vive le roi !” parvient à ramener le calme. Il passe pour être le maître de Paris. Le lendemain le roi s'enfuit. Journée des Barricades, le 12 mai 1588 éclate à Paris un soulèvement populaire mené par le "Conseil des Seize" (censé représenter les seize arrondissement du Paris de l'époque) ainsi que par le Duc de Guise (Henri Ier de Guise). Ce soulèvement a pour cause principale l'animosité du peuple à l'égard du roi Henri III, soupçonné de vouloir désigner comme son successeur Henri de Navarre (futur Henri IV), un protestant.
Dès lors, le peuple de Paris se range derrière le duc de Guise (Henri de Guise), chef de la Sainte Ligue. Celui-çi est en effet, malgré l'interdiction royale, revenu à Paris. Dès lors, méfiant, Henri III fait venir dans la capitale plusieurs régiments de garde suisse et de garde française. Le roi ayant violé un privilège qui veut qu'aucune troupe étrangère n'ait le droit de séjourner à Paris, et les Parisiens craignant de voir les chefs catholiques arrétés, les esprits s'échauffent et, le 12 mai, des barricades sont montées au coeur du Quartier Latin (du mot barrique, principal objet utilisé pour les constituer).
La journée se termine par la mort d'une soixantaine de soldats, la victoire du duc de Guise qui prend possession de Paris, et la fuite du roi Henri III au château de Blois. Dès lors en position de force, Henri Ier de Guise en profite pour faire signer l'édit d'union à Henri III (par lequel ce dernier s'engage à ne jamais conclure "aucune paix ou trêve avec les hérétiques") et se faire nommer lieutenant général du royaume. Le roi convoque les États Généraux à Blois.
► 1588 - 13 mai Henri III s'enfuit de Paris.
► 1588 - 21 juillet Édit de l'Union exigeant que le roi soit catholique. Henri III est contraint de signer à Rouen avec la Ligue l'édit d'Union, par lequel il nomme Henri de Lorraine, dit le Balafré (Henri de Guise), lieutenant général des armées du royaume et le cardinal de Bourbon (Charles Ier de Bourbon) l'héritier présomptif du trône sous le nom de Charles X.
► 1588 - 4 août Henri III nomme le duc de Guise (Henri de Guise) lieutenant-général du royaume.
►1588 - 22 décembre Henri III démissionne le duc de Guise (Henri Ier de Guise).
► 1588 - 23 décembre Henri III fait assassiner le duc de Guise (Henri Ier de Guise) et son frère (Louis II de Guise) par le capitaine du Guast. Depuis plusieurs jours, les partisans du duc de Guise redoutent que l'on attente à sa vie. “Il n'oserait” leur répond le balafré (Henri Ier de Guise) âgé de trente-huit ans, certain que le roi Henri III ne fera rien. A 7 heures du matin en ce 23 décembre, le duc se rend au Conseil du roi. Il entre dans la chambre du roi en picorant des raisins de Damas. Des mignons du roi, dont M. de Montsériac, saluent cet homme qui mesure un peu plus de deux mètres, puis le suivent à distance comme par respect. Tout à coup, Montsériac se jette sur lui et lui enfonce son poignard dans la poitrine.
Le duc crie : “Mon Dieu, mes péchés sont en cause, ayez pitié de moi”. Puis le sang sort de sa bouche. Il murmure encore : “Miserere mei, deus”. Il s'écroule sur le sol. Henri III s'avance alors. Il contemple le corps du duc et murmure “Dieu qu'il est grand ! Plus grand encore mort que vivant”. Louis II de Guise, dit le cardinal de Guise (né le 6 juillet 1555 à Dampierre - mort le 24 décembre 1588, au château de Blois), appartenait à la célèbre maison de Guise, branche cadette de la maison de Lorraine, qui joua un rôle de premier plan dans la vie politique française au XVIe siècle. Il était le deuxième fils de François Ier de Lorraine, duc de Guise, et d'Anne d'Este-Ferrare, comtesse de Gisors (1531 - 1607). Il fut archevêque-duc de Reims de 1574 à 1588.
► 1588 L'Angleterre soutient les Pays-Bas contre l'Espagne. L'Espagne arme l'Invincible Armada contre l'Angleterre. La flotte est détruite dans le Pas-de-Calais par la flotte anglaise. Philippe II d'Espagne envoie son "Invincible Armada" pour débarquer l'armée de 19 000 hommes d'Alexandre Farnèse (Pays-Bas), en Angleterre afin de punir la reine Élisabeth Ière d'Angleterre de l'exécution de Marie Stuart sa cousine et de rétablir le catholicisme. La flotte quitte Lisbonne le 18 juin. La mort de son comandant, le marquis de Santa Cruz la laisse aux mains de l'incompétent duc de Medina Sidonia (départ de La Corogne, le 12 juillet).
Elle entre en Manche le 28 juillet et jette l'ancre au large de Dunkerque et de Calais. Tempêtes, harcèlement des marins anglais (Drake, Hawkins, Frobisher, Raleigh) qui refusent l'affrontement direct, en dirigeant sur l'Armada des navires enflammés, retard des renforts d'Alexandre Farnèse, font échouer l'expédition qui ne peut débarquer (30 juillet-7 août). Un fort coup de vent du Sud la force à lever l'ancre le 10 août et à entamer la circumnavigation des Iles Britanniques. La flotte a perdu 11 000 hommes et soixante-trois vaisseaux sur cent trente retourneront à Lisbonne (15 septembre). L'Espagne perd sa suprématie maritime.
► 1588 mort de Véronèse.
► 1589 - 5 janvier Mort de Catherine de Médicis (à Blois). La reine a soixante-dix ans, lorsqu'elle s'éteint tranquillement à Blois. Six mois plus tard, son fils bien-aimé Henri III sera assassiné.
►1589 Henri III a fixé provisoirement sa résidence à Tours. Il s'allie avec Henri de Navarre (futur Henri IV) pour tâcher de recouvrer Paris et le pouvoir effectif ; leurs troupes réunies viennent attaquer la capitale ; à Saint-Cloud, où elles stationnent en vue de cette opération.
► 1589 - 12 février Le duc de Mayenne (Charles de Guise), frère du duc de Guise (Henri de Guise) entre à Paris. Charles de Guise, duc de Mayenne, (né en 1554 à Alençon, Orne - mort en 1611 à Soissons, Aisne) Charles de Guise est le fils de François Ier de Lorraine de Guise et donc le frère d'Henri Ier de Guise. Il fut premier chambellan et gouverneur de Bourgogne. Il prit Brouage lors de la sixième guerre de religion (1577), et enleva La Mure aux protestants du Dauphiné lors de la prise d'armes suivante. Il fut amiral de France jusqu'en 1582, poste qu'il perdit au profit du duc de Joyeuse, l'un des deux "archimignons" d'Henri III de France.
Il devient chef de la Ligue après l'assassinat de son frère Henri de Guise en 1588 ; à la mort de Henri III de France, il fait vainement proclamer roi le cardinal de Bourbon (Charles Ier de Bourbon). Il fut vaincu à Arques (1589) et à Ivry (1590) par Henri IV de France. En 1591, il fit pendre les dirigeants de la Ligue parisienne qui, eux, venaient de faire pendre Barnabé Brisson, premier président du parlement de Paris, scellant ainsi la rupture entre la Ligue nobiliaire et la Ligue urbaine. Il échoua à se faire élire roi par les états généraux qu'il avait convoqué à Paris en 1593. Il fit acte de soumission solennelle à Henri IV de France en novembre 1595, en échange de 3 580 000 livres et de trois places de sûreté en Bourgogne, dont il perdit le gouvernement.
► 1589 - 13 mars Les ligueurs nomme le duc de Mayenne lieutenant-général du royaume.
► 1589 - 30 avril Réconciliation de Henri III et Henri de Navarre (futur Henri IV) a Plessis-lès-Tours.
► 1589 - 3 juillet Henri III et Henri de Navarre prennent Étampes.
► 1589 - 26 juillet Henri III et Henri de Navarre prennent Pontoise.
► 1589 Siège de Paris par Henri III et le futur Henri IV, alors protestant. As-sassinat de Henri III, fin de la dynastie capétienne des Valois.
► 1589 - 1er août Attentat du moine Jacques Clément à Saint-Cloud contre Henri III. Le roi est à Saint-Cloud lorsqu'un moine demande à le voir pour lui communiquer d'importantes informations. Alors qu'il est agenouillé devant le roi, qui le reçoit, le moine Jacques Clément le frappe au bas-ventre d'un coup de couteau. “Ah ! le méchant moine, il m'a tué !”, s'écrie le roi, qui retire le couteau de son ventre et réussit à frapper au front son agresseur. Les mignons du roi se précipitent sur le moine et le lardent de coups de dagues.
Ils jettent le cadavre par la fenêtre. Quelques heures plus tard, malgré des soins que le roi devine vains, Henri III, qui n'a pas eu d'enfants de Louise de Lorraine, désigne son cousin Henri de Navarre (bientôt Henri IV) comme son successeur et exige qu'on le reconnaisse pour tel. Devant l'hésitation de ceux qui l'entourent, le roi se redresse sur son lit et leur dit : “Je vous l'ordonne”. Jacques Clément (1567-1589) est un religieux dominicain qui a assassiné le roi Henri III le 1er août 1589.
► 1589 - 2 août Mort de Henri III, Henri de Navarre lui succède.
► 1589 Par suite de la mort de Henri III, Henri de Navarre devient roi de France sous le nom de Henri IV; mais les catholiques de l'armée de Henri IV refusent de le reconnaître à cause de sa religion et l'abandonnent. Henri IV ne pouvant continuer le siège de Paris porte ses troupes en Normandie et gagne la bataille d'Arqués sur le duc de Mayenne (Charles de Mayenne, Charles de Guise). Les catholiques lui opposent la candidature au trône du Charles Ier de Bourbon (cardinal de Bourbon et oncle d'Henri IV) et de son côté Philippe II aspire à faire passer la couronne de France sur la tête de sa fille Isabelle d'Espagne, qu'il a eue d'Élisabeth de France, fille de Henri II.
► 1589 LES BOURBONS.
► 1589 Maison capétienne de Bourbon. cette branche de la dynastie capétienne est issue de Robert de France, comte de Clermont (et par mariage seigneur de Bourbon), dernier fils de Saint Louis. Elle régna sur plusieurs pays d'Europe (Navarre, France, Espagne, Deux-Siciles, Luxembourg, Andorre, Lucques, Parme...), se scindant en de nombreuses branches. Henri IV le Grand, 1553 - 1610, Roi de France 1589-1610 ; Louis XIII le Juste, 1601 - 1643, Roi de France 1610-1643 ; Louis XIV le Grand, 1638 - 1715, Roi de France 1643-1715 ; Louis de France, 1661 - 1711, Grand Dauphin ; Louis de France, 1682 - 1712, Dauphin ; Louis XV le Bien-Aimé, 1710 - 1774, Roi de France 1715-1774 ; Louis de France, 1729 - 1765, Dauphin ; Louis XVI, 1754 - 1793, Roi de France 1774-1791, roi des Français 1791-1792 ; Louis XVIII, 1755 - 1824, Roi de France 1814-1815 et 1815-1824 ; Charles X, 1757 - 1836, Roi de France 1824-1830.
► 1589 Henri IV (1589-1610)
► 1589 Henri IV. Fils d'Antoine de Bourbon descendant de Saint Louis et de Jeanne d'Albret reine de Navarre, il devient chef du parti calviniste à la mort de Condé (Louis Ier de Bourbon prince de Condé oncle du futur Henri IV) en 1569. Roi de Navarre à la mort de son père en 1572, la même année il est marié à Marguerite de Valois (future reine Margot) soeur du roi Henri III, il échappe au massacre de la Saint Barthélemy. En 1576, il reprend la tête de l'armée protestante. La guerre des religions se poursuit et le 14 septembre 1577 c'est la paix de Bergerac qui est sanctionnée par l'Édit de Poitiers le 17.
Cette paix fait apparaître la montée en puissance du parti des "politiques" qui se veut ni catholique ni protestant. Pendant la visite des provinces françaises (du 2 août 1578 au 18 novembre 1579) de Catherine de Médicis la guerre reprend. Le 10 juin 1584 François d'Anjou (François de France) l'héritier du Trône, quatrième fils de Henri II, meurt de tuberculose. L'héritier maintenant est Henri de Navarre. Henri III envoie des émissaires auprès d'Henri de Navarre pour le persuader d'abjurer. Les Ligueurs et des représentants de Philippe II d'Espagne désigne le cardinal Charles Ier de Bourbon l'oncle de Henri de Navarre successeur d'Henri III.
Sous la pression des ligueurs, Henri III interdit le culte protestant en juillet 1585, cet édit est agravé le 7 octobre puis à nouveau le 26 avril 1586. En juillet 1587 des émeutes ont lieu dans Paris, les émeutes de la faim en juin le setier de blé est passé de 22 à 30 francs, Paris grouille de mendiants. Le 20 octobre 1587 les troupes huguenotes commandées par le Béarnais battent les troupes de la ligue à Coutras, Anne de Joyeuse qui les commandait et son frère sont tués ainsi que 2000 hommes et 400 nobles catholiques. C'est la première grande victoire de Henri de Navarre (Henri IV). Le 9 mai 1588 malgré les ordres du roi, Henri Ier de Guise entre dans la capitale où il est acclamé.
Le roi devant cette popularité n'ose pas le faire arreter. Le 12 mai suite à un malentendu survenu dans un climat de tension savamment entretenu par la ligue, Paris se couvre de barricades, le lendemain Henri III est obligé de quitter Paris, haï qu'il est des Ligueurs et se rapproche de Henri de Navarre. En septembre 1588, Henri III convoque les états généraux à Blois au cours desquels il fait assassiner Henri Ier de Guise et son frère Louis cardinal de Lorraine (Louis de Lorraine). Le 2 Août 1589, Henri III est, à son tour, assassiné par le moine ligueur Jacques Clément.
Henri III avait avant sa mort reconnu Henri de Navarre (Henri IV) comme héritier de la couronne. Mais la Ligue ne pouvait accepter un Huguenot comme roi. Les ligueurs proclament le cardinal Charles Ier de Bourbon roi sous le nom de Charles X, il est alors captif de son neveu (il mourra le 9 mai 1590). Mayenne reprend l'offensive, et va affronter Henri de Navarre qui est retranché dans Dieppe où il attend des renforts anglais. Mayenne est d'abord battu, malgré sa supériorité numérique, à Arques près de Dieppe le 21 septembre 1589 puis à Ivry (Ivry la bataille) le 14 mars 1590. En mai Henri engage le siège de Paris tenu par la ligue commandée par le duc de Nemours, frère de Mayenne (Charles de Mayenne).
Le 6 août la situation des Parisiens est très critique les Ligueurs entament des négociations mais les font traîner en longueur jusqu'à l'arrivée de renforts qui brisent le siège. Le 30 août 1590 le siège est levé, il a fait 45 000 morts dans la capitale soit 20% de la population. Les campagnes aussi sont épuisées des révoltes éclatent un peu partout, l'autorité de la ligue s'effrite. Sur les conseils de son compagnon d'arme Maximilien de Béthune futur Sully, Henry IV s'instruit à la religion catholique et se convertit le 25 juillet 1593 a Saint Denis. Une trêve est signée, les Parisiens marchent en foule à Saint Denis. Le 27 février 1594, Henri IV est sacré à Chartres (Reims est toujours tenu par la ligue) il entre dans Paris en mars 1594.
Il doit cependant continuer la lutte contre la ligue et Philippe II d'Espagne vainqueur en 1595 à Fontaine Française, les combats continueront jusqu'en 1598 dans le nord de la France. A partir de 1598 il se consacre à la reconstruction de la France et à rétablir l'autorité royale. Il est aidé de Sully qu'il nomme surintendant des finances et Grand voyer. Barthélemy de Laffemas est nommé Contrôleur Général du Commerce et des Manufactures, il favorise l'installation de manufactures à Lyon, Tours, Paris en Poitou et en Béarn et exportation de soies, tapisseries, cuirs.
Avec la paix, l'autorité se rétablit, la prospérité économique renaît. Les campagnes qui avaient été ravagées par 36 années de guerre civile retrouve leur dynamisme, les marais de Saintonge sont asséchés. Henri IV crée le collège de La Flèche qu'il confie aux Jésuites, il fait achever le Pont Neuf (premier pont de Paris dépourvu d'échoppes et d'habitations) qu'il inaugure en 1603. Il fait achever la place royale (actuelle place des Vosges) puis la place Dauphine, la pointe de l'ile de la cité. Reprenant un projet de François Ier il fonde l'hôpital Saint-Louis. Il fait réaliser le canal de Briare assurant la jonction entre Seine et Loire.
Après Jacques Cartier qui découvre le Saint-Laurent en 1534, Samuel Champlain prend possession de Terre Neuve en 1603, remonte le Saint-Laurent et fonde la colonie française de Québec en 1608. En 1599 Henri IV fait annuler son mariage avec Marguerite et épouse Marie de Médicis en 1600. Il fera une courte guerre contre le duc de Savoie en 1600 qui agrandira le royaume de la Bresse, du Bugey, du Valromey et du pays de Gex. Il promulgue l'édit de Nantes en 1598 permettant aux protestants la liberté de culte. La France est toujours prise en tenaille par l'empereur germanique également roi d'Espagne et Henri IV se prépare à attaquer l'Allemagne en confiant la régence à la reine Marie de Médicis.
Son ami Sully souffrant, Henri IV se rend à son chevet lorsqu'il se fait assassiner par Ravaillac le 14 mai 1610. Il avait auparavant échappé à de nombreux attentats perpétrés par des ligueurs fanatiques (au moins 7). Henri IV fut amoureux fou de Gabrielle d'Estrées très jolie femme qui pensait surtout aux bénéfices que pouvait tirer sa famille de cette liaison en 1591 et 1592 la conduite du roi fut motivée par cet amour plus que par la raison d'état. Henri IV songeait à l'épouser quand elle mourut brusquement en avril 1599. Elle laissera trois enfants légitimés dont César chef de la maison de Vendôme.
Le titre de roi de France et de Navarre est un double titre royal que portèrent les rois de France et les rois de Navarre pendant deux siècles, à compter d'Henri IV de France (qui était aussi Henri III de Navarre), jusqu'à la prise du titre de roi des Français par Louis XVI de France en 1789. Le titre de roi de France et de Navarre fut repris de 1814 à 1830 par Louis XVIII de France puis Charles X de France, sans que la Navarre retrouve son indépendance, perdue lors de son incorporation dans le département français des Pyrénées-Atlantiques en 1790.
► 1589 - 29 septembre Charles de Mayenne est vaincu lors de la Bataille d'Arques, en Normandie, par Henri IV, qui bénéficie de renforts anglais débarqués à Dieppe. Henri IV, qui, avant de remonter vers Paris, a décidé de s'assurer de la Normandie que la Ligue catholique, contestant sa légitimité, tient, après avoir été refoulé de Rouen, a été accueilli à Dieppe. A quelques lieues de la ville, apprenant l'arrivée du duc de Mayenne à la tête de 35 000 hommes, parce que ses troupes sont moins nombreuses, Henri IV installe un camp retranché à l'entour du château d'Arques. Les troupes du duc s'acharnent en vain pendant deux semaines à prendre la place pour ramener à Paris le Béarnais “bien ligoté”.
Enfin les troupes anglaises qu'attend Henri IV arrivent. Un certain Maximilien de Béthune, bientôt duc de Sully, se distingue par sa vaillance pendant la bataille qui contraint le duc de Mayenne à la retraite. La bataille d'Arques eut lieu du 15 au 29 septembre 1589 entre les troupes royales de Henri IV et les Ligueurs dirigés par Charles de Mayenne. Suite au décès de Henri III, le roi de Navarre protestant Henri de Bourbon est appelé à régner sous le nom d'Henri IV. Il déclare très vite vouloir "maintenir et conserver la religion catholique, apostolique et romaine", cependant les grandes villes françaises se rangent derrière la Ligue et son chef, Charles de Mayenne, frère cadet du défunt duc de Guise.
Charles de Mayenne, dit aussi Charles de Lorraine ou Charles de Guise, était un noble français né le 26 mars 1554 à Alençon et mort le 4 octobre 1611 à Soissons. Il fut duc de Mayenne de 1573 à 1611. Il est celui que l'histoire a retenu sous le nom de Duc de Mayenne ou plus simplement Mayenne, tel qu'Henri IV l'appelait. Il était le fils de François Ier, duc de Guise, et d'Anne d'Este, et donc le frère d'Henri Ier de Guise le Balafré. Il fut premier chambellan et gouverneur de Bourgogne. Sully, de son nom complet Maximilien de Béthune, duc de Sully, Pair de France, Prince Souverain d'Henrichemont, Marquis de Rosny, etc (1560-1641), est un ministre d'Henri IV de France et de Navarre.
► 1589 - 4 août Déclaration de Saint-Cloud: Henri IV promet de maintenir et conserver dans son royaume le catholiscime. Henri IV proclame son intention de conserver la religion catholique en France et se faire instruire dans la religion catholique.
► 1589 - 8 août Henri IV prend Dieppe.
► 1589 - 13 septembre Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier de Savoie, revendique la couronne de France. Charles-Emmanuel Ier de Savoie, né à Rivoli en 1562 d'Emmanuel-Philibert et de Marguerite de Valois (Marguerite de France). Successeur de son père en 1580, 11° duc. Il épouse à Saragosse en 1585 sa cousine Catherine d'Autriche (1567-1597) fille de Philippe II d'Espagne et d'Élisabeth de France (fille d'henri II). Ce prince intelligent, bien éduqué, ami des arts, des lettres et du faste fut en fait un piètre politique qui compromit l'oeuvre de son père et inaugura une période négative de déclin et de catastrophes pour ses États.
► 1590 - 5 janvier Le Parlement de Bordeaux reconnaît Henri IV comme roi de France.
► 1590 - 14 mars Victoire de Henri IV à Ivry contre la ligue. Charles de Mayenne, vaincu, fait sa soumission à Henri IV. La bataille d'Ivry est une bataille ayant eu lieu le 14 mars 1590 dans le cadre des guerres de religion. Elle se déroula dans la plaine Saint-André entre la ville de Nonancourt et la ville d'Ivry désormais nommé Ivry-la-Bataille en l'honneur de ce combat. C'est aussi lors de ce combat que fut prononcé le célèbre "Mes compagnons, Dieu est pour nous ! Voici ses ennemis et les nôtres ! Si vos cornettes vous manquent, ralliez vous à mon panache blanc, vous le trouverez toujours sur le chemin de l'honneur et de la gloire" par Henri IV en référence aux grandes plumes blanches que le roi avait fait poser sur son chapeau pour être plus facilement repérable pendant la bataille.
► 1590 mai Début du siège de Paris.
► 1590 - 8 mai Mort du cardinal de Bourbon (Charles Ier de Bourbon), préten-dant au trône de France.
► 1590 - 30 août Henri IV est contraint par les armées espagnoles de lever le siège de Paris.
► 1590 invention du microscope par Janssen (Hollande). Zacharias Janssen (v.1588- v.1631) est un fabriquant de lentilles hollandais du XVIe siècle. Certains pensent qu'il fut le premier à créer un nouvel appareil optique : le microscope optique, mais ce point reste contesté. Le microscope est un instrument permettant d'avoir une image d'un objet ou d'un phénomène de dimensions trop petites pour être visible à l'oeil nu. Le premier microscope optique fut inventé à la fin du XVIe siècle par le hollandais Zacharias Janssen.