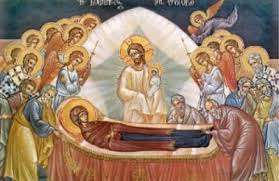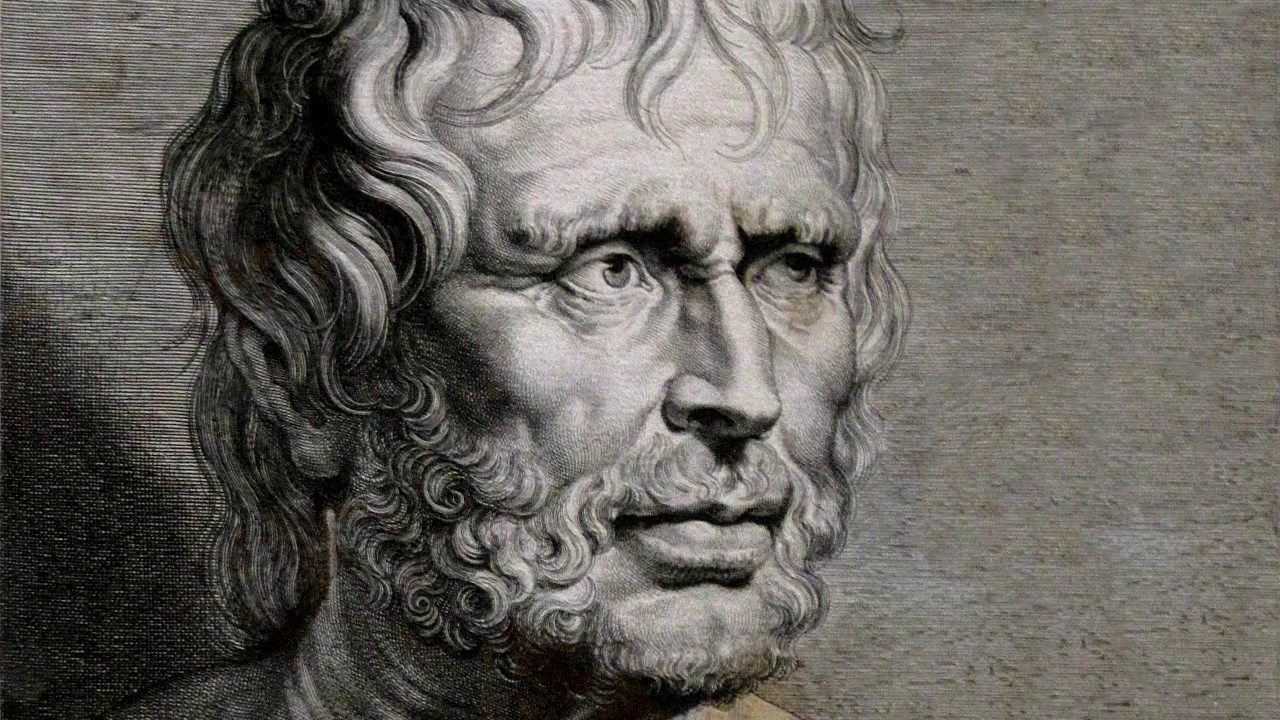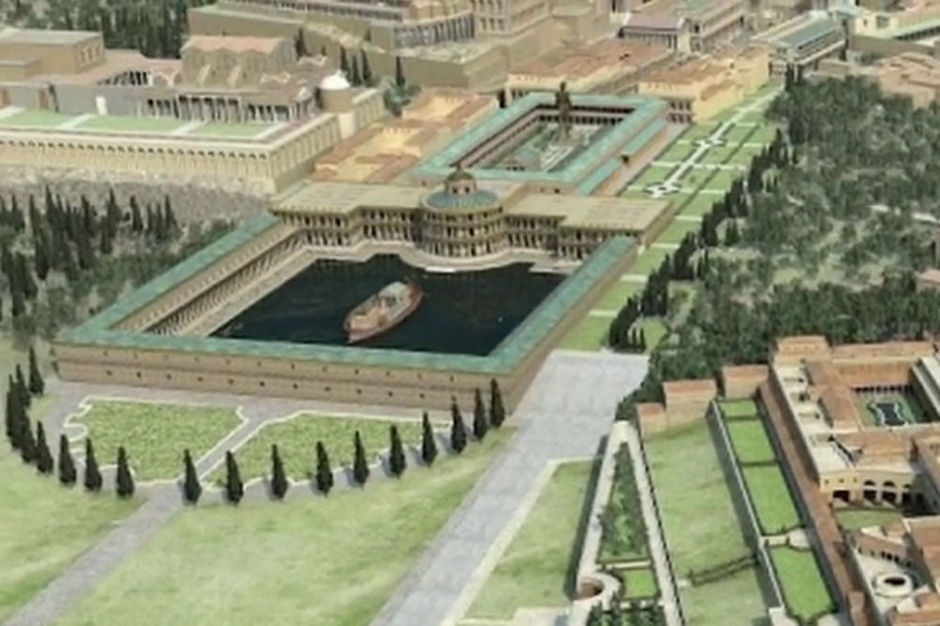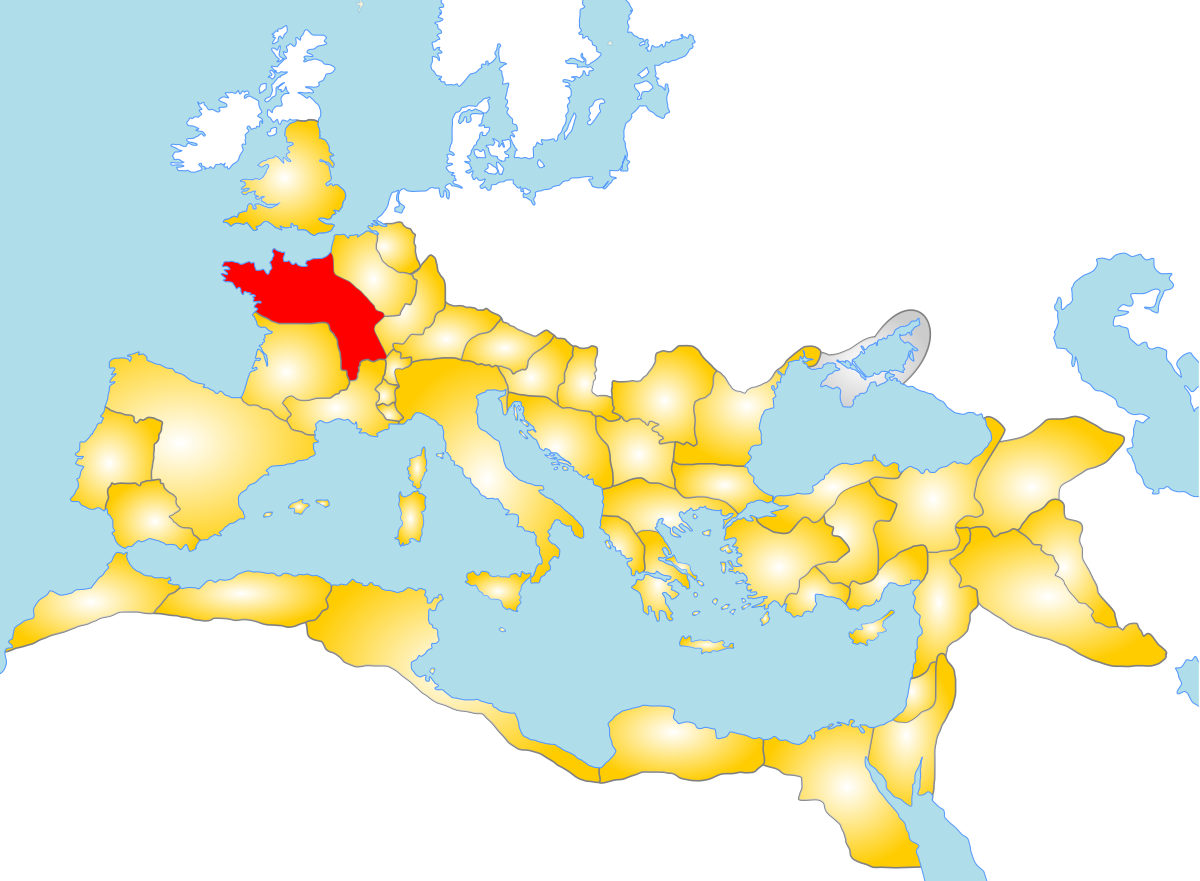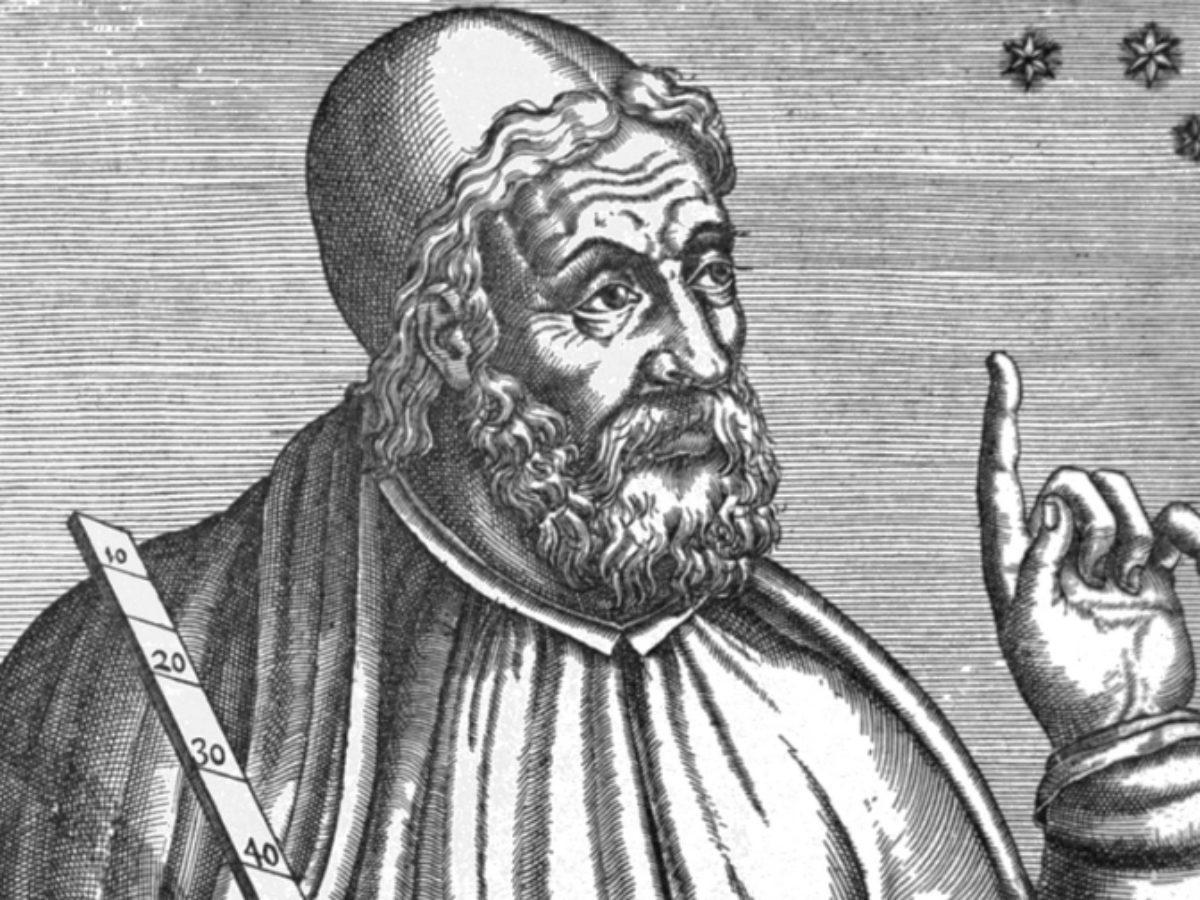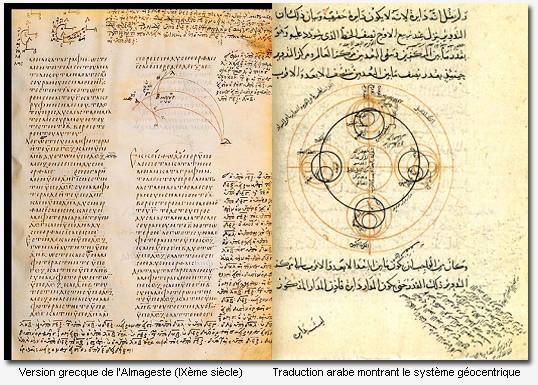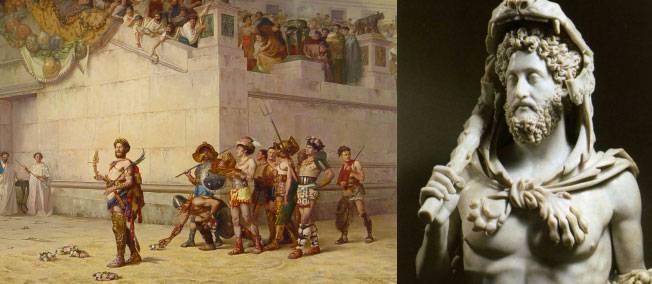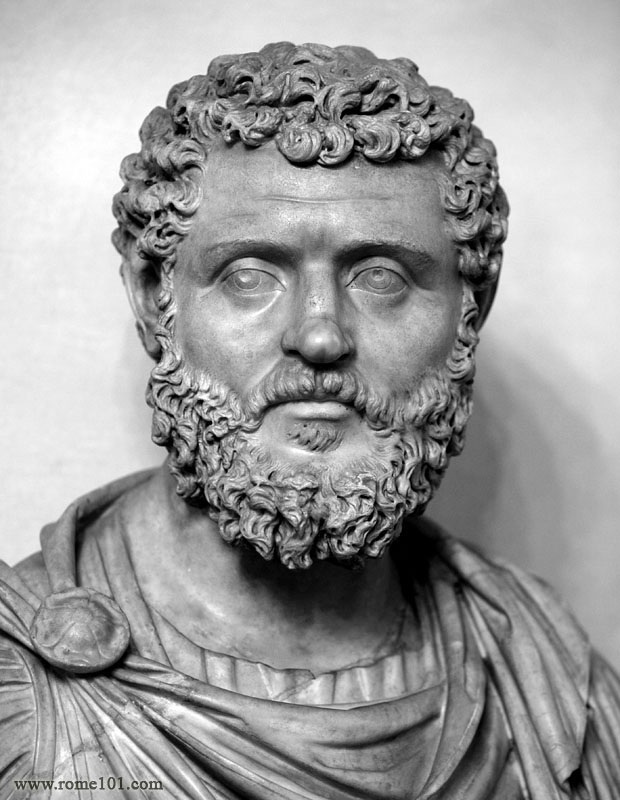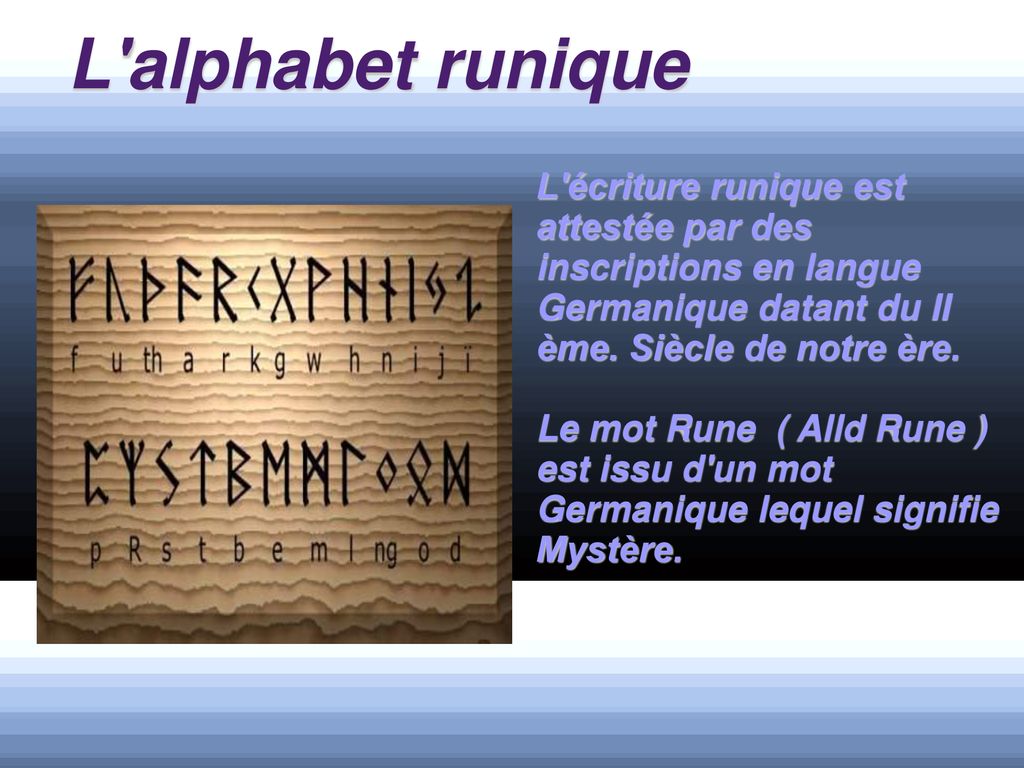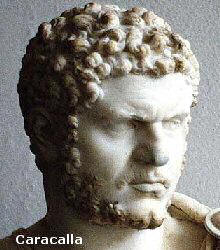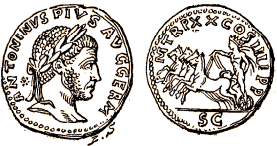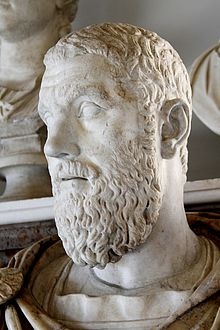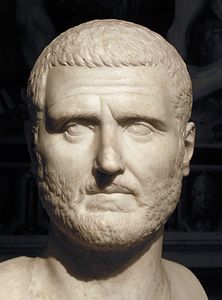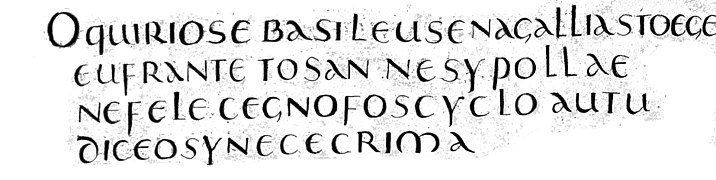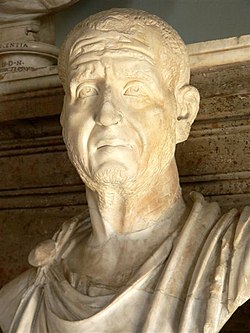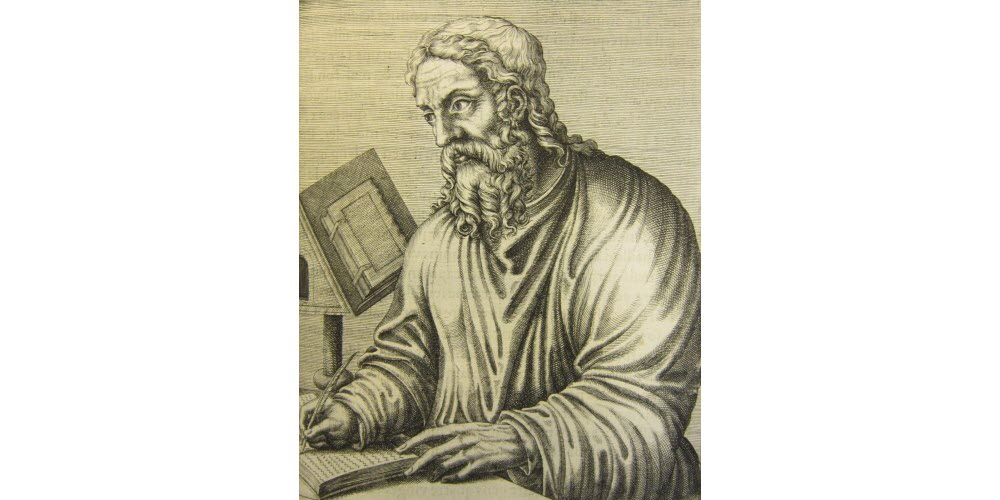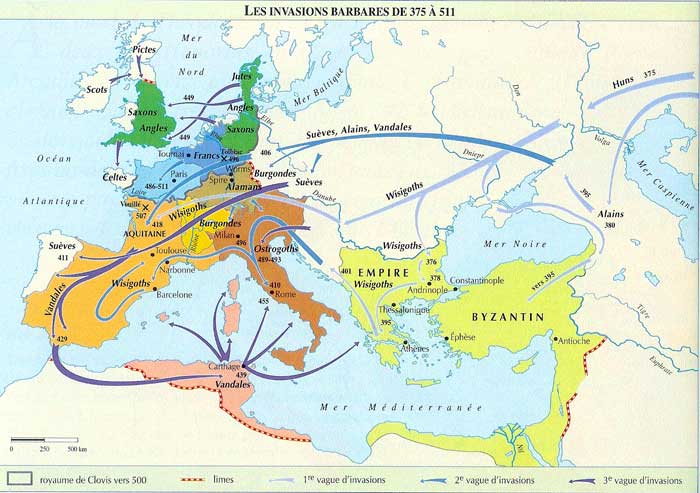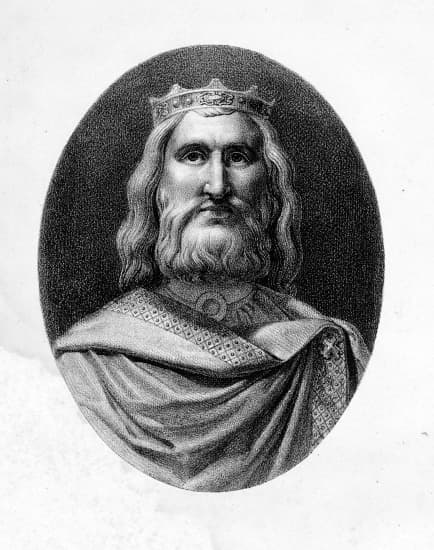21. 1 à 49 - Naissance et mort de Jésus Christ
► 1 à 33 - naissance et mort de Jésus Christ, dit Jésus de Nazareth. Personne-clef du christianisme ; il est considéré par les croyants comme le Messie et le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est non seulement l'envoyé de Dieu mais encore le propre Fils éternel de Dieu, né avant tous les siècles. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes le célèbrent religieusement, et même l'adorent. D'autres courants chrétiens le célèbrent religieusement en développant des christologies plus variées.
Il est considéré comme un prophète particulier par les musulmans. Le christianisme est issu de la rencontre, commencée sous Alexandre le Grand, de la pensée grecque et du judaïsme. Le nom "christianisme" vient de la traduction du mot hébreu Messie, "Oint", en grec Khristos, soit le Christ. Selon les Actes des apôtres 11 - 26, ce fut à Antioche que, pour la première fois, les croyants en Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Le christianisme emprunte au judaïsme des éléments fondamentaux : la croyance en un Dieu unique (monothéisme) qui se montre sur Terre de façon transcendante et immanente ; la croyance en la venue d'un Messie ; la croyance en la Résurrection des morts et dans le Jugement dernier. Mais il modifie ces fondements de la manière suivante : En Jésus, Dieu s'est montré en tant qu'être humain (notons que certains groupes se déclarant chrétiens, comme les Témoins de Jéhovah, ne seront pas d'accord ici).
Jésus est le Messie attendu des Juifs ; la résurrection de Jésus a déjà eu lieu et, comme Jésus, les humains morts en ayant foi en Lui ressusciteront. Et il s'oppose au judaïsme sur deux éléments clés : Depuis Jésus, Dieu veut créer une famille d'enfants de Dieu, non limitée aux seuls Juifs ; C'est la foi en Jésus-Christ qui définit cette famille, et non la pratique de la loi mosaïque (oeuvres).
► 1 à 700 - Hiéroglyphes mayas. La famille linguistique des langues mayas regroupe soixante-neuf langues parlées par plus de deux millions de personnes vivant du sud-est du Mexique jusqu'au Honduras. Leur origine remonte, croit-on, à plus de cinq millénaires. De l'époque dite classique (600-800 ap. J.C.) à la conquête espagnole, ces langues furent écrites sur des bâtiments, de la poterie et des codex, grâce à un système d'écriture très élaboré de hiéroglyphes. Les Mayas ne possédaient ni alphabet, ni écriture syllabique, mais la plupart de leurs mots étaient monosyllabiques. Ils employaient une écriture phonétique que l'on peut considérer comme une forme améliorée de rébus dans le sens où l'image est devenue, au cours du temps, tellement stylisée qu'elle cesse d'être reconnaissable.
► 1 - La population mondiale atteint 170 millions.
► 2 - Auguste autorise le retour de Tibère.
► 2 - août Retour de Tibère à Rome.
► 2 - 20 - août Mort de Caius César, petit-fils d'Auguste à Marseille.
► 2 - Ovide entreprend les "Métamorphoses". Aux alentours de l'an 2, Ovide se lance dans la rédaction d'une oeuvre d'ampleur : les "Métamorphoses". Poème épique comprenant environ douze milles vers dans une quinzaine de livres, elle apparaîtra comme son oeuvre majeure. Du chaos qui créa le monde jusqu'à la montée au pouvoir de César, Ovide relate de nombreuses fables et légendes de la mythologie dans lesquelles les personnages finissent métamorphosés en objet, plante ou animal. Parfois réalistes, parfois très imagées, les mises en scène du poème respectent toutes une certaine harmonie au sein de l'oeuvre. Exilé en l'an 8, Ovide ne parviendra jamais à terminer son ouvrage.
► 3 - Expédition contre les Parthes qui se sont emparés de l'Arménie.
► 3 - Nouvel imperium proconsulaire accordé à Tibère.
► 3 - 9 - Juillet Lucius est blessé d'un coup de poignard par Lullius.
► 4 - Loi Aelia Sentia (minimum 20 ans pour affranchir un esclave). À Rome la loi Lex Aelia Sentia qui régie l'acte privé de libération des esclaves, tandis qu'une autre loi permet de châtier les esclaves par la torture et de leur marquer le visage au fer rouge.
► 4 - 21 - Février Mort de Lucius, petit-fils d'Auguste.
► 4 - 26 - Juin Auguste adopte Tibère (son beau-fils) et Agrippa Postumus (son dernier petit fils). Agrippa Posthumus (12 av. J.-C. - 14), fils posthume de Marcus Vipsanius Agrippa et de sa troisième épouse Julia, fille de l'empereur Auguste. Ses frères aînés, Caius Julius Caesar Vipsanianus et Lucius Julius Caesar Vipsanianus, avaient été adoptés par leur grand-père maternel l'empereur Auguste, mais ils moururent prématurément en l'an 2 et en l'an 4 de notre ère. Auguste adopta du coup son dernier petit-fils vers le 26 ou 27 juin de l'an 4, mais il adoptait en même temps son beau-fils le futur empereur Tibère, dernier mari de sa fille Julia. Pour des raisons inconnues, il est relégué en l'an 7 à Sorrente et dépouillé de ses biens reversés au Trésor militaire. Il fut ensuite envoyé sur l'île de Pianosa entre la Corse et l'Italie.
► 4 - Tibère reçoit la puissance tribunicienne pour dix ans.
► 4 - Juillet Tibère reprend ses campagnes en Germanie.
► 4 - Juillet Conjuration de Cinna contre Auguste. Cinna, fils d'une fille de Pompée.
► 5 - Nouvelle campagne de Tibère en Germanie, soumission des Chauques et des Lombards. Les Chauques (latin Chauci) sont une peuplade germanique au temps de la Rome antique occupant un vaste territoire côtier s'étendant de la Frise à l'ouest jusqu'à l'Elbe à l'Est. Les Lombards étaient un peuple germanique venu de la baltique, appartenant plus précisément au groupe des Germains de l'Elbe. Ce peuple, conduit par leur roi Alboïn envahit l'Italie en l'an 568.
La Frise est une région du littoral de la mer du Nord, composée de plusieurs régions séparées aux Pays-Bas, dans le nord de l'Allemagne, et au Danemark. Les habitants sont des Frisons, un peuple germanique, et la langue le frison. Les Frisons sont un peuple germanique appartenant sur le plan ethnolinguistique au rameau westique. Ce peuple s'est sans doute formé tardivement, au IIe siècle de notre ère, et a pu être confondu, à l'origine, avec ses plus proches voisins : les Angles, les Jutes et les Saxons. Au VIIIe siècle, les Anglo-Saxons de l'île de Bretagne conservaient le souvenir de cette origine commune : elle fut, selon Bède le Vénérable, le facteur qui déclencha l'envoi de missions chrétiennes anglaises sur le continent germanique du VIIe jusqu'au Ixe siècle.
► 6 - Révolte en Pannonie et en Dalmatie. La Pannonie (en latin Pannonia) est une ancienne région de l'Europe centrale, située à l'emplacement de l'actuelle Hongrie, et partiellement de la Croatie.
► 6 - Création des cohortes de vigiles chargées du maintien de l'ordre à Rome la nuit.
► 7 - Campagne de Tibère en Germanie et en Dalmatie.
► 7 - Marcus Julius Agrippa (dit Postumus) est exilé dans l'île de Pianosa.
► 8 - Soumission de la révolte en Pannonie.
► 9 - Prise d'Andretium mettant fin à la révolte en Dalmatie.
► 9 - Les Germains massacrent l'armée de Quintilius Varus en Germanie dans la forêt de Teutoburg.
► 9 - Annexion de la Judée. La Judée est une région de Palestine située au sud de la Samarie. Ces deux régions sont désignées collectivement sous le nom de Cisjordanie.
► 10 - Campagne de Germanicus en Dalmatie et en Réthie. Germanicus, Caius Julius Caesar dit Germanicus (né à Rome en septembre 15 avant J.C., mort près d'Antioche le 10 octobre 19) : général romain, marié à Agrippine l'Aînée. Il est le frêre ainé de Claude, empereur Romain. Sur les 9 enfants de ce mariage, six survécurent : Néron Caesar, Drusus, Caius Julius Caesar (Caligula), Julia Agrippina (Agrippine la jeune), Drusilla et Julia Livilla. Consul en 12. A la mort d'Auguste, il parvient à contrôler 4 légions qui se rebellent en Germanie. Début des campagnes de Germanicus en Germanie (fin en 16). En 16, il remporte une victoire à Idistaviso sur le chef de guerre germain Arminius - d'où son surnom de Germanicus - et capture sa femme Thusnelda. Retour triomphal à Rome le 7ème jour avant les calendes de juin. Il est ensuite envoyé en Orient en 17. En 19, il y meurt brusquement (peut-être empoisonné sur ordre de Tibère).
► 11 - Incursions de Tibère en Germanie.
► 12 - octobre Triomphe de Tibère pour ses victoires en Dalmatie.
► 13 - Auguste associe Tibère au pouvoir (imperium majus).
► 14 - Renouvellement de la puissance tribunicienne de Tibère.
► 14 - Départ de Tibère pour l'Illyrie.
► 14 - 19 - Août Mort d'Auguste à Nola, Tibère devient empereur des romains. A sa mort, l'empereur Auguste est honoré comme un Dieu. Il est le fondateur de l'Empire romain (-27). Fils adoptif de Jules César, il a mis fin à la guerre civile, organisé l'administration des provinces romaines et favorisé le développement religieux et artistique à Rome. Son règne, le plus brillant de l'histoire romaine, sera appelé "siècle d'Auguste". Tibère, son fils adoptif, lui succédera.
► 14 - TIBÈRE (14 à 37) (Tiberius Claudius Nero)
► 14 - Tibère (Tiberius Claudius Nero), né en -42 et mort en 37, est le deuxième empereur romain. Fils de Livie, il est adopté par son beau-père Auguste qui en fait son héritier. Tibère devient empereur à la mort de ce dernier en 14. Il contribue alors à assainir les finances de l'Empire, mais il devient impopulaire après l'empoisonnement de son neveu et fils adoptif, le très respecté Germanicus en 19, assassinat qu'on le soupçonne d'avoir commandité en sous-main. Il continuera d'ailleurs à persécuter la femme et les enfants de Germanicus, famille dont il redoutait sans doute les prétentions dynastiques. Malade et usé, il s'exile à partir de 27 sur l'île de Capri. Rome est alors contrôlé par Séjan, le chef de la Garde Prétorienne.
La fin de son règne est marquée par les complots (exécution de Séjan en 31, répression des opposants) et la contestation du Sénat. Tibère meurt le 16 mars 37 ; son neveu Caligula, troisième fils de Germanicus, prend par la suite le pouvoir. Certaines sources anciennes dont Suétone et Tacite prétendent que Tibère fut assassiné, étouffé par Caligula et/ou son garde Macron, mais il mourut peut-être de mort naturelle.
► 14 - Août Assassinat d'Agrippa Postumus à Pianosa.
► 14 - Août Révolte des légions en Pannonie et en Germanie.
► 14 - 4 - Septembre Lecture du testament d'Auguste devant le Sénat.
► 14 - 8 - Septembre Obsèques d'Auguste.
► 14 - 17 - Septembre Tibère accepte officiellement la charge de l'Empire devant le Sénat.
► 14 - 26 - Septembre Drusus II arrive en Pannonie à la tête d'une armée. Drusus, Julius Caesar Drusus (13 av. J.-C. - 14 septembre 23), fils de Tibère et de Vipsanie, sa deuxième femme, réprima la révolte des légions de Pannonie en l'an 14 et triompha des Alemani. Son père l'éleva au consulat (21) et partagea avec lui la puissance tribunitienne. Mais le jeune prince ayant donné un soufflet à Séjan, celui-ci, pour se venger, le fit empoisonner en l'an 23.
► 14 - Campagne de Germanicus en Germanie, destruction du sanctuaire de Tanfana (déesse)
► 14 - Septembre Le Sénat accorde l'impérium proconsulaire à Germanicus en Germanie.
► 15 - Campagne de Germanicus et Cecina en Germanie.
► 15 - Séjan est nommé préfet du prétoire. Séjan (Lucius Aelius Sejanus) (né en -20 et mort en 31), fut le préfet de la garde prétorienne de l'empire romain et le citoyen le plus influent de Rome. Séjan est né à Volsinii en Étrurie. Il devint préfet du prétoire au moment de l'accession de Tibère au trône impérial, grâce à l'amitié que le nouvel empereur portait à son père Séius Strabo. Après la nomination de ce dernier en temps que gouverneur de l'Égypte, il devint commandant unique de la garde prétorienne, et commença à augmenter ses pouvoirs.
Séjan était probablement l'amant de Livilla, femme de Drusus II, le fils de Tibère. Après la mort de Drusus II (peut-être empoisonné par son épouse) en 23, il devint plus puissant que le Sénat et regroupa la garde prétorienne dans un seul camp établit au-delà de la porte de Viminal à Rome. Il va tenter de semer la discorde dans la famille impériale, entre autres entre Tibère et Agrippine l'Aînée, ou entre Néron César et Drusus César (deux fils de Germanicus). En 31, après avoir gagné le consulat, Séjan se crût inattaquable, et pensa que la voie lui était ouverte vers le trône impérial. Ses projets furent dénoncé à l'empereur Tibère par la belle-soeur de ce dernier, Antonia, et Macron, préfet des Vigiles, fut chargé d'y mettre un terme. Le 18 octobre, Séjan fut étranglé dans la prison du Tullianum tandis que toute sa famille était massacrée. Après l'exécution de Séjan, Macron prit le commandement de la garde prétorienne.
► 16 - Conjuration de Scribonius Libo.
► 16 - Nouvelle campagne de Germanicus en Germanie.
► 17 - Dernière campagne de Germanicus en Germanie.
► 17 - Mai Triomphe de Germanicus pour sa campagne de Germanie.
► 17 - Départ de Germanicus pour l'Orient.
► 17 - Soulèvement de Tacfarinas (chef numide) en Afrique. Début du soulèvement numide (fin en 24). Révolte des Musullames des Hauts-Plateaux en Maurétanie, dirigés par le Numide Tacfarinas, ancien membre des troupes numides auxilliaires et déserteur de l'armée romaine. Les insurgés revendiquent les terres les plus fertiles dont ils sont étés spoliés par la colonisations romaine.
► 18 - Intervention de Germanicus en Arménie, où il installe Zénon sur le trône. Zénon: un fils du roi du Pont dénommé désormais Artaxias III.
► 18 - Strabon écrit sa Géographie. Strabon, né à Amasya, Cappadoce, vers 58 av. J.-C., mort entre 21 et 25, géographe grec. Peu de choses nous sont connues de sa vie. Sa famille habitait à Amasya, une ville dans la région du Pont-Euxin. Strabon lui-même dit qu'il a étudié auprès d'Aristodème, précepteur des enfants de Pompée, en Carie. Ensuite, il s'installa à Rome et étudia auprès d'un certain Tyrannion, géographe de son état. En 25 ou 24 av. J.-C., il voyagea en Égypte, accompagnant le préfet romain Aelius Gallus le long du Nil.
Après de nombreux voyages, il retourna à Amasya, où il entreprit de rédiger une Histoire en 43 volumes, qu'il voulait la continuation de l'oeuvre de Polybe. Aucun de ces volumes ne nous est parvenu. Ensuite, il s'attaque à une Géographie, conçue comme complémentaire de l'Histoire, en 17 volumes, que nous avons tous, sauf quelques parties manquantes du livre VII. Son but était d'offrir à un lectorat aussi large que possible un livre agréable et instructif, qui pût être lu d'affilée.
► 19 - Annexion de Palmyre à l'Empire romaine. Palmyre est une oasis du désert de Syrie, 210 km au nord-est de Damas. Une cité éponyme, bâtie selon la Bible par le roi Salomon, se trouvait jadis sur cette oasis, position privilégiée sur la route des caravanes entre la Syrie et la Mésopotamie. Devenue romaine sous Tibère, avec la province romaine de Syrie, elle atteignit son apogée sous Hadrien, qui lui donna son indépendance en 129, ainsi que ses successeurs. C'était alors une ville splendide, chantée par les poètes.
► 19 - 10 octobre Germanicus neveu et fils adoptif de Tibère meurt empoisonné à Antioche. Antioche est une ville de Turquie proche de la frontière syrienne, chef-lieu de la province de Hatay.
► 20 - février Début du procès de Pison accusé de l'assassinat de Germanicus. Pison: gouverneur de Syrie,
► 20 - mai Suicide de Pison.
► 21 - janvier Tibère se retire en Campanie.
► 21 - Révolte de Sacrovir (éduen) et de Florus (trévire) écrasée à Autun par l'armée de Germanie (Silius). Les chefs de tribus gaulois Trévires et Éduens Caius Julius Florus et Caius Julius Sacrovir prennent en otage des fils de chefs gaulois qui recevaient une éducation romaine à Augustodunum (Autun). La rébellion est rapidement matée. Autun est une commune française, située dans le département de la Saône-et-Loire et la région Bourgogne.
► 22 - mars Retour de Tibère à Rome.
► 22 - Le Sénat accorde la puissance tribunitienne à Drusus II à la demande de Tibère.
► 23 - 14 septembre Drusus II meurt empoisonné par sa femme à l'instigation de Séjan (ministre de Tibère).
► 23 - Séjan demande l'autorisation d'épouser la veuve de Drusus II à Tibère qui l'en dissuade.
► 24 - Révolte servile à Rome.
► 25 - Séjan protège Tibère lors d'un accident (éboulement).
► 25 - Procès puis suicide de Cremutius Curdus qui avait publiquement montré son hostilité à Séjan.
► 26 - Ponce Pilate est nommé préfet en Judée. Ponce Pilate était préfet (procurateur) de la province romaine de Judée au Ier siècle (de 26 à 36), c'est-à-dire, selon le Nouveau Testament, au moment de la crucifixion de Jésus.
► 27 - Tibère se retire sur l'île de Capri. L'empereur Tibère se retire dans son palais de l'île de Capri, d'où il gouverne l'Empire durant les onze dernières années de son règne. Il ne reviendra plus à Rome, laissant la conduite effective des affaires, et donc un pouvoir immense à son préfet du prétoire, Séjan. Ce dernier ne va pas tarder à en abuser, jusqu'à comploter contre l'empereur, qui ordonne son assassinat, le 18 octobre 31, ainsi que celui de toute sa famille.
► 29 - Mort de Livie, épouse d'Auguste et mère de Tibère.
► 29 -Tibère appelle Caligula auprès de lui. Caligula, Caius Julius Caesar Germanicus, dit Caligula, fils de Germanicus et d'Agrippine l'Aînée, naquit la veille des calendes de septembre en 12, sous le consulat de son père et de C. Fontenius Capito. Il était petit-neveu de l'empereur Tibère et arrière-petit-fils d'Auguste. Enfant, il vécut avec son père dans les camps militaires, et ses botillons adaptés à ses petits pieds lui valurent le surnom de "Caligula" ("petites bottes"), qu'il finit par détester. Tibère avait assigné sa succession conjointement à son propre petit-fils Gemellus et à Caligula; mais celui-ci se fit seul reconnaître par le Sénat (en 37), adoptant d'abord Gemellus, puis le faisant assassiner par la suite.
30 - 7 avril Condamnation de Jésus en Judée.
30 - Arrestation de Drusus III (Drusus Caesar, fils de Germanicus) sur les ordres de Séjan.
30 - Procès et condamnation d'Agrippine, de Drusus César et Néron César ses fils. Agrippine l'Aînée, en latin Agrippina maior (vers 14 avant J.-C. - 33 après J.-C. en exil sur l'île de Pandataria), était la fille de Julie (donc la petite fille d'Auguste) et d'Agrippa. Elle épousa Germanicus. Agrippine l'Aînée accompagne son mari en Germanie inférieure, où elle accouchera d'Agrippine la Jeune en 15 ou 16. Après le retour triomphal à Rome en 17, Germanicus est envoyé en Orient : Actium, Athènes, Lesbos, Égypte, Syrie. Germanicus meurt (empoisonné?) en octobre 19 à Antioche lors du voyage en Orient.
Agrippine accompagné du futur Caligula et de sa fille cadette, Julia Livilla (née pendant le voyage) raccompagne ses cendres et parcourt le trajet de Brindes à Rome. Le cortège funéraire de Germanicus déclenche un fort mouvement de sympathie populaire à son égard et la suspicion sur le rôle trouble joué par Tibère dans la mort de son fils adoptif. Agrippine et ses enfants sont alors ballotés entre les rivalités personnelles et les affaires d'état : Tibère interdit à Agrippine de se remarier et le préfet du prétoire, Séjan, après s'être débarrassé de Drusus, le fils de Tibère, réussit à brouiller définitivement Agrippine et l'empereur. La disgrâce et l'exécution de Séjan en 31 n'améliore pas le sort d'Agrippine. Exilée par Tibère, d'abord à Pompéi, puis sur l'île de Pandataria, elle finira par y mourir de faim en octobre 33.
► 31 - 1er janvier Début du Consulat de Tibère et Séjan.
► 31 - Tibère appelle de nouveau Caligula auprès de lui à Capri (jusqu'en 33).
► 31 - 16 octobre Macron, préfet des vigiles, porteur d'une lettre de Tibère arrive à Rome.
► 31 - 17 octobre Lecture de la lettre de Tibère hostile à Séjan devant le Sénat.
► 31 - 17 octobre Arrestation, condamnation et exécution de Séjan.
► 31 - Macron devient préfet du prétoire en remplacement de Séjan.
► 31 - Condamnation et exécution des enfants de Séjan.
► 32 - Purges de Tibère contre les partisans de Séjan.
► 33 - Tibère fait demi-tour sur le chemin de Rome où il devait assister au mariage de Caligula.
► 33 - Mariage de Caligula et de Junia Claudilla.
► 33 - Mort de Drusus III, frère aîné de Caligula en prison.
► 33 - novembre Mort d'Agrippine l'Aînée en exil sur l'île de Pandantaria.
► 33 - Passion et Crucifixion de Jésus-Christ.
► 34 - Tibère fait demi-tour sur le chemin de Rome où il devait assister aux fêtes données pour le vingtième anniversaire de son accession au pouvoir.
► 35 - Artaban III (Parthe) met son fils sur le trône d'Arménie. Artaban III ou Artabanus III est roi des Parthes de 12 à 38 après J.C. Il fut proclamé roi et son prédécesseur Vononès Ier s'enfuit vers l'Arménie. En 34, il entreprend une action militaire contre les romains. À la mort de Artaxias III (Zeno) d'Arménie, Artaban mit son fils, Arsaces, sur le trône arménien. Deux nobles parthes, refusant l'autorité d'Artaban demandèrent l'aide de Rome pour mettre sur le trône un descendant de Phraatès IV, Tiridate III. Celui-ci devint roi grâce à l'appui du général romain Lucius Vitellius. Artaban reprit le trône un an après. Cette lutte permit à un certain nombre de villes de devenir indépendantes. Vitellius reprit la lutte, Artaban se réfugia chez un vassal, Izates II pendant qu'un certain Cinnamus montait sur le trône. Artaban récupéra celui-ci par la négocation mais mourut peu de temps après.
► 35 - Intervention de Tibère contre Artaban III.
► 36 - Tibère remplace Artaban III par Tiridate sur le trône parthe.
► 36 - Inondation du Tibre et Incendie à Rome.
► 36 - Mort de Junia Claudilla, épouse de Caligula en couches.
► 36 - novembre Tibère fait de nouveau demi-tour sur le chemin de Rome.
► 37 - 16 mars Assassinat de Tibère, Caligula fils de Germanicus et Agrippine l'Aînée devient empereur.
► 37 - CALIGULA (37 à 41) (Caius Julius Caesar Germanicus)
► 37 - Caligula, Caius Julius Caesar Germanicus, dit Caligula, fils de Germanicus et d'Agrippine l'Aînée, naquit la veille des calendes de septembre en 12, sous le consulat de son père et de Fontenius Capito. Il était petit-neveu de l'empereur Tibère et arrière-petit-fils d'Auguste. Pendant six mois, les Romains purent se féliciter d'un empereur juste, utile et libéral, qui leur faisait oublier la sinistre fin du règne de Tibère; mais une grave maladie fit changer dramatiquement Caligula. Dès lors il s'achemina comme son grand-oncle vers une odieuse tyrannie, s'adonnant à la débauche (on lui prête entre autres une longue liaison amoureuse avec sa soeur Drusilla), se livrant aux pires extravagances, et dirigeant l'empire en proie à ses lubies.
Il ridiculisa le Sénat et l'institution des consuls, fit assassiner ou bannir la plupart de ses proches, et on l'accuse encore de s'être amusé d'horribles tortures en plus de meurtres arbitraires. Sa mégalomanie le poussa à vouloir se faire adorer à l'égal d'un dieu vivant, avec ses attributs, ses honneurs, son culte et ses temples jusque dans Jérusalem. Il se concilia cependant le peuple en es et de jeux du cirque. Une dernière conjuration eut enfin raison du tyran: en 41, après 4 ans de règne, il fut assassiné à l'âge de 29 ans par des soldats de sa garde. Les conjurés, trouvant son oncle Claude tremblant derrière une tenture, l'acclamèrent empereur. Celui-ci épousera plus tard une autre soeur de Caligula, Agrippine la Jeune, qui verra ainsi son fils d'un précédent mariage accéder à l'empire: Néron, le dernier des Julio-Claudiens.
37 - 18 mars Le Sénat accorde l'imperium à Caligula en évinçant Tiberius Gemellus (petit-fils de Tibère)
37 - 28 mars Arrivée de Caligula et de la dépouille funèbre de Tibère à Rome.
37 - 3 avril Éloge funèbre de Tibère par Caligula lors de ses funérailles à Rome.
37 - 3 avril Lecture du Testament de Tibère, Caius César (Caligula) et Tibérius Gemellus sont ses héritiers.
37 - avril Réhabilitation des condamnés ou exilés du règne de Tibère.
37 - avril Caligula reçoit la puissance tribunicienne des comices tributes.
37 - mai Caligula est nommé Grand Pontife.
37 - juin Distribution d'un congiaire au peuple de Rome.
37 - 1er juillet Discours de Caligula devant le Sénat exposant son programme.
37 - juillet Distribution d'un nouveau congiaire au peuple de Rome.
37 - 31 août Inauguration du temple d'Auguste à Rome par Caligula.
37 - 21 septembre Le Sénat accorde à Caligula le titre de "père de la patrie".
37 - octobre-novembre Maladie de Caligula.
37 - Caligula fait exécuter Tiberius Gemellus qu'il soupçonnait de comploter contre lui.
37 - Caligula fait exécuter Publius Afranius Potitus qui fait le serment d'offrir sa vie aux dieux pour le rétablissement de l'empereur.
37 - Disgrâce et suicide du sénateur Marcus Silanus, beau-père de Caligula.
37 - 15 décembre Naissance de Néron (futur empereur), fils d'Agrippine la Jeune, soeur de Caligula. Néron, né Lucius Domitius Ahenobarbus le 15 décembre 37 et mort le 9 juin 68, est le cinquième et dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne ; il règna de 54 à 68. Néron devint l'héritier de l'empereur, son grand-oncle et père adoptif Claude (Claudius). Il accède au trône le 13 octobre 54, à la mort de son grand-oncle. En 66, il ajouta le titre Imperator à son nom. Il fut dépossédé de son pouvoir en 68 et se suicida assisté de son scribe Epaphroditos.
38 - Caligula demande au Sénat d'exercer un contrôle annuel des comptes de l'état.
38 - Caligula rend aux Comices Centuriates le choix des magistrats (supprimé sous Tibère).
38 - mai Caligula épouse Livia Orestilla.
38 - 10 juin Mort de Julia Drusilla, soeur de Caligula.
38 - juillet-août Caligula répudie Livia Orestilla.
38 - août Macron est nommé préfet en Égypte.
38 - 23 septembre Funérailles et divinisation de Drusilla.
38 - Macron relevé de ses fonctions de préfet du prétoire et mis en accusation se suicide.
38 - octobre Caligula épouse Lollia Paulina, femme du gouverneur de Macédoine.
38 - 21 octobre Grand incendie à Rome.
39 - 1er janvier Second consulat de Caligula.
39 - janvier Procès et condamnations de nombreux citoyens romains.
39 - 1er février Caligula abandonne son consulat.
39 - Construction d'un pont de bateaux (4,6 km) entre Misène et Baïes.
39 - Conjuration contre Caligula à l'instigation de ses soeurs, des consuls et du général de l'armée du Rhin.
39 - 2 septembre Caligula destitue les 2 consuls en exercice.
39 - Caligula se rend en Germanie et fait exécuter Gaetulicus, Général de l'armée du Rhin et Lepidus.
39 Galba (futur empereur) est nommé à la tête des armées en Germanie.
39 26 octobre Lettre de Caligula au Sénat exposant la conjuration.
39 Interventions de Galba et Caligula contre les Germains.
40 décembre Caligula de retour de Germanie entre dans Lyon.
40 1er janvier Troisième consulat de Caligula.
40 Caligula fait exécuter Ptolémée, cousin de l'empereur et roi de Maurétanie. Ptolémée de Maurétanie, fils de Juba II de Maurétanie (-52 à 23) et de Cléopâtre Séléné (-40 à 6), Ptolémée règne de 23 à 40. Il est assassiné par son plus proche parent l'empereur Caligula (12 à 41). Sans descendance connue, des recherches récentes font apparaître un mariage morganatique avec Urania, esclave affranchie. La Maurétanie désigne le territoire des Maures dans l'Antiquité. Il s'étendait sur le Maroc et l'ouest algérien actuels. Les Maures: C'est au VIe siècle av. J.-C. que se distingue parmi les ethnies berbères d'Afrique du Nord un peuple débordant largement les frontières de l'actuel Maroc. Ce sont les Maures.
40 Révolte d'Aédémon, second de Ptolémée en Maurétanie.
40 Départ de Caligula pour Boulogne en vue d'une expédition en (Grande) Bretagne.
40 avril-mai Mariage de Caligula avec Milonia Caesonia.
40 mai Retour de Caligula à Rome.
40 juin Instauration de taxes destinées à rétablir les finances publiques.
40 Répression de la révolte et annexion de la Maurétanie.
40 31 août Ovatio de Caligula pour sa victoire sur le complot de Gaetulicus.
40 septembre Complot de Anicius Cerealis, Sextus Papinius et Bassus contre l'empereur.
40 1er janvier Quatrième consulat de Caligula.
41 24 Janvier Assassinat de Caligula par des membres de la garde prétorienne. L'empereur Caligula, arrière petit-fils d'Antoine, est assassiné par des soldats de la garde prétorienne. La folie qui avait frappé l'empereur peu de temps après son avènement (37) l'avait transformé en tyran sanguinaire et mégalomane. Il n'hésitait pas à rabaisser ses sujets en disant d'eux : "Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent", et se considérait comme le "Nouveau Soleil". La légende raconte aussi qu'il avait élevé son cheval favori au rang de consul. Son assassinat est vécu à Rome comme une libération.
41 24 janvier Les Prétoriens choisissent Claude, oncle de Caligula et frère de Germanicus pour empereur.
41 CLAUDE (41 à 54) (Tiberius Claudius Nero Drusus)
41 Claude (Tiberius Claudius Nero Caesar Drusus) était un empereur romain. Né en -10 à Lugdunum, fils de Drusus et frère de Germanicus, il succéda à Caligula en 41 alors qu'il avait déjà 50 ans. Il accéda au pouvoir en comblant de cadeaux (donativa) les cohortes prétoriennes, inaugurant ainsi un malheureux usage, puisque celles-ci réclameront dorénavant de tels cadeaux aux nouveaux empereurs. Il épousa en premières noces Plautia Urgulanilla, dont il eut un fils mort en bas âge et une fille qu'il fit exposer car il la soupçonnait de bâtardise, en secondes Aelia Paetina avec qui il eut une fille Antonia, en troisièmes Messaline qu'il fit exécuter et en quatrièmes noces sa propre nièce Agrippine la Jeune.
Claude réussit là où beaucoup avaient échoué : la conquête de la Bretagne (actuelle Grande-Bretagne). Il n'ajouta pas moins de cinq provinces à l'Empire dont la Lycie, la Mauritanie, la Norique et la Thrace. Il étendit la citoyenneté romaine à beaucoup de provinces avec une préférence pour sa patrie natale, la Gaule. Le sud de l'île de Bretagne fut conquis sous son règne (entre 43 et 47). Sensible aux demandes des notables gaulois, il obtint en 48 du Sénat que ceux-ci puissent accéder aux magistratures publiques de Rome. Reconnaissants, les délégués des nations gauloises firent graver son discours sur les Tables Claudiennes, plaques de bronze placées dans le sanctuaire fédéral de Lugdunum. En 49, il bannit les juifs de Rome. Il mourut empoisonné à l'instigation d'Agrippine en 54.
41 Victoire de Galba en Gemanie (Chattes).
42 Rébellion du Général Scribonianus (consul) contre Claude.
42 Galba est nommé proconsul en Afrique.
43 Débarquement de 4 légions romaines sous le commandement d'Aulus Plautius dans le Kent (Richborough).
43 Prise de Camulodunum (Colchester) par les armées romaines.
43 Claude entame la conquête de la (Grande) Bretagne.
43 La (Grande) Bretagne devient province romaine.
43 Fondation de la ville de Londres (Londinium).
44 La Maurétanie (Maroc) devient province romaine.
44 La Judée devient province romaine. A la mort d'Hérode Agrippa Ier, peut-être empoisonné par les Romains, la Judée est gouvernée par des procurateurs romains. D'après Flavius Josèphe, les troupes romaines de Césarée maudissent le souvenir d'agrippa, entrent de force dans sa maison, violent ses filles et célèbrent sa mort publiquement par des fêtes et des libations.
46 La Thrace devient province romaine.
46 à 125 - naissance et mort de Plutarque. Écrivain grec. Plutarque eut une vie calme et responsable, bon père de famille, bon "citoyen" dans sa ville. Il voyagea en Égypte, à Rome et dans le reste de l'Italie avant de suivre des études au collège sacerdotal de Delphes. Il est l'auteur d'un grand nombre d'oeuvres, dont seules 'Vies parallèles' et 'Oeuvres morales' nous sont parvenues. Il y fait preuve d'un grand talent d'écrivain et de conteur mais aussi d'historien et de penseur. Son influence fut immense sur des auteurs occidentaux tels Machiavel, Érasme ou Jean-Jacques Rousseau et, grâce aux anecdotes qui rythment ses écrits, il reste un des auteurs antiques dont la lecture est la plus plaisante.
47 Interventions romaines contre le Icènes (Grande) Bretagne.
48 Conjuration de Messaline et Silius contre Claude. Messaline, Valeria Messalina (probablement née en 25) est la petite-fille d'Antonia Maior et donc l'arrière-petite-fille de Marc-Antoine. Elle est aussi la nièce de Cneius Domitius Ahenobarbus, premier époux d'Agrippine la Jeune et père de Néron. Elle épousa Claude en 39 ou 40 et eut deux enfants avec le futur empereur: Octavie (née en 40, future épouse de Néron) et Britannicus (né en 41).
49 Mariage de Claude et d'Agrippine la Jeune. Agrippine la jeune (née en 15 ou 16 après J.-C. à Ara Ubiorum - morte assassinée à Baules par Néron en mars 59, à l'âge de 43 ou 44 ans).
49 Le Sénat accorde le titre "d'Augustus" à Claude.
49 Expulsion des juifs de Rome.
22. 50 - Fondation de Cologne - à 59
► 50 - Une première réunion des apôtres et des anciens, appelée concile de Jérusalem, eut lieu vers 50 au sujet de l'observance des règles traditionnelles du judaïsme. Le concile de Jérusalem est un nom appliqué rétrospectivement à une réunion décrite dans le livre des Actes des Apôtres, quinzième chapitre. Les évènements qui y sont décrits sont généralement datés des environs de l'an 50, une dizaine d'années avant la mort de Jacques le Juste, le frère de Jésus. Le point de débat était celui-ci : la foi en Jésus était-elle suffisante pour être sauvé ou devait-on en plus observer les règles traditionnelles du judaïsme ?
Le cas fut amené à Jérusalem qui était l'Église-Mère. Dans cette Église, Pierre représentait le chef des apôtres et Jacques le Juste le chef des Anciens. Même Jacques le Juste, l'hébraïsant par excellence, était d'accord avec Pierre, Paul et Barnabé pour dire que Jésus était le Sauveur de tous et qu'il ne fallait pas imposer les règles judaïques traditionnelles aux chrétiens issus du paganisme. L'Église avait su surmonter cette première difficulté et s'adapter à une nouvelle situation.
Jacques, chef de l'Église de Jérusalem, a donné sa décision, connue ultérieurement sous le nom de Lettre apostolique (ou décret apostolique) (Actes 15, 23-29) : "Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut ! Ayant appris que, sans mandat de notre part, certaines gens venus de chez nous ont, par leur propos, jeté le trouble parmi vous et bouleverser vos esprits, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous transmettent de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci qui sont indispensables : vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. ". La grande conséquence de ce concile fut l'entrée massive des païens dans l'Église. Jacques le Juste, aussi appelé frère du Seigneur, souvent identifié avec Jacques le Mineur ou bien Jacques d'Alphée, martyrisé en 62, fut d'après la tradition, le premier évêque ou patriarche de Jérusalem, et l'auteur de l'Épître de Jacques du Nouveau Testament.
► 50 - Construction du pont du Gard en Gaule. Le Pont du Gard est un pont romain à trois niveaux situé dans le sud de la France, près de Remoulins, dans le département du Gard. Il enjambe le Gardon et assure la continuité de l'aqueduc romain du même nom et qui conduisait l'eau d'Uzès à Nîmes.
► 50 à 125 - naissance et mort de Épictète (Hiérapolis, Phrygie, 50–Nicopolis, Épire 125 ou 130) est un philosophe de l'école stoïque. La philosophie d'Épictète se veut pratique, comme un ensemble de règles permettant de mettre en application de grandes valeurs morales. La droiture d'esprit qu'il préconise lui fait rejeter les effets de style des orateurs, les joutes pseudo logiques des sophistes et la recherche effrénée des honneurs. La question principale à laquelle tente de répondre sa philosophie est de savoir comment vivre sa vie.
Tous les autres grands questionnements de la philosophie sont de peu d'importance à ses yeux face à cette première interrogation. Une des premières réponses qu'il apporte à ceci est d'apprendre à distinguer les choses qui dépendent de nous de celles qui n'en dépendent pas. Le précepte radical qu'il offre ensuite est de considérer qu'il est impossible de changer les choses qui ne dépendent pas de nous, alors autant les accepter telles quelles pour pouvoir être heureux. "Celles qui en dépendent sont nos opinions, nos mouvements, nos désirs, nos inclinations, nos aversions ; en un mot, toutes nos actions".
Ces choses-là sont libres et chacun peut exercer sa volonté entière sur elles. Cette liberté absolue de la volonté ne peut être restreinte ni par la douleur, ni par la mort, ni par quoi que se soit qui est extérieur à elle. Si la volonté s'accommode d'un quelconque fait c'est que d'une certaine manière elle a voulu cette accommodation. Pour le stoïcien rien ne sert de vénérer la nature, les dieux ou d'autres maîtres, seuls des principes rationnels doivent permettre de comprendre – ou simplement accepter - le mouvement du monde et des hommes. C'est par une analyse rationnelle qu'il détermine ce qui ne dépend pas de lui, et c'est grâce à cette même raison qu'il définit ses jugements sur le monde.
► 50 - Apparition du codex. Le codex est une révolution comparable à l'invention de l'écriture. Le livre n'est plus un rouleau continu, mais un ensemble de feuillets reliés au dos. De ce fait, il devient possible d'accéder directement à un endroit précis du texte. Le codex est également plus facile à poser sur une table, ce qui permet au lecteur de prendre des notes en même temps qu'il lit.
La forme codex s'améliore avec la séparation des mots, les majuscules et la ponctuation, qui facilitent la lecture silencieuse, puis avec les tables des matières et les index, qui facilitent l'accès direct à l'information. Cette forme est tellement efficace, qu'elle est encore celle du livre, plus de 1500 ans après son apparition. Le papier remplace progressivement le parchemin. Moins cher à produire, il permet une diffusion plus large du livre.
Malgré ces défauts, mauvaise résistance au pliage et dégradation à l'humidité, le papyrus resta le support privilégié de l'écriture durant toute l'antiquité. Cependant la légende rapporte dans les écrits des auteurs antiques qu'au IIe siècle avant JC, le souverain égyptien Ptolémée V aurait interdit l'exportation de papyrus vers Pergame (dans l'actuelle Turquie) car la bibliothèque de cette ville rivalisait avec celle d'Alexandrie. Cela aurait favorisé l'apparition d'un nouveau support pour l'écriture : le parchemin, nom venant du latin "pergamena" ou de pergame.
L'usage du parchemin découpé en feuilles va permettre la création du Codex, livre tel qu'il se présente de nos jours. Le Codex est composé de feuilles pliées, assemblées en cahier cousus ensemble. Il fait apparaître la notion de page comme un espace séparé, autonome et discontinu. Introduit au IIe siècle après JC en occident, il fût adopté principalement par les premiers chrétiens. Ainsi une religion à vocation universelle rompait avec les formes culturelles établies et lançait un vaste mouvement de diffusion des textes sacrés. Mais son adoption ne se généralisa réellement qu'au début du IVe siècle dans l'Occident romain et au Ve siècle dans l'Empire byzantin, lorsqu'il se libéra complètement de l'organisation du rouleau en devenant plus étroit et plus haut.
Les critiques de l'époque trouvaient que ce nouveau support de l'écrit était léger et portatif mais ne représentait pas le sérieux du Volumen. Le codex est un livre de forme parallélépipédique, résultat de l'assemblage de feuillets manuscrits, d'abord en parchemin à partir du Ier-IIe siècle dans l'empire romain puis en papier depuis le XIIIe siècle. Cette présentation des textes a constitué une véritable révolution au début de l'ère chrétienne car à l'inverse du rouleau (volumen), qui impose une lecture continue, le codex permet d'accéder aux chapitres (structure du texte) de manière directe.
L'habitude de numéroter les pages (par des lettres) accompagna cette innovation. Son adoption dans la chrétienté est d'autant plus marquée que, support de la Bible, le codex permet de se différencier des rouleaux sur lesquels les juifs écrivent la Torah. Le Codex Vaticanus est un manuscrit de vélin en écriture grecque onciale daté du IVe siècle. Il reprend une grande partie de l'ancien et du Nouveau Testament. Le Codex Sinaiticus est un manuscrit complet du Nouveau Testament datant du IVe siècle. Il contient également des parties de la Septante.
► 50 - Invention du soufflage du verre par les Phéniciens. L'histoire du verre remonte à la préhistoire : en 100 000 avant notre ère, l'obsidienne, un verre volcanique, est déjà taillé par l'homme pour former des pointes de flèches ; les tectites, billes de verre formées par des impacts avec des météorites, servent également de bijoux ; enfin, les fulgurites, petits tubes issus de la fusion du sable atteint par un éclair, sont connus.
L'utilisation du verre au quotidien se répand sous l'Empire romain. Inventée en Phénicie (aujourd'hui principalement le Liban), la technique de soufflage du verre date du Ier siècle av. J.-C., et entraîne un grand développement de l'usage du verre dans tout l'Empire, car elle utilise moins de matière vitreuse. Ainsi, l'usage du verre se démocratise largement, pour les récipients et même les vitrages. Le verre entre aussi dans la décoration des demeures (tesselles de mosaïque), la bijouterie (incrustations) ainsi que pour les premiers vitrages de maisons ou d'édifices publics.
► 51 - Burrus est nommé préfet du prétoire. Sextus Afranius Burrus fut nommé préfet du prétoire par l'empereur Claude en 51. Après la mort de Claude en 54, il fut avec Sénèque le Jeune un conseiller de Néron au début de son règne, avec une influence positive pendant les cinq premières années de ce règne. Il décède en 62, de mort naturelle (maladie de la gorge, cancéreuse selon des interprétations modernes).
► 51 - Victoire romaine en (Grande) Bretagne contre Caratacos. Un soulèvement britannique contre Rome échoue sous Caratacos. Il est capturé avec l'aide de la reine des Brigantes, Cartimandua. Caratacos (latinisé en Caratacus), roi et chef militaire celte de l'île de Bretagne qui a dirigé la résistance à la conquête romaine de la Bretagne de l'invasion de Claude Ier en 43 ap. J-C jusqu'à sa capture en 51.
► 52 - Des pèlerins galiléens sont assassinés dans un village de Samarie. Le procurateur Cumanus ne punissant pas les meurtriers, une bande de Zélotes se met à massacrer plusieurs villages samaritains. Ils sont arrêtés et exécutés par les troupes de Cumanus. L'affaire est portée devant le légat Quadratus qui envoie des délégués à Rome, où appuyés par le jeune Hérode Agrippa II (fils d'Hérode Agrippa Ier), les Juifs obtiennent gain de cause.
Cumanus est exilé. Claude envoie son favori Antonius Félix, un Grec, comme procurateur en Judée (fin en 60). Il épouse Drusilla, la soeur d'Agrippa. Sa politique maladroite et injuste entraîne le développement du parti Zélote. Félix arrête leur chef Eléazar par trahison puis doit faire face aux Sicaires (assassins), Zélotes armés de poignards qui exécutaient leur compatriotes ralliés aux Romains, comme le grand-prêtre Jonathan.
A cette époque paraissent plusieurs prophètes rassemblant les foules et leur promettant la liberté, ce qui entraîne la réaction immédiate des Romains. Félix fait ainsi exécuter les partisans de "l'Égyptien" qui voulaient pénétrer dans Jérusalem. Profitant de l'agitation, les grands-prêtres s'emparent des dîmes dues aux simples prêtres, ce qui accentue les tensions sociales. Les zélotes, sont les groupes qui combattent le pouvoir romain les armes à la main pendant la Première guerre judéo-romaine. Révoltés au départ contre le recensement de Quirinius, qui permet l'impôt "par tête", ils se radicalisent et finissent par s'attaquer aussi bien à leurs compatriotes jugés timorés ou soupçonnés de collaborer avec les Romains, qu'aux païens qui - pensent-ils - souillent la Terre promise par leur seule présence.
► 53 Mariage de Néron et Octavie, fille de Claude et Messaline.
► 54 Claude nomme Galba proconsul d'Afrique.
► 54 13 octobre Assassinat de Claude (empoisonnement) sur ordre d'Agrippine.
► 54 13 octobre Néron devient empereur.
► 54 NÉRON (54 à 68) (Lucius Domitius Claudius Nero)
► 54 Néron (Lucius Domitius Claudius Nero Caesar), né à Antium le 15 décembre 37 et décédé à Rome en 68, il fut empereur de 54 à 68. Il était l'arrière-arrière-petit-fils d'Auguste et le neveu de Caligula, par sa mère Agrippine la Jeune. Il fut adopté par Claude pendant que ce dernier était empereur, qui lui donna Sénèque comme précepteur. Il épousa Octavie et fut déclaré empereur, à la mort de Claude, à l'âge de 17 ans.
Claude mourut empoisonné le 13 octobre 54 et Néron fut rapidement nommé empereur à sa place. Il n'avait que 17 ans. Les historiens s'accordent à considérer que Sénèque a joué le rôle de figure de proue au début de son règne. Les décisions importantes étaient probablement laissées entre les mains plus capables de sa mère Agrippine la Jeune (qui pourrait avoir empoisonné Claude elle-même), de son tuteur Lucius Annaeus Seneca, et du praefectus praetorianus Sextus Afranius Burrus.
Les cinq premières années du règne de Néron furent connues comme des exemples de bonne administration, suscitant même l'émission d'une série de pièces de monnaie célébrant le quinquennium Neronis. Les affaires de l'empire étaient traitées avec efficacité et le Sénat bénéficiait d'une période d'influence renouvelée dans les affaires de l'État. Les problèmes devaient pourtant bientôt surgir de la vie personnelle de Néron et de la course à l'influence croissante entre Agrippine et les deux conseillers.
Tout le monde savait que Néron était déçu de son mariage et trompait Octavie. Il prit pour maîtresse Claudia Acte, une ancienne esclave, en 55. Agrippine tenta d'intervenir en faveur d'Octavie et exigea de son fils le renvoi d'Acte. Burrus et Sénèque, pour leur part, choisirent de soutenir leur protégé. Néron résista à l'intervention de sa mère dans ses affaires personelles. Son influence sur son fils diminuant, Agrippine se tourna vers un candidat au trône plus jeune.
Britannicus, à quinze ans, était toujours légalement mineur et sous la responsabilité de Néron, mais il approchait de l'âge de la majorité. Britannicus était un successeur possible de Néron et établir son influence sur lui pouvait renforcer la position d'Agrippine. Mais le jeune homme mourut brutalement le 12 février 55. La proclamation de sa majorité avait été prévue pour le 13 février. La coïncidence des dates laisse penser qu'il a été empoisonné. Burrus est suspecté d'avoir pris part au meurtre.
Néron se révoltait de plus en plus contre l'emprise d'Agrippine, et il commençait à envisager le meurtre de sa propre mère. Il justifiait ses intentions en clamant qu'elle complotait contre lui. Le pouvoir d'Agrippine déclinait encore rapidement, tandis que Burrus et Sénèque devenaient les deux hommes les plus influents de Rome. Alors que ses conseillers s'occupaient des affaires de l'État, Néron s'entourait d'un cercle de proches.
Les historiens romains rapportent des nuits de débauche et de violence, alors que les affaires plus banales de la politique étaient négligées. Marcus Salvius Otho était au nombre de ces nouveaux favoris. À tous points de vue, Otho était aussi débauché que Néron, mais il devint aussi intime qu'un frère. Certaines sources considèrent même qu'ils ont été amants. Otho aurait présenté à Néron une femme qui aurait d'abord épousé le favori, puis l'empereur.
Poppée (Poppaea Sabina) était décrite comme une femme de grande beauté, pleine de charme, et d'intelligence. Les rumeurs d'un triangle amoureux entre Néron, Othon, et Poppée. En 58, Poppée avait assuré sa position de favorite de Néron. L'année suivante (59) fut un tournant dans le règne de Néron. Néron et/ou Poppée auraient organisé le meurtre d'Agrippine.
Sénèque eut beau tenter de convaincre le Sénat qu'elle mettait sur pied une conspiration contre son fils, la réputation de l'empereur fut irrémédiablement entachée par ce cas de matricide. Othon fut bientôt chassé de l'entourage impérial, et envoyé en Lusitanie comme gouverneur. Le tournant suivant fut l'année 62, pour plusieurs raisons. La première fut un changement parmi ses conseillers. Burrus décéda et Sénèque demanda à Néron la permission de se retirer des affaires publiques.
Leur remplaçant aux postes de préfet prétorien et de conseiller fut Gaius Ofonius Tigellinus. Il avait été banni en 39 par Caligula, accusé d'adultère avec à la fois Agrippine et Livilla. Il avait été rappelé d'exil par Claude, puis avait réussi à devenir un proche de Néron (et peut-être son amant). Avec Poppée, il aurait eu une plus grande influence que Sénèque en eut jamais sur l'empereur.
Quelques mois plus tard, Tigellinus épousait Poppée. Une théorie suggère que Poppée tenta, pendant ces quatre ans (58-62) d'éloigner Néron de ses conseillers et de ses amis ; si cela est vrai, ce qui est arrivé à Burrus et Sénèque pourrait ne pas être le fruit du hasard. Le deuxième événement important de l'année fut le divorce de l'empereur. Néron, âgé alors de vingt-cinq ans, avait régné huit ans, et n'avait pas encore d'héritier. Quand Poppée tomba enceinte, Néron décida d'épouser sa maîtresse, mais son mariage avec Octavie devait d'abord être annulé. Il commença par l'accuser d'adultère. Mais Néron avait déjà acquis la réputation d'être infidèle, alors qu'Octavie était connue pour être un parangon de vertu.
Il fallait des témoignages contre elle, mais la torture d'un de ses esclaves ne parvint qu'à produire la célèbre déclaration de Pythias, selon laquelle la vulve d'Octavie était plus propre que la bouche de Tigellinus. Néron réussit à obtenir le divorce pour cause d'infertilité, ce qui lui permettait d'épouser Poppée et d'attendre qu'elle donne naissance à un héritier. La mort soudaine d'Octavie, le 9 juin 62 provoqua des émeutes publiques. Un des effets rapides de la nomination de Tigellinus fut la promulgation d'une série de lois contre les trahisons ; de nombreuses peines capitales furent exécutées.
Début 63, Poppaea donna naissance à une fille : Claudia Augusta. Néron célébra l'événement mais l'enfant mourut quatre mois plus tard. Néron n'avait toujours pas d'héritier. Le 19 juillet 64, éclata le Grand incendie de Rome. Le feu débuta dans les boutiques des environs du Cirque Maxime. Néron était alors en vacances dans sa ville natale, Antium mais il dut revenir en toute hâte.
L'incendie fit rage pendant une semaine. La rumeur circula que Néron aurait joué de la lyre et chanté, au sommet du Quirinal, pendant que la Ville brûlait. Les mêmes récits nous décrivent un empereur ouvrant ses palais pour offrir un toit aux sans-abris et organisant des distributions de nourriture pour éviter la famine parmi les survivants. Mais Néron perdit toute chance de redorer sa réputation en rendant trop vite publics ses projets de reconstruction de Rome dans un style monumental (et moins inflammable).
La population désorientée cherchait des boucs émissaires, et bientôt des rumeurs tinrent Néron pour responsable. On lui prêtait pour motivation l'intention d'immortaliser son nom en renommant Rome Neropolis. Il était important pour Néron d'offrir un autre objet à ce besoin de trouver un coupable. Il choisit pour cible une petite secte orientale, celle des chrétiens. Il ordonna que les chrétiens soient jetés aux lions dans les arènes, alors que d'autres étaient crucifiés en grand nombre.
Il est possible que certains passages de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament décrivent l'Antéchrist sous les traits Néron. L'ouvrage a peut-être été écrit par les chrétiens pour exprimer leur désarroi après la répression sanglante de Néron sur la secte. En 65, Néron fut impliqué dans un autre scandale, pris plus au sérieux par le peuple de cette époque qu'il ne le serait de nos jours. Il était considéré comme dégradant pour un empereur romain d'apparaître comme un amuseur public, jouant la comédie, chantant et jouant de la lyre. De plus, Néron ordonna que Gnaeus Domitius Corbulo, un général populaire et valeureux, se suicidât, pour faire suite à de vagues soupçons de trahison.
Cette décision poussa les commandeurs militaires, à Rome et dans les provinces, à envisager l'organisation d'une révolution. C'est également à cette époque, selon la tradition, que Néron a ordonné personnellement la crucifixion de Saint Pierre et, plus tard, la décapitation de Saint Paul. Le Sénat démit Néron, qui se suicida le 6 juin 68. On raconte qu'il prononça ces derniers mots avant de se poignarder à la gorge: "Quel artiste périt en moi !". Avec sa mort, la dynastie julio-claudienne prenait fin. Le chaos s'ensuivit lors de l'année des quatre empereurs.
► 54 Les Parthes envahissent l'Arménie alors sous contrôle romain.
► 55 février Assassinat (empoisonnement) de Britannicus, fils de Claude.
► 55 à 120 - naissance et mort de Tacite. Historien romain. Issu d'une famille prospère et influente, Tacite fait, grâce à ses talents d'orateur, une carrière politique brillante. Il obtient un consulat sous l'Empire de Nerva puis entre au Sénat, même s'il a longtemps critiqué les abus de rhétorique de ses membres. Historien officiel du régime, il fait néanmoins preuve d'un grand sens critique et participe à l'ouverture d'esprit des Romains. En effet, il démontre dans ses oeuvres, 'Vie d'Agricola' pour les Bretons (Anglais) et 'La Germanie' (l'Allemagne), que les peuples (que les Romains appellent uniformément 'Barbares') ont en réalité des cultures très diverses et élaborées. Dans un style que d'aucuns affirment comme le meilleur de tous les auteurs latins, il a aussi su dépeindre avec justesse les hommes et les moeurs de son temps.
► 57 Campagne de Corbulon (général de Néron) en Arménie contre les Parthes. Début de la campagne d'Arménie (fin en 63). Victoire de Corbulon contre Tiridate Ier d'Arménie et Vologèse Ier, roi des Parthes.
► 58 Troubles en Arménie, nouvelle campagne de Corbulon pour y rétablir l'ordre.
► 58 Othon est nommé gouverneur de Lusitanie (jusqu'en 68). Othon fut empereur romain de janvier à avril 69.
► 58 Prise et incendie d'Artaxata (en Arménie) par les armées romaines sous les ordres de Corbulon.
► 59 Mars Assassinat d'Agrippine la jeune par ordre de Néron.
► 59 Prise de Tigranocerte (Arménie) par les Légions de Corbulon.
23 - De 60 ( Rome s'empare du territoire des Icènes) à 99 ( Arrivée de Trajan à Rome)
► 60 Rome s'empare du territoire des Icènes à la mort de Prasutagus. Le roi icénien, Prasutagus meurt et laisse sa femme Boudicca et ses filles sous la protection de Néron. Le procurateur romain Catus Decianus, s'empare des biens des Icéniens, laisse violer ses filles devant Boudicca qui est flagellée.
► 60 Révolte de Boudicca (reine des Icéniens) contre l'occupation romaine en (Grande) Bretagne.
Boudicca reine des Icéniens - de google
► 60 Prise et massacre de Colchester par les armées de Boudicca.
► 60 Suetonius Paulinus (gouverneur romain) s'empare de l'île Mona (Anglesey au nord du pays de Galles) servant de refuge à la résistance celtique.
► 60 Victoire des armées de Boudicca contre la IXème Légion de Petillius Cerealis.
► 60 Les légions de Suetonius évacuent Londres qu'ils ne peuvent défendre.
► 60 Prise et massacre de Londres par les armées de Boudicca.
► 60 Défaite et Suicide de Boudicca contre les armées romaines de Suetonius Paulinus à Lichfield.
► 60 Écriture de 'l'Évangile selon Matthieu'. L'évangile selon Matthieu est l'un des quatre évangiles du Nouveau Testament. Les évangiles sont traditionnellement imprimés dans l'ordre suivant : Matthieu, suivi par Marc, puis Luc et enfin Jean. Ce livre est traditionnellement attribué à Matthieu, un collecteur d'impôts devenu l'apôtre de Jésus-Christ. Cependant, certains érudits modernes le considèrent comme anonyme. Il a été longtemps considéré comme étant le plus ancien des évangiles.
Les hypothèses modernes, en particulier la théorie des deux sources a remis en cause cette antériorité. D'après cette théorie et ses dérivées, l'évangile de Marc lui serait antérieur et aurait été l'une de ses sources, en compagnie de l'hypothétique source Q. Comme les auteurs des autres évangiles, l'auteur écrit ce livre selon ses plans et objectifs, à la fois de son propre point de vue et en empruntant à d'autres sources.
Selon l'hypothèse des deux sources, qui est la solution la plus acceptée au problème synoptique, Matthieu s'inspira de Marc et d'une source hypothétique appelée Q par les érudits (initiale de l'allemand Quelle, signifiant "source"). Peu d'indices dans l'évangile lui-même permettent de déterminer sa date de composition. Certains érudits pensent qu'il a été écrit avant la destruction de Jérusalem (Matthieu 24), probablement entre les années 60 et 65 après Jésus-Christ, mais d'autres le datent des années 70, voire de 85.
L'étude de cet évangile montre qu'il a été très probablement écrit à l'origine à destination des juifs. En effet, les nombreuses références aux prophéties de l'Ancien Testament ainsi que la généalogie de Jésus indiquent que l'auteur a voulu prouver aux juifs que Jésus était bien le Messie qu'ils attendaient. Par ailleurs, le Sermon sur la Montagne (Matthieu 5 --- 7, où se trouvent les Béatitudes) veut prouver aux juifs que contrairement à ce qu'ils croient, la loi judaïque, dans l'enseignement chrétien, est toujours en vigueur bien qu'elle doive être transcendée. Matthieu, ou saint Matthieu.
Pour l'Église catholique, les Églises des deux et trois conciles et pour l'Église orthodoxe, il est l'un des douze apôtres cités par les Évangiles. Dans la tradition chrétienne, il est souvent symbolisé par un homme (souvent ailé) parce que son évangile commence par la généalogie du Christ. Fête le 21 septembre en Occident et le 16 novembre en Orient. Né en Galilée, de son nom Lévi, il était publicain (percepteur des impôts) à Capharnaüm, employé au péage d'Hérode. Il suivit Jésus, devint apôtre et écrivit le premier évangile. Il prêcha aux Hébreux, écrivit pour eux son Évangile en araméen, traduit en grec, et mourut martyr en Ethiopie, en 61. Son corps fut transféré à Salerne. C'est à lui qu'est attribué traditionnellement le premier évangile canonique, bien que le texte ne l'affirme pas et que l'exégèse moderne ne le pense pas.
► 60 Écriture de 'l'Évangile selon Luc'. L'évangile selon Luc (kata Lukas, où kata signifie selon) a pour auteur Luc (médecin et, selon la légende, peintre, compagnon de saint Paul). Il n'a pas connu lui-même le Christ, durant son ministère public. Il a également composé les Actes des Apôtres, qui sont la suite de son évangile. Les deux livres sont pareillement dédiés à "Théophile" (personnage réel, ou peut-être fictif, figure de l'"ami de Dieu", Théo-phile). Les deux ouvrages ont été rédigés probablement dans les années 60, avant la destruction du Temple (en 70), et avant le martyre des apôtres Pierre et Paul à Rome (en 64 ou 67). Avec l'évangile selon Marc et l'évangile selon Matthieu, il fait partie des évangiles dits synoptiques. C'est le plus long des quatre évangiles, retenus dans le Nouveau Testament. Saint Luc est un médecin syrien parmi les premiers convertis au christianisme et à l'évangélisation de l'Empire romain par l'apôtre évangéliste saint Paul dont il devient le disciple.
Il est collecteur de témoignages oculaires de la vie de Jésus Christ qu'il n'a pas connu personnellement et un des quatre évangélistes en grec ancien de la Bible chrétienne. Son évangile selon saint Luc est le troisième du Nouveau Testament qui fait partie des trois évangiles dits "synoptiques" avec l'évangile selon saint Matthieu et l'évangile selon saint Marc. Luc donne le récit le plus détaillé de la naissance et de l'enfance de Jésus de Nazareth et est généralement considéré comme l'auteur du livre des Actes des Apôtres qui suit les quatre évangiles dans le Nouveau Testament.
► 61 Vologèse Ier, roi des Parthes revendique de nouveau le trône d'Arménie.
► 61 Caesannius Paetus remplace Corbulon à la tête des troupes d'Arménie.
► 61 Galba reçoit le gouvernement de l'Espagne.
► 62 Caesannius Paetus et ses troupes sont assiégés à Rendeia par les Parthes.
► 62 Caesannius Paetus capitule à Rendeia, trois jours avant l'arrivée de Corbulon.
► 62 Burrus (ou Burrhus préfet du prétoire, c'est à dire commandant de l'Armée de Néron) meurt, la rumeur veut que Néron l'ait empoisonné, Sénèque perd un appui précieux, le règne va s'enfoncer dans les crimes. La préfecture du prétoire est partagée entre l'incapable Foenius Rufus et Tigellinus, redoutable intrigant, qui flatte les vices du maître. Il utilise de manière abusive la loi de lèse-majesté pour se débarrasser des nobles les plus en vue.
Sénèque - de google
► 62 Exécution de Rubellius Plautus sur les ordres de Néron.
► 62 Exécution de Cornellus Sylla sur les ordres de Néron.
► 62 Vitellius. Vespasien (Titus Flavius Sabinus Vespasianus) futur empereur romain de 69 à 79. Vitellius (Aulus Vitellius Germanicus) (24 septembre 15 - 22 décembre 69) est un empereur romain ayant régné du 2 janvier 69 au 22 décembre de la même année.
► 62 Juin Néron répudie Octavie pour stérilité, l'accuse d'adultère et la fait exiler sur l'île de Pandataria.
► 62 19 juin Octavie est exécuté sur ordre de Néron.
► 62 Mariage de Néron avec Poppée.
► 63 21 janvier Naissance de Claudia, fille de Néron et Poppé (elle meurt en mai).
►63 Traité de Rhandeia (Cappadoce) fixant la frontière romano-Parthe sur l'Euphrate et L'Arménie revient à la dynastie arsacide d'Iran mais l'investiture de ses rois dépend des empereurs romains. Tiridate Ier, qui s'est rendu à Rome auprès de Néron, peut ainsi devenir roi d'Arménie, inaugurant l'installation d'une dynastie arsacide dans ce pays.
Il reconstruit Artachat rebaptisée initialement Néronia. La Cappadoce est un ancien pays d'Asie mineure, actuellement située en Turquie. L'Euphrate est un fleuve d'Asie de 2 780 km de long. Il prend sa source en Arménie turque, puis passe par la Syrie pour arriver en Iraq. Il traverse l'Iraq du nord-ouest vers le sud-est, passant par Fallujah au centre du pays, et puis environ 10 km à l'ouest des ruines de Babylone. Il rejoint le Tigre dans le sud-est du pays environ 100 km au nord-ouest de Bassorah pour former le Chatt-el-Arab et se jeter dans le golfe Persique. La Mésopotamie, du grec "milieu" et "fleuve", entre le Tigre et l'Euphrate, est l'un des berceaux de la civilisation.
► 63 Pline l'Ancien écrit son 'histoire naturelle' résumant les données botaniques de son époque. Pline l'Ancien, est né en 23 à Novum Comum (Côme) et mort en 79 à Stabies, près de Pompéi lors de l'éruption du Vésuve. Il fut un important auteur et naturaliste romain, notamment auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée 'Histoire naturelle'. Il adopta son neveu Gaius Plinius Caecilius Secundus qui prit le nom de Pline le Jeune en 79. 'Naturalis Historia', qui compte 37 volumes, est le seul ouvrage de Pline l'Ancien qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce document fut longtemps la référence en matière de connaissances scientifiques et techniques. Pline compila le savoir de son époque sur des sujets aussi variés que les sciences naturelles, l'astronomie, l'anthropologie, la psychologie ou la métallurgie.
► 63 Suicide de Torquatus Silanus accusé par Néron sans preuve et probablement faussement, d'inceste, est exilé et se suicide.
► 64 19 Juillet, le feu a pris dans Rome, et l'on a vu des soldats courir dans la cité avec des torches enflammées. Néron, en apprenant la nouvelle, alors qu'il se reposait au bord de la mer, aurait chanté des extraits du poème d'Homère sur l'incendie de Troie. Il n'en fallait pas plus à Suétone et à Pline pour accuser Néron d'avoir fait incendier Rome. Celà ne semble pas très plausible. Si Néron avait voulu se donner le spectacle d'un gigantesque incendie, il avait les moyens de le faire allumer ailleurs, et surtout pas à proximité du nouveau palais impérial qui renfermait de magniques oeuvres d'art admirées par l'empereur. Voulait-il reconstruire Rome à son goût ? Il aurait alors fallu détruire les quartiers populaires, insalubres. Ce sont ceux qui ont été le moins atteints... Suétone, est un historien romain né dans le milieu des années 70 de notre ère et mort vers 130. Il est issu d'une famille de récente chevalerie, probablement romaine.
► 64 Construction de l'énorme palais de Néron, la Domus Aurea (Maison Dorée), édi-fié en l'an 64, après le grand incendie de Rome. La Domus aurea est un immense palais impérial de la Rome antique, construit par Néron, qui couvrait une partie importante de Rome intra muros. Elle comportait plusieurs bâtiments distincts, de vastes jardins, un lac artificiel. Après la mort de Néron, l'espace occupé fut rendu aux Romains : le lac devint par exemple le Colisée, amphithéâtre dédié aux jeux nautiques. La Domus transitoria ayant été détruite par l'incendie de 64 apr. J.-C., l'empereur Néron confie à deux architectes, Severus et Celer (Tacite, Annales, XV, 42), la construction d'un somptueux palais qui doit s'étendre du mont Palatin au mont Caelius (le Celio). Constitué de vastes appartements et de salles d'apparat, l'ensemble comprend en outre des bains, des maisons de campagne, des cryptoportiques et des jardins où se dressent des colonnades qui se reflètent dans des nymphées.
►65 Avril Échec de la conjuration de Pison, arrestation-exécution des conjurés. Pison, aristocrate jouisseur et débauché issu de la très ancienne famille des Calpurnii, feignait hypocritement la vertu pour séduire ses commensaux, les nobles réactionnaires hostiles à la politique de Néron. Hautain et dédaigneux, il affectait de compatir aux misères du peuple pour séduire une plèbe qu'il méprisait mais dont le soutien était indispensable en cas de coup d'état.
►65 Suicide de Pison.
►65 Suicide de Sénèque impliqué dans la conjuration de Pison.
►65 Mort de Poppée sous les coups de Néron.
►66 Début des troubles à Césarée (Judée). La ville de Césarée en Israël est située sur la côte méditerranéenne, au sud de la ville de Dor.
►66 Mariage de Néron avec Statilia Messalina.
►66 Juin Révolte juive à Jérusalem. Première guerre judéo-romaine, Un jour de shabbat, en l'an 66, à Césarée, un homme sacrifie des oiseaux à l'entrée de la synagogue, ce qui provoque la colère des Juifs. Il s'ensuit des batailles de rue entre Juifs et païens. Une délégation de Juifs se rend à Sébaste auprès du procurateur Gessius Florus qui fait la sourde oreille. Les troubles atteignent Jérusalem. Florus choisit ce moment pour prendre 17 talents dans le trésor du Temple, ce qui entraîne une réaction en chaîne de révoltes et de représailles. Après avoir essayé de réprimer la révolte dans le sang, Florus se retire à Césarée tandis que les insurgés s'emparent de l'esplanade du Temple. Un essai de conciliation d'Agrippa II et de Bérénice est rejeté.
À l'instigation d'Eléazar, fils du grand-prêtre Ananie, les révoltés s'emparent de Massada et font cesser les sacrifices quotidiens pour l'empereur. Sous la direction d'Agrippa II et des Hérodiens, des familles des grands-prêtres et des notables pharisiens, les partisans de la paix essayent de réduire les révoltés par la force. L'armée d'Agrippa II est battue dans Jérusalem, Ananie est assassiné, les palais royaux sont incendiés et les derniers Romains exécutés. Une rébellion éclate à Césarée. Le mouvement se répand à toute la Palestine où Juifs et Gentils s'affrontent. Plusieurs milliers de Juifs périssent dans les émeutes à Alexandrie.
►66 juin Vespasien est envoyé en Judée à la tête de 3 légions pour réprimer la révolte.
►66 août Prise de la forteresse Antonia, tenue par les troupes Hérode II, roi de Judée, par les rebelles juifs.
►66 août Massacre de la population juive à Césarée.
►66 novembre Victoire des rebelles juifs contre les armées de Cestius, gouverneur de Syrie à Bethoron. Le gouverneur de Syrie Cestius Gallus attaque Jérusalem avec la XIIe légion. Il s'empare du faubourg nord mais échoue devant le Temple et se retire, puis tombe dans une embuscade près de Beth-Horon. Il perd plus de cinq mille fantassins et presque quatre cents cavaliers. Cette victoire change la révolte en guerre d'indépendance à laquelle se rallient les autorités traditionnelles : grands-prêtres, leaders pharisiens, sadducéens et esséniens. La révolution s'organise et le pays divisé en sept districts : Joseph ben Gorion et le grand-prêtre Anne sont chargés de Jérusalem, Jésus ben Sapphias et Eléazar ben Ananias de l'Idumée, Joseph fils de Mattathias (Flavius Josèphe) organise la Galilée.
►66 septembre Départ de Néron pour la Grèce.
►66 Tiridate accepte de recevoir la couronne d'Arménie de Néron. Tiridate Ier fut un roi d'Arménie. Il fut vaincu par le général romain Corbulon. Mais il pris sa revanche, et fut couronné roi par Néron en 66.
►67 Martyre des apôtres Pierre et Paul. Pierre, selon les Évangiles et le livre des Actes des Apôtres, Simon de Bethsaïde dit (Képhas) = Pierre [début du Ier siècle (v. 10)/Rome, 29 juin 64, selon une certaine tradition] est l'un des douze apôtres de Jésus. Pierre est considéré comme un saint, entre autres, par l'Église catholique et comme le premier pape. Selon la tradition (catholique et orthodoxe), après avoir évangélisé Antioche et en avoir été l'évêque, Pierre est parti à Rome, en est devenu le premier évêque [v.42/67 (les années de Saint-Pierre)] et est mort en martyr (crucifié la tête en bas par "humilité" vis-à-vis de Jésus - "Croix de Saint-Pierre") à l'emplacement du mont Vatican ou sur les pentes du Janicule (emplacement marqué par Saint-Pierre-in-Montorio).
Paul, Paul de Tarse ou saint Paul est considéré comme l'une des figures centrales du christianisme primitif, par le rôle qu'il a joué dans son développement, et par son interprétation de l'enseignement de Jésus. Selon le Nouveau Testament (livre des Actes des Apôtres et les lettres de Paul), Paul se revendique comme l'un des principaux disciples (comme un apôtre) de Jésus-Christ qui lui serait apparu et l'aurait converti, quelques années après sa mort. Il eut un rôle de première importance dans le développement et la diffusion du christianisme primitif, au point que certains théologiens, estimant que Paul donne un enseignement différent de celui de Jésus de Nazareth, le considèrent comme le véritable fondateur du christianisme.
►67 Mars-avril Arrivée de Vespasien à Antioche. En 67, le général Flavius Vespasien est envoyé par Néron avec trois légions. Il occupe Sepphoris en Galilée (printemps), assiège Flavius Josèphe dans Yotpata qui est prise. Flavius Josèphe se rend. Vespasien fait la jonction avec Agrippa II, s'empare de Tibériade et de Tarichée, puis de Gamala et du mont Thabor. À la fin de l'année, le nord de la Palestine et la région côtière au sud de Jaffa sont soumis.
►67 22 mai Prise de Gadara par les armées de Vespasien. Gadara, cité fortement hellénisée (grecque) située dans la Décapolis (actuellement Um Qeis, en Jordanie).
►67 1er juillet Prise de Jotapata (Galilée) par les armées de Vespasien.
►67 Suicide de Corbulon convoqué à Corinthe par Néron pour lui annoncer sa condamnation.
►67 Suicide des deux légats de Germanie en Grèce, convoqués par Néron.
►67 22 octobre Prise de Gomala (Judée) par les armées de Vespasien.
►68 Mars Retour triomphal de Néron à Rome.
►68 Mars Révolte de Vindex, gouverneur de Lyon qui proclame Galba empereur. Gaius Julius Vindex était un gouverneur romain de la province Gallia Lugdunensis (Bretagne, Normandie actuelles et le pourtour parisien) qui s'est rebellé contre l'Empereur Néron en 68. Il prit rapidement contact avec certains de ses homologues gouverneurs. Tous le dénoncèrent auprès du prince sauf le gouverneur de Taraconnaise et futur empereur Galba.
Ce dernier entra bientôt dans la révolte et devint le meneur d'une révolte qui se métamorphosait en guerre civile. Rufus se dirigeant vers Vesontio pour en faire le siège, Vindex dut s'y rendre afin déviter la prise du chef lieu de la capitale des Séquanes. Ils entrèrent tout deux en contact et selon Jean d'Antioche se mirent d'accord afin de se partager le pouvoir. Vindex devait alors recevoir l'Espagne sans avoir obtenu le consulat, Rufus voyait son gouvernement étendu à l'ensemble des Gaules et Galba était reconnu Princeps. Cependant, le sort en voulut autrement.
Alors que l'armée des révoltés faisait marche de façon désordonnée, les légions de Germanie prirent l'initiative sans recevoir d'ordre de leur général de les attaquer. Cette affrontement, qui aujourd'hui encore est entouré d'un halo de mystère, vit périr 20 000 Gaulois ce qui mena Vindex à se suicider. Bien qu'il fut défait et tué par le général Lucius Verginius Rufus à la fin mai ou au début juin de l'année 68, la rebellion de Vindex était le début d'une série de soulèvements contre le Princeps. Bien que Vindex se suicida lors d'une bataille qui en toute logique n'aurait pas due avoir lieu, son objectif avoué se réalisa. Néron chuta et fut remplacé par Marcus Sulpicius Galba qui inaugurait une année de troubles durant laquelle se succédèrent quatre empereur. (Galba, Othon, Vitellius, et Vespasien)
►68 avril Soulèvement de Galba, gouverneur en Espagne Tarraconaise.
►68 avril Défection d'Othon légat commandant les Légions d'Afrique.
►68 mai Défaite de Vindex près de Besançon face à Verginius Rufus à la tête de l'armée du Rhin.
►68 mai Prise de Jéricho par les armées de Vespasien. La révolte se durcit face à la menace romaine. La guerre civile éclate à Jérusalem où Jean de Gischala et les Zélotes prennent le pouvoir et imposent comme grand-prêtre Pinhas de Habta, probablement sadocide. Appuyés par un groupe d'Iduméens, les Zélotes liquident les notables et les membres des grandes familles sacerdotales. En 68, Vespasien soumet la Pérée (mars), occupe Antipatris, Lydda, Jamnia, Emmaüs, traverse la Samarie et descend sur Jéricho. Il cesse les opérations militaires à l'annonce de la mort de Néron (9 juin). Jéricho est une ville de Cisjordanie (Moyen-Orient), située sur la rive ouest du Jourdain; c'est la ville la plus basse du monde avec une altitude proche de -240 m. Jéricho est une des plus anciennes cités du monde, dont la fondation remonterait au VIIIe millénaire avant JC, donc à une période où le niveau de la Mer Morte était vraisemblablement beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui.
►68 9 juin Le Sénat déclare Néron ennemi public et reconnaît Galba empereur.
►68 GALBA (de 68 à 69) (Servius Sulpicius Galba)
►68 Galba. Terracina vers 3 av. J.-C. - Rome 69 apr. J.-C., empereur romain (68-69). Successeur de Néron, il fut assassiné par les partisans d'Othon.
►68 11 juin Suicide de Néron, marquant le début d'une nouvelle guerre civile. Déclaré ennemi public par le sénat, Néron fuit Rome et, plutôt que de se suicider, choisit de se faire tuer par un affranchi. L'empereur romain avait sombré dans la folie et la cruauté. Il avait fait assassiner tous ses ennemis politiques, mais aussi sa mère, Agrippine, son frère, Britannicus, et avait tué sa femme, Octavie. Des mouvements de révolte avaient alors éclaté dans l'Empire et le sénat avait désigné Galba, le gouverneur de l'Espagne Tarraconaise, comme le nouvel empereur romain.
►68 Vitellius reçoit le commandement de l'armée de Germanie inférieure.
►68 octobre les armée de Galba entrent dans Rome.
►69 2 janvier Les armées de Germanie Supérieures proclament Vitellius empereur.
►69 10 janvier Galba adopte publiquement Pison.
►69 15 janvier Assassinat de Galba et Pison par les Prétoriens qui proclament Othon empereur.
►69 OTHON (69) (Marcus Salvius Otho)
►69 Othon fut empereur romain de janvier à avril 69. Né en 32 à Ferentinum (ou Ferentium) en Étrurie, mort à Bedriacum le 16 avril 69, Marcus Salvius Otho est issu d'une famille de notables (grand-père sénateur, père proconsul d'Afrique sous Tibère, élevé au rang de patricien par l'empereur Claude, etc). Selon Suétone, Othon fut un personnage assez peu recommandable et disposé à tout pour parvenir à ses fins. Il séduisit ainsi une vieille femme dans le seul but d'entrer en contact avec Néron dont il deviendra l'un des favoris. On lui prête une complicité homosexuelle avec l'empereur.
Suétone prétend que mis au courant de l'intention de Néron d'assassiner Agrippine sa mère, il lui prête une assistance concrète en organisant un repas le soir du meurtre pour donner le change. Il tombe cependant en disgrâce en refusant de restituer Sabina Poppaea qu'il avait épousée pour complaire à Néron, mais dont il tomba réellement amoureux. En conséquence de quoi, il fut exilé 10 ans en Lusitanie où il officia comme ancien questeur avec une modération et un désintéressement exceptionnels. Cherchant à se venger, il prête son concours à Galba pour se débarrasser de Néron, mais quand il apprend que Galba a adopté Pison, il voit ses rêves d'accession au pouvoir suprême s'écrouler.
Criblé de dettes, il n'a d'autre solution que de se débarrasser par le meurtre de Galba et de Pison. La conjuration est passablement improvisée, mais elle réussit. Il se présente aussitôt au Sénat. Sa route est barrée par Vitellius qui vient de se faire proclamer en Germanie. Othon part l'affronter et, après quelques petites victoire dans le nord de l'Italie, finit par être vaincu à Bedriacum. Othon décide alors de se donner la mort avec une dignité qui surprend Suétone.
►69 14 mars Othon quitte Rome à la tête de son armée à la rencontre de Vitellius.
►69 14 avril Victoire de Vitellius sur Othon à Bedriacum.
►69 15 avril Suicide d'Othon.
►69 VITELLIUS (69) (Aulus Vitellius)
►69 Vitellius (Aulus Vitellius Germanicus) (24 septembre 15 - 22 décembre 69) est un empereur romain ayant régné du 2 janvier 69 au 22 décembre de la même année. Aulus Vitellius est le fils de Lucius Vitellius, consul et gouverneur de Syrie sous Tibère. Vitellius passa sa jeunesse à Capri au milieu des mignons de l'empereur Tibère.
Il s'attira ensuite les faveurs de Caligula par ses qualités de conducteur de char et celles de Claude et Néron par ses qualités au jeu de dés. L'amitié de ces empereurs lui permet d'être tout d'abord consul en 48, puis aux alentours de 60-62 proconsul d'Afrique. Après la chute de Néron, il est nommé, à la surprise générale, commandant des légions de Germanie inférieure par Galba. C'est là qu'il réussit à se faire apprécier par ses subalternes et ses soldats, pour son indulgence. Vitellius était loin d'être ambitieux, il était plutôt paresseux et très attiré par la nourriture et la boisson.
À la mort de Galba, assassiné par Othon, Vitellius est proclamé empereur, ou plus précisement empereur des armées de Basse et Haute Germanie par ses légions le 2 janvier 69 à Colonia Agrippinensis (Cologne). Au même moment Othon est proclamé empereur à Rome par la garde prétorienne dirigée par Nymphidius Sabinus. Vitellius partage alors ses légions en deux groupes. Il prend le commandement de l'un et envoie l'autre contre Othon. Il doit son accession au trône à ses deux généraux Caecina et Valens qui commandaient les deux légions du Rhin : ceux-ci franchissent les Alpes et battent l'armée d'Othon à la Bataille de Betriac, le 14 avril 69. Othon se suicide deux jours plus tard et Vitellius marche sur Rome en vainqueur.
Le 19 avril, le Sénat romain entérine la nomination de Vitellius comme empereur. L'armée de Vitellius se livre sur son chemin au pillage et au massacre, le nouvel empereur fait lui aussi preuve d'une grande cruauté et devient rapidement impopulaire. Le premier juillet, les troupes d'Égypte proclament Vespasien empereur. En apprenant la nouvelle les légions de Mésie, de Pannonie, et de Dalmatie se révoltent aussi et prêtent serment à Vespasien. Celui-ci venait d'écraser la révolte des Juifs et représentait une meilleure stabilité aux yeux des Romains.
À Rome les premiers troubles commencent, Vitellius pour étouffer la révolte fait alors tuer, en incendiant le Capitole, Flavius Sabinus, le préfet de la ville et frère de Vespasien. Antonius Primus qui commande les légions du Danube envahit l'Italie du nord et bat l'armée de Vitellius à Crémone à la fin du mois d'octobre 69. Il prend ensuite la direction de Rome. Les uns après les autres les alliés de Vitellius se rallient à Vespasien. Vitellius tente tout pour négocier une paix, sans succès. Alors que les premiers éléments de l'armée de Primus pénètrent dans Rome, il tente de s'enfuir, et se cache dans la loge du portier de son palais. Capturé par les hommmes de Primus il est reconnu et lapidé par la foule romaine, son corps est traîné par un croc et jeté dans le Tibre. Domitien le fils cadet de Vespasien est alors nommé césar en attendant l'arrivée de l'empereur Vespasien à Rome à la fin de l'année 70.
►69 19 avril Le Sénat entérine le titre impérial à Vitellius.
►69 1er juillet Les légions d'Orient proclament Vespasien empereur.
►69 17 juillet Vitellius entre dans Rome.
►69 août Les légions du Danube se rallient à Vespasien.
►69 3 septembre Antonius (pro-Vespasien) s'empare de Padoue. Padoue est une ville située dans le nord de l'Italie à 40 kilomètres de Venise, sur la rivière Bacchiglione.
►69 17 septembre Caecina (général romain) à la tète des armées de Vitellius quitte Rome à la rencontre des armées de Vespasien.
►69 24-25 octobre Victoire des armées de Vespasien sur celles de Vitellius près de Crémone.
►69 18 décembre Capitulation de Vitellius.
►69 20 décembre Antonius Primus, allié de Vespasien s'empare de Rome. Quelques chefs militaires voulurent devenir empereur. Parmi ceux-ci, Vitellius, commandant des légions de Germanie s'empara du pouvoir impérial et Vespasien, en Orient avec ses armées qui le proclamèrent empereur. Antonius Primus prit le parti de Vespasien. Gagnant victoire sur victoire, Antonius Primus se rapprochait de Rome.
Voyant cela, Vitellius lui envoya ses meilleures légions en octobre 70 à Crémone. Après une bataille sanglante, Antonius Primus vainquit Vitellius. Il essaya de négocier avec Vitellius pour éviter que le sang des Romains des deux côtés ne coule. Mais Vitellius changea d'avis et assassina le frère de Vespasien, lui aussi partisan de la conciliation. Les hostilités reprirent. Vitellius, abandonné par les siens, fut à son tour assassiné par les fidèles de Vespasien. Arrivé à Rome en pleine gloire, pendant quelques jours, il put penser devenir empereur. Sa fidélité à Vespasien l'en empêcha et Vespasien fut empereur.
►69 21 décembre exécution de Vitellius. L'Empereur Vitellius est égorgé en plein coeur de Rome par les partisans du général Titus Flavius Vespasien. Ce dernier avait été proclamé empereur par les légions du Danube et de l'Orient le 1er juillet avant l'assassinat de Vitellius. Vespasien fera une entrée triomphale dans Rome dix mois après la victoire de ses partisans. Le nouvel empereur mettra fin à la grave crise de succession ouverte par la mort de Néron en 68 et règnera sur l'empire pendant 10 ans.
L'Empereur Vitellius
►69 VESPASIEN (69 à 79) (Titus Flavius Vespasianus)
►69 Vespasien (Titus Flavius Sabinus Vespasianus) (9-79) est un empereur romain. Il fut proclamé Auguste le 1er juillet 69 à Alexandrie par les légions d'Orient, et instaura la dynastie des Flaviens, alors qu'il réprimait la révolte juive. Il partit alors immédiatement pour Rome, laissant son fils Titus achever le siège de Jérusalem. Son règne mit fin à la guerre civile qui suivit la mort de Néron, et il fut le dernier empereur de l'année des quatre empereurs (69). Il se consacra à la restauration politique et économique de Rome. Il ordanne aussi la construction du célèbre "amphithéâtre flavien", plus connu sous le nom de colisée. Ses fils Titus puis Domitien lui succédèrent.
►69 22 décembre Le Sénat accorde le titre impérial à Vespasien.
►70 Août Le général romain Titus, fils de Vespasien, s'empare de Jérusalem et détruit le Second Temple de Jérusalem. Cet évènement, particulièrement douloureux dans l'histoire des Juifs, est commémoré chaque année le 9 Av. Les troupes de Titus attaquent Jérusalem par le nord (30 mai 70), prennent la première puis la seconde muraille. Jean de Gischala défend l'Antonia et le Temple et Simon Bar-Giora la ville haute. Titus renforce le siège (juillet). La famine se fait sentir. Le 6 août, les sacrifices quotidiens dans le Temple cessent.
Titus s'empare de l'Antonia et brûle les portes extérieures du Temple, puis attaque le Temple qui est complètement brûlé (28 août). Il s'empare enfin de la ville haute où s'étaient réfugiés Simon Bar-Giora et Jean de Gischala. Jérusalem est rasée, sauf les trois tours du palais d'Hérode (Hippicus, Phasaél et Mariamne) et une partie de la muraille. Les Romains créent la province de Judée, distincte de la Syrie. Le Sanhédrin est dissout. Le culte sacrificiel cesse d'être célébré. À l'automne 70, des centaines de milliers de prisonniers juifs sont tués dans des spectacles publics à Césarée. Titus, Flavius Vespasianus, fils de Vespasien, appartenant à la dynastie des Flaviens, était empereur romain de 79-81.
► 70 8 septembre Prise et incendie de Jérusalem par les armées romaines.
► 70 Sabinus devient empereur des Gaulois, soulève la Gaule avant de se faire battre par les Romains. Un Batave Civilis souleva ses troupes en Belgique alors que Vitellius et Vespasien s'affrontaient pour l'Empire. Le Lingon Julius Sabinus, officier gaulois aidé par deux officiers trévires vint à bout de trois légions romaines en garnison sur les bords du Rhin. Il brisa les tables de Lyon et se fit même proclamer "César", mais fut bientôt vaincu par les Séquanes. Pris par les Romains après avoir vécu caché durant neuf années, il finit supplicié avec son épouse. Julius Sabinus est un gaulois du peuple des Lingons. C'est un officier naturalisé romain comme l'indique son nom. En 69, profitant de la période de troubles qui secoue l'Empire romain (année des quatre empereurs et des troubles déclenchés sur le Rhin par les Bataves, il déclenche une révolte en Gaule belgique. Après avoir été vaincu, il est resté caché puis a été découvert, emmené à Rome ainsi que sa femme Eponime et ses deux fils jumeaux.
Julius Sabinus, Éponine - de google
► 70 Écriture de 'l'Évangile selon Marc'. L'évangile selon Marc (kata Markon) forme avec les trois autres évangiles, le coeur du Nouveau Testament, la partie la plus récente de la Bible. Le deuxième (par sa place) des quatre évangiles canoniques est aussi le plus bref et probablement le plus ancien ; c'est l'un des évangiles synoptiques. Son auteur est Marc, généralement identifié au Marc compagnon de Paul, puis de Pierre, qui nous est connu par le Nouveau Testament, spécialement les Actes des Apôtres et les épîtres de Paul et de Pierre.
Il a probablement été écrit avant la catastrophe de 70 (après Jésus-Christ) car dans le discours eschatologique de Mc 13 il n'est fait aucune distinction entre la ruine de Jérusalem et la fin du monde. Il a certainement été écrit après la catastophe de 70 car il sait que le Temple sera détruit. Or il est écrit dans Ezéchiel (46.15) que les sacrifices du Temple sont éternels. Donc la ruine du Temple doit coïncider avec la fin du monde. Les 'logia' de l'apôtre Matthieu, rédigés en langue hébraïque, dont l'existence nous est connue par la tradition, et qui étaient sans doute plus anciens, n'avaient probablement pas la forme d'un évangile, mais plutôt celle d'un recueil de sentences ou de discours. Marc né Jean surnommé Marcus, est un des premiers convertis au christianisme et à l'évangélisation de l'Empire romain par l'apôtre Pierre.
Il est disciple évangéliste des apôtres Pierre et Paul et l'auteur de l'Évangile selon Marc du Nouveau Testament. Il est le fondateur et le premier pape de l'Église chrétienne orthodoxe (Église chrétienne d'Orient et de la partie grecque de l'empire romain). Son Évangile est le second du Nouveau Testament et le premier des trois évangiles dits "synoptiques" avec l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc.
Les armées romaines mettent le siège devant Massada. Massada, qui signifie forteresse en hébreu. Le site, constitué de plusieurs palais et de fortifications antiques, se trouve en Israël au sommet d'une montagne isolée sur la pente est du désert de Judée, il surplombe la Mer Morte.
► 71 Vespasien nomme son fils Titus préfet du prétoire.
► 71 Juin Double triomphe de Titus et Vespasien à Rome.
► 72 Annexion de la Commagène. La Commagène, province antique située au pied du Taurus, sur la rive droite de l'Euphrate.
► 72 Vespasien ordonne la construction du Colisée. Colisée, est un amphithéâtre de Rome qui pouvait accueillir de 45 000 à 50 000 spectateurs. Il forme une ellipse de 527 m. de circonférence, de 188 m. de long pour 156 m. de large. Les quatre étages culminent de nos jours à 48,5 m. L'arène, quant à elle, mesure 86 m. sur 54 m. Sa construction commença sous le règne de Vespasien aux alentours de l'an 70 et fut terminée par son fils Titus en 80. Le Colisée a été construit sur un site près de l'énorme palais de Néron, la Domus Aurea (Maison Dorée), édifié en l'an 64, après le grand incendie de Rome. Il y avait une grande statue de Néron (Colossus en latin), proche du site, d'où l'amphithéâtre a tiré son nom.
► 73 Titus est fait censeur avec son père.
► 73 2 mai Prise de Massada, dernière ville révoltée de Judée par Lucius Flavius Silva.
► 74 Édit d'expulsion des astrologues et des philosophes de Rome.
► 74 Conquête des Champs Décumates. Champs décumates, les territoires gagnés par les Romains sur la rive droite du Rhin reçurent le nom de Champs décumates (Agri decumates).
► 77 Cneius Julius Agricola est nommé Gouverneur de (Grande) Bretagne. Cneius Julius Agricola (13 juillet 40 à Fréjus - 23 août, 93 à Rome) fut un général romain, artisan d'une grande partie de la conquête de la Grande-Bretagne.
► 79 Début de la campagne d'Agricola en Écosse (jusqu'en 83).
► 79 24 juin Mort de Vespasien à Aquae Cutiliae, Titus, son fils devient empereur.
►79 TITUS (79 à 81) (Titus Flavius Vespasiannus)
►79 Titus Flavius Vespasianus, appartenant à la dynastie des Flaviens, était empereur romain de 79-81. Il était le fils aîné de l'empereur Vespasien avec lequel il partagea le pouvoir avant de lui succéder. Il est resté célèbre pour avoir pris Jérusalem, en 70, après un long siège. L'arc de Titus, bien conservé, fut érigé pour commémorer cette victoire par son frère Domitien, devenu empereur. Durant la campagne de Judée, Titus s'était épris de Bérénice, fille du roi Hérode Agrippa Ier, qui assistait son frère Agrippa II dans l'exercice du pouvoir (selon les Actes des Apôtres). Il l'emmena à Rome, mais devant la désapprobation des Romains, dut renoncer à l'épouser. Leur séparation "invitus invitam" est le sujet de deux tragédies de Corneille et de Racine. D'une grande bonté et prodigalité, Titus bénéficia d'une extrême popularité durant son court règne, malgré les grands fléaux qui survinrent alors : l'éruption du Vésuve en 79, puis la peste et un incendie qui anéantit une partie de Rome l'année suivante. C'est sous son règne que fut achevé le Colisée, commencé sous Vespasien, et que furent édifiés les Thermes qui portent son nom.
►79 24 août Éruption du Vésuve entraînant la destruction de Pompéi et d'Herculanum. Pompéi, était une ville de Campanie en Italie près de Naples au pied du Vésuve, fondée au VIe siècle av. J.-C. En 79, elle fut entièrement ensevelie avec Herculanum et Stabies, lors d'une éruption plinienne de ce volcan. Oubliée pendant 1 600 ans, elle fut redécouverte par hasard pour devenir aujourd'hui l'un des fleurons de l'archéologie et un extraordinaire témoignage de l'Empire romain.
►80 Nouvel incendie à Rome.
►80 Le Colisée de Rome est achevé
►80 Dioscoride écrit un traité classant les végétaux selon leurs propriétés alimentaires, médicinales, aromatiques, et vénéneuses. Dioscoride né vers 40 à Anazarba en Turquie et mort vers 90, est un médecin grec dont l'oeuvre a été la source principale de connaissance en matière de plantes médicinales durant l'Antiquité. Elle est encore utilisée jusqu'au XVIe siècle.
►80 Invention par Héron d'Alexandrie de l'éolipyle, première machine à vapeur et à réaction. Héron d'Alexandrie ou Héron L'Ancien était un ingénieur, un mécanicien et un mathématicien grec du Ier siècle après J.-C.
►80 Écriture de 'l'Évangile selon Jean'. L'évangile selon Jean fut probablement écrit vers la fin du Ier siècle de notre ère, soit après les trois autres évangiles dits "synoptiques" qu'il complète. Clément d'Alexandrie (150 env. -215 env.) l'appelait l'"évangile spirituel". On a concédé à Jean le symbole de l'aigle (parmi les "quatre Vivants" de l'Apocalypse : cf. Ap 4,6-8) : c'est en effet l'animal qui, dit-on, vole le plus haut, et peut regarder le soleil en face... L'évangile selon saint Jean se distingue par son ton et son style, qui est tout sauf prosaïque : il a un caractère solennel qui évoque la liturgie, la poésie.
Pourtant, il est parmi les quatre évangiles canoniques celui qui a le vocabulaire le plus pauvre, le plus limité. Son langage est symbolique, figuratif. Le fait qu'un terme (comme "élevé" (3,14), à propos de la crucifixion) pût avoir un sens double, et devenir source d'équivoque était plus qu'une affaire de style : c'était aussi le coeur du drame – "les ténèbres n'ont pas reçu la lumière" (Jn 1,5). Spécialement depuis saint Irénée, qui identifie Jean l'apôtre, Jean l'Ancien (ou le presbytre) et le "disciple bien-aimé", l'ensemble de la littérature johannique (les 3 épîtres, l'Apocalypse, l'évangile) sont attribués à Jean l'apôtre, le fils de Zébédée, qui nous est bien connu par le témoignage des évangiles synoptiques, et celui des Actes des Apôtres.
Jean, selon les évangiles et le livre des Actes des Apôtres, Jean est l'un des douze apôtres de Jésus. Son père s'appelle Zébédée. Sa mère est Marie Salomé et il a pour frère un autre apôtre : Jacques le Majeur. On l'appelle Jean l'Apôtre ou Jean l'Évangéliste ou Jean le Théologien pour le distinguer de Jean le Baptiste, précurseur et prophète de Jésus. On lui attribue l'Évangile qui porte son nom, le "Quatrième Évangile", pour le distinguer des trois autres, dits "Évangiles synoptiques" ainsi que le Livre de l'Apocalypse, dit aussi Apocalypse de Jean.
►81 13 septembre Mort de Titus à Aquae Cutiliae, Domitien, second fils de Vespasien devient empereur.
►81 14 septembre Le Sénat accorde le titre impérial à Domitien.
►81 DOMITIEN (81 à 96) (Titus Flavius Dominatius)
►81 Domitien (Titus Flavius Domitianus) fut empereur romain de 81 à 96. Domitien est né le 24 octobre 51 (an 804 de Rome), fils cadet de Vespasien et de Domitille, frère et successeur de Titus. Domitien reçut le titre de César en décembre 69, donc d'héritier de l'Empire, en même temps que son frère Titus, mais il était le seul présent à Rome avec son oncle Flavius Sabinus qui périt dans l'incendie du Capitole. Il est proclamé "Princeps Iuventutis" (Prince de la Jeunesse), titre qu'il conserva même après la mort de son père en 79. À la mort de son frère Titus, le 13 septembre 81, que certains disent assassiné à son instigation, Domitien devint empereur.
Il se lance dans une politique de conquêtes et fait de nombreuses campagnes en Bretagne et en Germanie. Il réforme l'administration romaine, relève Rome des ruines provoquées par les incendies de 64 et de 80. Pour lui, les grands ennemis de l'Empire sont les Daces, il fait élever un limes (ligne fortifiée) sur la frontière danubienne. En 86, les jeux Capitolins sont organisés pour la première fois. Le palais Flavien est érigé sur le Palatin. En 87, les Jeux Séculaires sont célébrés avec faste. Une première campagne est lancée sur la Dacie qui se termine par une paix de compromis, laissant Décébale maître de la situation. Domitien vient de remporter une brillante campagne contre les Sarmates et les Suèves. Le général Agricola meurt le 23 août 93 en disgrâce. En 95, Domitien fait exécuter Flavius Clemens, son cousin.
Il est accusé de faire régner une véritable terreur (persécution des chrétiens et des juifs). Il est assassiné le 18 septembre 96 à 45 ans à l'instigation de sa femme Domitia et du préfet du prétoire. Domitien fut nommé consul dix sept fois, revêtu de la puissance tribunicienne, son orgueil et sa cruauté ont cependant terni sa mémoire. Selon Suétone, à la nouvelle de son assassinat, le Sénat se hâte de faire disparaître toute trace de Domitien.
►83 Campagne de Domitien en Germanie.
►83 Victoire d'Agricola au mont Graupius marquant l'annexion de l'Écosse à l'Empire. Mont Graupius, lieu des Highlands non localisé, sans doute situé entre Édimbourg et Aberdeen.
►85 Les Actes des Apôtres narrent les actes de saint Pierre et de saint Paul. Les Actes des Apôtres sont le cinquième livre du Nouveau Testament. Du même auteur que l'Évangile selon Luc, ils démarrent à l'Ascension suivie ensuite de la Pentecôte et relatent les débuts de l'Église primitive. On peut distinguer deux parties principales dites cycle pétrinien et cycle paulinien.
Le premier cycle rapporte des faits où l'apôtre Saint Pierre est le personnage principal; le second ceux où l'apôtre Saint Paul l'est. Le livre intitulé Actes des Apôtres est la deuxième partie d'un ouvrage écrit par Luc à Théophile. La première partie est l'Évangile selon Luc. Les chapitres 1 à 12 rapportent les grandes activités missionnaires des douze apôtres sous la direction de Pierre immédiatement après la mort et la résurrection du Sauveur.
Les chapitres 13 à 28 font une brève description des voyages et de l'oeuvre missionnaire de l'apôtre Paul. Saint Pierre, Simon, fils de Jonas, dit Simon-Pierre ou Saint Pierre, né au début de l'ère chrétienne en Galilée et mort vers 65 à Rome, est l'un des douze apôtres du Christ, parmi lesquels il tient une position privilégiée, et l'un des chefs de l'Église primitive. Il est considéré par le catholicisme comme le premier évêque de Rome, ce qui fonderait la primauté épiscopale dont se prévaut le pape. Son personnage a suscité un grand nombre d'oeuvres artistiques, en particulier dans l'Occident latin.
►89 Révolte de L. Antonius Saturninus, légat de Germanie supérieur contre Domitien.
►89 Traité de paix avec les Daces. La Dacie, dans l'Antiquité, est le pays des Daces - appelés aussi Gètes - une grande région d'Europe centrale, bordée au nord par les Carpathes, au sud par le Danube, à l'ouest par le fleuve Pathissus (Tisza), en Hongrie, à l'est par le Tyras (Dniestr), frontière actuelle entre la Moldavie et l'Ukraine. Elle correspond approximativement à l'actuelle Roumanie. Vers l'ouest, elle s'étendait probablement jusqu'au Danube quand il coule du nord au sud à Waitzen (Vacz). En revanche, Ptolémée place sa frontière orientale sur le fleuve Hierasus (Siret), en Roumanie. Les habitants de cette région faisaient partie de l'ensemble Thrace. En Grèce antique, ils étaient usuellement appelés Gètes, dans l'Empire Romain Daces.
►90 à 168 - naissance et mort de Ptolémée. Astronome et astrologue grec qui vécut à Alexandrie (aujourd'hui en Égypte). Ptolémée, Claudius Ptolemaeus. Il est également l'un des précurseurs de la géographie. Ptolémée fut l'auteur de plusieurs traités scientifiques, dont deux ont exercé par la suite une très grande influence sur les sciences islamiques et européenne. L'un est le traité d'astronomie, qui est aujourd'hui connu sous le nom de 'l'Almageste'. L'autre est la 'Géographie', qui est une discussion approfondie sur les connaissances géographiques du monde gréco-romain. 'Almageste' (Al en arabe, suivi d'un superlatif grec signifie "le très grand"), dans ce travail, il a proposé un modèle géocentrique du système solaire, qui fut accepté comme modèle dans les mondes occidentaux et arabes pendant plus de mille trois cent ans. L'almageste contient également un catalogue d'étoiles et une liste de quarante-huit constellations, antérieure au système moderne de constellations bien que ne couvrant pas toute la sphère céleste.
►90 Domitien bannit les philosophes de Rome. Après la conjuration de 89, l'empereur Domitien décide de faire tomber des têtes et surtout d'exiler les intellectuels de la ville. Il s'en prend en particulier aux philosophes, n'appréciant guère, lui qui se fait nommer "Maître et Dieu", la possibilité d'une critique. Le stoïcien Épictète, opposant à la tyranie, est ainsi contraint de quitter la ville. Six ans plus tard, Domitien sera assassiné.
►93 Persécution contre les Juifs, les Chrétiens et l'opposition sénatoriale.
►96 18 septembre Assassinat de Domitien par un de ses affranchis.
►96 NERVA (96 à 98) (Marcus Cocceius Nerva)
►96 Nerva (Marcus Cocceius Nerva) fut empereur romain de 96 à 98. Bien que son règne fût extrêmement court, il eut le mérite de fonder ce qu'on appelle communément la dynastie des Antonins. Contrairement aux dynasties précédentes, le prince régnant choisissait son successeur parmi les fonctionnaires qui lui paraissant le plus apte à assumer cette tâche. Vieux militaire, il se choisit un excellent général comme successeur, Trajan. Antonins, la dynastie dite des Antonins est la dynastie régnant sur l'Empire romain de 96 à 192 (soit 96 années, la plus longue dynastie impériale). On appelle également ses cinq premiers empereurs les Cinq bons empereurs.
►96 18 septembre Le Sénat accorde le titre impérial à Nerva.
►96 Mutinerie des légions du Rhin et du Danube.
►97 28 octobre Adoption de Trajan, légat de Germanie par Nerva.
►98 25 janvier Mort de Nerva, son fils adoptif Trajan devient empereur. Marcus Ulpius Trajanus est proclamé empereur romain à la mort de Nerva. Il entraînera l'Empire dans une politique de conquêtes si intense que le royaume romain atteindra des dimensions jamais égalées. Souverain provincial, Trajan brillera aussi par sa simplicité et sa tolérance. L'empereur Hadrien lui succèdera.
►98 TRAJAN (98 à 117) (Marcus Ulpinius Traianus)
►98 Trajan, de son nom complet Marcus Ulpius Traianus est un empereur romain né probalement le 18 septembre 53 à Italica (Espagne actuelle) et mort le 7 août 117 à Selinus (Cilicie). Son prédécesseur à la tête de l'empire, Nerva, était un homme assez âgé que les prétoriens pensaient pouvoir manipuler. Ils l'avaient donc placé là "en transition", mais il prend tout le monde de court en adoptant Trajan en octobre 97 et en le désignant comme césar (successeur). À la mort de Nerva début 98, Trajan lui succède donc.
C'est le premier empereur non-italien. Son règne commence bien : il rompt avec la violence de Domitien et maintient une politique proche du Sénat, ce qui lui assure rapidement une certaine popularité. Des années 97 à 111, il choisit plutôt une politique pacifique et s'occupe surtout d'affaires civiles. Vu qu'il a été choisi car adopté et non imposé par l'hérédité, il met l'accent sur la nature constitutionnelle de son pouvoir. Le Sénat va jusqu'à lui accorder le titre d'optimus (littéralement, "le meilleur").
Du printemps 101 à l'automne 102, Trajan part pour sa première guerre en tant qu'empereur avec 12 de ses légions. Les Daces sont rapidement vaincus et capitulent en 102 avec la prise de Sarmizegetusa, la capitale de la Dacie, avec un gros butin à la clé. Une fois la première guerre des Daces finie, Trajan ne désarme pas pour autant : il fortifie la frontière Nord au niveau du Danube. La peuplade des Iazyges se juge encerclée par ces fortifications et s'allie au Roi des Daces, Décébale. En 105 débute ainsi la seconde guerre des Daces. Décébale fuit en Transylvanie.
En 106, les Daces sont vaincus, Décébale se suicide et la Dacie devient province impériale. Trajan veut égaler Alexandre le Grand et protéger la frontière de l'Euphrate trop vulnérable. En 109-110, le roi des Parthes meurt : son successeur Chosroes place sur le trône arménien Pfartamasiris, qui n'a pas l'agrément des Romains. Considérant que c'est une violation du compromis établi avec Néron, Trajan part en octobre 113.
Dès 114 l'Arménie est conquise et annexée officiellement et Pfartamasiris s'enfuit. Trajan en profite pour resserrer les liens avec ses alliés du Caucase. Les années qui suivent sont assez mal connues : on sait que Trajan fait des opérations en Mésopotamie en 114 - 115. En 116, il conquiert l'Assyrie et la Babylonie, et descend avec ses 2 armées jusqu'au golfe Persique. Mais les Parthes s'organisent, et ils soulèvent les peuples soumis à Rome, notamment les Juifs. La révolte gagne vite du terrain, l'Assyrie est rapidement perdue. Trajan tente alors de remettre la Babylonie à un souverain fantoche, Pfartamasphates, mais cela dissimule mal l'échec de l'annexion qu'il projetait. En 117, la révolte se généralise: l'Orient est en feu. Trajan revient vers l'Occident, laissant à son légat le soin de ramener l'armée. Il meurt à Selinus en Cilicie le 7, 8 ou le 9 août 117. Presque immédiatement, toutes ses conquêtes sont perdues.
►99 Arrivée de Trajan à Rome.
24 - De l'An 100 (Écriture du premier dictionnaire chinois) à 139 (Marc Aurèle est nommé César)
► 100 Écriture du premier dictionnaire chinois, le Shuo Wen. Le Shuo Wen Ji Zhi (Dictionnaire des caractères), qui date de l'an 100 et est donc de la dynastie des Han de l'Est, traite de façon systématique l'étymologie et la forme de 9353 caractères chinois.
► 101 Première guerre de Dacie (jusqu'en 102). Trajan quitte Rome le 25 mars, traverse le Danube et entre dans le Banat au printemps. Il doit se porter au secours des troupes de Mésie inférieures attaqués par les Daces et leurs alliés. Trajan est vainqueur à Tapae, sur la Bistra, en Dobroudja méridionale (automne). La rencontre n'est pas décisive. Le roi des Daces Décébale dispose de 200 000 hommes. L'armée romaine, renforcée au cours de la seconde guerre, dispose de 150 000 à 175 000 hommes.
L'expédition à été longuement préparée : percement d'une route à travers la montagne, creusement d'un canal pour contourner les chutes du Danube (100-101), construction d'un pont sur le fleuve, de vingt piles de pierre, long de 1,2Km à Drobeta (103-105). La Dacie est dans l'antiquité un territoire de la région Carpato-Danubiano-Pontique correspondant approximativement à celui de la Roumanie actuelle. La Dacie (du latin Dacia) tire son nom du nom romain de ses occupants principaux, les Daces, qui sont très proches des Thraces. Ils parlaient un dialecte thrace (langue indo-européenne). Décébale, (en latin : Decebalus) (règne de 87 à 106) était un roi dace.
► 105 Seconde guerre de Dacie (jusqu'en 107). Seconde Guerre de Trajan en Dacie (105-106). Décébale ouvre les hostilités. Trajan quitte Rome le 4 juin, repousse une offensive dace sur le bas Danube, entre en Transylvanie, probablement par le col de Tour-Rouge, tandis que, parti du moyen Danube, ses lieutenants s'avancent simultanément par l'ouest. Trajan assiège Sarmizegetusa en été. La ville tombe, et Décébale est fait prisonnier.
► 105 Invention du papier (Chine). Le papier est apparu au IIIe siècle av. J.-C. en Chine, sous le règne de Qin Shi Huang (fondateur de la dynastie Qin). Les Chinois avaient alors repéré les dépôts blancs d'écume sur les rochers à la suite des crues. Ils ont alors essayé de le reproduire. C'est Tsai Lun, ministre de l'agriculture qui, en 105, codifie pour la première fois l'art de fabriquer du papier. Ils utilisaient du lin, du chanvre, du bambou et de l'écorce de mûrier.
Ce secret restera chinois et japonais jusqu'au VIIIe siècle. Lors de la bataille de Talas en 751, les Arabes, victorieux, font prisonniers de nombreux Chinois et récupèrent ainsi le secret. Ils comprennent rapidement l'intérêt de ce nouveau support pour propager l'islam, et Samarkand en sera le tout premier centre de production du monde musulman. Ils essayeront sans résultat d'y incorporer du coton afin d'améliorer sa blancheur. Le papier arrive alors en Occident avec les conquêtes Arabes.
On le retrouve à Bagdad en 793, au Caire en 900, à Xàtiva (San Felipe, Espagne) en 1056, en Sicile en 1102, à Fabriano (Italie) en 1276 et enfin en France au début du XIVe siècle. Le papier est alors un bien rare et des édits sur le recyclage du papier sont prononcés. On y incorpore alors des vieux chiffons qui prennent vite de la valeur, d'où l'expression se battre comme des chiffonniers. Samarkand ou Samarcande est une ville d'Ouzbékistan, capitale de la Région de Samarcande (Samarqand Viloyati). Son nom signifie probablement "lieu de la rencontre" ou "lieu du conflit" et illustre bien sa position à la limite des mondes turc et persan.
► 106 Prise de la capitale dace par les armées romaines.
► 106 Suicide du roi de Dacie Décébale.
► 106 Annexion de l'Arabie à l'Empire.
► 107 Annexion de la Dacie à l'Empire.
► 112 Création d'un canal entre le Nil et la Mer Rouge.
► 113 L'architecte Apollodore de Damas termine le nouveau forum de Trajan. Avec les fonds provenant de Dacie, Trajan lance un vaste programme de constructions édilitaires tel la Colonne Trajane, qui commémore les victoires de Trajan contre les Daces (mai), et une grande basilique, édifiées sur le forum de Trajan. Apollodore de Damas, était un architecte de la Grèce antique, né à Damas (Syrie actuelle) entre 50 et 60 après J.-C. et décédé en 129 ou 130. Il fut appelé à Rome par l'empereur Trajan en 92. Il resta ingénieur et architecte de l'empereur jusqu'à la mort de ce dernier en 117.
Il était aussi sculpteur et auteur de traités techniques, notamment sur les machines de guerre. Selon la tradition, l'empereur Hadrien l'aurait condamné à mort pour s'être moqué de plans qu'il avait élaborés. Le Forum de Trajan est le splendide symbole du forum impérial dans sa forme la plus achevée. Il fait de tous les fora impériaux un ensemble relativement unitaire. La Colonne Trajane est un monument antique érigé sous le règne de l'empereur Trajan en 113, situé et encore debout de nos jours sur le Forum de Trajan près de la colline du Quirinal à Rome.
► 114 Janvier Arrivée de Trajan à Antioche, début de la campagne contre les Parthes (jusqu'en 117). Antioche est une ville de Turquie.
► 114 - 29 avril Trajan reçoit du Sénat le titre d'"Optimus" (le meilleur).
► 114 - Annexion de l'Arménie à l'Empire.
► 115 Prise de Nisibis par Trajan. Nisibis ville de la Perse ancienne.
► 116 Prise de Doura-Europos, capitale parthe par Trajan. Le site archéologique de Doura Europos (Salhieh) est situé à l'extrême sud-est de la Syrie sur le moyen Euphrate.
► 116 - 20 février Trajan reçoit du Sénat le titre de "Parthicus".
► 117 Insurrection juive.
► 117 - 8 août Trajan adopte publiquement Hadrien.
► 117 - 10 août Mort de Trajan à Selinus en Cilicie. La Cilicie est un pays situé dans la moitié orientale du sud de l'Asie mineure.
► 117 - 11 août Les légions d'Orient proclament Hadrien, alors gouverneur de Syrie, Empereur.
► 117 HADRIEN (117 à 138) (Publius Aelius Hadrianus)
► 117 Hadrien ou Adrien (Publius Aelius Hadrianus), empereur romain, est né en 76 à Italica et mort en 138. Il succède à son père adoptif Trajan en 117. Empereur humaniste, lettré, poète et pacifique, il n'attache pas une grande importance aux conquêtes de Trajan sur l'Euphrate et rompt avec la politique expansionniste de son prédécesseur, s'attachant à pacifier et à organiser l'Empire tout en consolidant les frontières. On lui doit, entre autres, des fortifications continues, appelées limes, destinées à protéger l'empire contre les invasions barbares (mur d'Hadrien au nord de l'Angleterre, par exemple).
C'est sous son règne qu'ont eu lieu d'importants soulèvements en Judée, en particulier en 132/135 la révolte de Bar-Kokheba qui donne une éphémère indépendance à la Judée, qui se sont soldés par des répressions et l'une des diasporas du peuple juif parmi les plus lourdes de l'Antiquité. Jérusalem, prise en 134, est ravagée et devient Aelia Capitolina ; la région est désormais appelée Palestine.
Amoureux du monde hellénique (grec), il tente de restaurer la religion grecque en restreignant les cultes orientaux. En 127, dans un rescrit au proconsul d'Asie, Minicius Fundanus, il affirme que les chrétiens ne peuvent pas être mis à mort sans procès préalable. Son amour pour le jeune Antinoüs (ou Antinoos), mort en 130, l'a poussé à le faire représenter de nombreuses fois en statues, lesquelles nous sont parfois parvenues et nous permettent de donner un visage au célèbre bithynien, ainsi qu'à fonder la cité d'Antinoupolis en Égypte. Cette relation a servi d'argument à ses ennemis. Marié à Sabine, il n'a pas d'enfant avec elle mais adopte Aurelius Antoninus (plus connu sous le nom d'Antonin le Pieux), qui lui succédera à la tête de l'Empire romain.
► 117 Révolte en Maurétanie.
► 118 Arrivée d'Hadrien à Rome.
► 120 Arrivée d'Hadrien en (Grande) Bretagne.
► 121 Voyage d'Hadrien en Gaule.
► 122 Début de la construction du "Mur d'Hadrien". Le mur d'Hadrien est une fortification en pierre et en tourbe construit à partir de 122 par les Romains sur toute la largeur de l'Angleterre pour protéger le Sud de l'île des attaques des tribus de l'actuelle Écosse. Le nom est également parfois employé pour désigner la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, même si la frontière actuelle ne le suit pas. Le mur a marqué le nord de l'empire romain en Grande-Bretagne pendant très longtemps, et c'était également la frontière la plus somptueuse de l'empire. En plus de son utilisation comme fortification militaire, on pense que les portes du mur auraient également servi de postes de contrôle pour la perception de taxes sur les produits importés.
► 123 Traité de paix avec les Parthes.
► 125 En Afrique du Nord, la peste tue 500 000 personnes.
► 125 Reconstruction du Panthéon de Rome (le Panthéon d'Hadrien). Le Panthéon d'Hadrien, le Panthéon d'Agrippa fut détruit par un nouvel incendie en 110 sous Trajan. Il fut entièrement reconstruit sous le règne de l'empereur Hadrien, vers l'an 125, comme le révèlent les dates imprimées dans les briques, comprises entre 123 et 125. On peut supposer que Hadrien l'ait inauguré lors de son séjour prolongé à Rome entre 125 et 128. Il en fit même usage occasionnellement comme tribunal, rendant la justice en compagnie de quelques sénateurs.
Le plan du nouvel édifice est exceptionnel, sans précédent dans l'architecture romaine. L'influence d'Hadrien sur la conception du bâtiment est envisageable, si l'on considère l'originalité de l'architecture de la villa qu'il se fit bâtir près de Rome. Le visiteur qui franchit le classique pronaos à colonnes du Panthéon quitte un monde rectiligne et lumineux pour se trouver enveloppé dans la pénombre d'une cella circulaire et non plus rectangulaire, surmontée d'une coupole immense. Des temples à cella ronde furent édifiés à l'époque archaïque, comme le temple de Vesta ou le temple d'Hercule Victor, mais dans des dimensions beaucoup plus modestes, et jamais accolés à un porche classique.
► 125 mort de Plutarque.
► 127 Fin de la construction du "Mur d'Hadrien".
► 128 Hadrien reçoit le titre de "Pater Patriae".
► 130 mort d'Antinoos favori et amant de l'empereur Hadrien. Antinoos est né en Bithynie (province d'Asie mineure), à Bithynium-Claudiopolis, vers 110. Hadrien le rencontre lors de l'un de ses voyages en Asie, probablement en 123. Il devient rapidement un favori de l'empereur. En 130, il trouve la mort noyé dans le Nil, dans la région d'Hermopolis.
► 130 - 30 octobre Fondation de la ville Antinoupolis par Hadrien. Antinoupolis ou Antinoé est une cité antique égyptienne sur la rive orientale du Nil, en face d'Hermopolis. Elle fut créée par l'empereur voyageur Hadrien. Cette cité romaine abritait la mémoire du jeune favori de l'empereur, Antinoos, mort suite à une noyade dans le Nil. Il fut divinisé grâce à une assimilation osirienne. Le culte était pratiqué dans son temple, l'Antinoéion.
► 131 Édit perpétuel pris par Hadrien et rédigé sous la direction du jurisconsulte Salvius Julianus qui codifie le droit romain et compile tous les édits déjà rédigés. Il est applicable dans tout l'empire.
► 131 Annexion de la Judée à l'Empire.
► 131 à 201 - naissance et mort de Claude Galien. Médecin grec de l'Antiquité. Considéré comme l'un des pères de la médecine, il a eu une influence durable sur la médecine musulmane, juive et chrétienne du Moyen Âge. Il quitte Pergame, voyage tout autour du bassin méditerranéen, visite Smyrne, Corinthe et Alexandrie, où se trouve la plus importante école de médecine de l'époque.
À 29 ans, il revient à Pergame et devient le médecin de l'école des gladiateurs où il met à profit les blessures survenues lors des combats pour parfaire ses connaissances en anatomie. Très fort en anatomie, dont il pense qu'elle est la base de toute bonne médecine, il fait des démonstrations publiques d'anatomie et de physiologie. Une nombreuse clientèle de notables se dispute ses soins. Il devient le médecin de l'empereur Marc Aurèle. Très jalousé, car peu modeste et critique, il doit quitter Rome en 167.
Il y revient deux ans plus tard à la demande de Marc Aurèle (pour des raisons inconnues). Il devient médecin de la cour et s'engage à soigner les deux fils de l'empereur. À la mort de Marc Aurèle, il devient, jusqu'à sa propre mort en 201, le médecin de l'empereur Commode. L'incendie du Temple de la Paix (192) détruit l'essentiel de sa bibliothèque, ses manuscrits et sa collection de "médicaments simples". A plus de 60 ans, Galien tente de récrire tout ce qu'il a perdu. (Entreprise énorme puisque son oeuvre couvre 20 000 pages, publiées en grec mais non totalement traduites dans les langues modernes.). Claude Galien fut sans aucun doute un des fondateurs de la médecine. Il reste avant tout un grand enseignant et écrivain. Il ne laisse pas moins de 500 ouvrages, qu'il a pris la peine de lui-même ordonner dans 'Sur ses ouvrages'. Il s'est efforcé de bâtir une encyclopédie des sciences de son temps, en se plaçant au-dessus des écoles.
► 132 Début de la révolte en Judée sous l'impulsion de Simon Bar-Kokheba. La réaction des Juifs à l'injure qui leur était faite a conduit à l'une des seules grandes révoltes de l'ère romaine. La révolte de Bar Kokhba (132-135), ou la seconde guerre judéo-romaine, ou encore la second révolte juive est la seconde insurrection des juifs de la province de Iudaea contre l'empire romain, et la dernière des guerres judéo-romaines.
Certaines sources, la mentionne comme la troisième révolte, en prenant en compte les émeutes de 115-117, connues sous le nom de guerre de Kitos, qui ont été écrasées par le général Lusius Quietus qui gouvernait la province à l'époque. Simon Bar-Kokheba anima le soulèvement, qui atteignit son paroxysme en 132. Simon dit Bar-Kokheba, ce qui signifie le fils de l'étoile, est un patriote juif qui, outré par la décision de l'empereur Hadrien de faire construire un temple dédié à Jupiter sur l'emplacement du temple de Jérusalem (détruit en 70 par Titus), prend la tête d'un soulèvement en Judée.
Cette révolte prend une grande ampleur, malgré l'opposition d'une partie du clergé, et pendant trois ans les romains doivent déployer de grandes forces pour mettre à mal la rébellion. Jérusalem est reprise en 134, en grande partie détruite et Hadrien change le nom de celle-ci en Aelia Capitolina. Bar-Kokheba mène la guérilla pendant ces trois années mais il est vaincu et trouve la mort (135) dans la forteresse de Betar, au sud-ouest de Jérusalem, où il s'était réfugié.
► 135 Écrasement de la révolte juive.
► 136 décembre Adoption d'Aelius Caesar.
► 138 - 1er janvier Mort d'Aelius Caesar.
► 138 - 25 février l'empereur Hadrien demanda à son fils adoptif, Antonin, d'adopter Marc Aurèle à son tour ainsi que Lucius Verus, le fils de celui qu'Hadrien avait d'abord choisi comme héritier et qui venait de mourir. Marc Aurèle (Marcus Aurelius Antoninus) (121-180) est un empereur et un philosophe stoïcien romain. Lucius Verus (Lucius Aurelius Ceionius Commodus Verus) est empereur romain de 161 à 169 conjointement avec Marc Aurèle bien que celui-ci possède la réalité du pouvoir.
► 138 - 10 juillet Mort d'Hadrien à Baïes, Antonin le Pieux devient empereur. A la mort de l'empereur Hadrien, son fils adoptif Antonin (en latin Titus Aelius Fulvius Antoninus Pius) lui succède. Il sera très vite honoré du titre de "pius" (pieux) pour sa piété et son intégrité dans l'administration de l'Empire. Vers 140, Antonin fera édifier entre le Forth et la Clyde (Grande-Bretagne actuelle), le mur de défense qui porte son nom.
► 138 - ANTONIN (138 à 161) (Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus)
► 138 Antonin le Pieux (Titus Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antoninus Pius) est né en 86 à Lanuvium, dans le Latium, et fût empereur romain de 138 jusqu'à sa mort en 161. C'est dans l'administration civile qu'Antonin le Pieux débuta sa carrière. Il devînt successivement questeur, prêteur, puis consul en 120. Ensuite il affirma ses talents d'administrateur en dirigeant un district d'Italie, puis comme proconsul d'Asie.
Étant marié à la nièce de la femme d'Hadrien, ce dernier l'adopta mais fera de lui son successeur qu'à condition qu'Antonin adopte Marcus Aurelius Antoninus (futur Marc Aurèle) et Lucius Verus, ce qu'il fît. Hadrien pensait qu'il ne régnerait pas longtemps, mais Antonin régna 23 ans. Antonin doit son surnom de "Pieux" au Sénat. Il semblerait que sa dévotion envers son père en soit la raison. Son règne ne fût pas marqué de conquêtes, mais plutôt par une volonté de consolidation de l'état actuel.
C'est dans cet esprit qu'il fît ériger le Mur d'Antonin en Grande-Bretagne, entre le Forth of Firth et le Clide, et qui doublait le Mur d'Hadrien. C'est traditionnellement durant son règne qu'on considère que l'Empire Romain était à son apogée, du fait de l'absence de guerre et de révolte majeure en province. C'est pourtant cette politique défensive et attentiste qui annonce les difficultés financières et militaires de l'Empire Romain.
► 138 - 5 décembre Antonin nomme Marc Aurèle Questeur du Prince.
► 139 Marc Aurèle est nommé César. César était l'un des titres des empereurs romains, les situant dans la continuité de Jules César. On désigne communément sous ce nom Jules César et les onze empereurs qui régnèrent après lui : Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus et Domitien, quoique les six derniers de ces princes soient entièrement étrangers à la famille de César. Suétone a écrit la vie des douze Césars.
À partir d'Auguste, Caesar est l'un des praenomina (ce qui vient avant le nomen familial - ce n'est pas l'exact équivalent du prénom) des empereurs, en compagnie généralement d'imperator. En 293, l'empereur Dioclétien introduisit la Tétrarchie : deux Césars étaient désignés comme empereurs-adjoints des deux Augustes. Cette organisation ne survécut pas à la ruine de la Tétrarchie à partir de 306, quand Constantin fut proclamé César par les troupes de son père, Constance Chlore.
Constantin Ier réutilisa le titre, mais pour donner un statut impérial à ses fils et les installer dans certaines régions de l'empire afin de l'y représenter. Son fils, Constance II, fit Césars ses cousins Gallus, puis Julien. Leur statut était intermédiaire entre celui des Césars de la Tétrarchie et celui des princes héritiers de Constantin : membres de la famille impériale, dotés par là de l'aura plus ou moins magique propre aux empereurs, ils étaient son représentant, disposaient d'un certain pouvoir, mais étaient soumis aussi à un très strict contrôle. Après l'exécution de Gallus pour ses erreurs à Antioche et l'usurpation de Julien, les empereurs suivants n'eurent plus recours à ce dispositif, qu'ils jugeaient sans doute dangereux. Ainsi, quand Théodose Ier voulut élever son fils Arcadius sur une première marche du trône, il le fit directement Auguste.
25 - De l'an 140 (Marc Aurèle nommé Consul) à 198
► 140 Marc Aurèle est nommé Consul.
► 141 Construction du mur Antonin en (Grande) Bretagne (jusqu'en 143).
► 142 Révolte paysanne en Égypte (jusqu'en 144).
► 144 Soulèvement en Maurétanie (jusqu'en 145).
► 145 Marc Aurèle épouse la fille d'Antonin, Anna Galeria Faustina junior.
► 146 Marc Aurèle reçoit la puissance tribunitienne et l'Imperium procon-sulaire.
► 147 Campagne contre les Maures.
► 147 Marc Aurèle reçoit la puissance tribunitienne et l'imperium procon-sulaire.
► 150 Début de la domination des tribus berbères sur le Soudan. Les Berbères sont une ethnie autochtone d'Afrique du Nord. La question de l'origine des Berbères est un sujet déjà ancien puisque dès l'Antiquité, les historiens se sont penchés sur cette question. Les récits de l'Antiquité et du Moyen Âge donnent à ce peuple une origine perse, égyptienne et sémite. Le nom de "berbère" est issu de barbarus, donné par les gréco-romains à tout ce qui n'était pas de coutumes et de civilisation gréco-romaines. Les Romains n'ont jamais réussi à soumettre ces peuples, même après la prise de Carthage au IIe siècle av. J.-C., d'où leur nom.
► 150 Ptolémée écrit 'l'Almageste', il présente son système géocentrique: la Terre, fixe, est le centre du monde, autour de laquelle tournent la Lune, le Soleil et au-delà les autres planètes. Les étoiles, accrochées à la dernière sphère céleste, marquent la limite de l'Univers.
► 152 Révoltes en Égypte (Jusqu'en 153).
► 152 Construction du mur d'Antonin dans le nord de la (Grande) Bretagne.
► 154 Lucius Verus est nommé questeur.
► 156 Expéditions militaires en Dacie (jusqu'en 157).
► 161 - 7 mars Mort d'Antonin à Lori, Marc Aurèle, son gendre, devient empereur.
► 161 MARC AURÈLE & LUCIUS VERUS (161 à 169) (Marcus Aelius Aurelius Verus & Lucius Aelius Aurelius Commodus Verus)
► 161 Marc Aurèle Né en 121 dans une famille italienne installée en Espagne. Après la mort de son père, alors qu'il n'a que trois ans, l'empereur Hadrien le prit sous sa protection et demanda, en 138, à son fils adoptif, Antonin, de l'adopter à son tour ainsi que Lucius Verus, le fils de celui qu'Hadrien avait d'abord choisi comme héritier et qui venait de mourir. Il échangea avec son maître de rhétorique, Fronton, une correspondance qui s'étendit de 139, époque où Marc Aurèle devint son élève, à 166, année de la mort de Fronton.
Cette correspondance est intéressante car elle fournit de précieux détails sur la vie personnelle et familiale de Marc Aurèle et sur la cour d'Antonin. Elle révèle aussi la forte amitié qui lia les deux hommes, amitié parfois ternie par quelques brouilles comme en 146/147 quand Marc Aurèle se "convertit" à la philosophie. En 145, il épousa Faustine la Jeune, la fille d'Antonin, dont il aura de très nombreux enfants. Les historiens antiques se sont plu à évoquer les nombreux adultères supposés de Faustine mais il est certain que Marc Aurèle fut profondement affecté par le décès en 176 à Halala en Cappadoce de celle que les soldats appellaient affectueusement, du fait de sa présence aux côtés de son époux dans les campagnes militaires, Mater castrorum (la Mère des camps).
En 161, à la mort d'Antonin, Marc Aurèle devint empereur et associa au pouvoir son frère d'adoption Lucius Verus. Son règne fut marqué par de nombreuses invasions qui menaçaient l'Empire de toute part. L'année de son accession au trône les Parthes envahirent les provinces orientales de l'empire et l'armée romaine connut un premier désastre. Lucius Verus est envoyé en urgence en orient. Si les capacités militaires du co-empereur sont réelles, son amour du luxe et de la débauche lui font vite abandonner la direction des opérations à deux excellents généraux, Statius Priscus et surtout Avidius Cassius.
Entre 162 et 166, les Romains reprennent l'avantage et s'emparent des deux grandes villes du royaume parthe, Séleucie et surtout la capitale Ctésiphon. En 165, Marc Aurèle persécute les chrétiens. Justin meurt martyr. Les deux empereurs célèbrent leur triomphe en 166 mais l'armée romaine de retour à Rome ramène dans ses bagages une terrible épidémie qui fait de tels dégâts dans la population que certains historiens en ont fait abusivement la cause décisive de la décadence romaine (survenue deux siècles plus tard). Les conséquences sociales et économiques de cette épidémie furent cependant très graves.
Le début du règne connut d'ailleurs de grandes catastrophes naturelles qui marquèrent fortement les esprits, comme les inondations du Tibre en 161 ou le tremblement de terre de Cyzique en 165. À peine la guerre contre les Parthes est-elle terminée qu'une nouvelle menace apparaît aux frontières. Les peuples barbares installés dans les régions danubiennes, les Quades et les Marcomans, menacent directement le nord de l'Italie. La menace est si forte que les deux empereurs se rendent personnellement sur place en 168/169 et passent l'hiver en Aquilée.
En janvier 169 Lucius Verus meurt épuisé et malade et laisse ainsi Marc Aurèle comme seul empereur. Il faut plus de cinq années (169/175) à l'empereur pour venir à bout de cette menace. C'est alors qu'une fausse rumeur - réelle ou prétexte? - de la mort de Marc Aurèle conduit Avidius Cassius, gouverneur d'une large partie de l'orient, à se proclamer empereur. La fidélité du gouverneur de Cappadoce, Martius Verus, laisse le temps à l'empereur de lever des troupes et de se préparer à marcher sur le rebelle.
Mais en juillet 175 celui-ci est assassiné et sa tête envoyée à Marc Aurèle. Ce dernier juge plus prudent d'effectuer cependant un voyage en orient avec sa femme, qui meurt en chemin, et son fils Commode. Il visite la Cilicie, la Syrie, l'Égypte puis au retour par Smyrne et Athènes où, avec son fils, il est initié aux mystères d'Eleusis. Éphémère triomphe car dès 177 Marc Aurèle doit repartir guerroyer sur la frontière danubienne. Il meurt d'une peste (dont la nature exacte est inconnue) en 180 à Vindobona (aujourd'hui Vienne en Autriche).
► 161 Invasion des Chattes en Germanie supérieure.
► 161 Invasion parthe en Syrie et en Arménie.
► 162 Incursions germaniques repoussées par Anfidius Victorinus légat de Germanie.
► 162 Défaite romaine à Elegeia face au parthe Vologèse III.
► 162 Lucius Verus part en campagne contre les Parthes.
► 162 Offensives parthes repoussées par Avidius Cassius. Caïus Avidius Cassius, né en Syrie et a conduit toute sa carrière militaire en Orient, en s'illustrant en particulier lors de la guerre des Parthes en 161-165. Excellent chef, il sait rétablir la discipline par des méthodes radicales et réprimer une révolte agraire en Égypte en 172. Il est gouverneur de toutes les provinces d'Orient en 175, lorsque court le bruit que Marc Aurèle est mort au combat dans les guerres danubiennes. Avidius se proclame alors empereur, mais son "règne" ne dure que trois mois: la rumeur s'avère fausse, et l'usurpateur est assassiné par l'un de ses soldats.
► 163 La frontière de (Grande) Bretagne est ramenée au mur d'Hadrien.
► 164 Destruction de Séleucie par les armées romaines. Syrie séleucide, les frontières physiques de la Syrie séleucide sont définies par sa géographie: la Mer Méditerranée à l'ouest, le désert s'étendant à l'infini vers l'est, le Taurus et l'Amanus au nord et l'Eleutheros au sud. La nature de ces frontières en a de tout temps fait des zones de transit plus que des limites infranchissables.
► 165 Prise de Ctésiphon, capitale parthe, par les armées romaines.
► 166 Épidémie de peste (jusqu'en 181).
► 166 Traité de paix avec les Parthes.
► 166 Le Sénat accorde le titre de père de la patrie à Lucius Verus et Marc Aurèle.
► 166 - 12 octobre Triomphe de Lucius Verus et Marc Aurèle pour leurs victoires contre les Parthes.
► 166 Commode reçoit le titre de César. Commode (Marcus Aurelius Commodus Antoninus) (31 août, 161 - 31 décembre, 192) est un empereur romain ayant régné de 180 à 192, qui est considéré comme un des pires empereurs romains.
► 166 Des envoyés de Marc Aurèle partis en 162 arrivent en Chine par la voie maritime et remettent des cadeaux à l'empereur chinois.
► 167 Incursions quades et marcomanes. (peuples germaniques). Les Quades sont un peuple germanique occidental, peut-être d'origine germano-celtique. Les Marcomans sont un peuple germanique occidental, connu notamment grâce à l'historien romain Tacite qui les situe entre Naristes et Quades, dans l'actuelle Moravie. La Moravie est une région d'Europe centrale, formant aujourd'hui la partie orientale de la République tchèque.
► 168 Expéditions sur le Danube.
► 168 Mort de Ptolémée.
► 169 Mort de Lucius Verus.
► 169 Marc Aurèle (169 à 180) (Marcus Aelius Aurelius Verus)
► 169 Attaques des Marcomans et des Quades.
► 171 Intervention de Marc Aurèle au-delà du Danube contre les Marcomans.
► 172 Soumission des Quades.
► 173 Soumission des Marcomans.
► 174 Incursions germaniques repoussées par Didius Severus Julianus dit Julien. Julien, Didius Julianus fut empereur romain du 28 mars au 2 juin 193.
► 174 Marc Aurèle écrit 'Pensées’
► 175 avril-mai Révolte d'Avidius Cassius en Orient qui se proclame empe-reur.
► 175 - 7 juillet Commode reçoit le titre de César.
► 175 août Assassinat d'Avidius Cassius.
► 176 - 23 décembre Triomphe de Marc Aurèle et Commode.
► 177 - 1er janvier Commode est nommé Auguste (co-empereur) par Marc Aurèle. Auguste est le titre porté par les empereurs romains, par référence à la dignité accordée au premier d'entre eux, Auguste, en particulier à partir de Dioclétien. Titre de noblesse équivalent à celui d'empereur, apparu en 27 av. J.-C. lorsque le sénat romain l'attribua à Octave, qui fut ensuite connu sous le nom d'Auguste. Par la suite, ce titre fut utilisé par presque tous les empereurs romains qui suivirent, particulièrement à l'époque de la Tétrarchie où il y avait 4 empereurs: Deux augustes et deux césars.
► 177 Martyrs de chrétiens à Lyon (dont Sainte Blandine). Sainte Blandine est une fidèle de la première communauté chrétienne de Lyon. À l'origine esclave romaine, elle se joint à la communauté chrétienne avec d'autres romains qui refusent d'honorer d'autre dieu que le dieu chrétien, renonçant ainsi à célébrer le culte de l'empereur romain. Cette attitude soulève une réprobation dans la communauté gallo-romaine. Marc Aurèle décide alors de lancer une campagne d'arrestation des chrétiens aboutissant au martyre de sainte Blandine et de ses compagnons (dont l'évêque de Lyon, saint Pothin) en 177 à l'amphithéâtre des Trois Gaules. D'après Eusèbe, évêque de Césarée, qui a rapporté les faits dans son Histoire ecclésiastique, les lions refusèrent de dévorer sainte Blandine lors de son martyre. Elle fut finalement égorgée.
► 178 - 3 août départ de Marc Aurèle et Commode en campagne en Germanie (jusqu'en 180).
► 180 - 17 Mars Mort de Marc Aurèle, son fils Commode devient empereur. Marc-Aurèle meurt à Vienne de la peste au cours d'une campagne pour étendre les frontières de l'Empire Romain vers le nord. Au-delà de son statut d'Empereur, Marc-Aurèle reste dans l'histoire l'homme qui a en quelque sorte accompli les espoirs de Platon d'un "philosophe roi". Grand stoïcien, Marc-Aurèle laisse en effet une oeuvre philosophique imprégnée des théories morales des philosophes du Portique et d'Épictète. Le tyran Domintien avait bannit Épictète et ses idées de Rome. Elle seront finalement parvenues à la tête de Rome quelques dizaines d'années plus tard avec Marc-Aurèle.
► 180 COMMODE (180 à 192) (Lucius Aelius Aurelius Commodus)
► 180 Commode (Marcus Aurelius Commodus Antoninus) (31 août, 161 - 31 décembre, 192) est un empereur romain ayant régné de 180 à 192, qui est considéré comme un des pires empereurs romains. Son règne termina l'ère des "cinq bons empereurs", de la dynastie des Antonins. Il est le fils du populaire Marc Aurèle, son accession au trône à la mort de son père a tout d'abord été vu comme un signe heureux par le peuple romain. Mais bien vite, celui-ci, s'attendant au digne successeur du grand Marcus Aurelius, subit les excentricités du nouvel Empereur.
Commodus renomma peu à peu toutes les institutions, fit battre monnaie à son effigie et changea le nom des mois et même Rome se transforma en Colonia Lucia Annia Commodiana. Sa mégalomanie lui avait pourtant attiré les faveurs de la Plèbe, lorsque, organisant de nombreuses occasions des jeux, il descendait dans l'arène pour y vaincre des gladiateurs et des fauves. Jamais il ne connut la défaite, et il s'identifia très vite à Hercule, se faisant représenter portant des peaux de lions et une massue. Nombreux furent les attentats à sa vie qui échouèrent, mais en 192, l'esclave Narcisse, l'entrainant au maniement des armes, l'étrangla dans son bain.
► 180 Victoire de Commode contre les Germains.
► 180 Retour de Commode à Rome.
► 180 Échec de l'offensive "barbare" sur le mur d'Hadrien.
► 182 Commode confie le pouvoir à Tigidius Perennis, préfet du prétoire. Sextus Tigidius Perennis fut d'abord chef du bureau impérial de la correspondance administrative (a epistulis) avant d'être nommé préfet du prétoire par Marc Aurèle. Il eut d'abord comme collègue Tarrutienus Paternus, mais il élimina celui-ci en 182, sous prétexte qu'il aurait favorisé, au moins passivement, une tentative d'assassinat sur la personne de Commode.
Perennis, lui, n'était pas issu de l'aristocratie sénatoriale mais de l'ordre équestre, et c'est sans doute pour cela que Commode, de plus en plus soupçonneux à l'égard du Sénat (et pour cause) lui conserva sa confiance. Et ce d'autant plus que le préfet du prétoire l'encourageait à persécuter ces optimates qui, évidemment, voyaient son élévation d'un très mauvais oeil. Comme général, il ne se débrouillait pas trop mal : il mena avec succès des opérations en Dacie, en Grande-Bretagne et en Afrique du Nord. Il "tomba" en 185, victime d'une intrigue assez mystérieuse suite à une cabale montée par le parti sénatorial, qui le haïssait, ainsi que par Cleander, qui visait à le remplacer dans les faveurs de l'empereur.
► 183 Conspiration de Claudius Pompeianus et Lucilla, soeur de Commode contre lui. L'empereur, retournant un soir à son palais, comme il passait sous un des portiques étroits et obscurs de l'amphithéâtre, un assassin fondit sur lui l'épée à la main. La menace fit manquer le coup; l'assassin fut pris et aussitôt il révéla ses complices. Cette conspiration avait été tramée dans l'enceinte du palais.
Lucilla, soeur de Commode, et veuve de Lucius Verus, s'indignait de n'occuper que le second rang. Jalouse de l'impératrice régnante, elle avait armé le meurtrier contre la vie de son frère. Claudius-Pompeianus, son second mari, sénateur distingué par ses talens et par une fidélité inviolable, ignorait ses noirs complots : cette femme ambitieuse n'aurait pas osé les lui découvrir, mais, dans la foule de ses amans (car elle imitait en tout la conduite de Faustine), elle avait trouvé des hommes perdus, déterminés à tout entreprendre, et prêts à servir les mouvemens que lui inspiraient tour à tour la fureur et l'amour. Les conspirateurs éprouvèrent les rigueurs de la justice; Lucilla fut d'abord punie par l'exil et ensuite par la mort.
► 185 Assassinat de Tigidius par les Prétoriens, Commode confie le pouvoir à Cléandre. Cléandre, Marcus Aurelius Cleander (alias Kleandros) était un ancien esclave phrygien, probablement (du moins si l'on en croit son nom latin) affranchi par Marc Aurèle. Il avait été nutritor (précepteur) de Commode avant de devenir son favori. Grand chambellan et chef de la garde de l'empereur, il gouverna de fait l'Empire romain entre 185 et 190. Il fut aussi préfet du prétoire juste avant sa mort, dans la seconde moitié de l'année 189. Un chambellan est un gentilhomme chargé du service de la chambre d'un monarque. Chambellan.
A l'origine valet de chambre des rois mérovingiens et carolingiens, le chambellan gagne progressivement ses lettres de noblesse. Intime du souverain, il devient l'un de ses conseillers privilégiés. Au XIVe siècle, la charge s'orne du titre de "grand chambellan" recherché par les plus illustres familles. La charge abolie par la Révolution réapparaît sous l'Empire et la Restauration. Ainsi, Talleyrand est nommé grand chambellan de Napoléon Ier.
► 185 Pertinax est nommé légat de (Grande) Bretagne. Pertinax (Publicus Helvius Pertinax, 1er août 126 - 28 mars 193) fut empereur romain de janvier à mars 193.
► 185 à 254 - naissance de Origène. Père de l'Église. Il naît dans une famille chrétienne. En 202, sous le règne de Septime Sévère, l'Église d'Alexandrie est persécutée et son père Léonidès meurt martyrisé. Selon Eusèbe de Césarée, qui lui consacre le sixième livre de son histoire ecclésiastique, Origène doit alors travailler pour faire vivre ses nombreux frères et soeurs.
En 212, il succède à Clément d'Alexandrie à la tête de la didascalée (école catéchétique). Il vend sa bibliothèque pour s'assurer un revenu, et mène une vie ascétique. C'est alors qu'il prend au pied de la lettre certaines paroles de Jésus de l'Évangile selon Matthieu au verset 19:12 ("il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux") et de l'Évangile selon Marc, verset 9:43 ("si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la"), il se castre. Il continue à étudier, notamment auprès d'Ammonios Saccas.
En 230, son évêque, Démétrius, lui reproche d'avoir prêché sans avoir été ordonné, et de s'être émasculé (ce qui par ailleurs était un crime au regard du droit romain). En 231, suite à cette querelle, Origène quitte Alexandrie pour Césarée, en Palestine, où il continue. En 250, sous le règne de Dèce, il subit la persécution et meurt en 254, probablement des suites de ses blessures. Selon saint Jérôme, il serait mort à Tyr, et aurait été enterré dans la cathédrale. Selon la tradition, il n'aurait jamais été reconnu comme saint par l'Église à cause de sa mutilation.
► 186 Soulèvement de Maternus en Gaule. Maternus, simple soldat, mais d'une hardiesse et d'une valeur extraordinaires, rassembla ces bandes de voleurs, et en composa une petite armée. Il ouvrit en même temps les prisons, invita les esclaves à briser leurs fers, et ravagea impunément les villes opulentes et sans défense de la Gaule et de l'Espagne.
Les gouverneurs de ces provinces avaient été pendant longtemps spectateurs tranquilles de ces déprédations; peut-être même en avaient-ils profité: ils furent enfin arrachés à leur indolence par les ordres menaçans de l'empereur. Environné de tous côtés, Maternus prévit qu'il ne pouvait échapper; le désespoir était sa dernière ressource: il ordonne tout à coup aux compagnons de sa fortune de se disperser, de passer les Alpes par pelotons et sous différens déguisemens, et de se rassembler à Rome pendant la fête tumultueuse de Cybèle.
Il n'aspirait à rien moins qu'à massacrer Commode, et à s'emparer du trône vacant. Une pareille ambition n'est point celle d'un brigand ordinaire. Les mesures étaient si bien prises, que déjà ses troupes cachées remplissaient les rues de Rome: la jalousie d'un complice découvrit cette singulière entreprise, et la fit manquer au moment que tout était prêt pour l'exécution.
► 188 Pertinax est nommé proconsul d'Afrique.
► 189 Cléandre est nommé préfet du prétoire.
► 189 Exécution de Cléandre, Laetus devient préfet du prétoire.
► 189 Julien devient proconsul d'Afrique en remplacement de Pertinax nom-mé préfet de Rome.
►191 Pescennius Niger est nommé gouverneur de Syrie. Pescennius Niger est légat de Syrie en 193 lorsque les Prétoriens mettent le titre d'Empereur aux enchères. Fatiguées des révolutions de palais à Rome, les légions provinciales l'acclament même temps que Septime Sévère. Les légions de Syrie sont évidemment les premières à soutenir leur chef, mais celles de Palestine et d'Égypte suivent le mouvement.
C'est l'Orient qui s'embrase : la ville d'Antioche se rallie, ainsi que les rois parthe et arménien. Mais il ne manque pas d'appuis à Rome parmi les artisans et les petits propriétaires. Septime Sévère, après s'être imposé à Rome, décide de partir en campagne pour éliminer son rival. Il prend Byzance et Antioche, bat Pescennius Niger à Issos en 194. Celui-ci trouve la mort en tentant de se réfugier chez les Parthes.
► 192 Pertinax est nommé préfet de Rome.
► 192 - 31 décembre Assassinat de Commode par un de ses esclaves. L'empereur de Rome, Commode est étranglé dans son bain à l'âge de 31 ans après 12 ans de règne. Le meurtre est organisé par sa concubine, Marcia, et par le préfet du Prétoire, Aemilius Laetus, qui ne supportaient plus ses extravagances et sa cruauté. Marc Aurelius Commodus était le fils de l'empereur Marc Aurèle.
Buste de Marc Aurèle
► 192 PERTINAX (193) (Publius Helvius Pertinax)
► 192 Pertinax (Publicus Helvius Pertinax, 1er août 126 - 28 mars 193) fut empereur romain de janvier à mars 193. Sa carrière avant de devenir empereur est principalement connue par les Historia Augusta. Né dans la ville d'Alba, d'un père homme libre, il débuta sa carrière comme "grammaticus" (professeur de grammaire), puis, désireux de changer de métier, se fit aider pour devenir officier dans une cohorte.
Se distinguant dans la guerre qui suivit, il fut promu plusieurs fois, servit en Grande-Bretagne puis le long du Danube, et devint procurator en Dacie. Victime d'intrigues de cour durant le règne de Marc Aurèle, il fut rapidement rappelé pour aider Claudius Pompeianus dans les guerres germaniques. En 175 il fut nommé suffect consul, et jusqu'en 185 fut gouverneur des provinces de Moesia, Dacie, Syrie, puis de Grande-Bretagne.
Durant les années 180, il joua un rôle dans le Sénat, jusqu'à ce que Perennis le force à se retirer. Trois ans plus tard il fut rappelé pour éviter une mutinerie militaire en Grande-Bretagne. Il y acquit une réputation de stricte obédience à la discipline. En 187 il fut obligé de démissionner, officiellement à cause du ressentiment au sein des troupes face à cette discipline. Il était préfet dans la garde prétorienne lorsque Commode fut assassiné.
Devenu empereur, il tenta de restreindre le train de vie officiel, comme le fit Marc Aurèle. La garde prétorienne fut déçue du faible "donativum" qui lui fut accordé et tenta de le remplacer par Falco, mais la tentative échoua. Le 28 mars 193, un groupe de soldats, déçus de n'avoir reçu que la moitié de leur paye, fit irruption dans le palais et tua Pertinax.
Didius Julianus prit le pouvoir, ce qui déclencha une courte guerre civile pour la succession, finalement remportée par Septime Sévère la même année. Revenu à Rome, ce dernier reconnu Pertinax comme empereur légitime, exécuta ses assassins, et força le Sénat à lui accorder des funérailles d'État. Il organisa également plusieurs années de suite des jeux pour l'anniversaire de sa naissance et de son couronnement.
► 193 - 1er janvier Les prétoriens portent Pertinax à la tête de l'empire.
►193 - 28 mars Les prétoriens assassinent Pertinax et portent Didius Julianus dit Julien à la tête de l'empire.
► 193 - 9 avril L'armée d'Illyrie proclame Septime Sévère empereur à Carnatum. Septime Sévère (Lucius Septimius Severus) fut empereur romain de 193 à 211. Avec lui commence la dynastie des Sévères.
► 193 JULIEN (193) (Marcus Didius Julianus)
► 193 Didius Julianus (Marcus Didius Severus Iulianus) fut empereur romain du 28 mars au 2 juin 193. Fils de Quintus Petronius Didius Julianus et Aemilia Clara, famille noble de Milan, sa date de naissance varie selon les sources : 30 janvier 133 selon Dion Cassius et 2 février 137 selon les Augustes histoires.
Élevé par Domitia Lucilla, mère de Marc Aurèle, il devient consul en 175. Lorsque l'empereur Pertinax fut assassiné par la garde prétorienne, il offrit à chaque soldat de celle-ci 25 000 sesterces. Le Sénat, menacé par les militaires, le nomme empereur, et sa femme et sa fille reçoivent le titre d'"Auguste". Mais cette action se révèle très impopulaire, et trois généraux (Pescennius Niger en Syrie, Clodius Albinus en Grande-Bretagne et Septime Sévère en Pannonie) fomentent rapidement une rébellion. Septime Sévère marche sur Rome, le renverse et le fait décapiter. Puis il dissout la garde prétorienne et fait exécuter les assassins de Pertinax. S'ensuit une guerre civile qui dure jusqu'en 197.
► 193 avril Les légions d'Orient proclament Pescenius Niger, légat de Syrie empereur à Antioche.
► 193 avril Marche de Septime Sévère sur Rome.
► 193 -1er juin Les légions de Septime Sévère arrivent devant Rome; exécution de Didius Julianus (Julien).
► 193SEPTIME SÉVÈRE (193 à 211) (Lucius Septimus Severus)
► 193Septime Sévère (Lucius Septimius Severus) fut empereur romain de 193 à 211. Avec lui commence la dynastie des Sévères. Septime Sévère naît le 11 avril 145 à Leptis Magna, une ville située en Tripolitaine sur la côte de la Libye actuelle. Ses parents sont Publius Septimus Geta et Fulvia Pia. Il se marie en secondes noces avec Julia Domna, fille du grand prêtre d'Emèse (Syrie), dont il avait deux fils, Geta et Caracalla.
L'historien Dion Cassius le décrit comme un homme de petite taille, maigre, très vif et taciturne. À l'âge de 18 ans il quitte Leptis Magna pour Rome, où il occupe diverses fonctions civiles et militaires. En 191 il accède au poste de légat de Pannonie supérieure, avec le soutien de Aemilius Laetus, le préfet de la garde prétorienne. Lors de son séjour en 193 à Carnuntum, la capitale de la province de Pannonie supérieure, il apprend les meurtres de Commode et Pertinax.
Ses légions stationnées sur le Danube l'acclament alors comme empereur. Le 1er juin 193 le Sénat condamne Didius Julianus (Julien) à mort, ce qui ouvre la voie à Septime Sévère, qui entre à la tête de ses légions à Rome le 9 juin 193. Par une ruse il parvient à désarmer les meurtriers de Pertinax, des membres de la garde prétorienne, et les fait exécuter. Durant l'automne et l'hiver 193 Septime Sévère triomphe de son adversaire Pescennius Niger, légat de Syrie, qui avait été proclamé empéreur par ses légions. La bataille finale décisive a lieu au printemps 194 à Issus.
Son pouvoir étant ainsi consolidé, il se proclame fils de Marc Aurèle et se crée une généalogie fictive jusqu'à Nerva. En 195 Septime Sévère part en campagne contre les Parthes. Clodius Albinus, nommé César et légat de la province de Bretagne, traverse la Manche en 196 avec ses légions (40 000 hommes). La bataille décisive a lieu en 197 à proximité de Lugdunum (Lyon). Septime Sévère et ses légions sont victorieux. Clodius s'enfuit et se donne la mort. Septime Sévère fait déshabiller la dépouille et la fait piétiner par son cheval ; la tête tranchée est envoyée à Rome, le corps est jeté dans le Rhône.
La famille de Clodius n'est d'abord pas inquiétée, mais sa veuve et ses fils seront ultérieurement assassinés. Dans les années 197 à 199 de nouvelles campagnes victorieuses contre les Parthes aboutissent à la création de la province Mésopotamie. Après la conquête de la ville de Ctésiphon, il fait tuer environ 100 000 habitants, hommes, femmes et enfants, et s'empare du trésor des Parthes.
Pendant les cinq années suivantes il organise l'administration de la nouvelle province. Il voyage ensuite en Orient : il visite l'Égypte, y rend hommage à la dépouille embaumée d'Alexandre le Grand et remonte le Nil jusqu'à Thèbes. C'est seulement en 202 que Septime Sévère revient à Rome. Il cherche maintenant à consolider sa succession : il marie son fils Caracalla avec Plautilla, la fille de Gaius Fulvius Plautianus, préfet de la garde prétorienne, avec lequel il est lié d'amitié.
Les relations au sein du couple se détériorent cependant rapidement. Peut-être sur incitation de Caracalla, Plautianus est accusé de trahison par des centurions en 205. Septime Sévère le fait assassiner et Plautilla est bannie sur l'île de Lipari. En 208, Septime Sévère s'embarque avec ses deux fils Caracalla et Geta vers la province de Bretagne pour combattre les Calédoniens. Plusieurs batailles ont lieu jusqu'en 209, sans victoire décisive. Pour sécuriser la frontière nord de l'empire romain il fait consolider le Mur d'Hadrien sur une longueur d'environ 130 km. Affaibli par la maladie de la goutte il se retire à York où il meurt le 4 février 211 à l'âge de 65 ans.
►193 - 9 juin Septime Sévère entre à Rome.
► 193 - 10 juin Discours de Septime Sévère devant le Sénat.
► 193 Clodius Albinus refuse le titre impérial proposé par ses légions en (Grande) Bretagne.
► 193 juin Septime Sévère met le siège devant Byzance.
►193 Défaite de Septime Sévère à Périnthe (ville de Thrace) face à Pescenius Niger.
► 194 Dévaluation d'un tiers du Denier.
► 194 janvier Défaite de Pescennius Niger face à Septime Sévère.
► 194 mars Nouvelle défaite de Pescennius Niger face à Septime Sévère à Issos (en Turquie).
► 194 Séptime Sévère nomme Clodius Albinus César. Clodius Albinus est né à Hadrumète en Afrique entre 140 et 150. Il est issu d'une famille romaine qui a émigré en Afrique. Sa carrière suit le cursus classique des provinciaux compétents : commandement de troupes auxiliaires, puis d'une légion sous Marc Aurèle. Avec ce titre, il participe en 175 en Bithynie à la répression de la révolte d'Avidius Cassius, préteur en 180. consul suffect sous Commode vers 190/193, légat en Bretagne avec trois légions.
Lorsqu'il apprend début 193 l'usurpation de Didius Julianus (Julien), il se révolte, tout en refusant le titre impérial que lui proposent ses troupes. Septime Sévère, également révolté est reconnu empereur par le Sénat romain. Septime Sévère veut d'abord se débarrasser de Pescinnius Niger, également révolté en Syrie. Il s'entend donc avec Clodius Albinus resté en Bretagne, lui accorde le titre de César en avril 194, puis le prend comme collègue pour le consulat de l'année 194.
Une fois débarrassé de Pescinnius Niger, Septime Sévère change d'attitude : en décembre 195, il fait proclamer Clodius Albinus ennemi public par le Sénat. Forcé de réagir, Clodius Albinus se fait proclamer Auguste par ses troupes en janvier 197, et débarque en Gaule. Il s'installe à Lugdunum (Lyon), contrôlant la Bretagne, les Gaules et l'Espagne. L'armée de Septime Sévère penêtre en Gaule par le Jura. Clodius Albinus est battu à Tournus puis une seconde fois près de Lugdunum en février 197. Il se suicide pour ne pas être capturé. N'ayant pas été reconnu par le Sénat romain, il ne figure pas dans la liste des empereurs légitimes.
►194 Campagne contre les Parthes qui avaient apporté leur soutient à Pescennius Niger (jusqu'en 195).
► 195 Capture puis exécution de Pescennius Niger.
► 195 Expéditions de Septime Sévère en Mésopotamie contre les Parthes.
► 195 décembre Capitulation de Byzance.
► 195 Troubles à Lyon (195-197). Clodius Albinus, qui s'était proclamé empereur en Bretagne, entre en Gaule avec ses légions, et lève de nombreuses troupes. Il se trouve bientôt à la tête de 150 000 hommes. Septime Sévère, alors en Orient, accourt.
► 195 - 15 décembre Clodius Albinus est déclaré ennemi public.
► 196 janvier Les légions de (Grande) Bretagne proclame empereur Clodius Albinus.
► 196 Septime Sévère nomme son fils Caracalla César. Caracalla (186 - 8 avril 217) fut empereur romain de 211 à 217.
► 196 Septime Sévère s'empare de Byzance et la détruit. Intégrée à l'Empire romain, Byzance essuie la colère de l'empereur Septime Sévère, auquel elle s'oppose. La cité se range en effet du côté de Pescennius Niger, gouverneur de Syrie désireux de monter sur le trône. La ville est pillée, puis rasée. Elle sera reconstruite quelques années plus tard.
► 196 Clodius Albinus est soutenu par une partie des Sénateur à Rome.
► 196 Ralliement à Clodius Albinus des légions d'Espagne de Germanie et de Gaule.
► 196 Nouvel échec d'une offensive "barbare" sur le mur d'Hadrien.
► 197 - 19 février Septime Sévère bat Clodius Albinus qui se suicide près de Lyon. Lyon, la capitale des Gaules, est le théâtre d'une bataille sanglante entre deux armées romaines. Septime Sévère, chef de l'armée du Danube, affronte le gouverneur de Bretagne, Clodius Albinus. Tout deux veulent devenir maîtres de l'immense Empire romain. Septime Sévère l'emporte. Pour punir la ville d'avoir pris parti pour son adversaire, il la dévaste et extermine 18 000 chrétiens. Né à Leptis Magna en Afrique, Septime Sévère se retrouve alors à la tête de l'Empire romain.
► 197 Nouvel échec de l'offensive "barbare" sur le mur d'Hadrien.
► 197 juin Retour de Septime Sévère à Rome.
► 197 Exécution de 29 sénateurs partisans de Clodius Albinus.
► 197 - 28 août Caracalla est nommé Imperator designatus.
► 197 Seconde campagne de Septime Sévère contre les Parthes.
► 197 décembre Prise et pillage de Ctésiphon par les troupes romaines. Ctésiphon est une ville parthe située sur le Tigre à peu de distance de Bagdad, elle fut capitale des perses sous les Sassanides. Julien II dit l'apostat y remporta une bataille décisive en 363 mais il fut tué peu après. En 637, Ctésiphon tomba aux mains des arabes qui en pillèrent les matériaux pour construire Bagdad en 762.
► 198 - 28 janvier Geta, second fils de Septime Sévère est élevé au rang de César. Geta (Lucius Publius Septimius Antoninus Geta) fut empereur romain en 211 et 212 de notre ère.
► 198 Échecs des tentatives romaines pour la prise de Hatra. Hatra, cité antique située au sud-ouest de Mossoul (Irak). La ville a été fondée au Ier siècle av. J.-C. par les Parthes. En raison de sa position stratégique, la ville était au carrefour des routes caravanières, elle connaît une forte croissance et devient la capitale de la province d'Araba, royaume semi-autonome sous influence parthe. Au Ier et IIe siècle apr. J.-C., la ville est dirigée par une dynastie de princes arabes, de langue araméenne.
La ville est protégée par une enceinte circulaire de près de 7 km qui comporte 160 tours. Elle supportera ainsi avec succès les sièges romains de Trajan (en 116-117) et de Septime-Sévère (198-199). En 240, Sapor Ier parvient à s'emparer de la cité en bénéficiant, selon la légende, de la complicité d'Al-Nadira, la fille du roi d'Hatra, qui lui livre la ville. En récompense, toujours selon la tradition, Sapor épouse Al-Nadira avant de la tuer !
► 198 Conquête de la Mésopotamie (fin de la campagne contre les Parthes).
► 198 12 octobre Caracalla, fils aîné de Septime Sévère est nommé Auguste.
26 - De 200 (écriture runique) à 238 (Gordien III)
► 200 à 700 - Écriture runique. Employée par des peuples germaniques entre le IIe et le XIVe siècle de notre ère, l'écriture runique a été employée pour un grand nombre d'inscriptions retrouvées sur des poinçons, des anneaux, des fers de lances mais aussi et surtout sur pierre. Il s'agit en général de textes très courts. L'une des inscriptions les plus longues, celle de la pierre d'Eggjum en Norvège, ne compte que 200 signes. La plupart des textes a avoir été conservés ont été rédigés sur des stèles funéraires pour honorer un disparu.
Les lettres de l'alphabet runique sont généralement constituées d'un trait vertical auquel on ajoutait un ou plusieurs traits obliques. L'alphabet runique ou Futhark (terme formé à partir du nom des six premières lettres de cet alphabet) était l'alphabet utilisé par les anciens peuples de langues germaniques (comme les Angles et Nordiques (Vieux norrois)), qui étaient appelées runes. Il était aussi utilisé en divination et en magie. Au contraire des lettres de l'alphabet latin, les runes ont des sens intrinsèques. Le fait est, cependant, que l'alphabet latin est le fruit d'une longue et lente évolution, héritage des Étrusques, dont l'alphabet était lui-meme fruit de l'héritage des Phéniciens ; tout alphabet ayant lui-meme pour origine les pictogrammes, qui avaient, eux, une signification symbolique. Il est assez improbable que les peuples germaniques aient pu inventer un alphabet à partir de rien quelques millénaires après la naissance des premiers alphabets.
► 200 à 400 - L'art des premiers chrétiens. Défini par son style et son iconographie, l'art des premiers chrétiens, dit paléochrétien, est l'expression de la foi tout juste révélée et de la ferveur religieuse d'une société s'affirmant au sein de l'Empire romain en crise.
► 200 vers - le grammairien Probus dresse la liste des incorrections dans l'usage du latin: appendix probi. l'Appendix Probi, sorte de compilation d'"erreurs" fréquentes relevées par un certain Probus et datant du IIIe siècle de l'ère chrétienne. Ce sont bien ces formes, et non leur équivalent en latin classique, qui sont à l'origine des mots utilisés dans les langues romanes.
► 202 avril Septime Sévère est de retour à Rome.
► 202 Édit interdisant le prosélytisme juif et chrétien.
► 203 Construction de l'Hippodrome de Byzance. Après avoir rasé la cité, Septime Sévère entreprend la construction d'un immense hippodrome, au sommet d'une colline dominant la mer. Il sera agrandi par Constantin Ier et mesurera alors 450 mètres de long, sur 150 de large. Monument central de Byzance, puis de Constantinople, il sera actif jusqu'au pillage des croisés, en avril 1204. L'Hippodrome de Constantinople est l'arène hippique monumentale de la capitale de l'Empire byzantin, dans laquelle se déroulaient des courses de chars et d'autres manifestations. Commencé par Septime Sévère dans la ville qui s'appelait encore Byzance, et achevé par Constantin pour sa nouvelle capitale Constantinople, l'hippodrome a servi jusqu'à la fin du XIIe siècle, avant d'être partiellement incendié par les Croisés en 1203.
► 205 - 22 janvier Exécution de Plautien, préfet du Prétoire. Plautien: l'ami et le confident de Septime-Sévère. Caracalla épousa sa fille. la conspiration de Plautien, le père de Plautille, est un échec. Plautien est mis à mort et sa fille, la femme de Caracalla, est exilée aux Iles Lipari.
► 205 à 270 - naissance et mort de Plotin. Philosophe. Il est considéré comme le fondateur de la pensée néoplatonicienne. Les connaissances que l'on a de la vie de Plotin sont principalement rapportées par Porphyre de Tyr, un de ses disciples. À l'âge de 28 ans, Plotin part étudier la philosophie à Alexandrie, auprès d'Ammonius Saccas, auprès duquel il restera 11 années.
À 39 ans, il décide d'étudier les philosophies orientales et indiennes, et rejoint donc l'armée de Gordien III qui marche sur la Perse. Mais cette armée est vaincue et Gordien tué, si bien que Plotin doit, non sans difficultés, se réfugier dans la ville d'Antioche. Il s'installe ensuite à Rome, en 247 sous le règne de Philippe l'Arabe, et y enseigne la philosophie durant de nombreuses années, s'attirant la protection de l'empereur Gallien.
Il semble fonder une école philosophique en Campanie, près de Naples. Il meurt à Naples en 270. Le néoplatonisme est une doctrine philosophique élaborée à Alexandrie au IIIe siècle de l'ère chrétienne, par Plotin et son disciple Porphyre de Tyr, qui se développa jusqu'au VIe siècle et qui tentait de concilier la philosophie de Platon avec les doctrines religieuses orientales telles que le christianisme.
Cette philosophie a pour but la résolution d'un des problèmes au coeur de la pensée grecque antique, à savoir le problème de l'Un et du multiple. Plus particulièrement, il s'agit de comprendre comment passer de l'Un au Multiple. Nous constatons le Multiple dans la nature, or l'Un est le fondement de l'intelligibilité. Cette philosophie est rattachée au platonisme de par sa volonté de résoudre les apories de la pensée platonicienne, et en particulier celles d'un des dialogues les plus difficiles Parménide.
Il y a quatre principes qui commandent cette solution : Toute multiplicité suppose une unité qui lui donne sa structure, principe d'unité systématisante ; Toute unité transcende la multiplicité qu'elle unifie, principe de transcendance ; Toute multiplicité est contenue en quelque manière dans l'unité qui la transcende, principe d'immanence. Toute réalité qui, pour se réaliser, doit sortir de l'unité où elle était contenue, ne peut se réaliser pleinement que par un retour à l'unité dont elle émane, principe de conversion.
Le néoplatonisme de Plotin, retient surtout l'idée de l'absolue transcendance du Bien. Contrairement à Platon, qui pense que le philosophe doit redescendre dans la cité, pour y instaurer l'ordre et la justice, Plotin voit la philosophie comme un cheminement de l'âme vers ce principe de transcendance, donnant pour but à ce système, l'union avec le principe premier, originel, Dieu.
De ce point de vue, le néo-platonisme comporte une dimension mystique forte. Elle a influencé la philosophie et la science moderne, les grands systèmes de l'idéalisme allemand et même la pensée contemporaine. Porphyre (234-310), philosophe néoplatonicien. Il écrivit un traité 'Contre les chrétiens'. Parmi ses disciples, il semble qu'il faille compter Jamblique. Porphyre pense que le christianisme implique une conception absurde et irrationnelle de la divinité qui le condamnerait, aussi bien du point de vue des religions particulières que du point de vue transcendant de la philosophie. Dans le traité 'Sur le retour de l'âme', il propose une tout autre théorie des rapports entre philosophie et religion : les religions ne s'adresseraient qu'à des dieux inférieurs ou à des démons ; la philosophie les transcenderait, parce qu'elle serait le culte du Dieu suprême, dont le philosophe est le prêtre.
► 208 Départ de Septime Sévère pour la (Grande) Bretagne.
► 209 Geta, fils cadet de Septime Sévère est nommé Auguste.
► 211 - 4 février Mort de Septime Sévère à York, Caracalla et Geta (ses fils) deviennent empereur.
► 211 CARACALLA & GETA (211 à 212) (Marcus Aelius Aurelius Bassianus & Publius Septimius Geta)
► 211 Caracalla (186 - 8 avril 217) fut empereur romain de 211 à 217. Fils de Septime Sévère, il naquit en 186 à Lugdunum (aujourd'hui Lyon), son père étant alors gouverneur des Gaules. Baptisé Lucius Septimius Bassianus, il fut par la suite renommé Marcus Aurelius Antoninus, afin d'être rapproché de la dynastie des Antonins. Son surnom de Caracalla vient d'un type de manteau gaulois qu'il avait coutume de porter dès l'âge de douze ans.
Son père devint empereur en 193 et associa Caracalla au trône en 198. À la mort de Septime Sévère en 211, ses soldats tinrent à respecter son testament, obligeant Caracalla à partager le pouvoir avec son frère Geta. Une fois la paix revenue, l'armée démobilisée, et la famille impériale de retour à Rome, il assassina lui-même Geta d'un coup de glaive dans la gorge, sous les yeux de leur propre mère, qui tentait probablement de les réconcilier.
Caracalla se livra ensuite à une série de meurtres systématiques, ayant pour cible les amis, les relations et les partisans de Geta. Il interdit même, sous peine des pires supplices, que fut prononcé le nom de son frère en sa présence. Si l'on en croit Cassius Dio, Caracalla fut directement responsable de 20 000 meurtres durant son règne. Lorsque les habitants d'Alexandrie eurent vent des allégations de Caracalla qui prétendait avoir tué Geta pour se défendre, ils tirèrent une satire de son mensonge et de ses autres prétentions.
Caracalla, offensé par l'insulte, contre-attaqua en 215 en organisant le massacre de la délégation de citoyens venus l'acclamer à son arrivée à Alexandrie, puis lâcha ses troupes sur la ville, qui la mirent à sac, se livrant à un massacre si épouvantable "que les flots de sang, traversant l'esplanade, allèrent rougir l'embouchure, pourtant très vaste, du Nil" (Hérodien, IV, 9 : 3-8). Lors de sa campagne contre les Parthes, Caracalla demanda en mariage la fille d'Artaban, le roi des Parthes. Il l'obtint et accompagné de toute son armée, se rendit en Mésopotamie pour célébrer les noces impériales.
Quand la foule, civils et militaires confondus, fut rassemblée pour la fête, près de Ctésiphon, leur capitale, Caracalla donna un signal et le scénario du massacre d'Alexandrie se reproduisit : les soldats romains se ruèrent sur les Parthes et les égorgèrent en masse. Le roi parthe s'échappa de justesse et ne songea plus qu'à se venger de la duplicité romaine.
Il est surtout connu pour l'édit de Caracalla, de 212 (Constitutio Antoniniana), garantissant la citoyenneté romaine aux hommes libres de tout l'Empire (il semble toutefois que cette décision ait été motivée par des raisons fiscales : certains impôts, en particulier sur les successions, n'étant dus que par les citoyens romains); pour avoir déprécié la monnaie romaine en lui retirant 25% de son contenu en argent; et pour la construction de vastes thermes près de Rome qui peuvent encore être vus et sont connus sous le nom de thermes de Caracalla. Caracalla devint au cours de son règne un véritable tyran militaire particulièrement impopulaire (sauf auprès des soldats). Alors qu'il se rendait d'Edessa à Parthia pour y faire la guerre, il fut assassiné près de Harran le 8 avril 217, par Martialis. Le préfet du prétoire Macrin, souvent soupçonné (à raison) d'avoir commandité l'assassinat, lui succéda.
► 211 Geta (Lucius Publius Septimius Antoninus Geta) fut empereur romain en 211 et 212 de notre ère. Il participa avec son frère aîné Caracalla aux campagnes de son père l'empereur Septime Sévère, lequel, à sa mort, les désigna tous deux pour lui succéder. Comme les deux frères se haïssaient depuis leur enfance, Caracalla assassina lui-même Geta d'un coup de glaive dans la gorge, au bout d'une année de règne commun et fit ensuite effacer son nom et son image de tous les monuments publics (notamment de l'arc de triomphe de Septime Sévère toujours debout au Forum romanum).
► 211 Caracalla fait la paix avec les Calédoniens ramenant la frontière au mur d'Hadrien.
► 212 Février Carracalla assassine son frère avec qui il partageait le pouvoir.
► 212 CARACALLA (212 à 217) (Marcus Aelius Aurelius Bassianus)
► 212 Caracalla. Après l'assassinat de Géta, Caracalla fit décréter la "damnatio memoriae" de son frère. La "Constitution Antoniniana" fut promulguée en 212. Tous les habitants de l'Empire devenaient des citoyens romains. L'année suivante, il entreprit une campagne en Germanie et remporta de nombreuses victoires sur les Germains, les Iapyges et les Goths. Il reçut le titre de "Germanicus". La fin du règne fut marquée en 215 par la Réforme monétaire et la création de l'antoninien. Caracalla entame une ultime campagne contre les Parthes. Il est assassiné après avoir célébré ses vicennalia.
► 212 Édit de Caracalla accordant la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'empire. Caracalla promulgue un édit accordant le droit de cité, c'est à dire la citoyenneté romaine à tout habitant libre de l'Empire. Les égyptiens autochtones et les nomades et les tribus montagnardes de Berbérie en sont exclues. L'Édit de Caracalla est un décret, également appelé Constitutio Antoniniana, par lequel l'empereur romain Marcus Aurelius Antoninus Bassianus dit Caracalla (premier fils de Septime Sévère) confère, en 211-212 apr. J.-C., aux pérégrins libres de l'Empire romain, la citoyenneté romaine (droit de cité romaine). Jusqu'alors, la citoyenneté romaine (avec ses privilèges mais aussi ses devoirs fiscaux) n'étaient accordée de façon globale qu'aux habitants de l'Italie et dans les provinces aux municipes ayant le statut de colonie romaine.
► 212 Macrin devient préfet du prétoire. Macrin (Marcus Opellius Macrinus) (v. 165 - 218) est un empereur romain qui régna de 217 à 218.
► 213 Campagne sur le Danube (jusqu'en 214).
► 215 Campagne en Orient (jusqu'en 217).
► 216 Intervention militaire de Caracalla en territoire Parthe.
► 216 Inauguration des thermes de Caracalla à Rome. Thermes de Caracalla, les thermes étaient des établissements de bains publics chauds de la Rome Antique. Inaugurés à Rome sous l'empereur romain Caracalla (211-217) en 216 ap. J-C, les thermes de Caracalla, ou Thermae Antoninianae, sont le plus grand et le plus luxueux complexe thermal réalisé jusqu'alors, même s'il sera dépassé par la suite. En plus des équipements concernant directement les bains, ce complexe proposait des activités variées, ce qui explique sa taille gigantesque. Une superficie de plus de 10 ha, de la place pour 1600 baigneurs, 64 citernes de 80 000 litres chacune, ce sont quelques unes des caractéristiques remarquables des Thermes de Caracalla. C'est aujourd'hui l'édifice thermal le mieux conservé de l'époque impériale. Les ruines qui demeurent encore à Rome frappent par leur aspect colossal.
► 216 à 277 - naissance et mort de Mani, prophète. Né à Ctésiphon, Mésopotamie, en 216, Mani sera le prophète du manichéisme. Il est issu d'un milieu chrétien appartenant au courant gnostique du prophète Alkhasaï. Mani affirme très tôt être en contact avec un ange et être un calque de la vie de Jésus. Il se met à prêcher vers 240 mais c'est sa rencontre avec le roi sassanide Shapur Ier en 250 qui décidera du succès de sa doctrine : le monarque conçoit tout l'intérêt d'une religion nationale pour unifier son empire.
La foi nouvelle progresse rapidement et les communautés se multiplient sous son regard bienveillant. Vient le règne de Bahram Ier, en 272, qui favorise un retour au mazdéisme. Persécuté, Mani se réfugie à Khorasan où il fait des adeptes parmi les seigneurs locaux. Inquiété de voir cette influence grandir, Bahram le remet en confiance et le rappelle à Ctésiphon. Mais c'est la prison et les mauvais traitements qui l'attendent, puis la mort d'épuisement, âgé d'environ soixante ans.
La passion de Mani sera perçue comme une transposition de la passion du Christ par ses adeptes. Le manichéisme est une religion, aujourd'hui disparue, dont l'initiateur fut le mésopotamien Mani au IIIe siècle. C'est un syncrétisme inspiré du zoroastrisme, du bouddhisme et du christianisme qui le combattirent. Par dérivation et simplification du terme, on qualifie aujourd'hui de manichéenne une pensée ou une action sans nuances, voire simpliste, où le bien et le mal sont clairement définis et séparés. La base du manichéisme est de diviser l'Univers en deux : d'un côté le Bien et le royaume de la Lumière et de l'autre le Mal et le royaume des Ténèbres.
Selon le manichéisme, la Lumière et les Ténèbres coexistaient sans jamais se mêler. Mais suite à un évènement catastrophique, les Ténèbres envahirent la Lumière. De ce conflit est né l'Homme, son esprit appartient au royaume de la Lumière et son corps (la matière), appartient au royaume des Ténèbres. Cette lutte entre le Bien et le Mal est le fondement du manichéisme. Pour qu'un Homme puisse une fois sa mort arrivée atteindre le royaume de la Lumière, il faut qu'il abandonne tout ce qui est matériel.
► 217 - 8 avril Assassinat de Caracalla à Carrhes sur ordre de Macrin.
► 217 - 11 avril Les légions choisissent Macrin pour empereur.
► 217 MACRIN (217 à 218) (Marcus Opellius Macrinus)
► 217 Macrin (Marcus Opellius Macrinus) (v. 165 - 218) est un empereur romain qui régna de 217 à 218. Préfet du prétoire sous son prédécesseur Caracalla, il est souvent accusé d'avoir commandité son assassinat. Il fut lui-même assassiné après avoir tenté en vain de s'opposer au soulèvement d'une légion à l'instigation des cousins de Caracalla, dont l'un lui succède sous le nom d'Élagabal.
Macrin était originaire de Maurétanie Césarienne, c'est-à-dire de l'actuelle Algérie. D'origine obscure, il gravit petit à petit les échelons de l'administration fiscale, avant d'entrer dans la clientèle d'un des plus riches sénateurs de l'époque. Lui-même fut le premier empereur à n'être que membre de l'ordre équestre. Son règne fut également trop court pour qu'il ait le temps de venir à Rome : il séjourna essentiellement à Antioche, et son principal fait d'arme fut la signature d'un traité de paix avec les Parthes très favorable à ces derniers. Venant de l'administration civile, il se fit également détester de l'armée en envisageant de revenir sur certains avantages accordés par Caracalla, ce qui favorisa la révolte qui causa sa perte.
► 217 Défaite contre les Parthes près de Nisibe. Nisibe, ville nommée ensuite Antioche de Mygdonie située dans la partie septentrionale de la Mésopotamie, près du mont Masius et sur la rivière Mygdone.
► 218 Traité de paix avec les Parthes; Rome leur verse une forte indemnité.
► 218 Soulèvement de la IIIe Légion Gallica fidèle à la dynastie des Sévère à Emèse. Emèse ou Émèse était une ville de la Syrie romaine. C'est l'actuelle Homs.
► 218 - 15 mai Élagabal, Grand-Prêtre de Baal à Emèse et petit neveu de Septime Sévère est proclamé empereur par la IIIe Légion Gallica. Élagabal ou Héliogabale (Varius Avitus Bassianus) (205 - 222) fut empereur romain de 218 à 222 sous le nom de (Marcus Aurelius Antoninus).
► 218 Macrin nomme Diadumenien, son fils empereur.
► 218 - 8 juin Défaite de Macrin à Immae face aux partisans des Sévère.
► 218 Capture puis exécution de Diadumenien.
218 juin-juillet Capture puis exécution de Macrin.
Macrin
► 218 ÉLAGABAL (218 à 222) (Varius Avitus Bassianus)
► 218 Élagabal ou Héliogabale (Varius Avitus Bassianus) (205 - 222) fut empereur romain de 218 à 222 sous le nom de (Marcus Aurelius Antoninus). Né en 205 à Emèse (l'actuelle Homs) en Syrie, de Julia Soemias et de Varius Marcellus, il était par sa mère à la fois l'arrière petit-fils de Julius Bassianus, grand-prêtre du dieu Élagabal d'Emèse, et le petit-neveu par alliance de l'empereur Septime Sévère, qui avait épousé sa grand-tante Julia Domna en secondes noces.
Cette alliance lui donnait un autre empereur comme oncle germain, Caracalla. Les femmes, celles qu'on appelaient "les princesses syriennes", sont indissociables du destin d'Héliogabale. Descendant des Bassianides, rois sacerdotaux d'Emèse d'origine phénicienne, Varius Avitus Bassianus devint à 13 ans grand-prêtre héréditaire du dieu Baal. Lorsque Caracalla fut assassiné le 8 avril 217, à la tête des armées dans la plaine voisine de l'Euphrate, toutes les femmes de la branche syrienne de la famille impériale, chassées de Rome, se replièrent dans leur fief d'Émèse.
Il y avait là Julia Moesa, grand-mère d'Élagabal, Julia Soaemia, sa mère et Julia Mammaea, sa tante et mère du futur empereur Alexandre Sévère. En raison de sa ressemblance physique avec Caracalla, elles réussirent à convaincre l'armée de proclamer Varius empereur sous le nom usurpé de Marcus Aurelius Antoninus, déjà abusivement porté son père supposé Caracalla. L'empereur Macrin, resté à Antioche, fut pris de court. Piteux stratège, et ayant dressé l'armée contre lui, il fut défait et finalement assassiné en juin 218 : le jeune Varius se retrouvait le seul maître de tout l'Empire romain.
Il avait quatorze ans Prêtre oriental plus qu'empereur, Élagabal entreprit la route de Rome par une procession qui transportait la pierre noire sur un char d'or conduit des chevaux blancs qu'il conduisit à reculons jusqu'au Palatin qu'il atteignit durant l'été 219. Par des descriptions violemment contrastées, ils opposèrent un empereur qu'ils voulaient totalement pervers à son cousin et successeur, Sévère Alexandre, qu'ils présentaient (avec tout autant d'exagération) comme le parangon de toutes les vertus.
Dans la réalité des faits, Élagabal, fastueuse marionnette, laissa les rênes du gouvernement à sa grand-mère, Julia Moesa et à sa mère, Julia Soaemias. Ce furent cette emprise féminine, la superstition de l'empereur, ses caprices enfantins, ses dépenses inconsidérées, ses mariages homosexuels, et non son tempérament cruel ou sanguinaire, qui horripilèrent les "vieux Romains" et précipitèrent sa chute.
En juillet 221, la grand-mère d'Élagabal, Julia Moesa, pressentant que les vices de son petit-fils finiraient par le perdre, lui et sa famille, le convainquit d'adopter son cousin, Alexius Bassanius sous le nom de Sévère Alexandre et de l'associer au pouvoir au titre de "César". Ce jeune homme était la parfaite antithèse d'Élagabal: sévère, Alexandre l'était plutôt deux fois qu'une ! Avisé, vertueux, patient et sage, il parvint à se rendre populaire auprès de la seule force qui comptât réellement dans l'Empire : l'armée.
Aussi, quand les soldats apprirent qu'Élagabal cherchait à se débarrasser de son cousin et associé, ils commencèrent à murmurer contre lui. C'était sans doute une rumeur non fondée car, à ce moment, il semble bien qu'Élagabal avait accepté de bon coeur le partage du pouvoir que lui avait proposé sa grand-mère et qui prévoyait qu'il se consacrerait uniquement à ses activités religieuses tandis que son cousin assumerait les contraintes politiques et militaires du pouvoir.
Cependant, ayant confondu la foule en se montrant au balcon du Palais en compagnie du jeune prince, il voulut faire arrêter les meneurs: la foule furieuse envahit alors le palais, et l'empereur qui fut massacré dans les latrines du palais. Son corps fut traîné à travers les rues de Rome, puis la populace tenta de jeter le cadavre aux égouts, mais, comme les conduits étaient trop étroits, l'impérial cadavre fut finalement balancé dans le Tibre (11 mars 222). Son cousin, Sévère Alexandre, devenait empereur, et la pierre noire retournait à Emèse.
► 219 - 29 septembre Arrivée d'Élagabal à Rome.
► 220 Le dernier empereur des Han, Xiandi, est détrôné par Cao Pi (Ts'ao P'i), qui fonde la dynastie Wei. Avec la fin de la dynastie Han, la Chine est divisée en trois royaumes : Wei, Shu et Wu. La période dite des Trois Royaumes débute. Le royaume de Wei (220 - 265) était le plus important des trois royaumes qui se formèrent durant la période des Trois Royaumes de Chine. Il fut fondé par Cao Cao (d'où son nom chinois de Cáo Wèi, « Wei des Cao »), ancien ministre des Han, qui avait pris le contrôle du Nord de la Chine, y compris la capitale.
Cao Cao créa officiellement le duché de Wei en 213, dont il est promu roi en 216, mais ce n'est pas avant sa mort en 220, et la montée au pouvoir de son fils, Cao Pi, lequel déposséda le dernier empereur des Han que le Wei devient réellement un empire. Cao Pi se proclame empereur du Wei et décerne à son père le titre posthume d'Empereur Wu du Wei. Trois Royaumes de Chine désigne une période de l'histoire chinoise commençant en 220 après la chute de la dynastie Han et se terminant avec l'établissement de la dynastie Jin en 265. Durant cette période, les trois royaumes de Shu, Wei et Wu s'affrontèrent pour la domination de la Chine.
► 221 - 26 juin Élagabal adopte son cousin Sévère Alexandre.
► 222 - 13 mars Assassinat de Élagabal par les prétoriens, qui nomment Sévère Alexandre empereur.
► 222 SÉVÈRE ALEXANDRE (222 à 235) (Marcus Aurelius Severus Alexander
► 222 Sévère Alexandre (Marcus Aurelius Severus Alexander) est empereur romain de 222 à 235. Né en 208 en Phénicie il est élevé par sa grand-mère Julia Maesa, veuve de Septime Sévère, et par sa mère, Julia Mammaea, et reçoit une éducation soignée. Il est le petit neveu de l'empereur Caracalla et succède à son cousin Élagabal, qui le choisit comme César en 221.
Élagabal tente ensuite de revenir sur sa décision mais Julia Mammaea provoque une révolte des prétoriens qui coûte la vie à Élagabal. Aussitôt Sévère Alexandre prend des mesures allant à l'encontre de celles de son prédécesseur, surtout dans le domaine religieux. Ainsi, il renvoie à Emèse la pierre noire du culte solaire, qui était pour les Romains un objet d'indignation.
Le nouvel empereur, sous l'influence de sa mère et de sa grand-mère, redonne un rôle important au Sénat dont douze membres vont former un "conseil de régence ou de gouvernement" autour de l'empereur. Il s'entoure de conseillers éminents tels les juristes Ulpien qui devient préfet du prétoire (commandant de la garde impériale), ou Papinien, Herennius, Modestinus.
Il lance une politique d'urbanisation avec la construction de thermes qui s'élèvent sur le Champ-de-Mars, installe des paysans-soldats pour protéger les frontières avec obligation pour leurs fils de s'engager dans l'armée. La mort de Julia Maeesa en 223 affaiblit l'empereur, car cette femme avait une influence forte y compris auprès de nombreux officiers. Les militaires, justement, voient d'un assez mauvais oeil le rétablissement d'un régime politique dominé par les civils.
La révolte des prétoriens coûte ainsi la vie à Ulpien, tué sous les yeux de l'empereur, et l'ancien gouverneur de Pannonie, l'historien Dion Cassius ne doit la vie sauve qu'à une fuite éperdue en Bythinie sa province natale. En politique étrangère l'empereur est confronté aux Perses. Ceux-ci ont refait leur unité en 227 sous la conduite du roi Ardachir et pillent la Mésopotamie et la Cappadoce en 231. L'empereur à la tête d'une armée considérable est vainqueur des Perses mais est souvent confronté à des révoltes sporadiques de ses troupes qui craignent son irrésolution.
De retour à Rome en 233, l'empereur donne des Jeux Persiques qui ne suffisent cependant pas à le rendre populaire. Il lui est souvent reproché l'influence de sa mère. En 234, il se rend à Mayence pour repousser les Germains, en particulier les Alamans, mais hésite à combattre et préfère acheter la paix. Les légions indignées se révoltent (235) et l'empereur est tué sous sa tente ainsi que sa mère. C'est le début de la période d'anarchie militaire qui va durer jusqu'aux règnes d'Aurélien et de Dioclétien.
► 224 Le roi parthe Artaban V est renversé par le gouverneur perse Ardachir. Artaban V (208-226) dernier roi parthe, fils de Vologèse V, il défit Macrin à Nisibin. Il dut faire face à la fois à l'avancée des Romains à l'ouest et à la révolte des Sassanides. Il fut vaincu et tué dans la plaine d'Hormizdagan en Susiane par Ardachir. Le fils d'Artaban V, Artavasdès, s'était réfugié dans les montagnes avec les débris de l'armée parthe. Il y continua la lutte de 227 à 228 avant d'être capturé et exécuté à Ctésiphon.
Ardachir Ier, roi sassanide qui conçut le projet de rétablir l'empire perse. Il vainquit un certain Vologèse, prince du Kirmân, et installa à sa place son propre fils. Les princes de Susiane, d'Ispahan, de la Mésène, de l'Oman furent successivement battus et soumis. Il bat son suzerain Artaban V en Susiane en 224. Deux ans plus tard, Ctésiphon tombe entre ses main ; mais l'Arménie et la Géorgie lui échappent. La présence de Sévère Alexandre à la tête des légions romaines stoppe sa reconquête territoriale. En 237, il parvient à s'emparer de Nisibin et d'Harrân. Les Sassanides régnèrent sur l'Iran de 224 jusqu'à l'invasion musulmane des arabes en 651. Cette période constitue un âge d'or pour l'Iran tant sur le plan artistique que politique et religieux.
► 230 Ardachir entre en territoire contrôlé par les romains.
► 232 Campagne contre les Sassanides. Les Sassanides régnèrent sur la Perse de 224 jusqu'à l'invasion musulmane des arabes en 651. Cette période constitue un âge d'or pour l'Iran tant sur le plan artistique que religieux. Les Arabes sont, usuellement, un peuple originaire du Moyen-Orient et plus précisément du Yémen.
► 233 Incursions Alamanes dans l'Empire. Les Alamans ou Alémans étaient un ensemble de tribus germaniques établies d'abord sur le cours moyen et inférieur de l'Elbe puis le long du Main. Royaume alaman, Les dénominations de Royaume barbare d'Alémanie ou de royaume des Alamans ne désignent pas un territoire unifié dirigé par un seul et unique roi, mais d'une confédération de petits royaumes cohabitant dans un espace géographique dénommé Alémanie (Alamani dans sa forme latine) pour la première fois en l'an 289. La zone correspond à la province romaine de Germanie supérieure, avec des territoires situés dans les actuelles Suisse, pays de Bade, et Alsace. Si ce royaume ne se lance pas dans les Grandes invasions, il y est chronologiquement rattaché de par la période historique.
► 234 Début d'une nouvelle campagne en Germanie.
► 235 Sévère Alexandre entame des pourparlers de paix avec les Alamans.
► 235 - 18 mars Assassinat de Sévère Alexandre par des soldats à Mayence qui portent Maximin à la tête de l'empire.
Sévère Alexandre — Wikipédia
► 235 MAXIMIN Ier le Thrace (235 à 238) (Caius Julius Verus Maximinus)
► 235 Maximin le Thrace (Caius Julius Verus Maximinus) fut empereur romain de 235 à 238. D'origine illyrienne, Maximin gravit les échelons de l'armée romaine. Préfet des recrues en 235 alors que l'empereur Sévère Alexandre vient réprimer une révolte en Germanie, lorsque qu'un complot assassine l'empereur et sa mère, le 18 mars, et porte Maximin sur le trône impérial.
Maximin commença par réprimer la révolte en cours en Germanie. Il doit bientôt se rendre dans les Balkan réprimer affronter les Daces et les Sarmates. Il nomma son fils Maximus césar. Cependant devant l'élévation des impôts l'Afrique proconsulaire désigna son gouverneur, Marcus Antonius Gordianus (Gordien Ier), empereur. Agé de plus de 80 ans, celui-ci s'adjoignit immédiatement son fils, Gordien II. Le Sénat de Rome les reconnus en 238. Cependant le légat de Numidie, fidèle à Maximin, vint de cette province voisine de la Proconsulaire et vainquit les Gordien. À Rome, le Sénat ne tarda pas à trouver deux nouveaux adversaires à opposer à Maximim: Maxime Pupien et Balbin. Mais ceux-ci ne tardèrent pas à se tirailler pendant que le peuple nommait le fils et petit-fils des Gordien, Gordien III. Maximin partit donc en campagne en Italie, lorsqu'au début de l'été 238, lui et son fils Maximus furent massacrés par leurs troupes.
► 235 Maximin continue la campagne de Germanie.
► 235 Victoire romaine contre les Alamans.
► 236 Maximin élève son fils, Maximus, au rang de César.
► 236 Victoire romaine contre les Daces.
► 238 mars Révolte en Afrique Proconsulaire.
► 238 mars Les Révoltés prennent Thysdrus et assassinent le procurateur du fisc. Thysdrus, El Jem, ou El Djem est une ville tunisienne de taille moyenne situé au coeur du Sahel. Fondée sur les ruines de la cité antique Thysdrus, elle est célèbre pour son amphithéâtre, le plus grand de l'empire romain (35 000 spectateurs) après le Colisée de Rome (45 000 spectateurs). La ville abrite également un musée où sont exposées les découvertes archéologiques liées à l'amphithéâtre.
► 238 - 22 mars Les révoltés élisent Gordien (proconsul de la province) empereur avec son fils.
► 238 GORDIEN Ier & GORDIEN II (238) (Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus & Marcus Antonius Gordianus)
► 238 Gordien Ier (Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus) (v. 157-238) fut empereur romain en 238. En 238, Marcus Antonius Gordianus, âgé de 80 ans, est proconsul de la province romaine d'Afrique proconsulaire, lorsque les propriétaires, lassés des impôts levés par Maximin le Thrace le désignent comme empereur. Immédiatement, du fait de son âge, il s'adjoint son fils Gordien II. Le Sénat romain ne tarde pas à les reconnaître. Cependant en Numidie, province voisine de la Proconsulaire, le légat resté fidèle à Maximin, lèva une légion, affronte le plus jeune des Gordien, qui périt au combat. À la nouvelle de cette mort et cette défaite, Gordien Ier se suicida.
► 238 avril Le Sénat ratifie l'élection des Gordien et déclare Maximin ennemi d'état.
► 238 12 avril Assassinat de Gordien II par Capellianus, général de Maximin lors de la bataille de Carthage.
► 238 Suicide de Gordien trois semaines après son avènement.
► 238 - 22 avril Le Sénat nomme empereurs Balbin et Pupien.
► 238 BALBIN & PUPIEN (238) (Decimus Caelius Calvinus Balbinus & Marcus Clodius Pupienus Maximus)
► 238 Balbin (Decius Caelius Calvinus Balbinus) fut empereur romain de février-mai 238, conjointement avec Pupien.
► 238 Maxime Pupien (Marcus Clodius Pupienus Maximus) fut empereur romain de février à mai 238, conjointement avec Balbin. Il naquit dans le courant des années 170. Issu d'une vieille famille praticienne, il exerça la fonction de gouverneur dans diverses provinces de l'Empire, et fut plusieurs fois consul. En 234, Maxime Pupien exerce la fonction de préfet de la ville de Rome. Réputé austère et sévère, il fit preuve d'une autorité acharnée, lui attirant l'hostilité permanente du petit peuple de la ville.
Au début de l'année 238, Maximin le Thrace, empereur assez impopulaire et violent, fut sujet à une révolte en Numidie. Des grands propriétaires terriens prirent les armes contre un agent du fisc, le massacrant lui ainsi que les soldats chargés de sa protection. Ils acclamèrent Gordien, un vieux sénateur octogénaire, empereur, qui désigna une fois couronné son fils Gordien II comme co-empereur. Ils s'emparèrent miraculeusement de Carthage. Cependant Capelianus, légat de Numidie, fidèle à l'empereur Maximin, alla écraser la révolte et liquida les usurpateurs.
Cependant le sénat et le peuple romain, enthousiasmés de pouvoir déchoir l'empereur Maximin, s'étaient ralliés à la cause de Gordien. A la nouvelle de l'échec de la révolte, une peur panique s'empara de l'ensemble de la population, craignant une répression sanglante très certaine de l'empereur usurpé. C'est dans ce climat qui furent nommés empereurs Maxime Pupien, à la tête des armées, et Balbin, chargé du maintient de l'ordre à Rome.
L'impopularité de Maxime Pupien, et les protestations du peuple, imposèrent au sénat d'élever le neveux de Gordien II, le futur Gordien III, au rang de César, et héritier des deux empereurs. Maximin apprit calmement tous ces évènements alors qu'il était sur les rives du Danube. Il décida, bien que ne prenant pas pour sérieuse la menace, de marcher sur Rome avec ses troupes. Il franchit les Alpes sans encombre, pénétra en Italie, et parvint aux remparts de la ville d'Aquilée, que Maxime Pupien avait transformé en véritable forteresse, largement pourvue en hommes et en vivres.
A mesure que le siège durait, le moral des troupes de Maximin baissait, voyant les assiégés festoyer sous leur nez alors qu'eux n'avaient que la faim pour repas. La grogne se faisant plus vive, Maximin entreprit de punir ses généraux, les accusant de saboter le moral de troupe, et en fit exécuter quelques-uns pour l'exemple. Cette brutalité injustifiée provoqua la perte de Maximin, une conspiration de ses soldats eu raison de lui et son fils, ces derniers envoyant leurs tête au Sénat en signe de soumission aux nouveaux empereurs. Maxime Pupien et Balbin ne s'entendaient guère, mais c'est la garde prétorienne, mise à l'écart depuis le début des évènements, qui se décida à agir. Alors qu'était fêtée la victoire sur Maximin, les Prétoriens passèrent brusquement à l'action, se saisissant des deux empereurs, les torturèrent de façon acharnée, puis les traînant dans toute la ville jusqu'à leur caserne, où ils les achevèrent. Gordien III, acclamé par tout le monde, leur succéda.
► 238 avril Maximin et ses armées quittent le Rhin pour Rome.
► 238 Gordien III est nommé César sous la pression du peuple romain.
► 238 - 24 juin Assassinat de Maximin et de son fils par les prétoriens qui font allégeance à Balbin et Pupien.
► 238 juillet Assassinat de Balbin et Pupien par les Cohortes Prétoriennes.
► 238 GORDIEN III (238 à 244) (Marcus Antonius Gordianus)
► 238 Gordien III (Marcus Antonius Gordianus Pius) (v. 224-244) fut empereur romain de 238 à 244. Il est le fils de Gordien II et petit-fils de Gordien Ier, tous deux empereur en 238. Maxime Pupien et Balbin succédèrent à ces dernier mais le peuple demanda à ce que Gordien III leur fut adjoint. Aussi lorsque dans l'été 238, les prétoriens éliminèrent Pupien et Balbin il firent reconnaître Gordien comme empereur. Dans un premier temps il régna sous la direction de sa parenté et de sénateurs proche. Puis en 241, il tomba sous la coupe de Timésithée dont il épousa la fille. De rang équestre et ancien gouverneur, Timésithée devint préfet du prétoire.
En Orient, le souverain sassanide Sapor Ier avait conquit la Mésopotamie et s'attaquait à la Syrie. Gordien III mena l'expédition pour le contrer. En passant près du Danube l'expédition rétabli l'ordre sur la frontière. Il est mort au retour d'une expédition menée sur le territoire de l'empire perse, au bord de l'Euphrate. On a longtemps cru qu'il avait été assassiné par son préfet du prétoire Philippe l'Arabe, qui lui succéda. On estime aujourd'hui qu'il avait été blessé au combat ou atteint par une maladie, et que Philippe, au contraire, prouva l'attachement qu'il lui vouait en édifiant pour lui un vaste mausolée.
27 - De 241 (Gotfirn III) à 299 (Victoire de Constance sur les Alamans)
► 241 Les Perses de Sapor Ier franchissent les frontières de l'empire. Sapor Ier ou Shapur Ier, le roi sassanide (241-272) vainquit et captura l'empereur romain Valérien en 260. Il ne put cependant étendre sa victoire à la Syrie et l'Anatolie. Conscient de l'intérêt d'une religion nationale pour unifier son empire, il appuya le prophète Mani, initiateur du manichéisme. Son successeur, Bahram Ier, prendra le contre-pied de cette politique.
► 241 Gordien III part en campagne contre les Perses.
► 243 octobre Mort de Timésithée, préfet du Prétoire et beau-père de Gordien III, Philippe l'Arabe le remplace. Philippe l'Arabe ou l'Ituréen (Marcus Julius Philippus) fut empereur romain de 244 à 249.
► 244 février-mars mort de Gordien III.
► 244 PHILIPPE l'Arabe (244 à 249) (Marcus Julius Philippus)
► 244 Philippe l'Arabe ou l'Ituréen (Marcus Julius Philippus) fut empereur romain de 244 à 249. Fils d'un cheikh arabe, il devint préfet du prétoire en 243 et fut porté au pouvoir par l'armée de Gordien III, celui-ci étant mort pendant la retraite qui avait suivi une expédition contre la Perse. Il conclut la paix avec le roi sassanide Sapor Ier, moyennant le paiement d'un lourd tribut et lutta contre les barbares sur le Rhin et le Danube.
Il semble avoir entrepris d'importantes réformes, en particulier fiscales, mais n'eut sans doute pas le temps de les mener à leur terme. Eusèbe de Césarée, dans son Histoire Ecclésiastique (VI, 34), raconte qu'il voulait devenir chrétien et qu'il se comporta toujours "dans la crainte de Dieu". En réalité, si Philippe semble effectivement s'être intéressé au christianisme, à titre privé ou à quelque fin politique, ce que l'on sait des événements survenus sous son règne le présente comme strictement païen.
En 247, il célébra fastueusement les mille ans de Rome. La même année, il nomma son fils, Philippe le Jeune, césar. Le règne de Philippe l'Arabe fut marqué par deux usurpations: Jotapianus: en Cappadoce. Pacatianus: sur le Danube. Philppe chargea Gaius Messius Quintus Trajanus Decius (Trajan Dèce), alors préfet de la Ville, de réprimer ces usurpations. Mais cela fait, les propres soldats de Trajan Dèce l'acclamèrent empereur. Philippe dut à son tour marcher contre son ancien subordonné. En automne 249 ils s'affrontèrent à la bataille de Vérone. Trajan Dèce l'emporta et Philippe fut tué.
► 244 Traité de paix avec les Perses leur versant un tribut.
►244 Incursions Alamanes en Alsace et en Réthie.
► 244 Les raids du IIIe siècle. Après avoir connu près de trois siècles de paix et de prospérité (grâce à la pax romana, la Paix romaine), l'Empire romain est en proie, au IIIe siècle, à une crise à caractère économique et social. La Gaule est alors secouée par des incursions sporadiques de barbares. Jusqu'ici, l'armée romaine avait réussi à contenir la pression des peuples germaniques situés aux frontières de l'Empire, mais celle-ci se fait de plus en plus forte. En 244, 253 et 276 apr. J.-C., la Gaule, l'Espagne et le Nord de l'Italie sont dévastés par les Francs et les Alamans. Les Saxons font des raids en Bretagne. Rome réussit cependant à les repousser. Pour se défendre, de nombreuses villes élèvent alors des murailles.
► 246 Philippe élève son fils, Philippe le Jeune, au rang de César.
► 246 Campagne contre les Carpes et les Quades qui ont envahi la Dacie (jusqu'en 247).
► 247 - 21 avril Célébration du premier millénaire de Rome.
► 247 mai Philippe nomme son fils, Philippe le Jeune, Auguste (co-empereur).
► 248 Invasion de la Mésie, et incursions Goths et Vandales contre l'empire. La Mésie est une contrée balkanique de l'Europe ancienne, entre le Danube et la Macédoine. Elle recouvre un territoire inclu dans l'actuelle Bulgarie. Initialement peuplée par les Thraces, la région accueille à partir du VIIIe siècle av. J.-C. des colons grecs qui s'installent sur le littoral. Au Ier siècle av. J.-C., les Romains, maîtres de la zone, y fondent la province de Mésie, qui fera partiellement partie de l'empire d'Orient par la suite.
Dès le début du VIe siècle av. J.-C., les tribus slaves font leur apparition dans la région, assimilant progressivement les populations locales. À la même époque, les Bulgares, tribus d'origine turco-mongole conduites par le khan Asparuch, s'installent entre le Danube et les Balkans. Les Goths étaient des peuples germaniques, selon leur propres traditions originaires de la Scandinavie. Ils provenaient probablement de l'île de Gotland (terre des Goths) et se fixèrent dans la région de l'Ukraine moderne et de la Biélorussie. Les Goths formaient un seul peuple jusqu'au IIIe siècle, date à laquelle ils se séparèrent en Ostrogoths ou "Goths brillants", à l'Est, et en Wisigoths ou "Goths sages" à l'Ouest.
► 248 - 1er avril Les légions du Danube proclament le Général Pacatianus empereur puis l'assassinent quelques semaines plus tard.
► 248 Trajan Dèce est envoyé sur le Danube pour intervenir contre les Goths et Vandales. Les Vandales sont un peuple germanique oriental. Ils s'illustrèrent en pillant successivement la Gaule, la Galice et la Bétique (en Espagne), l'Afrique du nord et les îles de la Méditerranée occidentale lors des invasions barbares, au Ve siècle de l'ère chrétienne. Ils fondèrent également un éphémère "royaume vandale d'Afrique", ou "royaume de Carthage" (439–533).
► 248 L'armée du Danube porte à la tête de l'Empire Trajan Dèce.
► 249 août-septembre Le Sénat ratifie l'élection de Trajan Dèce.
► 249 TRAJAN DÈCE (249 à 251) (Caius Messius Quintus Decius)
► 249 Trajan Dèce, (Gaius Messius Quintus Trajanus Decius) fut empereur romain de 249 à 251. Dèce était un Pannonien de souche romaine. Il était préfet de la Ville de Philippe l'Arabe lorsque celui-ci lui demanda de réprimer des usurpations. Dèce s'acquita de sa tâche. Cependant en fin de campagne ses propres soldats l'acclamèrent empereur. Philippe l'Arabe partit à son tour en campagne contre ce nouvel usurpateur.
Ils s'affrontèrent à l'automne 249 lors de la bataille de Vérone qui marqua la fin de Philippe. En 250, il promulga un édit obligeant à sacrifier aux dieux, la désobéissance à cet édit pouvant mener à la peine capitale. Cet édit marque le début des persécutions contre les chrétiens qui refusèrent de sacrifier aux autres dieux. En 251, les Goths envahirent la Mésie et la Thrace. Il mena une expédition contre eux dans la Dobroudja. Après avoir vu son fils Herennius périr au combat, Dèce lui-même fut tué en juin. Trébonien Galle, gouverneur de Mésie éleva le fils survivant de Trajan Dèce, Hostilianus au pouvoir en s'arrangeant pour lui être associé. Hostilianus ne tardant pas à décéder Trébonien Galle devint empereur.
► 249 août Mort de Philippe l'Arabe lors de la bataille de Vérone contre Trajan Dèce. Vérone est une ancienne ville italienne, dans la province de Vénétie, sur les rives de la rivière Adige, à proximité du lac de Garde.
► 249 Valérien est chargé du gouvernement intérieur et de la défense militaire de l'Empire. Valérien (Publius Licinius Valerianus) était empereur romain de 253-260.
► 250 Trajan Dèce élève son fils Herennius au rang de César avec la puissance tribu-nitienne.
► 250 Édit de Dèce contre le Christianisme, persécutions de chrétiens. Persécution de Dèce, persécution brève et violente contre les nouvelles religions, en particulier, le christianisme. Elle est la cause de mouvements tels que le schisme novatien. En 249, quand Dèce devient empereur, il promulgue un programme de restauration politique et religieuse pour faire l'unité de tous les habitants de l'empire autour de l'empereur et des dieux de Rome.
L'empire affronte en effet des difficultés importantes : menaces croissantes sur les frontières, crise de la légitimité impériale. Aussi, il n'est pas étonnant que cet empereur manifeste le désir de mettre à mal les religions qui s'opposent à la religiosité romaine traditionnelle et notamment le christianisme. Ce dernier peut en effet passer pour une rupture de la paix des dieux (pax deorum) garante de l'ordre universel et du pouvoir romain. Leur refus de sacrifier peut aussi passer comme une offense directe à l'empereur : en période de crise cela ne semble plus acceptable à un pouvoir impérial fragilisé.
► 250 - 29 novembre Martyr de Saint Saturnin à Toulouse. Saint Saturnin était le premier évêque chrétien de Toulouse. Saint Saturnin sillonait la région à des fins d'évangélisation. En 250, attribuant le silence des oracles à ses passages fréquents, des prêtres païens lui demandèrent d'honorer Jupiter en lui sacrifiant un taureau. Son refus valut à saint Saturnin d'être attaché au taureau du sacrifice. La légende raconte que le taureau, pris d'une rage folle, descendit à toute allure les marches du Capitole, trainant derrière lui l'évêque. Son cou se brisa dès les premiers mètres.
On ne connait aujourd'hui ni l'architecture, ni l'emplacement exact de ce temple païen. Seul cet épisode de La Passion, écrite au Ve siècle, nous apprend qu'il était pourvu d'un escalier monumental. Le taureau aurait rejoint la campagne en passant par la porte nord de la ville, alors protégée par des remparts. Il aurait abandonné saint Saturnin sur la route de Cahors, la rue du Taur, lui donnant ainsi le nom qu'on lui connait aujourd'hui. Le corps sans vie du malheureux fut recueilli par les saintes Puelles, deux jeunes femmes.
Elles l'inhumèrent à l'endroit exact où son corps fut trouvé, dans un fossé assez profond pour que les païens ne puissent pas profaner la dépouille. Hilaire, évêque au IVe siècle, fit construire une petite église en bois, un oratoire, sur la tombe du martyr. C'est l'emplacement de l'église du Taur que nous connaissons aujourd'hui. Cette église devint bientôt un important lieu de pèlerinage. En 402, devant l'afflux des fidèles, les reliques du saint furent bientôt transférées dans une nouvelle basilique, construite sous l'épiscopat de saint Exupère, la basilique Saint-Sernin.
► 250 Le royaume d'Aksoum (Axoum) prend le contrôle du commerce dans la Mer Rouge. Aksoum est une ville d'Éthiopie, dans la province septentrionale du Tigré. Aksoum fut la capitale du royaume du même nom. Fondé au Ier siècle comme simple principauté, celui-ci connaît une croissance rapide et s'étend jusqu'au plateau du Tigré et la vallée du Nil, annexant les petits royaumes voisins. Il atteint son apogée au Ve siècle, il est alors une grande puissance commerciale, et le premier État africain à battre monnaie.
► 250 Apparition de l'écriture onciale romaine. L'onciale est une graphie particulière des alphabets latin et grec. C'est surtout pour l'alphabet latin que le terme est adapté. En effet, le mot oncial(e) y désigne un type précis de graphie, qui se développe entre le IIIème et le IVe siècle de l'ère chrétienne, à partir de la capitale quadrata et de l'ancienne cursive romaine. L'onciale est restée en vigueur jusqu'au début du IXe siècle, à partir duquel la minuscule caroline tend à la remplacer. Entre le VIIIe et le XIIIe siècle, elle est surtout conservée pour tracer les débuts de livres, de chapitres ou de sections, à la manière de nos majuscules, dans les manuscrits en minuscule caroline ou en gothique, deux graphies qui lui doivent certaines formes, comme celles du d ou du a. Au IIIe siècle après J.C., l'alphabet évolue. Le latin utilise alors l'onciale, une lettre plus petite, plus souple, plus ronde, plus facile à tracer. L'onciale sera utilisée jusqu'à l'époque carolingienne et adoptée dans de très nombreux pays du monde au détriment de leurs écritures traditionnelles.
► 251 Incursions goths en Mésie.
► 251 Nouvelle épidémie de peste (jusqu'en 268).
► 251 mai Trajan Dèce nomme son fils Herennius Augsute et son frère Hostilianus César.
► 251 juillet août Victoire contre les Goths sur le Plateau de Perven où meurt Herennius.
► 251 août Mort de Trajan Dèce lors de la bataille d'Aptaat contre les Goths près de la mère noire.
► 251 TRÉBONIEN GALLE (251 à 253) (Caius Vibius Trebonianus Gallus)
► 251 Trébonien Galle (Gaius Vibius Trebonianus Gallus) fut empereur romain de 251 à 253. Avant son élévation, Trébonien Galle était gouverneur de Mésie, région où Dèce accomplit sa dernière campagne, contre les Goths. À la mort de Dèce, Trébonien s'associa d'abord au fils de celui-ci, Hostilianus, élevé à l'empire. Mais ce-dernier décédant peut après, Trébonien devint empereur. Trébonien commença par négocier une paix avec les Goths. Cependant cela n'empêcha pas ceux-ci de s'agiter à nouveau en 253. Trébonien envoya son fils Volusianus mener une nouvelle expédition. Sur place, Marcus Aemilius Aemilianus, gouverneur de Mésie connu plusieurs succès militaires et ses hommes le proclamèrent empereur. Trébonien chargea Publius Licinius Valerianus (Valérien) de réprimer cette usurpation. Mais avant de parvenir en Mésie, les soldats de ce dernier le désignèrent empereur. Dans les combats qui suivirent entre les différents prétendant à l'Empire, Trébonien et son fils Volusianus furent tué en 253.
► 251 - 5 août L'armée nomme Trébonien Galle, gouverneur de Mésie, empereur.
► 251 - 15 août Trébonien Galle nomme Hostilianus Auguste.
► 251 octobre Hostilianus meurt de la peste.
► 251 octobre Trébonien Galle nomme son fils Volusien Auguste.
► 252 Campagne de Trébonien Galle contre les Perses (jusqu'en 253).
► 252 Incursions des Goths en Asie Mineure.
► 253 Intervention d'Émilien, gouverneur de Mésie contre les Goths. Émilien (Marcus Aemilius Aemilianus) fut empereur romain d'avril à août 253.
► 253 - 24 juillet Émilien est proclamé empereur par ses troupes.
► 253 Trébonien charge Valérien, chef des armées du Rhin et du Danube d'arrêter Émilien.
► 253 Valérien est proclamé empereur par ses troupes.
► 253 août Défaite et mort Trébonien Galle et son fils face aux armées d'Émilien.
► 253 Émilien est reconnu empereur par le Sénat.
► 253 ÉMILIEN (253) (Marcus Aemilius Aemilianus)
► 253 Émilien (Marcus Aemilius Aemilianus) fut empereur romain d'avril à août 253. Émilien avait succédé à Trébonien Galle dans la charge de gouverneur de Mésie. En 253, les Goths s'agitèrent. Les succès d'Émilien contre ses derniers aménèrent ses soldats à l'acclamer empereur. Publius Licinius Valerianus (Valérien) est chargé par Trébonien Galle de réprimer cette usurpation, cependant ce dernier se proclame lui-même empereur avant d'atteindre la Mésie. Dans les combats qui s'ensuivent Trébonien Galle est le premier éliminé mais Émilien ne tarde pas à être tué.
► 253 Valérien à la tête de ses armées marche contre Émilien.
► 253 - 22 octobre Émilien est assassiné par ses soldats qui se rallient à Valérien.
► 253 VALÉRIEN (253 à 260) (Publius Lucinius Valerianus)
► 253 Valérien (Publius Licinius Valerianus) était empereur romain de 253-260. Valérien est d'abord connu comme lieutenant de Dèce. En 253, Trébonien Galle, le charge de réprimer l'usurpation d'Émilien, gouverneur de Mésie. En cour de campagne, avant même d'avoir atteint la Mésie, Valérien est acclamé empereur par ses troupes. Dans les combat qui s'ensuivent Valérien reste le seul survivant après l'élimination de Trébonien Galle et son fils Volusianus, puis d'Émilien. Valérien s'adjoignit son fils Gallien. Il est capturé par le perse Sapor Ier en 259 et décéde en captivité.
► 253 Valérien nomme son fils Gallien Auguste. Gallien fut empereur romain de 253 à 268, partageant le pouvoir avec son père Valérien jusqu'en 260.
► 253 Incursions de Francs et d'Alamans en Gaule et de Goths en Dacie. Les Francs apparaissent au début du Ier millénaire dans les sources latines. Le nom Franc signifie "les braves", "les hardis" ou "les libres". Les Francs, peuples d'origine Germanique sont constitués de deux familles Francs Saliens dont on voit apparaître le nom dans les écrits romains vers le milieu du IIIe siècle et les Francs que l'on appellera Ripuaires beaucoup plus tard (VIIIe siècle) tentent de pénétrer dans l'Empire Romain (241, 242) mais sont repoussés par Aurélien.
Cependant individuellement ou en petits groupes, les Francs pénètrent dans l'empire romain. L'empire romain se disloque, des empires provinciaux autonomes se créent et notamment en Gaule. En 358 l'empereur Julien doit reconnaître l'installation des Francs Saliens en Toxandrie (Belgique entre la Meuse et l'Escaut) et leur accorde le statut de fédérés. De nombreux Barbares sont enrôlés dans l'armée romaine d'autant plus que Rome a renoncé au service militaire obligatoire (aux environs de 395). Les Francs au contact avec les Gallo-Romains acquièrent les connaissances nécessaires pour la conduite et la gestion des troupes.
L'expansion des Francs débute vers 406. En 413-428 les Francs rhénans s'établissent dans la région de Cologne. Aetius, Consul et Patrice romain (432-433) défend l'Empire contre les Barbares il bat successivement les Wisigoths, les Burgondes et les Francs mais lorsque les Huns s'approchent, repoussant devant eux de nombreux peuples il doit allier Gallo-Romain et Germains pour repousser l'envahisseur ce qu'il fera avec succès en battant Attila aux champs Catalauniques (que l'on situe souvent aux environs de Châlons sur marne) en 451. A sa mort (454) les Francs rhénans s'avancent jusqu'à Thionville. Les Francs Saliens plus actifs entre 430 et 450 sous leurs premiers chefs connus Clodion puis Mérovée, ils s'emparent de Tournai et Cambrai. Francs saliens. Tribu franque d'origine germanique installée au IVe siècle en Toxandrie, région comprise entre la Meuse et l'Escaut.
Avec les Francs rhénans, ils constituent la principale peuplade franque. Ils envahissent la Gaule au Ve siècle sous l'impulsion de leur chef Mérovée, ancêtre des Mérovingiens. Sous le règne de Clovis, ils se rendent maîtres d'une grande partie de la Gaule et rédigent leurs coutumes dans un texte connu sous le nom de loi salique. Loi salique, à l'origine, code civil et pénal de la législation des Francs saliens, la loi salique (508) contenait un article qui excluait les femmes du droit de succession à la terre. Il sera repris sous les derniers Capétiens (1316-1328) pour justifier leur évincement de la couronne de France, le dernier roi étant mort sans héritier mâle.
► 253 Gallien est chargé défense militaire de l'Occident, Valérien se chargeant de l'Orient.
► 254 Intervention de Gallien contre les Francs et les Alamans en Gaule (Jusqu'en 256).
► 256 Attaques des Goths en Asie Mineure.
► 256 Aurélien repousse les Francs. Aurélien (Lucius Domitrius Aurelianus, 215 - 275), empereur romain de 270 à 275.
► 256 Attaque de Sapor Ier contre l'Arménie.
► 256 Défaite romaine à Barbalissos contre les Perses.
► 256 Prise de Dura-Europos (en Syrie) par les Perses.
► 256 à 336 - naissance et mort d'Arius. Prêtre alexandrin à l'origine de l'hérésie qui porte son nom : l'arianisme. Comment Dieu peut-il être un et trois à la fois, même s'il apparaît comme tel dans l'Écriture ? Arius, prêtre d'Alexandrie répond que le Verbe (le Christ) n'est qu'une créature, n'ayant reçu le privilège d'être Fils que par adoption. La foi trinitaire n'ayant pas encore reçu de formulation définitive à cette époque, la crise se propage dans tout l'Orient au point que l'empereur Constantin Ier décide d'intervenir en convoquant le concile de Nicée.
Arius est exilé et excommunié mais l'arianisme continue de se répandre, même parmi les barbares évangélisés par l'évêque goth et arien Wulfila (311-383). La conception radicalement différente des rapports entre le Père et le Fils se prête à une soumission du spirituel au pouvoir temporel. Les empereurs Constant Ier, un des fils de Constantin Ier, et Valens qui règnent sur l'Orient sont ariens. Lors de la dissolution de l'empire romain, l'arianisme des royaumes barbares s'oppose au christianisme orthodoxe.
En 589, le dernier roi arien, Récarède Ier, roi Wisigoth d'Espagne, est le dernier à se convertir. L'arianisme, c'est une hérésie rattachée aux ariens qui dit que le christ n'est pas le fils de dieux mais un être doté de pouvoirs exceptionnels, qu'il n'est pas éternel, ni égal à dieu le père. Ils nient en particulier la consubstantialité du fils avec le père (c'est à dire la désignation de dieu en 3 personnes distincts, égales et en une seule et indivisible nature).
L'arianisme fut fondée en 318 par Arius (256-336) prêtre égyptien d'Alexandrie, sa doctrine fut condamnée par le concile de Nicée en 325 réuni sur l'ordre de l'empereur Constantin. Arius fut condamné, exilé et ses idées proclamées hérétiques. Un texte officiel de la croyance catholique fut promulgué "le credo" c'est à dire le "je crois en dieu" le fils Jésus Christ est proclamé "engendré, non pas créer de même nature que le père". Sur son lit de mort Constantin, qui avait rappelé Arius d'exil, le fit baptiser par Eusèbe, un évêque arien de Nicomédie.
L'arianisme se développa chez les peuples germaniques orientaux, de l'autre coté du Danube. En effet, naquit vers 311, un petit fils de prisonnier grec, parfaitement assimilé au point de parler le gothique et de porter un nom germanique Ulfila. Il dirigea une ambassade des Goths à Constantinople, capitale de l'Empire Romain d'Orient, puis, en 334, il fut consacré évêque par Eusèbe au concile d'Antioche, évidemment dans l'hérésie arienne. Arianisme. Hérésie chrétienne qui a cours du IVe au VIe siècle sur l'instigation d'Arius, condamné par l'Église en 325 et en 381. Cette doctrine niant la consubstantialité du Fils avec le Père – c'est-à-dire niant l'essence divine de Jésus – se scinde ensuite en plusieurs tendances qui rencontrent un vaste écho dans l'Empire et hors de celui-ci.
► 257 Édit de Valérien interdisant au chrétiens de tenir réunion dans les cimetières.
► 258 Nouvelle invasion de la Gaule par les Francs et les Alamans.
►258 Ingenuus, gouverneur de Pannonie inférieure se rebelle contre Gallien Ingenuus était commandant en chef des légions de Pannonie (Hongrie actuelle) et de Mésie (Bulgarie actuelle). Il était aussi chargé de la formation militaire du jeune Valérien II, fils de l'empereur Gallien et héritier présomptif du trône impérial romain.
► 258 Défaite d'Ingenuus à Mursa, face à Auréolus, général de la cavalerie de Gallien. Auréolus, était un général romain né en Dacie. Il servit d'abord sous les empereurs Valérien et Gallien puis pris la pourpre impériale en 267. Battu par Gallien puis par Claude le Gothique, il périt dans une bataille sous les murs de Milan en 268.
► 258 Nouvel édit de répression contre les chrétiens.
► 258 Salonin est nommé César. Salonin, fils de Gallien fut élevé au césarat après la mort de son frère, Valérien. Envoyé en Gaule, sous la protection de Postumus alors simple général, il fut proclamé auguste après la capture de Valérien Ier en juin ou juillet 260. Postumus, proclamé auguste à son tour, assiégea Salonin et le fit mettre à mort.
► 258 - 6 août Exécution du Pape Sixte II à Rome. Alors qu'il célèbre l'office dans le cimetière de Calixte à Rome, le pape Sixte II et quatre autres diacres sont arrêtés par les soldats de l'empereur Valérien et décapités. Deux édits interdisant le culte chrétien viennent alors d'être promulgués dans l'Empire romain. Au début du siècle suivant, l'empereur Constantin fera preuve d'une grande tolérance vis-à-vis des chrétiens et mettra ainsi fin aux persécutions.
► 258 - 10 août Exécution de Cyprien, évêque de Carthage.
► 258 - 24 août Exécution de 300 chrétiens à Utique.
► 259 Les armées de Valérien s'emparent d'Antioche.
► 259 Nouvelle incursion des Francs et des Alamans.
► 259 Les Romains abandonnent les champs décumates.
► 259 Valérien est fait prisonnier par Sapor Ier et décéde en captivité.
► 259 GALLIEN (260 à 268) (Publius Licinius Egnatius Gallienus)
► 259 Gallien fut empereur romain de 253 à 268, partageant le pouvoir avec son père Valérien jusqu'en 260. On fait habituellement de son règne la période la plus difficile de l'Empire romain. Mais cet empereur pâtit de l'image défavorable qu'a donnée de lui l'Histoire Auguste. En réalité, assailli à la fois par des usurpateurs et par des invasions sur presque toutes les frontières, il semble s'en être honorablement sorti et il a une part de responsabilité dans le redressement que connut la fin du siècle. Il remporta quelques victoires et procéda à d'importantes réformes.
Par ailleurs, il était un adepte de la philosophie néoplatonicienne. Il mourut assassiné par des partisans de Claude II le Gothique. L'Histoire Auguste est le nom que l'on donne couramment à un recueil de biographies d'empereurs romains composé en latin à la fin de l'antiquité (fin IVe siècle après J-C). Ce recueil commence avec la vie d'Hadrien et s'achève avec celle de Numérien. Il couvre donc la période allant de 117 à 285 de notre ère, avec cependant une lacune de 16 ans, entre 244 et 260.
► 259 Victoire de Postumus contre les Francs. Postume ou Postumus (220-269), fils de Gallien est un général gaulois qui se fit proclamer empereur en Gaule en 260. Postumus régna de 260 à 269 sur toutes les terres celtes de l'Empire d'Occident (Gaules, Bretagne, Espagne) et mourut assassiné par ses troupes.
► 259 Gallien nomme son fils Salonin Auguste à Cologne.
► 259 Postumus assiège Cologne. Le gouverneur des Gaules, M. Cassianus Postumus s'empare de Cologne et y proclame l'empire des Gaules. Les légions d'Espagne et de Bretagne lui apportent leur adhésion. Au cours du IIIe siècle, l'Empire romain connut une grave crise appelée l'Anarchie militaire. Aux invasions barbares s'ajoutèrent une crise économique, qui se traduisit par une dévaluation importante de la monnaie, une grande instabilité politique doublée de guerres civiles, les empereurs étant le plus souvent désignés par les armées, et mourant assassinés ou au combat.
De la mort de Sévère Alexandre en 235 à l'avènement de Dioclétien en 285, 64 empereurs ou tyrans se succédèrent ou luttèrent les uns contre les autres. Parmi eux se trouvent quelques généraux qui tentèrent de se tailler un empire en Gaule et s'intitulèrent Empereur des Gaules. * Marcus Cassianus Latinius Postumus ou Postume régna de 260 à 269 ; il régna sur toutes les terres celtes de l'Empire d'Occident (Gaules, Bretagne, Espagne) et mourut assassiné par ses troupes. * Postumus junior, associé en tant que César à son père Postumus, ne régna pas seul. * Caius Ulpius Cornelius Laelianus ou Lélien se révolta contre Postumus en 269, et fut tué par ses soldats. * Marcus Aurelius Marius, régna quelques jours en 269. * Marcus Piauvonius Victorinus régna de 269 à 271. * Caïus Pius Esuvius Tetricus, ou Tetricus régna de 271 à 273, avant de se soumettre à l'empereur Aurélien, son fils Caïus Pius Esuvius Tetricus Junior, Tetricus II le jeune fut proclamé César sans régner.
► 259 La garnison de Cologne livre Salonin et le général de ce dernier Silvanus à Postumus qui les fait exécuter. Silvanus était un personnage romain du IIIe siècle. Précepteur et conseiller (et peut-être préfet du prétoire) du jeune Salonin, le fils de Gallien, il resta avec lui sur la frontière du Rhin quand son père dut repartir en 258. A l'été 260, le général Postume se rebella, soutenu par l'armée, et assiègea Salonin et Silvanus dans Cologne. La ville fut prise rapidement, peut-être par trahison, et les deux hommes furent tués.
► 259 Les légions nomme Macrien le Jeune et Quietus, fils de Macrien empereurs.
► 259 Victoire de Gallien contre les Alamans près de Milan.
► 260 Troisième campagne du roi perse Sapor Ier contre Rome en Haute Mésopotamie. l'empereur romain Valérien est vaincu et fait prisonnier avec tout son état-major (dont le préfet du prétoire Successianus) et environ 70 000 hommes près d'Édesse, en Osroène. Valérien est supplicié et tué par Sapor Ier. Celui-ci envahit la Syrie, la Cilicie et la Cappadoce mais est arrêté par Ballista et Macrien le père puis attaqué par Odénat de Palmyre.
► 260 Défaite et mort de Macrien père (ministre des finances de l'empereur Valérien) et fils en Illyrie face à Auréolus, général de la cavalerie de Gallien.
► 260 Victoire d'Odénat, prince de Palmyre sur Sapor Ier. Odénat (Septimius Odheinat) est le plus célèbre des princes de Palmyre avec sa femme, Zénobie. Il naît vers 220 et meurt assassiné à Emèse en 267. D'origine Nabatéenne, il fait partie de la dynastie de Hairainides, qui acquiert la citoyenneté romaine sous Septime Sévère. Odénat est membre d'une famille ayant le droit de cité, mais restée très arabe dans ses traditions. Il acquiert le statut de sénateur sans doute sous Valérien et devient "vir consularis" (statut d'ancien consul) en 258. C'est sous Gallien qu'il acquiert, de fait, le pouvoir quasi absolu sur les provinces d'Orient à l'exception du Pont-Bithynie: Il est dans un premier temps "Dux Romanorum" (commandeur des romains) et vainc Macrien et ses fils et Ballista, usurpateurs contre Gallien.
Il est alors nommé par ce dernier "correcteur de tout l'Orient" et a le commandement de ce qui reste des onze légions romaines de cette partie de l'Empire et de toutes les forces disponibles, et a droit de regard sur l'administration civile et fiscale de toute l'Asie Mineure, la Syrie, la Mésopotamie et l'Arabie Pétrée. Il lance deux grandes campagnes militaires contre les Perses en 263, puis en 266-267 où il les écrase et les poursuit jusqu'à Ctésiphon, qu'il ne prendra toutefois pas, mais il contrôle alors la majeure partie des terres perses occidentales, avec Nisibe et Carrhae. Il se fait appeler "Roi des rois" à la manière perse ainsi que son héritier, Herodes.
► 260 Odénat créé le royaume indépendant de Palmyre (Syrie, Palestine, Arabie et Anatolie).
► 260 Défaite et exécution de Quietus, second fils de Macrien face à Odénat, prince de Palmyre.
► 260 Reprise de la Mésopotamie aux Perses par Odénat.
► 260 Postumus proclamé empereur par les armées du Rhin fonde "l'Empire Gaulois".
► 260 Assassinat de Salonin par Postumus, Gallien succède à Salonin.
► 260 Édit de Gallien mettant provisoirement fin aux persécutions contre les chrétiens.
► 260 Prise et pillage de Tarragone par les Francs. Tarragone est une ville située dans le nord-est de l'Espagne, en Catalogne.
► 261 Postumus remporte la victoire contre les Alamans.
► 261 La (Grande) Bretagne et l'Espagne rejoignent l'empire des Gaules de Postumus.
► 262 Gallien reprend le contrôle de la Réthie à Postumus.
► 263 Incursions des Goths en Asie Mineure et en Grèce.
► 264 Victoire de Odénat, prince de Palmyre contre Sapor Ier près de Carre (Mésopotamie).
► 265 Gallien tente en vain d'assiéger Postumus en Gaule.
► 265 La dynastie Wei, de courte durée, est balayée par le général Sima Yan, (Sseu-ma Yen, fils et successeur de Sseu-ma Tchao ou Sima Zhao) qui fonde sa propre dynastie les Jin ou Jin de l'Ouest (fin en 316). La dynastie Jin a succédé au Royaume de Wei (période des Trois Royaumes). Elle a été fondée par Wudi en 265. En 316 l'empire est divisé en deux : au Nord les Seize Royaumes et au Sud la dynastie des Jin orientaux qui prit fin en 420. La dynastie Jin (ensemble de la Chine puis Chine du Sud) compta 15 empereurs.
► 266 Défaite perse face à Odénat devant Ctésiphon.
► 267 Victoire de Gallien face au Goths sur le Nestus
► 268 Auréolus est proclamé empereur par ses troupes à Milan.
► 268 mars Victoire de Gallien sur Auréolus sur l'Adda qui se trouve enfermé dans Milan.
► 268 - 22 mars Assassinat de Gallien par ses officiers près de Milan, le commandant de la cavalerie est nommé empereur.
► 268 CLAUDE II le Gothique (268 à 270) (Marcus Aurelius Valerius Claudius)
► 268 Claude II (Marcus Aurelius Claudius Gothicus), dit Claude le Gothique, fut un empereur romain de 268 à sa mort en 270. Claude II fut nommé maître de cavalerie (magister equitis) après la tentative de putsch d'Auréolus puis participa vraisemblablement à la conspiration des généraux illyriens qui éliminèrent Gallien, son prédécesseur, en septembre 268. Avec l'appui de ces militaires, il prit le pouvoir pour mettre fin à l'anarchie militaire et aux sécessions qui déchiraient l'empire romain.
Ayant promis la vie sauve à Auréolus après la mort de Gallien, Claude le laissa néanmoins massacrer par ses troupes après la reddition de Milan où ce dernier s'était réfugié après sa défaite contre Gallien. Claude démontra alors ses qualités de stratège en écrasant près du lac de Garde des Alamans qui menaient des incursions en Italie du nord. Fort de ce succès, il se rendit ensuite à Rome pour recevoir l'investiture du Sénat de la Ville. Cette formalité accomplie, Claude rassembla toutes les forces disponibles et marcha sur les Balkans, menacés par une invasion de Goths qui sévissaient déjà dans les provinces danubiennes.
Il remporta en 268 à Naissus en Mésie supérieure (aujourd'hui Nish en Serbie) une victoire très difficilement acquise et peu décisive. Mais elle fut fort habilement exploitée par la propagande impériale, ce qui permit à l'empereur Claude de gagner son glorieux surnom de Gothique. Cependant, il fallut encore aux légions romaines plusieurs mois de dures campagnes et d'escarmouches sanglantes pour liquider les bandes errantes de Barbares et détruire la flotte avec laquelle les Goths ravageaient les côtes de Grèce et d'Asie Mineure.
Ce n'est finalement que vers l'année 270 que les Goths furent refoulés à l'est du Danube. Mais au mois d'août de cette année 270, et alors qu'il semblait voué à un règne long et glorieux, l'empereur Claude le Gothique s'éteint à Sirmium (aujourd'hui Mitrovica au Kosovo), victime de l'épidémie de peste qui décimait son armée. Sa mort précoce ne permit pas de régler deux autres graves difficultés qui minaient le pouvoir de Rome : la sécession de l'empire "romain" des Gaules et les velléités indépendantistes du royaume de Palmyre. Il fut divinisé après sa mort et un important monnayage de restitution fut frappé par Aurélien d'abord en 270, puis par Constantin Ier, qui prétendait descendre de Claude II, au début du IVe siècle. L'Église catholique retient de Claude le Gothique qu'il ordonna la décapitation de celui qui devint saint Valentin.
► 268 avril Reddition puis exécution d'Auréolus par Claude II.
► 268 Défaites des Alamans près de Milan et près du lac de Garde. Le lac de Garde est un des plus importants lacs italiens. Il est situé dans le nord de l'Italie, à mi-chemin entre Venise et Milan.
► 268 Postumus est assassiné par ses soldats devant Mayence, Marius prend sa place, empereur en Gaule.
► 268 Marius est éliminé par Victorinus qui est nommé Auguste.
► 268 Prise d'Athènes par les Goths et les Hérules. Les Hérules sont un peuple germanique appartenant au groupe ostique, ou groupe des Germains dits "orientaux", issus de Scandinavie, comme les Goths, les Vandales, les Burgondes, et les Gépides entre autres. Peu connus, les Hérules apparaissent comme un peuple mineur mais seront souvent signalés dans les raids gotiques et notamment sur la Mer Noire, où ils se découvrent vite une vocation de pirates.
Ils sont mentionnés pour la première fois dans les sources romaines au IIIe siècle lorsqu'en 268 et 269, ils prennent part à une coalition barbare qui réunit les Peucins et les Carpes, petites peuplades germanique, mais également des Gépides, et surtout des Goths. L'armée rassemblée, qui aurait compté plus de 300 000 guerriers (chiffre certainement éxagéré par les chroniqueurs romains et grecs), attaque les forces de l'empereur Claude II le Gothique sur le Danube.
► 268 Révolte d'Autun qui demande le secours de Claude II.
► 269 L'Espagne repasse sous le contrôle de Claude II.
► 269 Victoire de Claude II sur les Goths à Naissos (dans l'ex-Yougoslavie)
► 269 Chute et sac d'Autun après 7 mois de siège par Victorinus.
► 269 - 6 septembre Mort de Claude II, victime de la peste à Sirmium. Son frère Quitille est proclamé empereur par ses troupes à Aquilée. Sirmium était une ville romaine, aujourd'hui la ville de Srijemska Mitrovica ou Sremska Mitrovica en Syrmie, province de Voïvodine, en Serbie. Aquilée, colonie romaine fondée en -181, Aquileia devient cité moins d'un siècle plus tard. Durant le règne d'Auguste (de -31 à 14) elle est proclamée capitale de la dixième région d'Italie (actuellement Vénétie et Istrie). Le développement de la ville à cette époque est tel que sa splendeur lui vaut d'être comparée à une seconde Rome.
► 269 QUINTILLE (269 à 270) (Marcus Aurelius Claudius Quintillus)
► 269 Quintille, frère de Claude II, fut proclamé auguste par les troupes à Aquilée après la mort de ce dernier. Au même moment, Aurélien était lui aussi acclamé par les troupes stationnées à Sirmium. Abandonné par ses soldats, Quintille préféra se suicider.
► 269 - 3 novembre Les légions de Pannonie proclament Aurélien empereur.
► 269 - 23 novembre Suicide De Quintille.
► 270 Printemps - Aurélien devient empereur.
► 270 AURÉLIEN (270 à 275) (Lucius Domitius Aurelianus)
► 270 Aurélien (Lucius Domitrius Aurelianus, 215 - 275), empereur romain de 270 à 275. Aurélien était un soldat brillant qui s'opposa avec succès aux invasions des Goths. C'était un homme d'origine humble qui fut fait empereur par l'armée. Sa campagne la plus célèbre fut celle qu'il livra contre Zénobie, reine de Palmyre. Aurélien se montra indulgent avec les habitants de cette ville. Il ramena un énorme butin, dont une idole du temple du Soleil.
Aurélien est aussi le refondateur de la ville gauloise d'Orléans, qui reçut son nom après déformation. En l'honneur de Mithra et de son culte, le 25 décembre (jour du solstice d'hiver) 274, Aurélien proclama que le dieu Soleil était le patron principal de l'Empire Romain. Un temple fut dédié au dieu-soleil au Champ-de-Mars. Ainsi Aurélien a officiellement déclaré le 25 décembre jour anniversaire du soleil invaincu (Sol Invictus).
Mithra ou Mithras est un dieu indo-iranien, fils d'Anahita, dont le culte connut son apogée à Rome vers le IIIe siècle de notre ère. Le mithraïsme était alors une religion concurrente du christianisme. Son culte était surtout très populaire dans les armées, ce qui engagea une rivalité farouche entre les croyants des deux religions, à tel point que l'Église dut faire de nombreuses concessions au culte païen de Mithra.
Le mithraïsme ou culte de Mithra est un culte à mystères qui est apparu probablement pendant le IIe siècle av. J.-C. dans la partie orientale de la Méditerranée, d'où il s'est diffusé pendant les siècles suivants dans tout l'Empire romain. Il a atteint son apogée durant les IIIe et IVe siècles, époque pendant laquelle il devint un concurrent important du christianisme. Le culte de Mithra eut une implantation particulière auprès des soldats romains. Comme toutes les religions païennes, il fut déclaré illégal en 391.
► 270 Mort de Victorinus, Tetricus, sénateur, gouverneur d'Aquitaine, lui succède à la tête de l'empire des Gaules avec le soutient politique et financier de la mère de Victorinus, Victorina. Il donne le titre de César à son jeune fils Tetricus II. Tetricus (Caius Pius Esuvius Tetricus) régna comme empereur en Gaules de 271 à 273, après le meurtre de Victorinus. Il gouverna avec son fils Tetricus II le jeune. Tetricus est un sénateur d'Aquitaine dont l'ascension au pouvoir a été facilitée par Victorine, la mère de Victorinus.
► 270 Nouvelles incursions des Francs.
► 270 Intervention d'Aurélien en Pannonie (jusqu'en 271).
► 271 Construction du mur d'Aurélien autour de Rome.
► 271 Sécession de l'Égypte, de l'Asie Mineure, la Syrie sous l'impulsion de Zénobie, reine de Palmyre. Zénobie, Septimia Bathzabbai plus connue sous le nom de Zénobie, reine de Palmyre, devint souveraine de ce royaume vers 266 ou 267. Elle fit de Palmyre, le foyer culturel le plus brillant du Proche-Orient. Autoritaire et habile, elle soumit la Syrie, l'Égypte, l'Asie Mineure à l'exception de la Bithynie. C'est lors de sa conquête d'Alexandrie, que la célèbre bibliothèque d'Alexandrie fut incendiée.
En 271, Zénobie s'est proclamée impératrice et rompt avec l'Empire romain et donne à son fils Wahballat (Vaballatus) le titre d'Auguste. L'empereur Aurélien décide de mettre un point d'arrêt aux activités de Zénobie et envoie ses troupes en Égypte. En guerre contre l'empire Romain, elle parvient à quelques succès, avant d'être vaincue par l'empereur Aurélien en 272 qui défait ses troupes, s'empare de Palmyre et fait sa reine prisonnière. Emmenée à Rome, elle orne le triomphe de celui-ci. Aurélien se pare de la couronne et du manteau impérial et réintègre le royaume de Palmyre dans l'Empire. Puis exilée à Tibur (aujourd'hui Tivoli), la reine Zénobie mourut en 274.
► 272 août Prise de Palmyre par les troupes d'Aurélien, capitulation des armées palmyréennes.
► 272 août Capture de Zénobie et Vaballatus fuyant Palmyre.
► 272 Insurrection à Palmyre, Antiochos est proclamé roi.
► 272 Prise de Palmyre et massacre de la population par les armées romaines.
► 273 Reddition de Tetricus II face à Aurélien dans la plaine de Châlons-sur-Marne marquant la fin de "l'Empire Gaulois" et la restauration de l'unité de l'Empire. Tetricus II le jeune, Tétricus le Jeune est le fils de Tetricus. On ne sait rien de lui sinon qu'il fut associé avec son père au pouvoir dans l'Empire des Gaules et qu'il figura avec lui au triomphe d'Aurélien à la fin de l'année 274.
► 274 Édit de persécution contre les chrétiens.
► 275 Évacuation de la Dacie.
► 275 Nouvelles incursions des Francs jusque dans les vallées du Rhône et de la Saône.
► 275 - 23 mars Assassinat d'Aurélien près de Périnthe.
► 275 - 25 septembre Le Sénat désigne Tacite comme empereur.
► 275 TACITE (275 à 276) (Marcus Claudius Tacitus)
► 275 Tacite. L'interrègne a duré près de deux mois entre fin septembre et le début décembre 275 au maximum. Tacite n'avait pas été élu par le seul Sénat, mais avec le concours de l'armée, au cours d'un ballet diplomatique entre Rome et les armées pannoniennes afin que Tacite accepte la pourpre. La date de son élévation pose problème et la date traditionnelle du 25 septembre peut être remise en cause si l'interrègne a duré jusqu'au mois de décembre. Tacite, au début 276, quitte Rome pour aller combattre les Goths qui ont envahi l'Asie Mineure. Il est finalement assassiné à Tyane en Cappadoce.
► 275 Tacite nomme son frère Florien préfet du prétoire.
► 275 Campagne contre les Goths en Asie Mineure (jusqu'en 276).
► 276 - 7 juin Assassinat de Tacite, son frère Florien est proclamé empereur par ses troupes.
► 276 FLORIEN (276) (Marcus Antonius Florianus)
► 276 Florien, préfet du prétoire de Tacite, n'était certainement pas son frère ou demi-frère car il ne porte pas le même gentilice que lui (Claudius/Annius). Il ne put se maintenir au pouvoir car Probus fut acclamé empereur et il fut assassiné par ses propres soldats à Tarse.
► 276 juin L'armée d'Orient porte Probus à la tête de l'empire. Probus (Marcus Aurelius Probus) était empereur romain de 276-282.
► 276 5 septembre Assassinat de Florien par ses soldats qui se rallient à Probus.
► 276 PROBUS (276 à 282) (Marcus Aurelius Probus)
► 276 Probus est né le 19 août 232 à Sirmium. Il mène une brillante carrière militaire sous les règnes compris entre Valérien Ier et Tacite. Il est commandant de l'armée d'Orient à la mort de Tacite, est immédiatement proclamé empereur et triomphe facilement de Florien qui est assassiné. L'heure est grave. Le limes rhéno-danubien a cédé sous la pression des invasions germaniques.
Probus restaure la paix en Gaule, en Germanie puis en Rhétie où il inflige une sévère défaite aux peuples germains, en Thrace où il écrase les Sarmates et les Scythes, en Asie Mineure qu'il nettoie des pillards et des pirates pamphyliens, enfin en Afrique où il met fin aux incursions des Blemmyes. En 280, il signe la paix avec Vahram II, monarque sassanide. Il doit faire face aux usurpations de Saturnin, Bonose et Proculus. Probus, ayant triomphé de tous ses adversaires, rentre à Rome en 281 et célèbre ses victoires. Avant de préparer une nouvelle expédition contre les Sassanides, il tombe sous les coups de ses propres soldats à Sirmium en 282.
► 277 Victoire de Probus sur les barbares, il occupe de nouveau la rive droite du Rhin.
► 277 mort de Mani.
► 278 Campagne contre les Burgondes, Vandales, Scythes... (Jusqu'en 279). Les Burgondes sont un peuple germanique du rameau ostique, originaire de Scandinavie (peut-être de Norvège), et ayant participé aux invasions et migrations de la fin de l'Antiquité et du haut Moyen Âge, période durant laquelle ils s'établissent durablement en Gaule. Les Scythes sont un ensemble de peuples nomades, dont l'identité exacte est difficile à établir, mais qui sont probablement des peuples turcs originaires du Turkestan et de la Sibérie occidentale.
► 279 à 280 - Trèves avec Vahram II, roi perse sassanide.
► 280 Saturninus est proclamé empereur à Alexandrie. Saturninus, citoyen romain originaire d'Afrique du Nord (Maurétanie), était un ami très proche de l'empereur Probus. C'est sans doute en raison de cette fidélité supposée qu'il fut nommé gouverneur de Syrie. Probus parti rétablir l'ordre en Occident où les usurpateurs Proculus et Bonosus lui faisaient des misères, Saturninus pensa que le moment était venu pour lui de prendre le pouvoir. Il se fit donc proclamer empereur par les légionnaires stationnés à Antioche.
Son heure de gloire ne dura guère. Probus avait promptement rétabli la situation dans la partie occidentale de son Empire et liquidé les sécessionnistes gaulois. Même s'il songea un moment à régler également son compte à Saturninus, il n'eut pas le temps de mettre ses projets guerriers à exécution : les soldats des autres garnisons d'Orient, restés fidèles à l'empereur de Rome, marchèrent contre l'usurpateur d'Antioche, s'emparèrent de lui et l'exécutèrent.
►280 Saturninus est assassiné alors qu'il est assiégé à Apamée par Probus.
► 280 Carausius est nommé amiral et chargé de défendre les côtes de (Grande) Bretagne des raids saxons. Carausius, général d'origine ménapienne (tribu belge du Nord des Flandres). Carausius était ambitieux, audacieux et sans scrupules. Nommé par Maximien commandant de la flotte de Bretagne, basée à Boulogne, l'amiral Carausius était surtout censé empêcher les incursions des pirates francs en Gaule et en Bretagne.
Pour cela il devait, naturellement, les contenir en Mer du Nord, donc les arrêter avant qu'ils ne pénètrent dans la Manche pour se répandre partout dans les riches provinces gauloises. Mais Carausius adopta une tactique peu commune. En effet, il les laissait passer au large de Boulogne et piller à leur guise les provinces gauloises. Ce n'est qu'au retour qu'il les attaquait, quand, leurs barques alourdies de butin, ils tentaient de regagner leurs repaires.
Carausius faisait alors main basse sur tous ces trésors et, ainsi, l'or pillé en Gaule se retrouvait comme par enchantement dans ses insondables coffres. Les Saxons sont un peuple germanique. Une partie d'entre eux, ainsi que des Angles, des Jutes et des Frisons, envahirent la Grande-Bretagne au début du Moyen Âge. Jutes, peuple germanique de la mer du Nord localisé aux premiers siècles de l'ère chrétienne dans la partie méridionale de la péninsule du Jutland (Danemark) auquel ils ont donné leur nom.
Les Frisons sont un peuple germanique appartenant sur le plan ethnolinguistique au rameau westique. Ce peuple s'est sans doute formé tardivement, au IIe siècle de notre ère, et a pu être confondu, à l'origine, avec ses plus proches voisins : les Angles, les Jutes et les Saxons. Les Ménapiens étaient un peuple celte de la Gaule belgique. Ils sont mentionnés par César dans le De Bello galico et il situe leur territoire dans des marécages longeant la bande côtière de la mer du Nord.
► 280 Soulèvement de Bonosus à Cologne. Bonosus, empereur romain en 280. Profitant des troubles, Bonosus, un Breton né en Espagne d'une mère gauloise. Bonosus était un fort bon soldat et avait servi sous Claude II combattant les Goths à ses côtés. C'est à cette occasion qu'il aurait épousé Hunilla la fille d'un chef Goth.
L'Empereur Aurélien lui confia le commandement de la flotte du Rhin. Mais les Germains incendièrent les navires de la flottille de Bonosus qui était chargée d'assurer la sécurité maritime de la Grande-Bretagne. Bonosus eut peur de la réaction de l'Empereur Probus et il choisit de réunir ses officiers et de se faire proclamer Empereur à Cologne. Probus ordonna aux commandants des places-fortes qui entouraient la région contrôlée par Bonosus de marcher contre l'usurpateur et de l'éliminer. Bonosus encerclé préféra se suicider.
► 281 Proculus est proclamé empereur à Lyon. Proculus, empereur romain en 280. Profitant des troubles, Proculus, un Ligure d'Albenga qui s'était installé à Lyon, se proclame Empereur mais il est rapidement éliminé par les troupes de Probus.
► 281 Fuite de Proculus chez les Francs devant l'avancée des troupes de Probus.
► 281 Les Francs livrent Proculus à Probus qui le fait exécuter.
► 282 Départ de Probus en campagne contre les Perses.
► 282 septembre Carus, préfet du prétoire est proclamé empereur par ses troupes. Carus (Marcus Aurelius Carus) était empereur romain de 282-283.
► 282 septembre Assassinat de Probus à Sirmium, ses troupes se rallient à Carus.
► 282 CARUS (282 à 283) (Marcus Aurelius Carus)
► 282 Carus fut proclamé en Rhétie à la fin août 282. Probus fut assassiné à Sirmium. Carus confia à son fils aîné Carin le rang de césar fin octobre, bientôt suivi de Numérien en décembre. Carus nomma ses fils augustes en mars 283. Au printemps 283, Il entama une brillante campagne contre les Sassanides. Il prit Ctésiphon mais fut foudroyé par un éclair en juillet 283. Numérien, qui l'accompagnait, fut chargé de ramener les troupes.
► 282 septembre Ses 2 fils Carin et Numérien sont nommés César. Carin (Marcus Aurelius Carinus) était empereur romain de 283-285. Numérien (Marcus Aurelius Numerianus) était empereur romain de 283-284.
► 282 Carin est nommé Auguste et est chargé de la défense de l'Occident.
► 282 décembre Départ de Carus et Numérien en campagne contre les Perses.
► 283 mai Carus nomme Numérien Auguste.
► 283 Conquête de la Mésopotamie par Carus.
► 283 juillet Mort de Carus près de Ctésiphon (Perse). Son fils aîné Carin lui succède.
► 283 CARIN & NUMÉRIEN (283 à 285) (Marcus Aurelius Carinus & Marcus Aurelius Numérianus)
► 283 Carin, fils aîné de Carus, fut proclamé césar en octobre 282 et reçut le titre de prince de la jeunesse. Il devint auguste en 283.
► 283 Numérien est le fils cadet de Carus, né vers 253. Il fut nommé César en décembre 282. Il reçut le titre de prince de la jeunesse et fut accepté comme pontife dans les principaux collèges sacerdotaux. Après sa nomination au césarat, il accompagna son père en Orient en décembre 282. Ils atteignirent Antioche en février ou mars de l'année suivante. Numérien se vit élever à l'augustat au mois de mars 283.
► 283 Numérien signe une trêve avec les Perses.
► 284 septembre Grand incendie du forum.
► 284 novembre Assassinat de Numérien à Héraclée par Arrius Aper, son beau père, préfet du prétoire.
► 284 - 20 novembre Dioclétien Commandant de la garde exécute Arrius Aper soupçonné d'avoir tué Numérien. Dioclétien: Caius Aurelius Dioclès Diocletianus. Empereur romain (de 284 à 305), né en Dalmatie en 245, mort en 313.
► 284 - 20 novembre L'armée d'Orient proclame empereur Dioclétien à Nicomédie. Nicomédie, fondée en 264 avant notre ère en Asie Mineure, Nicomédie, appelée Izmit aujourd'hui, fut capitale du royaume de Bithynie. Dioclétien y établit sa résidence. Au IVe siècle, elle fut un haut lieu de l'arianisme.
► 285 Carin est assassiné par un de ses soldats après avoir remporté la victoire contre Dioclétien.
► 285 DIOCLÉTIEN (285 à 286) (Caius Valerius Aurelius Docletianus)
► 285 Dioclétien : Caius Aurelius Dioclès Diocletianus. Empereur romain (de 284 à 305), né en Dalmatie en 245, mort en 313. Apres avoir gravit les échelons de la hiérarchie, Dioclétien devint officier et se distingua sous les empereurs Probus et Aurélien. Après le meurtre de l'empereur Numérien, en septembre 284, Dioclétien fut proclamé empereur par ses soldats de l'armée de Chalcédoine. L'empereur Carin, le frère de Numérien, contesta ce titre et mit en déroute les forces de Dioclétien à la bataille de Moesia de 285. Cependant, il fut tué par l'un de ses officiers, ce qui assura le pouvoir à Dioclétien.
Il dut immédiatement faire face à plusieurs soulèvements au sein de son immense empire et fit alors appel à un officier de Pannonie, Marcus Aurelius Valerius Maximianus, mieux connu sous le nom de Maximien. Il le promut à la dignité de César en 285 puis à celle d'Auguste en 286, lui confiant l'Occident et conservant pour lui-même l'Orient. Pour assurer la défense et l'administration de l'empire, Dioclétien choisit deux collaborateurs supplémentaires en 293, promus à la dignité de César (des sortes de Lieutenant). Il avait adopté l'un d'eux, Gaius Galerius Valerius Maximianus, mieux connu sous le nom de Galère; le second, Flavius Valerius Constantius Chlorus plus connu sous le nom de Constance Ier Chlore, fut adopté par Maximien.
L'empire, devenu une tétrarchie (ou gouvernement à quatre), fut divisé en 101 provinces regroupées en 12 diocèses et en 4 grandes régions, chacune d'entre elles étant dirigée par un César ou un Auguste : Dioclétien, l'Orient, Maximien, l'Italie et l'Afrique, Galère, l'Illyrie et les régions du Danube, Constance, la Bretagne, la Gaule et l'Espagne. Chaque décret était signé conjointement par les quatre souverains mais les décisions prises par les Augustes, la plus haute dignité, et par Dioclétien qui conservait la suprématie, prévalaient. Cette division en quatre de l'empire romain facilitait le maintien de l'ordre. Des victoires remportées sur les ennemis de Rome en Afrique et en Perse permirent d'étendre les frontières de l'empire qui s'en trouva ainsi fortifié.
La réorganisation administrative permit une centralisation du contrôle, sur une base égale, de tous ses vastes territoires, et mit fin à jamais à la prééminence de l'Italie. Dioclétien introduisit à la cour des cérémonies orientales et adopta l'épithète de Jovius (de Jupiter), tandis que Maximien devenait Herculius (d'Hercule). Les réformes entreprises par Dioclétien furent rigides et oppressives, en particulier dans le domaine économique avec l'institution des diocèces et l'édit sur les prix (301) (édit du Maximum) qui fixait le coût maximal des marchandises et des salaires à travers tout l'empire. Mais cet édit s'avéra inapplicable et fut vite abandonné. Il persécuta les manichéens en 297 car il se méfiait d'une doctrine d'origine persane qui se développait dans son Empire au moment même où il était en guerre contre les Perses, et les Chrétiens à partir de 303, à l'instigation de Galère.
Dioclétien abdiqua en 305, et se retira près de Salone, dans un magnifique palais dévoué a Jupiter, qu'il s'était fait construire et dans les ruines duquel s'est édifiée la ville de Spalato (Split). Autour de ce palais, dans lequel figure un sphinx du XVè siècle av. JC que Dioclétien a fait ramener d'Égypte, s'est developpée la ville maintenant croate. Dioclétien instaura la Tetrarchie en 295 dans l'empire romain, qui fut d'une telle confusion que l'empire eut jusqu'a 6 empereurs en meme temps ! Dioclétien, malade, et Maximien, abdiquèrent ensemble en 305 en faveur de leurs Césars. Dioclétien passa ses dernières années dans son palais à Salone. Le système de la tétrarchie sombra dans les guerres qui suivirent ces abdications. Dioclétien mourut en 313.
► 285 Dioclétien nomme Maximien César. Maximien, Hercule (Marcus Aurelius Valerius Maximianus) était empereur romain de 285-305 et de 306-310.
► 286 Carausius se fait proclamer empereur par ses troupes en (Grande) Bretagne.
► 286 - 1er mars Dioclétien nomme Maximien Auguste en Occident et se réserve l'Orient.
► 286 DIOCLÉTIEN & MAXIMIEN (286 à 305) (Caius Aurelius Dioclès Docletianus & Marcus Aurelius Valerius Maximianus)
► 286 Maximien est né à Sirmium vers 250. Il est choisi par Dioclétien pour le seconder. Il est d'abord césar, puis auguste à partir d'avril 286, et c'est la fondation de la Dyarchie. Maximien s'installe à Trèves et doit lutter contre les invasions barbares et l'usurpation de Carausius en Bretagne. En 293, à la création de la Tétrarchie, il est secondé par Constance Chlore. Dioclétien oblige Maximien à abdiquer le 1er mai 305. Il accepte mal la retraite et va soutenir son fils Maxence quand celui-ci s'empare de Rome le 28 octobre 306. Il reprend du service comme auguste en 307 et aide Constantin à qui il donne sa fille Fausta en mariage. Maximien est obligé d'abdiquer à la conférence de Carnuntum le 11 novembre 308. Une dernière fois, il reprend la pourpre au début 310 à Marseille avant de se suicider ou d'être assassiné.
► 286 Incursion des Burgondes et des Alamans dans le nord.
► 287 - 1er janvier Maximien devient consul.
► 287 janvier Intervention de Maximien contre les Germains.
► 287 - 21 juillet Dioclétien prend le surnom de Jovius et donne celui d'Herculianus à Maximien.
► 288 Campagne de Dioclétien contre les Germains (jusqu'en 289).
► 290 Rencontre de Dioclétien et Maximien à Milan.
► 293 - 1er mars Constance Chlore est nommé César en Gaule et Galère à Nicomédie. (futurs empereurs). Constance Ier, Gaius Flavius Valerius Constantius, dit "Constance Chlore" (Chlorus: le pâle) vers 250-306) fut empereur romain de 293 à 306. Galère (Caius Galerius Valerius Maximianus) est un empereur romain du Bas-Empire. Né à Romuliana (près de l'actuelle Gamzigrad en Serbie) dans la province de Mésie, il est nommé César (empereur adjoint) par Dioclétien en 294 pour la partie européenne de l'Empire romain d'Orient. Il devient Auguste (co-empereur) en 305 pour l'Empire romain d'Orient.
► 293 - 1er mars Adoption de Constance Chlore par Maximien.
► 293 - 21 mai Adoption de Galère par Dioclétien.
► 293 Valéria, fille de Dioclétien épouse Galère.
► 293 Constance s'empare de Boulogne contrôlé par Carausius.
► 293 Carausius est assassiné par Allectus, son ministre des finances qui lui succède. Allectus, fonctionnaire des finances de Carausius. Après l'avoir assassiné il assura sa succession, soutenu par les marchands de Londres. Afin de sauver ce qui pouvait l'être, il renonça à défendre ses provinces continentales. Il rapatria en Grande-Bretagne les légions les plus combatives ainsi que sa flotte intacte. Mais Constance Chlore décida de bien préparer son invasion car la puissante flotte d'Allectus patrouillait constamment dans la Manche, et de plus, le Nord de la Gaule n'était pas encore pacifié. Le débarquement se fit en 296, opéré à la fois par Constance Chlore et son préfet du prétoire Asclepiodote qui eut la gloire de vaincre les troupes d'Allectus et de le tuer lors des combats.
► 296 Achilleus se proclame empereur sous le nom de Lucius Domitius Domitianus en Égypte. Achilleus, Lucius Domitius Domitianus, connu aussi sous le nom d'Achilleus, se rebella contre Dioclétien à Alexandrie vers juillet 296. La révolte dura sur deux années alexandrines et Dioclétien dut se rendre en Égypte pour l'écraser.
► 296 Nouvelles incursions perses contre l'empire.
► 296 Défaite des armées conduites par Galère contre les Perses.
► 296 Constance débarque en (Grande) Bretagne.
► 296 Victoire de Constance Chlore sur Allectus à Woolmer Forest. L'île de Bretagne est reconquise par le César Constance Chlore et de nouveau incorporée à l'Empire romain.
► 297 Édit de Dioclétien contre le Manichéisme.
► 298 Trêve de Nibise avec les Perses.
► 298 Dioclétien s'empare d'Alexandrie où Achilleus se réfugiait après 8 mois de siège.
► 298 Invasion des Alamans en Alsace et en Suisse, refoulés par Constance.
► 298 Nouvelle incursion des Alamans de nouveau battus par Constance près de Windisch. Windisch est une commune suisse du canton d'Argovie dans le district de Brugg.
► 298 Galère s'empare de la Mésopotamie.
► 299 Victoire de Constance sur les Alamans près de Windisch.
28 - De 300 (Essor de la civilisation maya) à 340 (Constance II, empereur romain)
► 300 Essor de la civilasation maya. Les Mayas étaient organisés en centres urbains composés d'un site cérémonial, de palais de dignitaires, de quartiers périphériques d'artisans, de commerçants et de guerriers, et de hameaux dispersés de population rurale. Ils possédaient un calendrier très précis, qui leur permettait de prévoir les éclipses solaires et lunaires, et un système d'écriture hiéroglyphique. Leur civilisation était matriarcale, c'est-à-dire qu'elle était dominé par les femmes (c'était les femmes qui avaient le pouvoir). C'est d'ailleurs elles qui transmettaient le nom de famille.
La civilisation maya est une civilisation précolombienne dont l'influence géographique s'est étendue au sud-est du Mexique (péninsule du Yucatan), à l'ouest du Honduras et du Salvador, au nord du Bélize et au Guatemala. Apparue au troisième millénaire avant J.C., elle a connu son apogée du IIIe siècle au xe siècle avant de connaître une décadence progressive et de disparaître au moment de la conquête espagnole au XVIe siècle. Ses principales oeuvres sont de nature architecturales, avec l'édification d'imposants temples et pyramides, astronomiques, comme en témoignent les multiples cycles du calendrier maya, et mathématiques, avec une numération de position en base 20 comprenant le zéro.
► 301 Édit du maximum de Dioclétien fixant le prix maximum des salaires et des marchandises, rapidement abrogé.
► 302 L'empereur romain Dioclétien introduit le système de budget annuel.
► 303 Édit de Dioclétien contre les chrétiens.
► 304 Dioclétien est gravement malade.
► 305 Concile de Cirta en Afrique. Les donatistes, dirigés par l'évêque de Numidie Donat, critiquent et condamnent ceux qui ont renié leur foi pendant les persécutions. Donatiste, de l'évêque Donat, il déniait toute valeur aux sacrements administrés par les évêques indignes ou jugés tels, son principal adversaire fut saint Augustin. Le donatisme, fondé par le chrétien d'Afrique du Nord Donatus, était un courant de pensée chrétien des Ve et VIe siècles.
Considéré comme schismatique puis hérétique par l'Église catholique, il s'est localisé dans l'Afrique du Nord romaine. Après le concile de Nicée, l'orthodoxie chrétienne engagea la lutte contre toute forme de déviation et d'hérésie, tandis que la politique des empereurs variait selon leur sympathie religieuse. Le donatisme, quoique non encore taxé d'hérésie, resta après la mort de son inspirateur Donat vers 355 un foyer d'opposition régionale à l'orthodoxie et connut tour à tour tolérance et répression.
L'hérésie naît d'un ressentiment de ceux qui se sentent proches des martyrs contre ceux qui ont apostasié (renié leur foi) pour échapper au martyre, ou contre les évêques qui auraient laissé détruire des livres saints des églises (on les appelle les traditores). L'évêque Donat, particulièrement virulent, va donner son nom au mouvement. Lors de l'ordination de l'évêque Cécilien, les schismatiques vont élire Donat à sa place, considérant l'ordination de Cécilien comme non valide car l'un des trois évêques qui l'ont ordonné était présumé "apostat".
Le mouvement prend une telle ampleur, avec des doubles nominations d'évêques, des rebaptisassions (les Donatistes considèrent les sacrements comme non valides si l'évêque qui les a donnés est soupçonné de traîtrise), et des actes de violence, que l'empereur Constantin va édicter une loi contre les schismatiques en 317. La répression sera sévère jusqu'en 321 et leur vaudra de nombreux "martyrs". Donat, Donatus Magnus, (mort vers 355), évêque schismatique d'Afrique, évêque de Cellae Nigrae en Numidie, dont les partisans prirent le nom de Donatistes.
Il excita un schisme vers 305 en refusant d'admettre à la communion les traditeurs (traditores), c'est-à-dire ceux qui pendant la persécution de Dioclétien avaient livré aux Païens les vases sacrés et les livres saints. Animateur intransigeant de la contestation contre la nomination de l'évêque de Carthage en 307, il est à l'origine du schisme qui porte son nom : le donatisme et qui divisa les chrétiens africains pendant le IVe siècle. Il fit déposer Cécilien, évêque de Carthage, qu'il accusait d'indulgence par rapport aux tradileurs; mais il fut lui-même excommunié par le pape Miltiade (313), et par les conciles de Rome et d'Arles. Cirta est la plus brillante cité de l'Algérie antique. Elle fut numide, romaine et byzantine pour laisser place à la ville actuelle Constantine.
► 305 Dioclétien est victime d'une attaque.
► 305 - 1er mai Dioclétien et Maximien abdiquent. Constance et Galère les remplacent aux titres d'Auguste, Sévère II et Maximin Daia sont nommés César par Dioclétien et Maximien. Sévère II, empereur romain (306-7). Flavius Valerius Severus n'était, avant d'arriver à l'empire, qu'un obscur aventurier. On ne sait rien de sa vie jusqu'à l'année 305. D'origine illyrienne, il s'était probablement attaché de bonne heure à la fortune de l'empereur Galère. Sévère II fut nommé par Galère césar pour l'Occident. Il dut bientôt prendre les armes contre Maxence, fils de Maximien Hercule, qui avait soulevé les prétoriens à Rome, s'était fait proclamer auguste en Italie et avait associé à l'empire son père Maximien, l'obligeant ainsi à sortir de sa retraite.
Sévère marcha sur Rome; mais son armée, où les anciens soldats de Maximien étaient nombreux, l'abandonna pour passer du côté de ses ennemis. Sévère prit la fuite et gagna Ravenne, mais il tomba entre les mains de Maximien. Maxence le fit mettre à mort (307). Maximin Daia était empereur romain de 305-313. Ancien berger thrace, neveu de Galère qui le nomma César en 305, il gouverna l'Égypte et la Syrie. Il se fit proclamer Auguste par ses soldats en 307, resta maître de l'Orient à Nicomédie d'où il reprit la persécution contre les Chrétiens. Vaincu par Licinius en 313, il s'empoisonna.
► 305 CONSTANCE & GALÈRE (305-306) (Caius Flavius Julius Constantius & Caius Galerius Valerius Maximianus)
► 305 Constance est devenu césar le 1er mars 293 en même temps que Galère. Constance, devenu auguste en 305, passa en Bretagne pour combattre les Pictes. Il mourut à York comme Septime Sévère, le 25 juillet 306. Constantin avait eu le temps de le rejoindre, malgré l'interdiction de Galère.
► 305 Galère (Caius Galerius Valerius Maximianus) est un empereur romain du Bas-Empire. Né à Romuliana (près de l'actuelle Gamzigrad en Serbie) dans la province de Mésie, il est nommé César (empereur adjoint) par Dioclétien en 294 pour la partie européenne de l'Empire romain d'Orient. Il devient Auguste (co-empereur) en 305 pour l'Empire romain d'Orient. Fils de modestes paysans, il gravit tous les échelons de l'armée sous Aurélien et Probus, avant d'être remarqué par Dioclétien dont il devient le gendre en même temps que le César. Tandis que Dioclétien lutte en Mésopotamie contre l'ennemi séculaire la Perse, il repousse les Barbares menaçants sur le Danube : Goths en 294 et 295, puis Sarmates et Marcomans 296 et 297.
Il fait également campagne en Mésopotamie, où il subit une défaite contre les Perses. Enfin, il guerroie longuement contre les Sarmates et les Carpes entre 299 et 305 qu'il repousse finalement au Nord du Danube. Il appliqua strictement les quatre édits de persécution contre les chrétiens en détruisant les lieux de culte. Ayant succédé à Dioclétien en 305, il continua à mener cette politique avant de leur octroyer un édit de tolérance en 311 à Sardique (actuelle Sofia), peu avant sa mort. Son règne fut troublé par la crise de la Tétrarchie. Il mourut au terme d'une terrible maladie (gangrène généralisée, semble-t-il) que les auteurs chrétiens de l'époque ont présentée comme une punition divine. Il fut remplacé par Licinius, qu'il avait fait Auguste dès 308.
► 306 Constantin, fils de Constance chasse les Francs. Constantin, Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, né à Naissus (aujourd'hui Nis en Serbie) en 272, proclamé empereur romain en 306 par les légions de Bretagne et mort en 337, est une figure prépondérante du IVe siècle.
► 306 25 juillet Mort de Constance près de York lors d'une campagne contre les Pictes. Le nom Pictes, peut-être formé à partir d'une épithète latine, signifierait littéralement "hommes peints" (entre autres, selon Bède le Vénérable). Il fut attribué par les Britto-romains, puis par les Anglo-Saxons aux habitants des basses terres de l'Écosse actuelle pour une période allant du IIIe siècle jusqu'au milieu du Ixe siècle environ. Les Pictes correspondaient ainsi vraisemblablement aux Caledonii.
► 306 Les armées de Constance nomment son fils Constantin Auguste.
► 306 Galère nomme Sévère II au titre d'Auguste et Constantin César.
► 306 SÉVÈRE II & GALÈRE (305-308) (Flavius Valerius Severus & Galerius Valerius Maximianus)
► 306 Sévère II fut nommé césar le 1er mai 305. Après la mort de Constance, il devint automatiquement auguste, mais fut contesté par Constantin et Maxence. Il passa en Italie au début 307, mais fut assiégé dans Ravenne par Maximien Hercule venu secourir son fils Maxence. Il se rendit à Maximien à condition d'avoir la vie sauve et fut ensuite exécuté. Ravenne est une ville d'Italie, capitale de province en Émilie-Romagne. Ravenne était un port important sous l'Empire romain et au début du Moyen Âge.
► 306 - 28 octobre Maxence, fils de Maximien est proclamé Princeps par les Prétoriens de Rome. Maxence (Marcus Aurelius Valerius Maxentius) fils de Maximien Hercule, il est un usurpateur qui prit le pouvoir à Rome en 306. Il meurt le 28 octobre 312, lors de la Bataille du pont Milvius, près de Rome.
► 306 octobre Maximien reprend son titre d'Auguste.
► 307 Maxence prend le titre d'Auguste.
► 307 Sévère II à la tête de ses armées marche contre Maximien et Maxence.
► 307 L'armée de Sévère II se rallie à Maxence et à Maximien, Sévère II s'enferme dans Ravenne.
► 307 Maximien met le siège devant Ravenne.
► 307 Maximien capture et fait exécuter Sévère II.
► 307 - 21 mars Constantin se proclame Auguste par ses troupes.
► 307 Maxence chasse son père qui rejoint Constantin.
► 307 - 25 décembre Constantin épouse la fille de Maximien.
► 308 Domitius Alexander, gouverneur d'Afrique se fait proclamer Auguste. Histoire de la Tétrarchie, la première Tétrarchie, dominée par Dioclétien, fonctionna parfaitement. Elle est le résultat d'une approche pragmatique de l'imperium par Dioclétien: l'Empire doit faire face à trop de menaces pour être tenu par un seul homme. La tétrarchie n'est pas un système politique à priori mais bien le résultat d'une expérience convaincante.
Quand Dioclétien et Maximien prirent leur retraite 20 ans après leur prise de pouvoir au cours d'un fabuleux triomphe, leurs Césars respectifs, Galère et Constance Chlore, les remplacèrent et deux Césars leur furent à leur tout adjoints, respectivement Maximin Daia et Sévère. Mais c'est bien Dioclétien qui oblige Maximien à abandonner le pouvoir pour redevenir un simple particulier, celui ci refuse au fond cette décision.
Après le départ de Dioclétien, le système s'affaisse et l'ancien jupitérien doit réintervenir plusieurs fois pour rétablir l'ordre. Mais le système fut perturbé par la mort de Constance Chlore en 306. Constantin Ier et Maxence prirent d'eux-mêmes le pouvoir, l'un en Bretagne, l'autre à Rome, en violation de toutes les règles: c'est un retour à la transmission familiale. Très vite, ils se déclarèrent tous les deux Augustes.
Profitant de la défaite de Sévère face à Maxence, alors qu'il tentait de récupérer la zone de l'empire qui lui était dévolue, Maximien reprit son titre d'Auguste et fit exécuter Sévère. Galère, malade, désigna alors Licinius pour remplacer celui-ci. Enfin, Domitius Alexander se fit proclamer en Afrique du Nord. Il y eut donc à un moment sept empereurs à la fois, tous revendiquant le titre d'Auguste. Par la suite, Constantin élimina Maximien, Maxence lors de la célèbre bataille du pont Milvius puis Domitius Alexander. Pendant ce temps, en Orient, après la mort de Galère, Licinius affronta Maximin Daia et finit par l'abattre. En 324, Constantin Ier vint à bout de Licinius.
► 308 - 11 novembre Entrevue de Cornuntum où Dioclétien impose Licinius au titre d'Auguste, Maxence est déclaré usurpateur. Licinius (Flavius Galerius Valerius Licinianus Licinius) fut empereur romain de 308-324. Il résida à Nicomédie et régna sur la partie orientale de l'Empire romain. En 313, il publia en commun avec Constantin Ier l'édit de tolérance religieuse, appelé habituellement édit de Milan.
► 308 GALÈRE & LICINIUS (308-309) (Galerius Valerius Maximianus & Flavius Licianus Lucinius)
► 308 Licinius Ier fut proclamé directement auguste à la suite de la conférence de Carnuntum le 11 novembre 308. En 313, après le rescrit de Milan, il épousa la demi-soeur de Constantin, Constantia. En 316 eut lieu une première guerre qui opposa Licinius à Constantin et qui se termina par la mort de Valens et la signature d'une paix entre les deux augustes. Le 1er avril 317 furent créés trois césars: Crispus, Constantin II et Licinius II. Une seconde guerre éclata entre Constantin et Licinius en 321 qui se termina par la défaite décisive de Chrysopolis en 324 et la déposition de Licinius qui fut exilé à Thessalonique avant d'être exécuté l'année suivante.
► 308 Maximin, César de Galère se fait proclamer Auguste en Orient par ses troupes.
► 308 Galère donne à Maximin Daia le titre de Filius Augustorum.
► 309 Incendie à Rome suivi de violentes émeutes.
► 309 Galère reconnaît à Maximin Daia le titre d'Auguste.
► 309 MAXIMIN, GALÈRE & LICINIUS (309-310) (Galerius Valerius Maximinus, Galerius Valerius Maximianus & Flavius Licinianus Licinius)
► 309 Maximin Daia, neveu de Galère, est devenu césar le 1er mai 305. Après la mort de Constance Ier Chlore le 25 juillet 306, il n'est pas devenu auguste et est resté subordonné à Galère. À l'issue de la conférence de Carnuntum en novembre 308, il n'est que Filius Augustorum tandis que Licinius Ier devient directement auguste. Ce n'est que l'année suivante que Maximin II prendra le titre d'auguste, titre reconnu par Galère seulement en 310. Après la mort de Galère en mai 311, il est le plus ancien des tétrarques survivants. Il se brouille avec Licinius et Constantin Ier, tandis qu'il essaye de se rapprocher de Maxence. Après 312, Licinius se retourne contre lui et il est finalement éliminé en 313.
► 309 L'Espagne se soulève contre Maxence et soutient Constantin.
► 309 Maximien soulève l'armée contre Constantin.
► 310 L'Espagne sous contrôle de Maxence rejoint Constantin.
► 310 Galère reconnaît à Constantin le titre d'Auguste.
► 310 CONSTANTIN, MAXIMIN, GALÈRE & LICINIUS (310-311) (Flavius Valerius Constantinus, Galerius Valerius Maximinus, Galerius Valerius Maximianus & Flavius Licinianus Licinius)
► 310 Constantin, Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, né à Naissus (aujour-d'hui Nis en Serbie) en 272, proclamé empereur romain en 306 par les légions de Bretagne et mort en 337, est une figure prépondérante du IVe siècle. Fils du César Constance Chlore et d'Hélène, fille du peuple, il rejoignit son père en Bretagne (Grande-Bretagne actuelle) quand celui-ci devint Auguste après l'abdication de Dioclétien et de Maximien Hercule, en 305.
Peu après, à la mort de son père à York, le 25 juillet 306, les troupes le proclamèrent César. La troisième tétrarchie comprit ainsi deux Augustes, Galère et Sévère, et deux Césars, Maximin Daia et Constantin. Quelques mois plus tard, comme Maxence, fils de Maximien, avait pris le contrôle de l'Italie et de l'Afrique du nord sous le titre d'Auguste, Constantin épousa la soeur de Maxence, Fausta, et prit lui aussi ce titre. En 310, après des campagnes victorieuses contre les Francs et les Alamans unis aux Bructères, aux Chamaves, aux Chérusques et aux Tubantes, il déjoua un complot de son beau-père, Maximien, qui fut contraint de se tuer.
En 311, à la mort de Galère, régnaient quatre Augustes : Maximin Daia, Constantin, Licinius et Maxence. Le 28 octobre 312, il fut vainqueur de Maxence, en remportant la bataille du pont Milvius. Constantin a affirmé avoir vu dans le ciel un signe lumineux, identifié plus tard comme le chrisme, formé des deux lettres grecques Khi (X) et Rho (P), les initiales du mot Christ. Ce signe est depuis un emblème de la Chrétienté combattante, notamment dans l'Empire d'Orient.
Certaines sources chrétiennes affirment qu'il s'est converti à ce moment-là. Il fut reçu comme un libérateur à Rome. En 313, il rencontra à Milan Licinius et conclut avec lui un accord de partage de l'Empire. Parmi les mesures prises en commun figurait un édit de tolérance religieuse, appelé habituellement édit de Milan. Les biens des chrétiens qui leur avaient été confisqués leur étaient rendus, leur culte était autorisé, ils n'étaient plus victimes de discriminations.
L'édit de Milan ne constitue pas formellement une officialisation du culte chrétien, qui est mis à égalité avec les autres cultes. Après un premier conflit, assez mal connu, en 316, son beau-frère, Licinius, qui avait vaincu Maximin Daia en 313, perdit presque toutes les provinces d'Europe. En 315, Constantin prit le surnom de Grand. En 317, les empereurs désignèrent comme Césars les deux fils de Constantin, Crispus et Constantin, et le fils de Licinius, Licinius le Jeune.
C'est vers cette date que Constantin transféra sa capitale à Sirmium, puis à Serdique. À partir de 320, Constantin entra de nouveau en conflit avec Licinius. Afin de favoriser les chrétiens, il abrogea les lois d'Auguste sur le célibat, imposa le repos dominical, autorisa l'affranchissement des esclaves par déclaration dans les églises (333), interdit (325) que l'on sépare les familles lors des ventes, autorisa l'Église à recevoir des legs et accorda le droit aux plaideurs de choisir entre le tribunal civil et la médiation de l'évêque.
De plus, il promulgua des lois contre la prostitution des servantes d'auberges, contre les enlèvements, et sur l'humanisation des prisons (326). Enfin de nombreuses lois furent créées afin de lutter contre les relations extra-maritales, là encore pour renforcer le poids du mariage et des cérémonies religieuses chrétiennes autour de ce sacrement. Ainsi, en 329, une loi punit l'adultère d'une femme avec son esclave, en 331, une autre restreint le droit au divorce.
En 336, une loi pénalisa la bâtardise. En 324, Licinius fut vaincu à Andrinople, puis à Chrysopolis et fit sa soumission à Nicomédée. Il fut peu après exécuté, ainsi que son fils. L'unité de l'Empire était rétablie. À partir de 324, Constantin transforma la cité grecque de Byzance en une "Nouvelle Rome", à laquelle il donna son nom : Constantinople. Il y installa la capitale, et l'inaugura en grande pompe après douze ans de travaux, en 330.
Constantin vient donc de préparer sans le savoir deux premiers éléments de la chute de l'Empire Romain : la perte de l'unicité de référence en matière de règlement des conflits, et la création de ce qui va devenir la capitale du futur empire romain d'Orient, qui survivra mille ans à celui d'Occident et développera (ou conservera, selon les points de vue) une ligne distincte de celui d'Occident lors du schisme de 1054.
Constantin institua une nouvelle monnaie d'or, le solidus dont la stabilité et l'abondance fut assurée aux confiscations qu'il fit des importants stocks d'or des temples païens. Le nom du solidus déformé en sou se maintint jusqu'à la Révolution française. Par contre, la dévaluation des monnaies d'argent et de bronze aggrava l'inflation et l'appauvrissement des couches modestes de la population. Constantin entreprit la construction de nombreuses églises, entre autres la célèbre basilique constantinienne, ou basilique du Latran et l'"Église d'or" à Antioche.
Voulant mettre fin à la querelle qui divisait les chrétiens à propos du rapport entre le Fils et le Père, il convoqua et présida un concile oecuménique le 20 mai 325 dans la ville de Nicée, en Bithynie. La conception inspirée par les thèses du prêtre Arius (subordination du Fils au Père) y fut condamnée. La plupart des 250 ou 300 évêques présents signèrent un "symbole" (= un accord) comportant le credo encore en usage aujourd'hui dans la plupart des Églises.
Constantin se chargea d'appliquer les décisions du concile de Nicée en faisant chasser de leurs sièges les évêques "ariens" (on dit aussi "homéens" ; ceux qui ont accepté le credo sont appelés "orthodoxes", "nicéens" ou "homoousiens"). Mais, à la fin de sa vie, Constantin se rapprocha des ariens et c'est leur chef, Eusèbe de Nicomédie, qui organisa son baptême, sur son lit de mort. En 326, Constantin fit périr son fils ainé Crispus, puis son épouse Fausta. On ignore les raisons de ces exécutions, qui ne sont peut-être pas liées entre elles, mais on a évoqué un adultère ou une dénonciation calomnieuse de la part de Fausta.
Il mena campagne contre les Goths, leur imposa la paix en 332, puis se porta contre les Sarmates du moyen Danube. En 337, il venait de déclencher un conflit avec la Perse Sassanide de Sapor II et s'apprêtait à mener une expédition contre cet empire, quand il mourut subitement près de Nicomédie. Il est considéré comme saint par les orthodoxes et les catholiques, pour avoir fait du christianisme la religion officielle de l'Empire. Son neveu Julien l'Apostat empereur en 361 tentera d'effectuer un retour aux dieux traditionnels, mais qui ne durera pas après sa mort en 363.
► 310 Maximien reprend son titre d'Auguste.
► 310 Suicide de Maximien.
► 311 Maxence s'empare de Carthage et mort de Domitius Alexander (usurpateur depuis 308).
► 311 - 30 avril Édit de tolérance de Galère envers les chrétiens.
► 311 - 5 mai Mort de Galère, Maximin Daia récupère sa part d'Empire.
►311 CONSTANTIN, LICINIUS & MAXIMIN (311-313) (Flavius Valerius Constantinus Galerius Valerius Maximianus & Flavius Licinianus Licinius)
► 311 Valéria, fille de Dioclétien et veuve de Galère refuse d'épouser Maximin Daia.
► 311 Maximin condamne Valéria et sa mère à l'exil en Syrie.
► 312 Guerre de Maxence contre Licinius et Constantin.
► 312 Victoire de Constantin à Turin et à Vérone contre Maxence.
► 312 - 28 octobre Mort de Maxence lors de la bataille du pont Milvius près de Rome. L'empereur romain Constantin bat son rival Maxence sur le pont de Milvius à trois kilomètres de Rome. La légende veut que Constantin eu la vision d'une croix dans le ciel peu avant la bataille où il y était écrit en grec "en toutô nika", "triomphe par ceci". Cette apparition incita le monarque à placer des chrismes sur les boucliers de ses soldats pour les protéger. La victoire contre Maxence le réconforte dans son idée. Dès lors Constantin choisit de défendre le christianisme.
La Bataille du pont Milvius opposa le 28 octobre 312 l'Auguste de l'Ouest Constantin à Maxence. La victoire de celui qui allait devenir l'empereur de Rome Constantin le Grand consacre le début d'une nouvelle ère pour l'empire tout entier. Le conflit prend sa source dans l'opposition entre les deux Césars de l'Ouest qu'étaient Constantin et Maxence. Le premier, fils de l'empereur Constance Chlore, règne depuis la mort de celui-ci en 306 sur les provinces de l'ouest de la Gaule et la Bretagne. Le second est le fils du Tétrarque Maximien et le gendre de Galère. Les deux hommes ont également un lien de parenté direct, puisque Constantin était depuis 307 l'époux de Fausta, soeur de Maxence.
► 312 Conversion de Constantin au christianisme, qui devient la religion officielle des romains. Il fut vainqueur de Maxence, en remportant la bataille du pont Milvius. Constantin a affirmé avoir vu dans le ciel un signe lumineux, identifié plus tard comme le chrisme, formé des deux lettres grecques Khi (X) et Rho (P), les initiales du mot Christ. Ce signe est depuis un emblème de la Chrétienté combattante, notamment dans l'Empire d'Orient. Certaines sources chrétiennes affirment qu'il s'est converti à ce moment-là. Il fut reçu comme un libérateur à Rome.
► 312 - 29 octobre Entrée de Constantin à Rome.
► 312 Constantin est nommé premier Auguste par le Sénat.
► 313 février Rencontre de Milan entre Constantin et Licinius.
► 313 février Mariage de Licinius et Constantia, demi-soeur de Constantin.
► 313 - 30 avril Défaite et fuite de Maximin à Tzirallum (Thrace) face à Licinius.
► 313 - 13 juin Édit de Milan venant confirmer la liberté de culte pour les chrétiens et la restitution des biens confisqués. L'édit de Milan confirme la liberté de culte pour les chrétiens et la restitution des biens chrétiens confisqués. Il autorise l'exercice public de la religion chrétienne. La liberté religieuse devient totale dans l'Empire romain. C'est la reconnaissance officielle du culte chrétien. Licinius, qui contrôlait déjà les Balkans et qui rêvait de conquérir l'Orient gouverné par Maximin Daia, conclut à Milan un pacte d'alliance avec Constantin.
Maximin avait longtemps poursuivi la politique de répression envers les Chrétiens, très nombreux dans la partie orientale de l'Empire. Mais aussi bien lui que son nouvel allié avaient tout intérêt à rallier ces activistes à leur cause. Constantin et Licinius accordèrent donc aux Chrétiens la liberté de célébrer leur culte. On leur rendit également leurs églises et leurs terres. Ce fut ce qu'on appela "l'Édit de Milan", même si, en fait, aucun "édit", de tolérance ou autre, ne fut signé à Milan en 313. Il s'agissait seulement d'une déclaration de principe faite par deux gouvernants païens (Constantin n'était encore ni baptisé ni converti), une arme de propagande, destinée à se procurer des intelligences en territoire ennemi.
Édit de Constantin, par l'édit de Milan de 313, promulgué par les empereurs Constantin Ier et Licinius, chacun peut "adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel" ; il accorde la liberté de culte à toutes les religions et aux chrétiens entre autres. Cette légalisation permet aux premières basiliques dans l'Empire Romain de voir le jour. Après l'édit de Milan, les chrétiens constituent en Orient de petites communautés, plus ou moins indépendantes les unes des autres, surtout situées dans les cités.
Chaque cité a son évêque, désigné par le peuple chrétien (en fait par le clergé et les notables), son clergé majeur (prêtres, diacres, sous-diacres) et mineur (lecteur, portiers, fossoyeurs), ses femmes consacrées (diaconesse). En Égypte le christianisme a déjà profondément pénétré dans les villages. L'Église calque alors son organisation sur celle de l'Empire (principe d'accommodement) : les cités sont regroupées en provinces ecclésiastiques dirigées par un évêque métropolitain.
En Dacie, cet édit a une moindre importance, car la Dacie vie de façon libre le christianisme depuis la retraite romaine de 256. Le grand port de la Mer Noire est nommée Constanţa en hommage à la fille de Constantin Ier, car cette ville possède une activité chrétienne très importante déjà depuis longtemps, plus de 14 Épiscopats (évêques) dans la seule ville Constanta, et la ville fut nommée "mitropolie", c'est-à-dire une éparchie (équivalent d'un Diocèse). Il donne également le nom à la ville Constantinople.
Il ne faut donc pas considérer ce fameux "Édit de Milan" comme l'expression du "Triomphe de la Croix" ou encore comme une preuve de la vérité de la Foi victorieuse des ténèbres du paganisme ! Le paganisme désigne l'ensemble des religions des païens. Les chrétiens de la partie occidentale de l'Empire romain ont appelé "païens", tous ceux qui, en dehors des juifs, pratiquaient un autre culte que le leur. Paganisme. Les premiers chrétiens désignent ainsi les religions polythéistes, c'est-à-dire la croyance en plusieurs dieux, à l'instar des civilisations de l'Antiquité. Les adeptes du paganisme sont appelés les païens.
► 313 août Mort de Maximin.
►313 CONSTANTIN & LICINIUS (313-324) (Flavius Valerius Constantinus & Flavius Licinianus Licinius)
►314 Valéria et sa mère sont exécutées à Thessalonique sur les ordres de Licinius. Thessalonique ou Salonique est une ville de Grèce, située au fond du golfe Thermaïque.
► 314 Concile d'Arles des églises chrétiennes. Concile d'Arles de 314, Ayant recon-nu la religion catholique (Edit de Milan en 313), Constantin Ier organise en véritable chef de l'église un Concile à Arles, le 1er août 314 pour y faire condamner le donatisme. Ce concile se déroule dans une église construite sur un ancien temple antique dédié à la Bonne Déesse et devenue depuis Sainte Marie Majeure et plus tard Notre Dame de la Major. Les pères conciliaires condamnent le donatisme, et tout en regrettant "l'absence" du pape Sylvestre qui a réussi à se défiler, ils estiment néanmoins utile de lui faire part des nombreuses décisions qu'ils ont prises et lui demandent de tout entériner, même si en l'occurrence, il n'a pas eu voix au chapitre. Comme les évêques réunis à Arles sont assurés du soutien de Constantin, le pape signe le tout. Ceci constitue une preuve évidente qu'à cette époque, l'autorité des conciles est supérieure à celle du pape.
►316 Exécution de Bassianus par Constantin, marquant la rupture entre les 2 Augustes. Bassianus, il était le récent beau-frère de Constantin et un ami de Licinius.
Début octobre 316, Licinius entra en guerre avec une très grosse armée pour le venger.
► 316 - 8 octobre Défaite de Licinius à Vukovar (Pannonie) face à Constantin.
►316 octobre Licinius nomme Valens, son général, Auguste pour remplacer Constantin.
► 316 novembre Défaite de Licinius au Campus Ardiensis (Thrace) face à Constantin. Licinius poussé par son César Valens engage des hostilités contre Constantin. Ce dernier le rencontre près de Philipoppolis et l'oblige à faire exécuter Valens.
► 316 novembre Exécution de Valens demandée par Constantin à Licinius.
► 316 Édit de Constantin en faveur des esclaves : il devient interdit de les punir par la crucifixion et de les marquer au fer rouge au visage (ils peuvent être marqués ailleurs ou porter un collier inamovible.
► 317 - 1er mars Les fils de Licinius et Constantin sont nommés César.
► 317 Constantin associe son fils Crispus au trône. Crispus, Crispus Flavius Julius, fils aîné de l'Empereur Constantin et de Minervina.
► 320 Défaite des Francs sur le Rhin face à Crispus.
► 320 Chandragupta Ier (319-330) fonde la dynastie des Gupta dans l'Inde du Nord. D'origine scythe, il aurait assassiné le roi de Pataliputra Sundara-varman et exilé son fils. Il épouse la princesse Licchavi Kumâradevî et rétablit l'empire. Des pièces de monnaies sont spécialement frappées pour commémorer l'événement. L'empire de Chandragupta englobe le Magadha et le Kosala (Bihâr actuel et bassin du Gange jusqu'à la Jumnâ). Les Kusana sont refoulés sur le Gandhara. Les Gupta sont une dynastie qui régne sur le nord de l'Inde du milieu du IIIe siècle à 535. Leur origine reste mystérieuse et il est probable qu'ils aient été tout d'abord un clan de râjas à la tête de petits états dans la vallée du Gange et de ses affluents.
► 321 Constantin accorde à l'église le droit de recevoir des héritages.
► 321 Adoption du dimanche comme jour de repos. La semaine a pour origine la pratique juive du Shabbat, qui a elle-même pour origine le récit de la Création du monde dans la Genèse. 7 jours correspondent approximativement à un "quartier" de lune. 13 semaines constituent une "saison" de 91 jours ; l'année de 365 jours comprend 4 "saisons" plus un jour, soit 52 semaines plus un jour.
Les Égyptiens, les Chinois et les Grecs groupaient les jours en décades. La première mention d'une semaine de sept jours apparaît dans la Bible des Hébreux, qui en attribue elle-même l'origine aux Chaldéens. Cette durée est à peu près celle d'une phase de la Lune. En Mésopotamie, le nombre sept était considéré comme néfaste et il était recommandé de ne rien entreprendre les 7, 14, 21 et 28 du mois.
En Occident, l'emploi du découpage en semaines date seulement du IIIe siècle après J. C. L'adoption du dimanche comme jour de repos, quant à lui, est dû à un décret de l'empereur Constantin Ier en 321. Dimanche est le nom du dernier jour de la semaine. Ce mot est issu du latin dies Dominicus, signifiant "jour du Seigneur". Les Romains associaient ce jour au Soleil. L'adoption du dimanche comme jour de repos dans la culture latine remonte à un décret de l'empereur Constantin Ier, le 7 mars 321: "Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés".
Prétextant que ce jour est le jour de la résurrection du Christ, "soleil des chrétiens", il l'imposa aussi aux chrétiens de Rome. Par ce décret, il établissait un véritable syncrétisme entre les 2 principales religions de Rome et de l'empire. Ses successeurs, face à la résistance de beaucoup de chrétiens restés fidèles au Sabbat divin, finirent par le rendre obligatoire dans tout l'empire romain. Les persécutions débutaient à présent, entre croyants au même Dieu !
► 322 Victoire de Constantin contre les Sarmates à Campona. Les Sarmates sont un ancien peuple scythique de nomades des steppes, appartenant sur le plan ethno-linguistique au rameau iranien septentrional du grand ensemble indo-européen. Ils étaient établis à l'origine entre le Don et l'Oural.
► 323 Constantin entre sur les terres de Licinius.
► 324 - 3 juillet Défaite de Licinius face à Constantin à Andrinople. Licinius se réfugie à Byzance.
► 324 Défaite navale de Licinius à Byzance qui prend la fuite.
► 324 - 18 septembre Défaite de Licinius à Chrysopolis qui se réfugie à Nicomédie.
► 324 septembre Capitulation de Licinius à Nicomédie, marquant la restauration de l'unité de l'Empire.
► 324 CONSTANTIN (324-337) (Flavius Valerius Constantinus)
► 324 Constantin choisit Byzance pour capitale.
► 324 - 8 novembre Constantin nomme Constance, son troisième fils, césar.
► 325 mars Exécution de Licinius sur ordre de Constantin.
► 325 Constantin Ier convoque et préside le concile oecuménique mondial des évêques à Nicée, en Asie Mineure. Le Concile s'ouvre le 20 mai en présence de 318 évêques et de légats du pape Sylvestre Ier. * Les quatre évangiles de Luc, Marc, Matthieu et Jean sont seuls retenus. Les autres dits évangiles apocryphes sont détruits. Certains d'entre eux, cachés, ne seront redécouverts qu'au XXe siècle. * L'arianisme est déclaré hérétique, l'identité de nature de Dieu et du Christ ayant été reconnue au cours du concile. Arius est exilé provisoirement ainsi qu'Eusèbe de Césarée. * Publication du Symbole de Nicée qui est le texte du Credo. * L'Église catholique fixe définitivement la fête de Pâques au premier dimanche après la pleine lune de printemps.
Premier concile de Nicée, à Nicée se tint en 325 le premier concile oecuménique. Cela signifie qu'il réunissait toutes les Églises. En effet, chaque patriarcat était indépendant et disposait de son propre magistère en sorte qu'un excommunié dans un patriarcat pouvait faire lever son excommunication dans le patriarcat voisin, ce qui ne manquait pas de se faire. L'empereur romain Constantin Ier convoque le concile. Il s'agit de réunir un tribunal afin de juger Arius. L'effet en sera la création d'une orthodoxie contre une hérésie conçue comme devant être éradiquée. Après plusieurs mois au cours desquels les évêques ne parvinrent pas à se mettre d'accord sur un texte décidant de la nature de la Trinité, l'empereur menaça les 14 récalcitrants. Trois restèrent fidèles à leur conception des choses dont Arius. Ces trois là furent excommuniés. Nicée est une ville d'Anatolie (Turquie) connue surtout pour deux conciles du début de l'histoire de l'église chrétienne.
► 326 Arrestation de Crispus à Pola accusé d'avoir voulu abuser de l'impératrice, Fausta.
► 326 Crispus est empoisonné sur le chemin de Rome.
► 326 - 26 juillet Fêtes à Rome pour les vingt ans de règne de Constantin.
► 326 Adultère de l'impératrice avec un esclave (crime normalement puni de mort).
► 326 L'impératrice est retrouvée morte, ébouillantée dans son bain.
► 327 Construction de la Basilique Saint-Pierre à Rome. La basilique Saint-Pierre de Rome ou plus exactement du Vatican se trouve sur la rive droite du Tibre. C'est le plus important édifice religieux du catholicisme, tant en terme de volume que de renommée. Ce n'est pas une cathédrale puisque l'évêque de Rome siège à Saint-Jean de Latran, en revanche, c'est l'église du pape.
La basilique est l'oeuvre de plusieurs siècles. Elle commence par être un petit monument commémoratif à l'endroit où Saint Pierre aurait été martyrisé, non loin du cirque de Néron. Puis, à partir de 324, l'empereur Constantin Ier fait bâtir une grande basilique. Au XVe siècle, le monument menace de tomber en ruine, et les papes décident de le raser pour en construire un nouveau. La construction de l'édifice actuel a débuté le 18 avril 1506 sous le règne de Jules II pour s'achever en 1626 sous celui de Paul V.
► 330 - 11 mai Fondation de Constantinople sur le site de Byzance. Elle devient officiellement la seconde capitale de l'Empire. Constantinople, fondée en 324 par Constantin le Grand sur le site de l'antique colonie grecque de Byzance, est inaugurée. Elle supplante rapidement Rome par sa richesse et le nombre d'habitants qui y vivent. En 395, elle deviendra la capitale de l'Empire romain d'Orient (ou Empire byzantin) et, à la chute de celui-ci en 1453, celle de l'Empire ottoman. Constantinople est l'ancien nom de l'actuelle ville d'Istanbul en Turquie. Son nom original, Byzance, reste largement utilisé.
► 331 Incursions de Goths sur le Danube.
► 333 Constantin donne à son fils Constantin II le gouvernement de la Gaule. Constantin II (né le 7 août 314 à Arles, mort en 340) est le fils de l'empereur Constantin Ier, qui le proclame César en 317, il fut empereur romain de 337 à 340.
► 333 Constantin donne à son fils Constance II le gouvernement de l'Égypte et l'Asie à Antioche. Constance II, (7 août 317 - 3 novembre 361), empereur romain de 337 à 361. On l'appelle souvent simplement "Constance" : son grand-père, Constance Ier est généralement appelé Constance Chlore.
► 333 - 25 décembre Constantin élève Constant au rang de César. Constant fut empereur romain de 337-350.
► 334 Invasion de l'Arménie par les armées Perses.
► 335 Constantin, soucieux de régler sa succession, divise l'empire entre ses trois fils et deux de ses neveux, Delmatius et Hanniballianus. Constantin II, l'aîné, devait recevoir la Bretagne, la Gaule et l'Espagne ; Constance, l'Asie, la Syrie et l'Égypte ; Constant, l'Italie, l'Illyricum et l'Afrique ; Delmatius, les Balkans ; Hanniballianus l'Asie orientale avec le titre de roi.
► 337 - 3 avril Constantin tombe malade lors de la célébration de Pâques.
► 337 - 22 mai Mort de Constantin, les 3 fils de Constantin se partagent l'Empire, Constant & Constantin II l'Occident et Constance l'Orient.
► 337 CONSTANTIN II, CONSTANT & CONSTANCE II (337 à 340) (Flavius Claudius Constantinus, F. Julius Constans & Flavius Julius Constantius)
► 337 Constantin II naquit le 7 août 314 à Arles. Fils de l'empereur Constantin Ier, qui le proclame César en 317, il fut empereur romain de 337 à 340. En 332, il dirige une expédition militaire victorieuse contre les goths. En 335, son père donne des responsabilités à ses trois fils, Constantin II, Constance II et Constant et à ses deux neveux Dalmatius et Hannibalien. En 337, à la mort de l'empereur Constantin, ses fils massacrent ses neveux et se partagent l'Empire. Le 9 septembre 337 Constantin II est déclaré Auguste par le Sénat, avec ses frères Constance II et Constant. Constantin II avait les provinces de Bretagne, de Gaule et d'Espagne; Constance II, les provinces d'Asie, d'Orient, de Pont et de Thrace et Constant, celles d'Italie, d'Afrique, de Pannonie, de Dacie et de Macédoine. Constantin II et Constant ne purent s'entendre. Voulant prendre l'Italie à Constant, Constantin II fut tué, en avril 340, à la bataille d'Aquilée. Ses provinces passèrent à Constant.
► 337 Constant était né en 320 et reçut le titre de césar le 25 décembre 333. Auguste après le 9 septembre 337 avec ses deux autres frères, Constantin II et Constance II, il ne tarda pas à se fâcher avec son frère aîné qui périt en avril 340. Après la mort de son frère, Constant récupéra l'héritage de Constantin II et eut en charge l'Occident. Une maiorina fut frappée à l'occasion du 1100ème anniversaire de Rome en 348, rappelé par la légende de revers "le Retour des Temps Heureux". Constant fut assassiné au début de l'année 350. La maiorina est une nouvelle monnaie créée en 348 par les co-empereurs.
► 337 Constance II est né le 7 août 318 à Sirmium. Il est élevé au césarat le 8 novembre 324 à l'âge de six ans. Il va régner trente-sept ans, l'un des plus longs règnes du IVe siècle. Après avoir écrasé la révolte de Magnence, il est seul auguste avec un césar, Constance Galle, qu'il fait exécuter en 354. Le 6 novembre 355, il élève son cousin Julien au titre de césar. Il se rend à Rome en 357, puis à Sirmium dont il fait sa capitale. Devant le danger sassanide, il quitte cette région en 359 et s'installe à Antioche. Julien est proclamé auguste en février 360. Constance meurt le 3 novembre 361, laissant Julien à la tête de l'Empire.
► 337 Assassinat de Delmace, et Jules Constance, neveu et demi-frère de Constantin. Jules Constance, Julius Constantius, né entre 294 et 300 fut le père de l'empereur romain Julien et de Gallus. Il était l'un des enfants que Constance Chlore eut de Théodora après avoir répudié sa première épouse, Hélène, mère de Constantin Ier.
► 337 - 9 septembre Entrevue de Viminacium entre les trois frères pour le partage de l'empire.
► 337 Attaques de Sapor II (roi sassanide de Perse) contre l'Empire en Mésopotamie.
► 339 Saint Martin offre la moitié de son manteau à un pauvre près d'Amiens. Saint Martin, Martin de Tours (né en 315 ou 336 à Sabria en Hongrie, mort à Tours en 397) fait partie des Pères de l'Église. Fils d'un officier romain il s'engage à 15 ans dans la cavalerie impériale romaine. Ayant quitté l'armée il se met sous la direction de saint Hilaire, l'évêque de Poitiers. Après avoir vécu 10 ans en ermite il fonde le premier monastère de la Gaule à Ligugé près de Tours ; nommé évêque de Tours en 372, il fonde un centre monastique à Marmoutier où il passe ses loisirs tout en gouvernant son diocèse avec zèle. Il est l'évêque, qui le premier, évangélise les campagnes, y créant partout des églises. Il meurt le 8 novembre 397.
► 339 Victoire de Constant contre les Sarmates.
► 340 Constantin II marche sur Rome (appartenant à son frère Constant).
► 340 mars-avril Défaite et mort de Constantin II face à Constant qui devient maître de l'Occident.
► 340 CONSTANT & CONSTANCE II (340 à 350) (Flavius Julius Constans & Flavius Julius Constantius)
► 340 Constant fut empereur romain de 337-350. Troisième fils de l'empereur Constantin Ier, qui le proclame César, en 323, après la soumission de Licinius à Nicomédie. En 335, son père donne des responsabilités à ses trois fils, Constantin II, Constance II et Constant et à ses deux neveux Dalmatius et Hannibalien. En 337, à la mort de l'empereur Constantin, ses fils massacrent ses neveux et se partagent l'Empire.
Le 9 septembre 337, Constant est déclaré Auguste par le Sénat, avec ses frères Constantin II et Constance. Constant, avait les provinces d'Italie, d'Afrique, de Pannonie, de Dacie et de Macédoine; Constantin II avait les provinces de Bretagne, de Gaule et d'Espagne, et Constance II, les provinces d'Asie, d'Orient, de Pont et de Thrace. Constantin II et Constant ne purent s'entendre. Voulant prendre l'Italie à Constant, Constantin II fut tué, en avril 340, à la bataille d'Aquilée. Ses provinces passèrent à Constant.
En 341 et 342, Constant entreprit peut-être (le fait est contesté) des campagnes contre les Francs et en 343 contre les Pictes et les Scots. Constant a persécuté les païens et les donatistes. Il interdit en particulier les sacrifices païens et la pratique de la magie en 341 et renouvelle cette interdiction en 346 avec son frère Constance II qui gouverne l'Orient. En janvier 350, Constant fut victime d'une conspiration militaire. À Autun, un officier, Magnence, fut proclamé empereur. Peu après, Constant fut tué par les hommes de Magnence près d'Elne.
► 340 Constance II, né en 317, empereur romain de 337 à 361. On l'appelle souvent simplement "Constance" : son grand-père, Constance Ier est généralement appelé Constance Chlore, et Constance III est un éphémère empereur romain du Ve siècle. Troisième fils de Constantin Ier (après Crispus et Constantin II), il partagea d'abord le pouvoir avec ses frères Constantin II et Constant, en se chargeant de la part orientale de l'empire.
Après la mort de Constantin II en 340, il continua à gouverner à partir d'Antioche cette zone, tout en menant une longue guerre contre la Perse. En 350, Constant fut détrôné par l'usurpateur Magnence et tué peu après dans les environs d'Elne. En 351, Constance II nomma César en Orient son neveu Gallus. Pour arrêter les progrès de Magnence, une fille de Constantin Ier provoqua le soulèvement d'un général pannonien, Vetranio, qui se fit empereur à Mursa. Constance II quitta l'Orient et Vetranio se soumit aussitôt.
La rencontre avec Magnence eut lieu au cours de la bataille de Mursa, en septembre 351, bataille qui fut pour Rome un irréparable désastre, toutes ses meilleures forces étant détruites. Magnence battu se suicida. Constance II conquit l'Italie en 352 et la Gaule en 353. L'ensemble de l'empire fut ainsi réuni sous son autorité. En 354, mécontent de la manière de gouverner de son neveu Gallus, il le fit exécuter. En 355, il envoya le demi-frère de Gallus, Julien, le représenter en Gaule, avec le titre de César, pendant que lui-même résidait à Milan, inquiet du danger Alaman.
En 357, il vint visiter Rome, qu'il ne connaissait pas, puis conduisit une offensive contre les Sarmates et enfin contre les Perses. Mais en 360, à Lutèce, les troupes de Gaule proclamèrent Julien Auguste, c'est-à-dire empereur à part entière. Constance II dut se porter contre lui, quand, en 361, en cours de route, il mourut subitement, après avoir reçu, comme son père, le baptème d'un prête arien, léguant le trône à son compétiteur. Beaucoup moins connu que Constantin Ier (et que Julien), Constance a eu cependant un long règne. Ce fut sans doute lui qui rendit impossible le retour de l'empire au paganisme. Il organisa soigneusement l'administration et, malgré des déboires, parvint à protéger l'empire contre les attaques qui menaçaient celui-ci sur deux fronts, du côté de la Perse et du côté du Rhin. Sous certains aspects, c'est le premier empereur byzantin.
► 340 à 397 - naissance et mort de Saint Ambroise. Père et docteur de l'Église. Saint Ambroise, évêque de Milan (de 374 à 397) est l'un des Pères de l'Église latins. Il est connu en tant qu'écrivain et poète, quasi fondateur de l'hymnodie latine chrétienne et lecteur de Cicéron et des Pères grecs, dont il reprend les méthode d'interprétation allégoriques. Il est aussi l'un des protagonistes des débats contre l'arianisme. C'est auprès de lui que saint Augustin se convertit au christianisme.
29 - De 341 à 400
► 341 Campagne de Constant contre les Francs sur le Rhin.
► 348 à 410 - naissance et mort de Prudence. Poète latin chrétien, né à Calahorra (Espagne) en 348. Il remplit diverses fonctions à la cour de l'empereur Honorius, et écrivit contre Symmaque, le dernier militant du paganisme, deux livres qui nous sont parvenus (385 et 388). Il mourut vers 410, sans doute en Espagne. On a de lui, outre les deux ouvrages cités, plusieurs recueils, dont les principaux sont de caractère lyrique (Cathemerinon, hymnes pour les diverses heures du jour; Peristephanon, hymnes en l'honneur des martyrs) et didactique (Apothéose, Hamartigénie). Enfin, dans la Psychomachie, il a créé le poème allégorique, dont la vogue a été si grande au Moyen Âge.
► 350 - 18 janvier Une conspiration de Marcellus (agent de Magnence), à Autun porte Magnence au pouvoir, Constant prend la fuite. Magnence, officier d'origine franque par sa mère, proclamé empereur à Autun, soulève une partie de l'armée et renverse l'empereur Constant Ier. Il prend le contrôle de la partie occidentale de l'Empire romain. Constant Ier doit prendre la fuite et est assassiné à Elne, au pied des Pyrénées. Magnence, (Flavius Magnentius), tyran, né en Germanie. Il fut fait prisonnier fort jeune et prit du service chez les Romains où il devint capitaine des gardes de l'empereur Constant. Il se fit proclamer empereur à Augustodunum (Autun) en 349, et battit Constant qui périt dans sa fuite 350. Marchant sur Rome, il y défit et tua Népotien, autre usurpateur, et proposa à Constance II de le reconnaître empereur d'Occident. Celui-ci pour toute réponse marcha contre lui, le battit à Mursa sur la Drave en Illyrie et le contraignit à prendre la fuite. Magnence se donna la mort à Lyon, en 353.
► 350 - 27 février Constant est capturé et exécuté à Helena (Elne).
► 350 CONSTANCE II (350 à 361) (Flavius Julius Constantius)
► 350 - 1er mars Le Général Vetranio, chef de la milice se fait proclamer empereur en Pannonie. Vetranio, géneral des légions du Danube, Vetranio se souleva en 350 contre Constance II lors de la révolte de Magnence. Ils firent un pacte et marchèrent sur Constance II. Mais celui-ci fit un "pacte secret" avec Vertanio en lui disant qu'il était prêt à partager l'empire et pour négocier il l'invita en Mésie (actuelle Serbie). Mais les légions de Vetranio furent soudoyées et changèrent de camp. Contraint de se rendre il fut exilé à Prusa en Turquie.
► 350 - 1er juin Népotien, petit-neveu de Constantin marche sur Rome. Usurpation de Népotien à Rome pendant 28 jours. Il est le fils d'Eutropia l'une des soeurs de Jules Constance. Népotien est battu et tué par Marcellus, agent de Magnence. Népotien, (Flavius Popilius Nepotianus), neveu de Constantin Ier et consul en 336. Il se fit proclamer empereur en 350 et vainquit Anicet, préfet du prétoire de Magnence. Il fut battu sous les murs de Rome par Marcellin, général de Magnence, et fut mis à mort après 23 jours de règne.
► 350 - 3 juin Népotien se fait proclamer empereur.
► 350 - 30 juin Marcellus entre dans Rome et exécute Népotien.
► 350 - 25 décembre Les troupes du Général Vetranio se rallient à Constance; Vetranio abdique.
► 350 Les Huns envahissent la Perse et l'Inde.
► 351 Magnence élève son frère Decentius au rang de César; il est chargé de défendre la Gaule.
► 351 Constance II élève Gallus, fils de Jules Constance, au rang de César. Gallus, Flavius Claudius Constantius Gallus (325/326-354) est un empereur romain du IVe siècle.
► 351 - 15 mars Constance II confie la direction de l'Orient à Gallus.
► 351 Départ de Constance II pour lutter contre les usurpateurs.
► 351 Silvanus trahit Magnence pour rejoindre Constance II. Claudius Silvanus (- 7 septembre 355) était un général romain d'ascendance franque qui a été empereur en Gaule pour 28 jours en 355.
► 351 - 28 septembre Constance II remporte la victoire contre Magnence à Mursa (Illyrie).
► 352 Prise d'Aquilée par Constance II.
► 352 Affrontement entre Magnence et Constance II en Gaule Cisalpine.
► 352 Incursion de Francs et d'Alamans en Moselle.
► 353 Constance remporte la victoire contre Magnence à Mons Seleucus.
► 353 - 10-11 août Suicide de Magnence à Lyon.
► 353 - 18 août Suicide de Decentius, frère et César de Magnence à Sens.
► 353 - Constance II nomme son cousin Gallus César en Orient.
► 353 à 431 - naissance et mort de Saint Paulin, évêque de Nole, est un poète latin né à Bordeaux en 353, mort à Rome en 431. Avec Prudence, saint Paulin de Nole est l'un des plus grands poètes latins chrétiens. On a conservé de lui 35 poèmes, très élégants, la plupart en hexamètres dactyliques. Parmi ceux-ci, il y a des "Laudes" annuelles en l'honneur du saint patron de Nole, Félix et trois paraphrases de Psaumes (genre littéraire qui aura une grande postérité). Paulin de Nole est aussi l'auteur d'un ensemble de 49 lettres de forme très ornée, témoignant de sa piété et de sa sensibilité personnelle, ainsi que du goût littéraire de l'époque.
► 354 Condamnation et exécution de Gallus pour les crimes commis dans l'exercice du pouvoir.
► 354 à 430 - naissance et mort de Augustin d'Hippone, Saint Augustin. Père de l'Église latine et théologien. Saint Augustin dans 'Les confessions' décrit sa conversion au christianisme avec une sincérité qui vaut plus que beaucoup de biographies. Le jeune Augustin est attiré par la philosophie, et se rapproche des mouvement manichéens, avant de se tourner vers le néoplatonisme, mais c'est sous l'influence de la pensée de Saint Ambroise qu'il décide de devenir prêtre. Écrivain fécond et actif, il déploie une intense activité de prédicateur, d'organisateur des communautés et de lutte contre les hérésies. La doctrine d'Augustin s'appuie sur la foi en Dieu mais ne combat pas la raison. Elle est une méditation de l'intelligence sur la création, le bien et la vertu. Les livres de Saint Augustin sont de nos jours autant lus par les esprits religieux que par les philosophes laïcs.
► 354 Le pape Libère fixe la date de la naissance du Christ, le 25 décembre. Aucun texte dans les évangiles ne précise la période de l'année où a eu lieu cet événement. C'est le pape Libère qui décide en 354 que Noël sera fêté le 25 décembre et qui codifie les premières célébrations pour pouvoir assimiler les fêtes populaires et païennes célébrées autour du solstice d'hiver. Libère (Liberius) fut évêque de Rome (pape) de 352 à sa mort en 366. Il succédait à Jules Ier et fut élu le 17 mai 352. Il fut le premier a désigner Rome comme le siège apostolique.
La Vierge Marie lui apparut dans un rêve dans la nuit du 4 et du 5 août, lui demandant de construire une chapelle. La même nuit, selon l'histoire ecclésiastique, il y eut une chute de neige miraculeuse sur les sept collines de Rome. Il acheva la construction de la basilique Sainte-Marie-Majeure deux années plus tard. Il combattit sans succès l'arianisme de l'empereur Constance, mais dut céder. Il eut à chasser l'antipape Félix II. À sa mort en 366, son trône fut réclamé par Damase Ier et Ursin. C'est Libère qui, selon la tradition, aurait en 354 fixé le jour de la naissance du Christ au 25 décembre.
► 355 Silvanus est accusé d'avoir fomenté un complot contre Constance II.
► 355 - 11 août Le chef franc Silvanus se fait proclamer empereur par ses troupes à Cologne.
► 355 septembre Assassinat de Silvanus par des hommes de Constance II.
► 355 Nouvelles invasion germaniques jusqu'en Gaule (Troyes, Lens, Autun...).
► 355 - 6 novembre Constance II nomme Julien (son cousin) César en Gaule. Julien : Flavius Claudius Julianus (331 - 363), nommé Julien l'Apostat par la tradition chrétienne, fut César en Gaule (355-361), puis empereur romain à part entière (361-363).
► 355 novembre Julien épouse Hélène, fille de Constance II.
► 355 - 1er décembre Julien quitte Rome pour prendre ses fonctions en Gaule.
► 356 - 24 juin Julien disperse les Alamans qui assiégeaient Autun.
► 356 Julien s'empare de Brumath. Brumath est une commune française, située dans le département du Bas-Rhin et la région Alsace.
► 356 Julien s'empare de Cologne.
► 357 Victoire de Julien face aux Germains près de Strasbourg.
► 357 - 4 avril Constance II accorde à Julien le commandement suprême des opéra-tions en Gaule.
► 357 - 28 avril arrivée de Constance II à Rome.
► 358 Capitulation des Francs face à Julien en Belgique.
► 358 Intervention de Julien en Rhénanie. La Rhénanie est une région de l'ouest de l'Allemagne. Elle doit son nom au Rhin, qui la traverse.
► 359 Campagne de Constance II contre les Perses.
► 359 Constance II rappelle Julien et ses légions en Orient en renfort contre les Perses.
► 360 Victoire de Julien contre les Alamans.
► 360 février Proclamation de Julien au rang d'Auguste par ses troupes à Lutèce.
► 360 Constance II refuse de reconnaître le titre d'Auguste à Julien.
► 361 Julien à la tête d'une armée marche contre Constance II.
► 361 Constance malade désigne Julien comme son successeur.
► 361 - 3 novembre Mort de Constance II à Mopsucrenae en Asie Mineure.
► 361 JULIEN l'Apostat (361 à 363) (Flavius Claudius Julianus)
► 361 Julien l'Apostat, Flavius Claudius Julianus (331 - 363), nommé Julien l'Apostat par la tradition chrétienne, fut César en Gaule (355-361), puis empereur romain à part entière (361-363). Il doit son surnom à sa tentative de restaurer la religion païenne dans l'empire romain, alors qu'il avait été élevé dans la religion chrétienne (plus exactement dans l'arianisme, sous la direction des évêques Eusèbe de Nicomédie, puis Georges de Cappadoce). Il a produit des écrits critiques contre le christianisme qui, avec le Discours Vrai de Celse, sont le meilleur témoin de l'opposition païenne au christianisme.
Neveu de Constantin Ier, qui était le demi-frère de son père Jules Constance, et dernier survivant, avec son demi-frère Gallus, de la branche cadette des descendants de l'empereur Constance Chlore, il fut élevé dans le christianisme et à l'écart de la cour. Il se convertit secrètement à l'ancienne religion et fit des études de lettres et de philosophie, pendant que Gallus était promu césar, puis exécuté. Alors qu'il avait commencé à approfondir ses études de philosophie à Athènes, il fut soudain rappelé à la cour.
En 355, après avoir épousé Hélène (dite "la jeune", par opposition à sa grand-mère l'impératrice), soeur de l'empereur Constance II, son cousin, celui-ci l'envoya en Gaule avec le titre de César, c'est-à-dire de vice-empereur. Il voyait cette promotion comme fastidieuse et dangereuse. Il fit de Lutèce (Paris) sa capitale et se révéla bon administrateur et bon soldat, repoussant les invasions des Alamans en 357 et 360 et des Francs en 358. En 360, spontanément ou parce que Julien les y avait poussés, ses soldats le proclamèrent empereur à part entière (Auguste). Constance refusant le fait accompli, Julien marcha contre lui vers l'Orient. Mais il n'y eut pas de bataille, car Constance mourut en 361.
Devenu maître de l'empire tout entier, Julien promulgua un édit de tolérance autorisant toutes les religions et il abrogea les mesures prises non seulement contre le paganisme, mais aussi contre les juifs et contre les chrétiens qui ne suivaient pas le credo d'inspiration arienne qui avait la faveur de Constance. Cependant, il révéla bien vite sa préférence pour le paganisme et son hostilité au christianisme (loi interdisant aux chrétiens d'enseigner la poésie classique, parce qu'elle évoque des dieux qu'ils refusent, faveurs aux cités qui restaurent les temples, indifférence devant les cas de vexations causées à des chrétiens).
Cependant, il ne prit aucune mesure de persécution, déclarant qu'il souhaitait que les chrétiens reconnaissent eux-mêmes leur erreur et qu'il ne voulait pas les y forcer. Parallèlement, il voulut réformer le paganisme (moralité des prêtres, création d'institutions charitables). Il manifesta son intention de revenir à un empire de forme moins autocratique et plus conforme à la tradition républicaine, mais il régna de manière assez autoritaire. Après avoir réorganisé et assaini l'administration, en réduisant en particulier le personnel du palais et celui qui était affecté à la délation et à l'espionnage, il s'installa à Antioche pour préparer une expédition contre la Perse.
Il entra assez vite en conflit avec la population de la ville, d'une part à cause de son paganisme affiché, d'autre part parce que sa rigueur morale s'opposait aux habitudes de vie qui avaient cours dans cette métropole. Au printemps 363, Julien se lança dans une vaste expédition militaire qui le mena victorieusement jusqu'à Ctésiphon, capitale des Perses. Mais il dut entamer une retraite, au cours de laquelle, le 26 juin 363, il fut mortellement blessé au cours d'un combat. L'attention de la tradition historique, chrétienne comme anti-chétienne, a été focalisée sur la politique religieuse de Julien. Mais ce n'était qu'une partie de sa politique et on ne peut dire qu'elle gouvernait tout le reste. Ainsi, en matière administrative, il ne semble pas avoir marqué de préférence religieuse dans le recrutement du personnel.
► 361 Julien est proclamé empereur à Lutèce.
► 361 - 11 décembre entrée de Julien à Constantinople.
► 361 Julien restaure les anciens cultes.
► 362 17 juin loi sur l'enseignement excluant les Chrétiens de l'enseignement.
► 362 Julien s'installe à Antioche.
► 362 - 26 octobre Le temple d'Apollon à Daphné est incendié.
► 363 - 1er janvier Julien refuse de recevoir une ambassade Perse.
► 363 - 5 mars Julien quitte Antioche à la tête d'une armée pour la Perse.
► 363 - 4 avril Julien entre en Perse.
► 363 - 29 mai Victoire de Julien devant Séleucie contre les Perses.
► 363 - 26 juin Blessure au combat de Julien lors d'un accrochage avec les Perses.
► 363 - 27 juin Julien meurt de ses blessures, un de ses officiers, Jovien lui succède.
► 363 JOVIEN (363 à 364) (Flavius Claudius Jovianus)
► 363 Jovien, Flavius Claudius Jovianus, fut empereur romain de 363-364. À la mort de Julien, une grave opposition éclata dans l'armée, entre les officiers des Gaules et les officiers d'Orient. Jovien, officier illyrien, fut choisi par les officiers de l'armée d'Orient. Il conclut avec les Perses de Sapor II une paix "peu honorable", cédant cinq des neuf satrapies, acquises en 297. Il déclara en outre renoncer à ses anciens droits de protectorat sur le royaume d'Arménie. Chrétien, il abrogea les mesures anti-chrétiennes de son prédécesseur, mais sans revenir pour autant aux lois anti-païennes de Constance II. Il mourut brusquement sur la route d'Ancyre à Constantinople, à Drépane, en Bithynie, dans la nuit du 16 au 17 février 364, à 33 ans environ, soit asphyxié par les vapeurs d'un brasero, soit des suites d'un repas trop bien arrosé.
► 363 Traité de paix avec les Perses leur rendant les territoires conquis par Dioclétien.
► 363 octobre Retour de l'armée romaine à Antioche.
► 363 Jovien nomme son fils Varronien consul.
► 364 - 11 janvier Jovien autorise de nouveau l'enseignement au Chrétiens.
► 364 Jovien confie à son frère Valens l'Orient pour mener des campagnes sur le Rhin et le Danube. Valens, Flavius Julius Valens (328-9 août 378), co-empereur romain de 364 à 378, d'abord avec son frère Valentinien Ier (jusqu'au mois de novembre 375), puis avec son neveu Valentinien II. Son frère lui confia le gouvernement de la partie orientale de l'empire, avec Constantinople pour capitale.
► 364 Victoire de Jovien contre les Barbares près de Châlon en Champagne.
► 364 17 février Mort de Jovien entre Nicée et Ancyre, Valentinien est appelé pour lui succéder. Valentinien Ier (Flavius Valentinianus) (321 - 17 novembre 375), co-empereur romain (364-375) avec son frère cadet Valens (364-378).
► 364 VALENTINIEN & VALENS (364 à 375) (Flavius Valentinius & Flavius Valens)
► 364 Valentinien Ier, coempereur romain (364-375) avec son frère cadet Valens (364-378). À la mort de l'empereur Jovien (363-364), il ne fut pas question de lui donner pour successeur son fils Varronien, mais comme à la mort de l'empereur Julien, une assemblée de hauts fonctionnaires et d'officiers, à Nicée, délibéra sur le choix de l'empereur (20 février 364). Elle désigna Valentinien (Flavius Valentinianus), fils d'un officier d'origine pannonienne arrivé jusqu'au rang de gouverneur de province, et lui-même, comme naguère Jovien, officier de la maison de l'empereur.
L'armée lui demandant de s'adjoindre tout de suite un collègue, il désigna, à Nicomédie, (28 mars 364), son frère cadet Valens (Flavius Valens), simple protector, sous Jovien, qui reçut pour sa part l'Orient avec Constantinople pour capitale, tandis que Valentinien prenait l'Occident avec Milan pour résidence. Le 24 août 367, Valentinien, qui venait d'être gravement malade proclama empereur à Amiens son fils Gratien (Flavius Gratianus), qui devint Auguste à 8 ans. Valentinien délivra la Gaule des Alamans, reconstruisit les fortifications du Rhin et renforça l'armée gauloise.
Il prit comme capitale Trèves, en 367. Son grand général Théodose l'Ancien, reprit la province de Bretagne, envahie par les barbares d'Écosse, d'Irlande et germaniques. Il dut faire face à la révolte de Firmus (373-375), qui occupa Césarée et qui fut tué par Théodose l'ancien. On lui doit une loi qui interdit les unions avec les barbares (370), pour la protection de la race. Il ne fut point persécuteur à l'égard des chrétiens. Il entretenait une foi chrétienne sincère, mais avec le souci de maintenir à l'égard du clergé chrétien les droits supérieur de l'État. Il confirma en 373 l'élection d'Ambroise à l'évêché de Milan et intervint dans les troubles qui eurent lieu lors de l'élection du pape Damase Ier (366). Il mourut en Pannonie, où l'avait appelé une guerre contre les Quades et les Sarmates (novembre 375).
► 364 Flavius Valens (328-378), coempereur romain de 364 à 378, d'abord avec son frère Valentinien Ier (jusqu'au mois de novembre 375), puis avec son neveu Valentinien II. Son frère lui confia le gouvernement de la partie orientale de l'empire, avec Constantinople pour capitale. Il dut au début de son règne faire face à la rébellion de Procope, un cousin de Julien l'Apostat. Alors que Valens était éloigné pour repousser les Perses, Procope vint incognito à Constantinople et des vétérans de Julien l'Apostat qui y étaient stationnés le proclamèrent empereur. Il put ainsi s'emparer de la capitale de l'empire d'Orient et rallier à sa cause les troupes des Balkans.
Durant les mois qui suivirent, de nombreuses villes de Thrace et d'Asie Mineure changèrent de camp. Toutefois Valens réussit à battre l'armée de Procope à Nacolea en Phrygie, en 366, après que les généraux de ce dernier eurent fui. Une nouvelle fois trahi, il fut livré à Valens qui le fit décapiter. Il eut à lutter à deux reprises contre les Goths: - contre les Wisigoths d'Athanaric (367-369), qui avaient soutenu la tentative de l'usurpateur Procope; - contre les Ostrogoths (refoulés par les Huns) et les Wisigoths réunis, qui en 375, se présentèrent en masse à la frontière de l'empire. Ne pouvant pas les empêcher d'entrer en Thrace (377), il leur livra, le 9 août 378, la désastreuse bataille d'Andrinople, où il trouva la mort. Valens favorisa les ariens contre les nicéens. Il persécuta aussi les milieux intellectuels païens, auxquels il prêtait des pouvoirs magiques et des intentions hostiles. En revanche, il prit des mesures de protection en faveur des classes inférieures.
► 364 - 26 février Valentinien est proclamé empereur à Nicée.
► 364 - 1er mars Valentinien nomme son frère Valens tribun des écuries.
► 364 - 28 mars Valentinien nomme Auguste son frère Valens.
► 364 - juin Partage de l'empire entre Valentinien (Occident) et Valens (Orient).
► 364 - novembre arrivée de Valentinien à Milan.
► 365 - 28 septembre Procope usurpe le pouvoir impérial à Constantinople. Procope, empereur romain en 365. Procope est un cousin de Julien II qui lui avait promis l'Empire en cas de décès. Après la mort de Julien II et après s'être soumis à l'Empereur Jovien, Procope s'était retiré en Cappadoce. Valens et Valentinien Ier, qui se méfiaient de lui, tentèrent d'éliminer ce prétendant potentiel au trône, mais Procope échappa aux tueurs des deux Empereurs et se cacha quelque temps sur les rives de la Mer Noire. En 365, il revint à Constantinople. Là, des légionnaires gaulois, vétérans de Julien II, embrassèrent sa cause et le proclamèrent Empereur.
A ce moment, Valens que sa cruauté et sa rapacité avaient rendu impopulaire, se trouvait en Mésopotamie, occupé à repousser une incursion Perse. Procope put donc facilement s'emparer de Constantinople et rallier à sa cause les légions stationnées dans les Balkans, ainsi que ses anciens hôtes, les Goths de la Mer Noire. Bien conseillé par ses ministres, Valens commença par faire un geste en faveur des mécontents : il rétablit dans ses fonctions Salluste, un ancien ministre de Julien II, très populaire et très compétent, mais qu'il avait destitué dès son accession au pouvoir.
Le retour aux affaires de cet honnête homme, de ce collaborateur et ami de Julien II, suffit à rallier à la cause de Valens tous les hésitants ainsi que tous ceux qui n'avaient embrassé la cause de Procope que par nostalgie du dernier Empereur. Manquant dorénavant de partisans, Procope fut vaincu dans deux combats, mais il réussit à s'enfuir. Toutefois il fut trahi par ses anciens partisans et livré à Valens qui le fit exécuter le 28 mai 366.
► 365 octobre Début d'une campagne en Gaule contre les Alamans.
► 365 novembre Valens assiège Chalcédoine où s'est réfugié Procope. Chalcédoine est une cité grecque de Bithynie (actuellement en Turquie), située sur l'entrée orientale du Pont-Euxin, face à Byzance et au sud de Chrysopolis (Scutari, actuellement Üsküdar).
► 366 - 26 mai Les troupes de Procope se rallient à Valens lors de la bataille de Thyatire.
► 366 - 27 mai Procope est livré à Valens par deux de ses anciens officiers; tous sont exécutés.
► 366 Marcellus à la tête d'une armée goth se fait proclamer empereur en Chalcédoine.
► 366 août Marcellus est capturé et exécuté par Equitius commandant des légions d'Illyrie.
►367 Les Pictes et les Scotts (peuples de l'écosse ancienne) franchissent le mur Hadrien et entrent en (Grande) Bretagne.
► 367 - 24 août Valentinien fait proclamer son fils Gratien alors âgé de 9 ans Auguste. Gratien - en latin Flavius Gratianus - (Sirmium, 359 - Lyon, 25 août 383) est un empereur romain (367 - 383).
► 367 octobre Valentinien s'installe à Trêves.
► 368 septembre Victoire de Valentinien sur les Saxons et les Francs.
► 368 Raids alamans contre Mayence.
► 369 Victoire de Valens sur les Goths.
► 369 Traité de paix avec Anthanaric, chef des Goths.
► 370 Campagne contre les Perses (jusqu'en 377).
► 371 Saint Martin devient évêque de Tours.
► 372 Firmus, prince maure se fait proclamer empereur en Maurétanie. Firmus, général des Maures en Afrique.
► 373 - 20 février Interdiction de rebaptiser les chrétiens donatistes.
► 373 Violente répression du général Théodose en Maurétanie. Théodose Ier (346-395) fut empereur romain et byzantin de 379 à 395. Il était le fils de Théodose l'Ancien.
► 374 Mariage de Gratien avec Constantia, fille posthume de Constance II.
► 374 Incursions Quades et Sarmates en Pannonie.
► 374 Traité de paix avec Macrien, roi des Alamans.
► 375 Expédition contre les Quades et Sarmates.
► 375 - 17 novembre Mort de Valentinien, son fils Gratien lui succède. l'empereur Valentinien Ier vient de Trèves pour soumettre les Quades rebelles en Slovaquie. Il meurt sur le Danube des suites d'une attaque, provoquée par sa colère devant la suffisance des émissaires quades. Valentinien laisse deux fils, Gratien, associé au pouvoir depuis 367, et Valentinien II, âgé de moins de quatre ans. Les soldats, à l'instigation de l'impératrice Justine, contraignent Gratien à prendre Valentinien comme collègue. Les deux frères se partagent l'occident. Début du règne de Valentinien II, empereur romain associé (Illyrie, Afrique, Italie). Début du règne de Gratien, empereur romain associé (Bretagne, Gaule, Espagne).
► 375 VALENS, GRATIEN & VALENTINIEN II (375 à 379) (Flavius Valens, Flavius Gratianus & Flavius Valentinianus)
► 375 Gratien - en latin Flavius Gratianus - (Sirmium, 359 - Lyon, 383) est un empereur romain (367 - 383). Le 24 août 367 Valentinien Ier, qui venait d'être gravement malade proclama empereur à Amiens son fils Gratien (Flavius Gratianus), qui devint Auguste à huit ans, sans jamais avoir été César. En 375, Gratien étant absent, les soldats de Pannonie proclamèrent Empereur un autre fils de Valentinien, Valentinien II, âgé de quatre ans. Gratien accepta le partage de l'Empire et concéda à Valentinien II, l'Illyrie. En 377, Gratien vainquit les Alamans.
En 378, il amenait des renforts d'Occident à Valens lorsque celui-ci périt au cours de la bataille d'Andrinople. Le 19 janvier 379, Gratien proclama Auguste l'Espagnol Théodose Ier, fils du général Théodose l'Ancien, qui réprima le soulèvement de Firmus, en 375 et qui fut exécuté à Carthage, en 376, probablement sur l'ordre de Gratien. Théodose reçut l'Orient. En 380, Gratien et Théodose arrêtent les Goths en Épire et Dalmatie. En 383, Gratien dut faire face à l'insurrection d'un général espagnol de l'armée de Bretagne, Magnus Clemens Maximus ou Maxime, et fut vaincu et tué en Gaule, à Lyon. Maxime s'étant rendu maître de toute la préfecture des Gaules, Théodose le reconnut empereur en 384. Gratien se montra très bienveillant envers le pape Damase Ier et à partir de 382 combattit le paganisme. Il supprima notamment les immunités dont jouissaient les prêtres et les Vestales. En 381, il avait transporté sa capitale de Trèves à Milan, auprès de l'évêque Ambroise.
► 375 Valentinien II (371 à Vienne, 392), fils de Valentinien Ier, empereur romain de 375 à 392. En 375, son frère, l'empereur Gratien étant absent, les soldats de Pannonie le proclamèrent empereur alors qu'il n'avait que quatre ans. Gratien accepta le partage de l'empire et concéda à Valentinien II l'Illyrie. En 384, à la mort de son frère Gratien, l'empire comptait trois empereurs : Maxime à Trèves, Valentinien II, sous la tutelle de sa mère Justine, à Milan, Théodose Ier à Constantinople.
Justine encouragea l'arianisme et favorisa les païens comme Symmaque ou Prétextat. En 387, Valentinien II fut chassé par Maxime, qui s'empara de Rome et occupa l'Italie. Théodose Ier hésita à s'interposer. Cependant épris de la soeur de Valentinien II, Galla, qu'il épousa, Théodose Ier intervint contre Maxime. Tandis que Valentinien II débarquait à l'embouchure du Tibre, Théodose Ier défaisait Maxime et le prenait dans Aquilée. Valentinien II regagna sa capitale Vienne où en 392, il fut assassiné par un général franc, Arbogast, que Théodose Ier avait chargé de le protéger. Arbogast proclama empereur Eugène.
► 375 - 22 novembre Les Armées du Danube proclament Valentinien II Auguste.
► 375 Justine, mère de Valentinien II et le Général Mérobaud assurent la régence pour Valentinien II. Justine (Flavia Justina Augusta), impératrice romaine, fille de Justus, gouverneur de Picénum. Elle épousa successivement l'usurpateur Magnence, l'empereur Valentinien Ier en 368 et après la mort de ce dernier, elle fit proclamer empereur Valentinien II, avec qui Gratien consentait à partager l'empire. Mérobaud, Flavius Merobaudes, dit Mérobaud fut un officier franc, naturalisé romain, magister equitum (maître de la cavalerie) de Valentinien Ier. A la mort de ce dernier en 375, il s'entend avec l'impératrice Justine pour faire acclamer son fils Valentinien II, âgé de quelques années seulement, mettant ainsi Gratien, frère aîné de Valentinien II, et son entourage, devant le fait accompli. Il est consul ordinaire en 377 et 383.
► 375 Procope est proclamé empereur par ses troupes à Constantinople.
► 375 Capture et exécution de Procope.
► 376 Valens autorise des Wisigoths à s'établir en Thrace. Les Wisigoths, ou Tervinges, étaient un peuple germanique d'origine scandinave, issu de la Suède méridionale et incorporé tardivement dans l'Occident romain. Après la chute officielle de l'Empire romain occidental (476), les Wisigoths ont continué pendant près de 250 ans à jouer un rôle important en Europe occidentale. C'est à coup sûr le peuple barbare le plus prestigieux d'Europe, tant par sa longue histoire et ses origines mythiques, que par ses traces qu'il laissa longtemps dans les esprits.
Alors qu'ils occupaient l'ancienne province romaine de Dacie depuis la fin du IIIe siècle, les Wisigoths ont adopté peu à peu l'arianisme, à partir de l'année 341, c'est-à-dire une branche du christianisme qui affirme que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais un être distinct créé directement par ce dernier. Cette croyance était en opposition totale avec la croyance chrétienne qui était majoritaire dans l'empire romain et qui plus tard s'est scindée en catholicisme et orthodoxie.
Les Wisigoths sont restés fidèles à l'hérésie arienne officiellement jusqu'en 589, lorsque le roi Récarède Ier (en espagnol : Recaredo) choisit de se convertir publiquement, faisant ainsi joindre officiellement l'Église catholique au royaume wisigothique d'Espagne. Toutefois, après cette date, un fort parti arien demeura fort actif et influent, notamment dans la noblesse. Il en sera encore question au début du VIIIe siècle dans les derniers jours du royaume. Les Wisigoths sont apparus pour la première fois dans l'Histoire en tant que peuple distinct en l'an 235, quand ils envahirent et dévastèrent la Dacie.
A partir de 268, ils s'attaquent à l'Empire romain et tentent de s'installer dans la péninsule des Balkans. Cette invasion concerna aussi les provinces romaines de Pannonie et d'Illyrie et menaça même l'Italie. Cependant, les Wisigoths furent battus près des frontières modernes d'Italie et de Slovénie et à la Bataille de Naissus, en septembre 269. Au cours des trois années suivantes, ils furent repoussés au-delà du Danube par une série de campagnes militaires menées par l'empereur Claude II le Gothique, le futur empereur Aurélien étant le commandant de la cavalerie.
Cependant, ils purent se maintenir en Dacie, qu'Aurélien fit évacuer en 271, transférant la population vers une nouvelle province créée au sud du Danube sous le nom de Dacia Ripensis. Ils y restèrent établis jusqu'en 376, lorsqu'un de leurs deux chefs, l'arien Fritigern, fit appel à l'empereur romain Valens et lui demanda l'autorisation de pouvoir s'installer sur les berges Sud du Danube, afin de se protéger des Huns, incapables de traverser en force ce large fleuve. Valens accorda sa permission et aida même les Wisigoths à traverser le Danube.
En retour, Fritigern dut fournir des mercenaires pour l'armée romaine. Mais, l'année suivante, une famine éclata sur les terres occupées par les Wisigoths et les gouverneurs romains de leurs territoires les traitèrent cruellement. Comme Valens ne répondait pas aux appels à l'aide de Fritigern, celui-ci prit les armes. La guerre qui s'ensuivit se termina le 9 août 378 lors de la bataille d'Andrinople où Valens mourut. Fritigern, victorieux, fut reconnu comme roi par son peuple et les Wisigoths devinrent la principale puissance des Balkans. Le successeur de l'empereur Valens, Théodose Ier, conclut la paix avec Fritigern en 379.
Le traité fut respecté jusqu'à la mort de Théodose en 395. Cette même année, Alaric Ier, le plus célèbre des rois Wisigoths, monta sur le trône, alors qu'à l'empereur Théodose succédaient ses deux fils incapables : Arcadius en Orient et Honorius en Occident. Au cours des quinze années suivantes les conflits furent entrecoupés par des années d'une paix vacillante entre Alaric et les puissants généraux germaniques qui commandaient les armées romaines. Mais, après l'assassinat du général d'origine vandale Stilicon (Stillicho) par Honorius en 408 et après le massacre des familles de 30 000 soldats wisigoths servant dans l'armée romaine, Alaric déclara la guerre.
Il fut bientôt aux portes de Rome, et devant le refus d'Honorius de négocier, les Wisigoths pillèrent la ville le 24 août 410. Cet événement frappa considérablement les esprits des contemporains, et sert parfois comme événement final de l'Antiquité. Lorsque la paix fut conclue, quelques années plus tard, Honorius accorda aux Wisigoths des terres dans la région de l'actuelle Aquitaine, suivies d'autres en Espagne. L'Espagne, outre les Wisigoths était également aux mains des Vandales et des Alains mais les Wisigoths écrasèrent ces derniers et harcelèrent les Vandales qui finirent par partir vers l'Afrique. Euric, le second grand roi des Wisigoths, unifia les diverses factions et, en 475, força les Romains à leur accorder l'indépendance complète.
À sa mort, les Wisigoths formaient le plus puissant des états succédant à l'Empire romain d'Occident. Lors de sa plus grande extension, avant l'année 507, le royaume wisigoth comprenait l'Aquitaine ainsi que toute la péninsule ibérique, mis à part une partie du nord de la péninsule, appartenant aux Basques, les Vascons, les Astures et les Cantabres (populations montagnardes d'origines celtibériques) et le royaume des Suèves dans le nord-ouest. En 507, après la bataille de Vouillé, les Francs prirent le contrôle de l'Aquitaine et, en 554, Grenade et l'Andalousie devinrent des possessions byzantines lors de la "reconquête de l'Ouest" par l'empereur byzantin Justinien Ier.
Le Wisigoths annexèrent le royaume des Suèves en 585 et chassèrent en 624 les Byzantins des régions méridionales. Mais le royaume wisigoth disparut en 711, lors du décès du roi Rodéric (Rodrigue/Rodrigo), tué lors de l'invasion du Sud de la péninsule par les Musulmans Omeyyades et leurs troupes de cavaliers berbères islamisés. La majeure partie de l'Espagne actuelle se trouva rapidement sous domination musulmane.
► 378 - 30 mai Retour de Valens à Constantinople.
► 378 juin Valens doit fuir Constantinople menacée par les Goths.
► 378 Gratien part avec son armée au secours de son oncle Valens menacé par les Wisigoths.
► 378 Les incursions des Alamans en Alsace provoque le retour de Gratien. Gratien tenta de porter secours à son oncle Valens, l'empereur d'Orient, qui était menacé par la rébellion des Goths, mais il fut retardé. Informés des projets militaires de l'empereur romain, les Alamans avaient en effet franchi le Rhin, histoire de profiter de l'absence de Gratien pour ravager les provinces gauloises. Très mauvais calcul : l'empereur romain était encore dans les parages ! Gratien écrasa les envahisseurs germaniques aux environs de Colmar, mais cette campagne militaire lui fit perdre un temps précieux. Quand il put enfin se diriger vers l'Orient pour aider Valens, il était trop tard : l'armée romaine d'Orient avait déjà été anéantie à Andrinople et Valens avait trouvé la mort dans la bataille.
► 378 Victoire de Gratien contre les Alamans à la bataille d'Argentia (Horbourg). Horbourg-Wihr est une commune française, située dans le département du Haut-Rhin et la région Alsace.
► 378 - 9 août Défaite et mort de Valens face aux Wisigoths à Andrinople (Thrace). Bataille d'Andrinople, au cours de laquelle l'empereur Valens est défait par les Wisigoths de Fritigern et tué. La Thrace est pillée, sauf les villes fortifiées, que les barbares ne peuvent prendre. Andrinople et Constantinople résistent. Théodose, un Espagnol envoyé par Gratien, a le temps d'intervenir pour reprendre la situation en main.
La bataille d'Andrinople ou d'Adrianople (aujourd'hui Edirne en Turquie européenne) a eu lieu le 9 août 378. Elle désigne l'affrontement entre l'armée romaine, commandée par l'empereur romain Valens et certaines tribus germaniques, principalement des Wisigoths (Goths Thervingues), et des Ostrogoths (Goths Greuthungues), commandées par Fritigern. Il s'agit d'un des plus grands désastres militaires romains du IVe siècle, comparable à la défaite de Cannes. Cette bataille ne résulte pas d'une invasion, mais d'une mutinerie des fédérés Goths établis dans l'empire romain.
► 378 Édit de tolérance envers les païens de Gratien.
► 378 Gratien nomme Théodose maître de la cavalerie.
► 378 Victoire de Gratien sur les Wisigoths en Pannonie.
►379 - 19 janvier Théodose est élevé au rang d'Auguste en Orient par Gratien.
► 379 GRATIEN, VALENTINIEN II & THÉODOSE (379 à 383) (Flavius Gratianus, Flavius Valentinianus & Flavius Theodosius)
► 379 Théodose Ier (Flavius Theodosius), 346-395, empereur romain et byzantin de 379 à 395, fils de Théodose l'Ancien. D'origine espagnole, d'une famille chrétienne, il fut proclamé empereur en 379 par Gratien et reçut l'Orient, la Macédoine et la Dacie. En 380, avec Gratien, ils arrêtèrent les Goths en Épire et en Dalmatie. Théodose installa une partie des Ostrogoths en Pannonie, et lui-même s'installa à Constantinople. La même année, il adhéra au symbole de Nicée, devint l'ardent défenseur des chrétiens et à Thessalonique, il publia l'édit suivant : "Tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, celle que reconnaissent Damase et Pierre d'Alexandrie, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit".
Le catholicisme devenait religion d'État. Il condamna l'arianisme lors du second concile oecuménique de Constantinople en 381. En 382, il installa les Wisigoths en Mésie. Entre 383 et 388, il dut faire face à l'usurpation de Maxime (Magnus Clemens Maximus), qui après avoir défait Gratien s'était emparé de toute la préfecture des Gaules et occupait Rome toute l'Italie au détriment de Valentinien II. Théodose vainquit Maxime qui fut tué à Aquilée, en 388. De 388 à 391, Théodose demeura en Occident, presque toujours à Milan. En 390, il réprima une émeute à Thessalonique. En 391, probablement sous l'influence de saint Ambroise, il supprima les dernières manifestations du paganisme "officiel" dans l'Empire (cependant, le culte survécut en clandestinité), fondant ainsi le premier État chrétien orthodoxe.
C'est ce qui lui valut le titre de Grand. Entre 392 et 394, il réprima l'usurpation d'Eugène, proclamé empereur, après l'assassinat de Valentinien II. En 393, il fut l'auteur du décret interdisant les Jeux Olympiques accusés de diffuser le paganisme. Il mourut peu après, le 17 janvier 395. À cette date l'Empire est réunifié pour la première fois depuis trente ans. De son premier mariage avec Aelia Flacilla, Théodose avait eu deux fils. Il avait fait Auguste Arcadius dès 383, et Honorius en 393. Il partagea entre eux l'Empire : Honorius (10 ans) reçut l'Occident et Arcadius (18 ans) l'Orient, et il chargea le Vandale Stilicon de veiller sur eux deux. Théodose commit l'erreur d'enrôler dans l'armée romaine des contingents de barbares en leur laissant une organisation autonome; ces fédérés préparèrent l'occupation de l'Empire par les barbares.
► 379 juin Théodose s'installe à Thessalonique.
► 379 - 3 août Abrogation de l'édit de tolérance envers les païens de 378.
► 380 - 28 février Édit de Thessalonique faisant du christianisme la religion officielle. Publication de l'Édit de Thessalonique. Théodose Ier convoque le Ier concile oecuménique de Constantinople (deuxième concile oecuménique) (fin en 381). Thessalonique ou Salonique est une ville de Grèce. Édit de Thessalonique le christianisme est déclaré comme religion de l'Empire Romain par l'empereur Théodose. Baptême de Théodose Ier, qui bannit par un édit tous les cultes païens et la doctrine d'Arius. L'empereur opte définitivement pour le dogme de la Trinité.
Premier concile de Constantinople, en 380 l'empereur Théodose Ier convoqua un concile à Constantinople qui dura jusqu'en juillet 381. Il s'agit du deuxième concile oecuménique de l'histoire du christianisme. Cent cinquante évêques, tous orientaux, y prirent part. Il fut présidé successivement par Mélèce, patriarche d'Antioche et, à sa mort, par Grégoire de Nazianze, qui donna sa démission de président et d'évêque de Constantinople tant l'assemblée se montra indisciplinée. Le concile de Constantinople compléta celui de Nicée : il affirmait la divinité du Saint-Esprit. Son credo est désigné sous le nom de symbole de Nicée-Constantinople.
► 380 Rencontre entre Gratien et Théodose à Sirmium, abandon de la Dacie et de la Macédoine.
► 380 - 24 novembre Théodose s'installe à Constantinople.
► 381 - 20 décembre Édit de Théodose interdisant les cultes païens.
► 382 Gratien s'installe à Milan.
► 382 Théodose accorde une parcelle de territoire en Mésie aux Goths.
► 382 Deuxième concile de Rome qui, sous l'impulsion de saint Jérôme, condamne les apollinaristes. Le concile de Rome fut convoqué dans la ville éponyme par le pape Damase en 382. Trois évêques orientaux seulement y assistèrent. Les autres prenaient part à celui que l'empereur byzantin avait réuni à Constantinople, la même année, pour confirmer les actes du deuxième concile oecuménique.
► 382 Le Sénat met hors la loi la religion romaine. Les chrétiens qui ne reconnaissent pas le dogme de la Trinité sont persécutés. Trinité chrétienne, dans le christianisme, le mot Trinité désigne Dieu, unique en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint, égales et participant à une même nature. L'énoncé du dogme de la Trinité se présente comme la conséquence de ce qui est dit du mystère de Dieu dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son existence et son unicité ; dans le Nouveau Testament ont été affirmés la divinité de Jésus-Christ et le caractère personnel de l'Esprit-Saint.
► 382 - 3 octobre Théodose autorise les Goths à s'installer entre le Danube et les Balkans.
► 383 - 19 janvier Théodose élève Arcadius, son fils aîné au rang d'Auguste. Flavius Arcadius (377-408) fut le premier empereur d'Orient (395-408).
► 383 juin Maxime est proclamé empereur par ses troupes en (Grande) Bretagne. Maxime (335 – 28 août 388) fut un usurpateur du trône de l'empire romain d'Occident de 383 à sa mort en 388, sur l'ordre de l'empereur Théodose Ier.
► 383 Maxime entre en Gaule à la tête des légions de (Grande) Bretagne.
► 383 Les armées de Germanie reconnaissent Maxime comme empereur.
► 383 Les armées de Gratien près de Paris se rallient à Maxime; Gratien s'enfuit.
► 383 - 15 août Gratien est capturé par Andragathe, Général de la cavalerie de Maxime près de Lyon.
► 383 - 25 août Exécution de Gratien par Maxime près de Lyon.
► 383 MAXIME, VALENTINIEN II & THÉODOSE (383 à 388) (Magnus Clemens Maximus, Flavius Valentinianus & Flavius Theodosius)
► 383 Valentininen II et Théodose reconnaissent le titre d'Auguste de Maxime.
► 383 Justine et Valentinien II arrivent à Milan.
► 384 Cynégius gouverneur d'Égypte ordonne la fermeture des temples. Cynegius Maternus (mort en 388) est un haut fonctionnaire romain d'origine espagnole faisant partie du cercle des partisans de l'empereur Théodose Ier, auquel il doit sa carrière : il est notamment préfet du prétoire d'Orient de 384 à sa mort le 14 mars 388, année où il fut également consul avec pour collègue l'empereur lui-même. Il est surtout connu pour son christianisme fanatique, son antisémitisme, et son zèle à combattre le paganisme : il fait notamment détruire des temples païens en Syrie et en Égypte en 386.
► 387 - 26 février Violentes émeutes à Antioche.
► 387 Justine et Valentinien font appel à Maxime face aux menaces des Sarmates. Les Sarmates sont un ancien peuple scythique de nomades des steppes, appartenant sur le plan ethno-linguistique au rameau iranien septentrional du grand ensemble indo-européen. Ils étaient établis à l'origine entre le Don et l'Oural.
► 387 septembre Maxime s'empare de Milan.
► 387 Maxime se fait reconnaître empereur par le Sénat.
► 387 Justine et Valentinien II quittent l'Italie et trouvent refuge à Thesalonique.
► 387 Mariage de Galla, soeur de Valentinien II avec Théodose.
► 387 Maxime nomme son fils Victor, Auguste et lui confie le commandement de la Gaule.
► 388 Valentinien II, est nommé Auguste en Illyrie.
► 388 Théodose marche contre Maxime.
► 388 - 28 août Maxime se rend à Théodose et meurt assassiné par un des soldats de Théodose.
► 388 THÉODOSE & VALENTINIEN II (388 à 392) (Flavius Valentinianus & Flavius Theodosius)
► 388 Victor, fils de Maxime, est capturé et exécuté par Argobast. Argobast devient par sa valeur et son expérience fort populaire dans l'armée. Valentinien qui supporte mal sa tutelle, le fait révoquer. Argobast refuse d'obéir et fait assassiner Valentinien, puis donne l'empire à l'un de ses amis, Eugène, haut fonctionnaire de la chancellerie impériale. Arbogast (? – 394) fut un officier des armées romaines sous Théodose Ier et Valentinien II. Il est d'origine franque, neveu de Richomer, consul en 384, également franc et tous deux intégrés dans l'empire romain.
► 388 Incursions des Francs près de Cologne.
► 388 Valentinien II s'installe à Vienne, préfecture des Gaules, sous la tutelle d'Argobast.
► 389 Le Général franc Argobast est nommé gouverneur de Gaule.
► 390 Traité de Constantinople entre Théodose et la Perse sur le partage de l'Arménie.
► 390 Massacre de Thessalonique suite au Lynchage du Général Botheric par la foule. Les marchands et artisans de Thessalonique, ruinés, se soulèvent. Le commandant de la garnison et des officiers impériaux sont tués. Ayant ordonné le massacre de 7000 insurgés, l'empereur Théodose Ier se fait excommunier par saint Ambroise à Milan. Il est contraint à une expiation publique. Thessalonique ou Salonique est une ville de Grèce, chef-lieu du nome du même nom, située au fond du golfe Thermaïque.
► 390 Le 25 décembre, l'évêque Ambroise de Milan force Théodose Ier à faire pénitence publiquement pour le massacre de milliers de civils rebelles en Thessalonique.
► 391 - 24 février Loi de Théodose interdisant toute cérémonie païenne à Rome.
► 392 Intervention d'Argobast et Valentinien contre les Francs. Valentinien II confie la défense de la Gaule au général franc et païen Argobast.
► 392 L'Italie sous la menace de Barbares fait appel à Valentinien II alors à Vienne.
► 392 Début de la querelle entre Valentinien II et Argobast.
► 392 - 15 mai Valentinien II est retrouvé mort pendu, Argobast fait nommer Eugène empereur. Eugène, Flavius Eugenius (mort le 6 septembre 394), rhéteur et grammairien, proclamé empereur en 392 contre Théodose Ier.
► 392 THÉODOSE (392 à 395) (Flavius Theodosius)
► 392 - 22 août Eugène soutenu par Argobast se proclame Auguste d'Occident.
► 392 - 8 novembre Édit de Constantinople interdisant le culte païen.
► 393 janvier Théodose nomme son second fils Honorius, Auguste pour l'Occident.
► 393 Eugène marche avec ses armées sur l'Italie.
► 393 Derniers Jeux olympiques. Théodose Ier supprime les Jeux olympiques et ferme ou détruit les temples de dieux païens.
► 394 mai Théodose quitte Constantinople avec ses armées à la rencontre d'Eugène.
► 394 - 5 septembre Les armées de Théodose se replie lors de la bataille de la rivière froide.
► 394 - 6 septembre Défaite d'Eugène et Arbogast lors de la bataille de la rivière froide.
► 394 - 8 septembre suicide d'Argobast.
► 394 Dernier texte hiéroglyphique connu. L'écriture hiéroglyphique est attestée dès la fin du IVe millénaire av. J.-C., à peu près à l'époque où les caractères cunéiformes apparurent en Mésopotamie. Elle fut employée pendant plus de 3 000 ans : la dernière inscription connue à ce jour est datée du 24 août 394, et se trouve dans le temple de Philae.
► 395 - 17 janvier Mort de Théodose après avoir placé son fils Honorius à la tête du gouvernement d'Occident, et Arcadius à celui d'Orient. L'empereur romain Théodose Ier s'éteint à Milan, laissant la place à ses deux fils, Arcadius et Honorius. Quelques mois plus tôt, après l'assassinat de Valentinien, il était parvenu à réunifier l'Empire. Il ne régnait auparavant que sur l'Orient. Au lendemain de sa mort, Arcadius prendra les rênes de l'Empire romain d'Orient, ou Empire byzantin, avec pour capitale Constantinople. Son frère, quant à lui, héritera de l'Occident. L'Empire romain ne sera plus jamais unifié.
► 395 L'Empire romain se divise en deux. Début du règne d'Arcadius, qui devient le premier empereur romain d'Orient (Empire byzantin). (fin en 408). Début du règne d'Honorius, premier empereur romain d'Occident. (fin en 423). Honorius, fils de Théodose Ier, a onze ans. Le vandale Stilicon, maître de la milice et époux de la nièce et la fille adoptive de Théodose Ier, Serena, devient régent de l'empire d'occident pendant treize ans.
Empire byzantin, en 395, à la mort de Théodose Ier, l'Empire romain est partagé en deux parties : l'Empire romain d'Occident qui disparaît en 476, et l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin qui durera jusqu'en 1453. Au cours de ces mille ans, les Byzantins se considérèrent "Romains", et ils appelèrent leur empire "l'Empire romain". Un certain nombre de lois et coutumes fut conservé des Romains ainsi que certains aspects culturels comme l'architecture. Ce fut aussi un empire chrétien qui, entre autres, aura défini certains dogmes du christianisme. L'Église officielle fut l'Église chrétienne universelle jusqu'au Grand Schisme d'Orient de 1054, ensuite cette partie de l'Église prit le nom d'Église orthodoxe. Leur religion, leur langue, et leur culture étaient essentiellement grecques plutôt que romaines.
► 395 Suite à la division de l'Empire romain, l'Égypte tombe sous la domination byzantine. Les croyances coptes s'intensifieront jusqu'à la conversion de tous les Chrétiens égyptiens. Deux siècles plus tard, le temple d'Isis sur l'île de Philae, dernier à vénérer la déesse, sera pris d'assaut. Avec lui s'éteindront définitivement les anciennes croyances égyptiennes.
► 395 L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT (395 à 476)
► 395 À l'origine l'Empire romain d'Occident couvre l'Afrique du Nord, l'Île de Bretagne, la Gaule, les péninsules ibérique et italienne et la Dalmatie jusqu'au Danube.
► 395 HONORIUS (395 à 423) (Flavius Honorius)
► 395 Flavius Honorius (384-423), empereur romain d'Occident. Né à Constantinople en 384, il est le fils de Théodose Ier et d'Aelia Flacilla et le frère cadet d'Arcadius. Il devint le premier monarque de l'Empire d'Occident en 395 à la mort de son père après que celui-ci eut partagé l'empire entre ses deux fils, partage qui sera, pour l'empire romain, définitif. Honorius n'a que 11 ans à la mort de son père. Celui-ci charge Stilicon, général d'origine vandale, époux d'une de ses cousines, Serena, nièce de Théodose Ier, de veiller sur les deux frères.
Stilicon est le véritable maître de l'Empire d'Occident jusqu'en 408 et sauve le trône d'Honorius des invasions germaniques à deux reprises par ses victoires militaires de Pollenza en 402 sur Alaric Ier et de Fiesole en 406 sur les Ostrogoths de Radagaise. C'est lui qui décide de transférer la capitale à Ravenne, protégée par une ceinture de marécages, où Honorius installe son palais, sa cour et son administration. De plus il fait épouser à Honorius sa fille Maria puis à la mort de cette dernière une autre de ses filles, Thermantia. Mais Stilicon souhaite intervenir aussi dans les affaires de l'Empire d'Orient.
Il élimine le puissant ministre d'Arcadius, Rufin le remplacant par Eutrope (395) mais entre ensuite en conflit avec celui-ci (vers 399) et finit par obtenir son renvoi et son exécution. Des contingents Goths provisoirement alliés à Stilicon pénétrent même dans Constantinople avant d'y être massacrés en 400. En 408 une coalition se forme contre Stilicon au sein de l'armée romaine inquiète des recrutements massifs de mercenaires barbares et reprochant à ce dernier de n'avoir pas réussi à protéger la Gaule de l'invasion des Vandales et des Suèves (406/408). Stilicon est assassiné avec sa famille sur ordre d'Honorius le 23 août 408 et remplacé comme préfet du prétoire par Olympius.
L'empire va rapidement succomber sous les coups des différents peuples germaniques. Les Vandales et les Suèves s'installent en Espagne en 409 et Honorius leur donne le statut de fédérés en 412. Surtout les Wisigoths d'Alaric Ier assiègent Rome en 408, 409 et finissent par s'en emparer le 24 août 410. Le sac de la ville symbole de l'empire, bien qu'elle ne soit plus la capitale, accentue la déchéance d'un empire qui ne se réduit qu'à l'Italie et l'Afrique du nord. Honorius ne défend pas Rome et semble dépassé par les évènements. Il réside surtout à Milan ou Ravenne et organise fêtes et plaisirs.
Il réussit à se débarasser des Wisigoths, après la mort d'Alaric Ier, en leur donnant l'Aquitaine où ils s'installent en 416 avec le statut de fédérés. Honorius est confronté à un grand nombre d'usurpations comme celles de Jovin, Priscus Attale, en 409/410, Maxime, en 409/411 et surtout celle de Constantin III en 407/411. Le général Flavius Constantius tente un ultime sursaut et réduit Constantin III puis l'autre usurpateur Maxime en 411. Il chasse de Gaule vers 414/415 Athaulf, le successeur d'Alaric Ier à la tête des Wisigoths, et épouse vers 415 Galla Placidia, veuve d'Athaulf et soeur d'Honorius. Il se fait proclamer Auguste en février 421, sous le nom de Constance III, mais Théodose II ne le reconnaît pas, et un conflit va s'ouvrir entre les deux empires, lorsque Constance III meurt en septembre 421.
Honorius meurt le 15 août 423. Théodose II aurait voulu rétablir l'unité impérale, mais face à l'usurpation de Jean 423/425, il se résigne à couronner comme César en 424, puis comme Auguste en 425 le neveu d'Honorius, Valentinien III. Le Vandale Stilicon, maître de la Milice assure la régence. Stilichon ou Stilicon (Flavius Stiliccho en latin), né avant 360, est un général et politicien romain d'origine barbare. De naissance vandale, il sert d'abord dans l'armée romaine comme simple auxilliaire mais gravit rapidement les échelons pour devenir chef de la Milice romaine dès 385 et épousera une romaine de haute naissance, la noble Serena tout en devenant citoyen romain.
Devenu plus tard le beau-père de Honorius, il en assure la régence. Général énergique, il protége éfficacement l'Italie contre les Invasions barbares et devient vite le véritable homme fort de l'Empire romain d'Occident à partir de 395. Il combat activement les Wisigoths du roi Alaric, menaçant l'Italie, extermine l'invasion de Radagaise près de Florence (406), mais ne peut empêcher la grande invasion de l'hiver 406/407 qui dévaste la Gaule et commençe à s'attirer l'animosité des troupes auxilliaires barbares mais aussi les jalousies des favoris de l'empereur qui persuade ce dernier que l'ambitieux Stilicon complote contre lui pour prendre le pouvoir. En 408, Honorius commandite son assassinat.
► 395 Les Goths sous la conduite d'Alaric pillent de nombreuses villes romaines. Alaric Ier, roi des Wisigoths (395–390). Il commanda les mercenaires de l'Empereur Théodose, puis ravagea et pilla la Grèce avant d'envahir l'Italie. Il prit Rome en 410 et mourut en tentant de s'emparer de la Sicile.
► 395 Stilicon revendique la possession du diocèse de Mésie alors rattaché à l'Orient.
► 395 - 27 novembre Rufin, préfet du Prétoire d'Orient est assassiné sur les ordres de Stilicon, Eutrope le remplace. Eutrope (?) - (399), eunuque, homme de la plus basse extraction et sans aucun mérite réel qui, à force d'intrigues et de souplesse, était devenu tout-puissant auprès de l'empereur Arcadius. Né en Arménie, cent fois vendu et revendu comme esclave, était parvenu par la protection du général Abundantius à obtenir une place chez les eunuques du palais. Par sa souplesse il avait attiré l'attention de Théodose qui l'honora de quelque confiance. Il fut ensuite au service d'Arcadiu.
► 397 - 11 novembre Mort de Saint Martin à Candes.
► 398 Arcadius, empereur d'Orient prend Alaric à son service et le nomme général en chef d'Illyrie. Flavius Arcadius (377-408) fut le premier empereur d'Orient (395-408). Fils aîné de Théodose Ier et de Aelia Flacilla, de petite taille et d'aspect chétif, il est associé vers 383 à l'empire, à l'âge de 6 ans, et reçoit le titre d'Auguste. Il est nommé consul à trois reprise en 385, 392 et 394. Instruit dans la religion chrétienne par divers précepteurs de grande renommée comme le rhéteur Thesmistius ou le diacre Arsénius, Arcadius va se révéler un prince faible subissant l'influence des divers membres de son entourage.
En 395 son père l'empereur Théodose Ier partage l'empire romain entre ses deux fils. Arcadius reçoit l'Orient avec sa capitale Constantinople et à Honorius revient l'Occident. C'est un partage de plus pour l'empire mais celui-ci est définitif. En fait ces deux souverain inexpérimentés ne sont que des paravents derrières lesquels se cachent les deux véritables maîtres de l'empire, Stilicon à l'ouest et Flavius Rufinus (Rufin) à l'Est en compétition avec le chambellan Eutrope. Ce dernier va marier Arcadius à Eudoxie, la fille du général franc de Théodose Ier Baute (Bauto).
Mais la fin de l'année 395 voit la catastrophique invasion des Wisigoths d'Alaric Ier, sans doute appelés par Flavius Rufinus qui souhaitait se protéger de Stilicon, qui pillent la Thessalie et prennent Athènes tandis que les Huns s'emparent de la Syrie et pillent Antioche. Arcadius envisage d'associer Flavius Rufinus à l'empire (sans doute contraint et forcé) quand ce dernier est assassiné, en novembre 395 par un chef Goth nommé Gaïnas probablement à l'instigation de Stilicon.
Eutrope devient alors le véritable maître de l'empire d'Orient et se comporte en tyran débauché. Accusé par Stilicon de complot et suscitant la colère populaire, il est exilé par Arcadius à Chypre en 399. Il est exécuté un peu plus tard car Stilicon fait pression sur Arcadius et, s'alliant momentanément avec les Goths qui pénètrent à Constantinople, obtient, outre l'exécution d'Eutrope, le renvoi d'Aurélien le nouveau préfet du prétoire.
Mais en 400 les Goths installés à Constantinople sont massacrés et Stilicon ne possède plus de moyen de pression sur Arcadius. Celui-ci règne alors seul et avec l'aide du patriarche de Constantinople Jean-Chrysostome entreprend une politique religieuse virulente contre le paganisme dont il fait détruire de nombreux temples. Hostile à l'arianisme, il doit compter avec son épouse qui, favorable à cette hérésie, réussira à deux reprise à faire exiler le patriarche. Arcadius meurt en 408 à 41 ans, 4 ans après Eudoxie, et laisse un fils, le futur Théodose II, et trois filles dont la fameuse Pulchérie.
30 - De 401 à 476 (fin de l'Antiquité)
► 401 novembre Alaric venant de l'orient entre en Italie.
► 401 Stilicon retire des troupes de (Grande) Bretagne pour renforcer la défense de l'Italie.
► 402 Honorius s'installe avec sa cour à Ravene.
► 402 février-mars Stilicon force les Goths à lever le siège de Milan.
► 402 - 6 avril Victoire de Stilicon contre Alaric.
► 402 à 403 - Alaric s'empare de Vérone ou Stilicon vient l'assiéger.
► 403 - Alaric s'enfuit en Illyrie (correspond à peu près à ce qui est actuellement la Slovénie)

► 404 - 1er janvier Triomphe d'Honorius à Rome.
► 405 Incursion d'Ostrogoth de Radagaise en Italie. Radagaise est un chef barbare païen d'origine gothique. À la tête d'une nombreuse armée hétéroclite composée entre-autres de Goths, de Vandales, d'Alamans et d'Alains, il entre en force en Italie au début de l'année 406, balayant les défenses frontalières, et commet de nombreux pillages et massacres dans la plaine du Pô.
Se dirigeant vers le sud, il est arrêté près de Florence par le général romain Stilicon et est sévèrement battu à Fièsole. Son armée, affaiblie par la famine et manquant d'espace pour combattre et/ou battre en retraite, est exterminée en grande partie, le reste enrôlé de force dans l'armée romaine; Radagaise est capturé et éxécuté avec les principaux chefs (août 408). Alains, peuple scythique, probablement originaire d'Ossétie, les Alains sont des cavaliers nomades apparentés aux Sarmates.
Principales migrations des Alains dans l'Antiquité tardive (jaune) et le Haut Moyen Âge (rose)
► 405 Victoire de Stilicon contre les Goths à Fiesole.
► 405 Jérôme de Stridon traduit la Bible en latin: la Vulgate. Saint Jérôme de Stridon, est surtout connu pour sa traduction de la Bible en latin, la Vulgate. Les chrétiens le considèrent comme un Père de l'Église, et l'Église catholique romaine l'a nommé docteur de l'Église. Né vers 340, à Stridon, à la frontière entre la Pannonie et la Dalmatie, il est mort à Bethléem le 30 septembre 420. La Vulgate est une traduction de la Bible en latin. Cette version repose pour l'essentiel sur le travail de traduction effectué par saint Jérôme au Ve siècle. C'est, sur décision du Concile de Trente (1545), la version officielle de l'Église Catholique.
► 406 Début des grandes invasions en Gaule à la suite du gel du Rhin.
► 406 Les grandes invasions du Ve siècle. Au Ve siècle, des peuplades venues d'Asie, les Huns, arrivent en Europe, chassées par les Chinois. Elles poussent à leur tour les Barbares cantonnés aux frontières de l'Empire. C'est ainsi qu'en 406, Vandales, Suèves, Alains, Alamans, Goths, et autres peuples germaniques déferlent à travers la Gaule et l'Espagne.
Les Vandales poussent même jusqu'en Afrique du Nord où ils s'établissent en 429. Les Wisigoths s'installent en 412 en Aquitaine, puis en Espagne. En 430, les Francs arrivent en Gaule Belgique. En 437, les Burgondes, installés sur la rive gauche du Rhin, sont chassés par les Huns. Ils s'installent alors autour de Lyon et dans les Alpes. Les Huns arrivent à leur tour en Gaule. Mais une alliance entre les troupes romaines et les peuples barbares permet de les repousser en 451 à la bataille des champs Catalauniques.
► 406 Commencement des Invasions des Barbares. Les Burgondes (venus du bassin de la Wartha) (Allemagne), puis les Francs (venus d'entre Weser, Main et Rhin) pénètrent successivement par petites bandes armées, dans la Gaule romaine. Après eux viennent les Wisigoths (originaires des bords du Danube). Les grandes invasions. Peu après 400, les tribus germaniques (Wisigoths, Alamans, Francs, Burgondes, Vandales, Angles, Saxons, Ostrogoths et Huns) déferlent sur l'Empire romain qui est coupé en deux.
Ces peuples barbares, constitués en sociétés guerrières divisées en clans familiaux, s'approprient la majorité des terres. La période des grandes invasions a bouleversé les bases du monde antique sédentaire et lui a mis un point final : c'est la fin de l'Antiquité. Les peuples barbares se fédèrent au IIIe siècle. L'Empire romain doit composer pour assurer sa survie; il échouera cette fois. Les grandes invasions commencent au IVe siècle, poussées par un peuple dont le seul nom terrifie les populations : Les Huns, guidés par leur célèbre chef Attila.
En 375, Après avoir traversé le Danube, Les Wisigoths d'Alaric, pénètrent en Italie à deux reprises en 401 puis en 410 (pillage de Rome) : ils négocient ensuite en 418 leur installation (environ 100 000 personnes dont 20 000 soldats) en Aquitaine, officiellement concédée par les Romains à la suite d'un traité (foedus). Ils choisissent comme capitale Toulouse. Fuyant eux aussi les Huns, les Vandales, les Suèves et les Alains franchissent pendant l'hiver 406 le Rhin, gelé par un froid exeptionnel. Ce sont alors 150 000 hommes qui envahissent l'Empire romain en déclin. Leur sédentarisation sur ces terres, et les potentats qu'ils développent constituent le premier acte du Haut Moyen Âge.
► 406 Stilicon assiège Florence où Radagaise s'est réfugié. Radagaise est un chef barbare païen d'origine gothique. À la tête d'une nombreuse armée hétéroclite composée entre-autres de Goths, de Vandales, d'Alamans et d'Alains, il entre en force en Italie au début de l'année 406, balayant les défenses frontalières, et commet de nombreux pillages et massacres dans la plaine du Pô.
Se dirigeant vers le sud, il est arrêté près de Florence par le général romain Stilicon et est sévèrement battu à Fiesole. Son armée, affaiblie par la famine et manquant d'espace pour combattre et/ou battre en retraite, est exterminée en grande partie, le reste enrôlé de force dans l'armée romaine ; Radagaise est capturé et exécuté avec les principaux chefs (août 406).
► 406 - 23 août Radagaise est exécuté après sa reddition.
► 406 - 31 décembre Des bandes de Vandales, d'Alains et de Suèves fran-chissent le Rhin gelé près de Mayence. Les barbares poursuivent leur route vers le Sud-ouest et ravagent la Gaule sans rencontrer de résistance notable. L'empire Romain vieillissant est incapable de réagir. Bientôt ils occuperont l'Espagne et le nord de l'Afrique. Dans leurs sillages d'autres groupes de Barbares envahiront l'Europe occidentale: les Alamans, les Burgondes et les Francs. L'Europe devient une mosaïque de royaumes barbares.
► 407 Accord entre Jovin, les Alamans et les Burgondes. Jovin, usurpateur en Gaule contre l'empereur Honorius de 411 à 412. Aristocrate gaulois, il est élu empereur à Mayence par les aristocrates gaulois en 411, face à l'incapacité d'Honorius et d'un autre usurpateur Constantin III à ramener la sécurité en Gaule après l'invasion de 406. Ses forces se résument à des Burgondes et des Alains enrôlés du côté romain, dans une Gaule dévastée par les barbares.
Pour se concilier Athaulf et ses Wisigoths présents en Italie, il les laisse passer les Alpes et entrer en Gaule en 412. Mais Athaulf préfère une alliance avec Constance III, représentant du pouvoir impérial légal qui est mieux à même de lui offrir du ravitaillement. Athaulf capture donc Jovin à Valence et l'exécute, au profit d'Honorius. Cette brève tentative témoigne des effets du désastre de l'invasion de 406 : décomposition de la domination impériale romaine, et velléités autonomistes des élites gallo-romaines, qui iront en s'accentuant.
► 407 Constantin III est proclamé empereur par l'armée de (Grande) Bretagne. Constantin III, succédant à Marcus et à Gratien, deux autres usurpateurs proclamés et aussitôt assassinés par l'armée de Bretagne, il fut proclamé empereur par ses troupes en 407. Il évacua aussitôt la Bretagne qui, en l'absence de troupes romaines, fut assaillie par les Jutes, les Angles, les Saxons, les Pictes, les Scots et les Frisons.
Constantin IIl prit le contrôle des Gaules, et s'établit à Trèves, l'empereur Honorius ne conservant sous son autorité que l'Italie et l'Afrique. En 408, il dut déplacer la capitale des Gaules, de Trèves à Arles, et, après avoir résisté à Sarus, envoyé par Stilicon pour réprimer sa rébellion, au siège de Vienne, il étendit son autorité sur l'Espagne. Fin 409, il ne put cependant arrêter l'invasion des Vandales, des Alains et des Suèves, qui s'installèrent en Espagne.
En 410, alors qu'il se rendait en Italie pour secourir Rome des invasions barbares ou pour y assoir son autorité, accompagné de son fils Constant, qu'il avait fait César dès 408, son général, Gerontius, qui gouvernait l'Espagne en son absence, proclama empereur Maxime à Tarragone. Gérontius traversa les Alpes, battit l'armée de Constant devant Vienne et tua celui-ci. Constantin III se réfugia à Arles. Gérontius s'apprêtait à commencer le siège d'Arles lorsque l'armée d'Honorius, dirigée par le général Constantius (futur Constance III) survint. Gerontius prit la fuite et Constantin III, après avoir négocié la reddition d'Arles, fut livré à Honorius qui le fit exécuter en novembre 411.
► 407 Constantin III débarque en Gaule et rallie quelques garnisons.
► 408 - 1er mai Mort d'Arcadius, Théodose II le remplace à la tête du gouvernement d'Orient. Théodose II (401– 28 juillet 450), empereur romain d'Orient (408–450).
► 408 - 13 août Rébellion au sein des armées de Stilicon à Ticinium (Pavie)
► 408 - 22 août Exécution de Stilicon sur les ordres d'Honorius à Ravenne.
► 408 novembre Alaric pose le siège devant Rome. Après avoir pillé Aquilée, Crémone, Alaric parait devant Rome et ne se retire qu'après avoir obtenu une rançon énorme; Honorius lui refusant le titre de maître de la milice, il revient devant Rome qui, désolée par la famine, ouvre ses portes; sur son ordre, le Sénat donne la pourpre au préfet de la ville Attale et nomme Alaric lui-même maître de la milice; puis Honorius, ayant fait attaquer à l'improviste le camp des Goths par leur compatriote Sarus, Alaric, qui avait déposé sa créature Attale, revient une troisième fois sur Rome, la prend et la livre au pillage (410).
► 408 - 14 novembre Loi d'Honorius excluant les ennemis des catholiques de l'administration.
► 408 décembre Alaric s'empare du port de Rome qu'il quitte contre une forte rançon. Stilicon achète le départ des Wisigoths d'Alaric d'Italie pour 4000 livres d'or et les envoie contre Arcadius en Orient. A la mort d'Arcadius en mai, la rumeur se répand que Stilicon veut faire de son fils, Eucher, un empereur. Il se fait assassiner à Ravenne sur ordre de son gendre, Honorius (24 août). Le pouvoir tombe entre les mains des favoris de l'empereur, Olympius, Jovius, Eusèbe, Allobichius. Alaric reprend le chemin de l'Italie. Il pille Aquilée et Crémone, puis marche sur Rome (octobre).
► 409 Vandales, Alains et Suèves envahissent l'Espagne.
► 409 Constantin III rétablit l'autorité de Rome dans la vallée du Rhin.
► 409 Le Sénat envoie Attale auprès d'Honorius pour lui demander l'exécu-tion du traité de 408. Attale, haut fonctionnaire romain, comte de largesses sacrées d'Honorius, il fut de 409 à 416 la marionnette politique du bras de fer entre les Wisigoths et le pouvoir impérial romain. Il est mandaté par le sénat de Rome pour servir de négociateur entre Alaric Ier qui menace Rome avec ses Wisigoths et l'empereur Honorius enfermé à Ravenne. En fin 409, Alaric assiège Rome, et force le sénat à décider la déchéance d'Honorius et à proclamer Attale comme Auguste.
Comme convenu, Attale satisfait aux exigences d'Alaric, en le nommant chef des armées (magister militium), puis tous deux marchent sur Ravenne. Honorius propose à Attale de partager l'empire, ce dernier refuse, sur de sa force. Ravenne est bien protégée, Honorius reçoit des renforts d'Orient, et le gouverneur d'Afrique Héraclien coupe le ravitaillement vers Rome, où la population affamée finit par se révolter.
Alaric cherche encore une voie négociée avec Honorius : il dégrade Attale en été 410 et renvoie son diadème et sa pourpre à Ravenne. En vain. Ne pouvant prendre Ravenne, Alaric se tourne vers Rome, et redonne la pourpre à Attale pour se concilier les habitants de Rome. Malgré celà, les romains ferment les portes de la Ville aux Wisigoths. Attale est de nouveau dégradé par Alaric.
Le 24 août 410, les Wisigoths pernètrent dans Rome et la pillent. De potiche, Attale devient bagage, entraîné par Alaric puis Athaulf d'Italie en Gaule, de Gaule en Espagne. Il dirige les chants lors du mariage d'Athaulf et de Galla Placidie ! En 414, Athaulf furieux du blocus alimentaire opéré par Constance, élève Attale au titre d'empereur, pour la troisième fois ! Après l'assassinat d'Athaulf, Wallia le livre au patrice Constance. Attale eut la vie sauve et figura comme captif au triomphe d'Honorius en 416. Il finit ses jours en exil aux îles Lipari, à une date inconnue.
► 409 Attale repart de Ravenne à la tête d'une armée de 6 000 hommes.
► 409 L'armée romaine est massacrée au cours d'une embuscade d'Alaric.
► 409 Alaric assiège de nouveau Rome pour imposer l'exécution du traité de décembre 408.
► 409 novembre Alaric oblige le Sénat à nommer Attale, préfet de la ville, empereur d'Occident.
► 409 Attale nomme Alaric commandant des armées.
► 410 Honorius rappelle les légions romaines en garnison en (Grande) Bret-agne pour défendre l'empire.
► 410 Attale met le siège devant Ravenne.
► 410 Défaite des troupes d'Attale en Afrique contre Héraclien, gouverneur d'Afrique.
► 410 Alaric destitue Attale à Rimini et envoie les insignes impériaux à Honorius. Rimini est une commune sur la côte adriatique au Nord de la Méditerranée.
► 410 Alaric victime d'une tentative d'attentat, redonne le titre d'empereur à Attale.
► 410 Alaric met le siège devant Rome qui refuse de lui ouvrir ses portes et dégrade Attale.
► 410 - 24 août Prise et pillage de Rome par Alaric jusqu'au 27. Alaric Ier, le roi des Wisigoths, après avoir envahi l'Italie, s'empare de Rome et la livre au pillage, avant de partir s'installer en Gaule méridionale. Le dernier empereur, Romulus Augustule sera détrôné par le roi barbare Odoacre en 476. Ce sera la fin de l'Empire romain d'Occident.
► 410 Alaric, roi des Wisigoths, s'était emparé de Rome qu'il avait livrée au pillage. Il mourut en 412 et eut pour successeur Ataulf son beau-père, qui épousa Placidia, fille de Théodose II le Grand. Les Romains lui accordèrent pour ses hordes, qu'ils espéraient détourner ainsi de leurs projets sur l'Italie, des territoires dans la Gaule méridionale (Aquitaine).
► 410 Alaric se dirige vers le sud de l'Italie.
► 411 Jovin se proclame empereur de l'empire romain.
► 411 Constant, fils de Constantin III est capturé à Vienne.
► 411 Constantin III assiégé à Arles, est capturé et décapité par Constance III. Constance III, Constantius, proclamé Empereur romain d'Occident en 421. Général de l'Empereur d'Occident Honorius avec le titre de patrice, Flavius Constantius vainquit les usurpateurs apparus dans le sillage des invasions germaniques de 406 : Constantin III en Gaule en 411, Maxime en Espagne en 411 puis en 413 Jovin de nouveau en Gaule.
Il parvient tres habilement à ramener les Wisigoths à la paix : en 414, en les affamant par un blocus, il les força à sortir d'Espagne pour revenir en Aquitaine. En 416, il traita avec leur roi Wallia, en échange de livraisons de ravitaillement. Wallia restitua l'usurpateur Priscus Attale et Galla Placidia, ex-otage d'Alaric Ier puis veuve d'Athaulf.
Enfin en 418, Constantius accorda aux Wisigoths le statut de fédérés (foedus) en Aquitaine de Toulouse à Poitiers. Les Wisigoths créèrent le royaume de Toulouse, où ils restèrent en paix jusqu'en 456. Constantius épousa en 417 Galla Placidia, soeur d'Honorius. Ils eurent deux enfants, Valentinien III et Honoria. Grâce à ses succès, Constantius fut nommé Auguste en février 421, sous le nom de Constance III, mais Théodose II ne le reconnut pas. Le rattachement religieux de l'Illyrie à Constantinople ouvrit un conflit entre les deux parties d'empire; Constance III mourut de maladie en septembre 421 alors qu'il préparait une expédition contre Théodose II.
► 412 Les Wisigoths pénètrent dans le sud de la Gaule, mais se cantonnent en Aquitaine dès 418. Athaulf conduit les Wisigoths en Gaule (100 000 personnes) où il s'empare de la Provence et de l'aquitaine. Narbonne, Toulouse et Bordeaux sont ravagées.
► 413 Installation des Burgondes sur la rive gauche du Rhin à l'appel de Jovin.
► 413 Athaulf pénètre en Gaule et s'empare de Narbonne, Toulouse et Bordeaux avant d'être battu par Constance. Athaulf est roi des Wisigoths de 410 à 415. Il est le successeur d'Alaric Ier, ainsi que son beau-frère. Il renonce au projet d'Alaric envers l'Afrique du nord et remonte toute l'Italie puis enlève aux usurpateurs Jovin et Sébastien la Provence puis l'Aquitaine. Il épouse Galla Placidia en janvier 414, la soeur de l'empereur légitime Honorius, qui était sa captive. En 415 il se prépare à envahir l'Espagne lorsqu'il est assassiné par l'un de ses officiers. Sigeric lui succède 7 jours avant que Wallia devienne roi.
► 414 Athaulf alors en Tarraconaise nomme Attale empereur.
► 415 Assassinat d'Athaulf par Sigéric, qui lui succède. Sigéric est roi des Wisigoths en 415. Porté au pouvoir par la faction hostile à la politique du roi Athaulf qui meurt assassiné, il est assassiné après 15 jours de règne le même mois de son élection (septembre 415) au nom de la faide germanique ("vendetta").
► 415 Assassinat de Sigéric par Wallia qui lui succède. Wallia, roi des Wisigoths (415-418), En septembre 415, après l'assassinat du roi Sigéric, instigateur du meurtre du roi Athaulf peu de temps avant, Wallia est porté au pouvoir. Il renvoit Galla Placidia en Italie en échange de 600 000 boisseaux de blé fournis par l'Empire aux Wisigoths et est reconnu par Rome comme gouverneur d'Aquitaine. Il est également chargé de combattre les "Barbares" qui infestent la péninsule ibèrique, c'est-à-dire principalement des Vandales, vieux ennemis des Goths, des Suèves et quelques clans alains.
► 415 Les Wisigoths entrent en Espagne.
► 415 Le corps du protomartyr Saint Étienne est découvert par un dénommé Lucien, prêtre à Caphar-Gamala, qui avait eu la révélation de son emplacement au cours d'un songe. L'évêque Jean de Jérusalem fait procéder solennellement à la translation du corps du martyr à l'église du Mont-Sion de Jérusalem, le 26 décembre 415. L'évêque Juvénal, successeur de Jean, commence la construction à Jérusalem d'une basilique destinée à recueillir la dépouille de Saint Étienne. Les travaux sont repris en 438 sous l'impulsion de l'impératrice Eudoxie, épouse de Théodose II.
Les restes du martyr sont transférés dans la nouvelle basilique, qui ne sera d'ailleurs achevée que vingt ans plus tard, lors de la cérémonie de dédicace par Saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, le 15 mai 439. L'actuelle basilique a été construite à l'emplacement de l'ancien ouvrage par les Dominicains à la fin du XIxe siècle. Saint Étienne, premier martyr de la chrétienté - ou protomartyr, apparaît comme étant à l'origine du culte des saints.
L'existence d'Étienne est attestée pour la première fois dans les Actes, au chapitre 6, où il est présenté comme un juif helléniste converti au christianisme, choisi avec six autres "hommes de bonne réputation, d'Esprit Saint et de sagesse" pour devenir les diacres chargés d'assister les apôtres. Étienne devient rapidement un personnage soit admiré, soit fortement haï à Jérusalem. C'est un érudit jamais pris en défaut et un éclatant dialecticien qui confond ses adversaires lorsque ceux-ci l'entreprennent. En outre, il acccomplit des "prodiges et des signes remarquables parmi le peuple"
► 416 Traité de paix entre Honorius et Wallia qui lui livre Attale. Les Wisigoths continuent leur invasion de l'Espagne. Leur roi Wallia, payé par l'empereur (600 000 mesures de blé) et à la tête de 100 000 hommes, combat les Alains et les Vandales (416-429). Les Vandales Silingues sont exterminés, tandis que les Alains, les Suèves et les Vandales Asdingues sont regroupés dans le nord-ouest de la péninsule. Les Suèves en profitent pour étendre leur domination vers le sud, mettant en place un état d'une extrême brutalité.
► 417 - 1er janvier Galla Placida, fille de Théodose II, épouse Constance III.
► 418 Installation des Wisigoths en Aquitaine, Toulouse devient leur capitale.
► 419 Naissance de Valentinien (futur Valentinien III), fils de Constance et de Galla Placidia soeur d'Honorius. Valentinien III (2 juillet 419, Ravenne - 16 mars 455, Rome) fut un empereur romain (de 424 à 455). Il fut le seul fils de Constance III et de Galla Placidia, fille du grand Théodose Ier. Il fut nommé César le 23 octobre 424 à Constantinople, et après une courte guerre en Italie pour éliminer le fonctionnaire Jean installé sur le trône, il fut sacré empereur de l'Empire romain d'Occident à Rome le 23 octobre 425. Galla Placidia est une impératrice romaine née en 390. Elle est la fille de Théodose Ier et la demi-soeur des empereurs Arcadius et Honorius.
► 420 LES MÉROVINGIENS
► 420 Les Mérovingiens constituèrent la première dynastie qui régna sur la majorité des territoires français et belge, du Ve siècle jusqu'au VIIIe siècle, immédiatement après l'occupation romaine de la Gaule. Ils sont issus des Francs Saliens qui étaient établis au Ve siècle dans les régions de Cambrai (Clodion le Chevelu) et de Tournai, en Belgique (Childéric). Le nom mérovingien provient du roi Mérovée, ancêtre légendaire de Clovis.
Parmi les Francs qui sont entrés au service de l'Empire depuis la fin du IIIe siècle, se trouvent les Saliens. Leur ancêtre légendaire, sans doute quasi-divin selon les rites germaniques, est pour eux la principale source de légitimité du pouvoir royal. Il se nomme Mérovée. Toutefois, au Ve siècle leur roi est aussi devenu proconsul des Gaules, c'est-à-dire un fonctionnaire romain d'origine germanique mais très bien assimilé. Les Francs sont alors solidement établis en Neustrie et leurs fonctions militaires leur confèrent un pouvoir important en ces temps troublés : le jeune Clovis (germ. Hlodowecus, qui donne par la suite les prénoms Ludovic ou Ludwig en Allemagne et Louis en France) devient leur roi à Tournai, probablement en 481.
Mais il lui faut plus que le pouvoir d'essence divine que lui confère la mythologie tribale germanique, pour s'imposer face aux évêques, aux patrices ou à la population gallo-romaine en partie christianisée. Installé à Soissons, où il a renversé un général romain nommé Syagrius, Clovis est sans doute d'abord sensible aux conseils de sa femme burgonde, Clothilde, convertie au catholicisme, et à ceux de l'évêque de Reims, Rémi. Peut-être au cours d'une bataille importante contre les Alamans, la bataille de Tolbiac, il promet de se convertir à la religion chrétienne catholique s'il est victorieux. Il tient parole et reçoit le baptême en 496 à Reims, avec 3000 guerriers.
Par la suite, il tente d'inculquer les principes chrétiens à son peuple qui demeure largement païen. Après une suite de victoires sur ses rivaux barbares, notamment sur les Burgondes, Clovis apparaît donc comme l'un des premiers rois germains d'Occident à avoir adopté la religion chrétienne dominante, celle de Rome, contrairement aux Wisigoths ou aux Lombards ariens et aux Alamans païens. Il parvient ainsi à gagner le soutien des élites gallo-romaines et à fonder une dynastie durable (laquelle prend le nom de son ascendant germanique) : les Mérovingiens. Établis en Neustrie, les Mérovingiens règnent sur la Gaule jusqu'au milieu du VIIIe siècle. Leurs souverains les plus connus sont : Dagobert Ier et la reine Brunehaut. Il faut noter qu'à cette époque, comme sous la dynastie suivante, il n'est pas question de France, mais bien d'un royaume des Francs : les rois germains, en effet, ne règnent pas sur un territoire, mais sur des sujets.
► 420 Les Mérovingiens forment une dynastie de rois francs descen-dants de Mérovée roi d'une tribu de Francs Saliens. Ils portent des cheveux longs on les surnommera les rois chevelus. A cette époque, les rois se comportent comme des propriétaires terriens, à leur mort leurs biens sont partagés entre les héritiers. Toutes les tentatives d'accroissement du domaine royal, notamment par les conquêtes territoriales, sont sans cesse remises en cause. Fréquemment, des conflits éclateront entre les héritiers lorsque l'un d'entre-eux cherchera à reconstituer le domaine à son profit.
Après le règne de Dagobert Ier s'amorce une période très troublée annonçant la fin de la dynastie Mérovingienne. Depuis Childebert II, la moyenne de la durée de vie des rois mérovingiens, qui était jusqu'alors de 46 ans, tombe à 28 et l'âge moyen d'accession au trône passe de 18 ans à 9 ans et demi. Il devient évident que ces rois enfants ne vont plus être que des jouets dans les mains de régents plus ou moins officiels. On peut voir que Clotaire II et Dagobert Ier qui font figure d'exception puisqu'ils ont vécu 45 et 35 ans et ont eu un règne personnel tout à fait estimable et même prestigieux. Les maires des Palais deviennent souvent les vrais rois, certains en feront un usage discret d'autres auront beaucoup moins de scrupules. Ils finiront par créer une nouvelle dynastie, les Carolingiens.
► 420 PHARAMOND (420-428), roi des francs.
► 420 Pharamond ou Pharamon fut le premier duc des Francs saliens. Traditionnellement, Pharamond est considéré comme le premier monarque mérovingien. Ce fut vers l'an 420, pendant qu'Honorius régnait en Occident, et Théodose le jeune en Orient, qu'il fut élevé sur un bouclier, montré à toute l'Armée, et reconnu chef de toute sa nation. C'était le mode de désignation des anciens rois francs.
En l'an 420 il traverse le Rhin près de Cologne en direction de l'ouest. Il divise la tribu des Francs en deux moitiés : les Francs saliens et les Francs rhénans ou "ripuaires". Il aurait eu pour fils Clodion le Chevelu et pour petit-fils Mérovée. Les Francs rhénans ou Francs ripuaires étaient une confédération de tribus d'origine franque. Ils étaient situés autour de Cologne, dans l'actuelle Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne). La dynastie qui les gouvernait s'appelait les Ripuaires. En l'an 420, le duc Pharamond sépara la tribu en deux groupes, prit la tête de l'un d'entre eux et partit vers l'ouest. Il fonda ainsi la tribu des Francs saliens et la famille des Mérovingiens.
► 420 La Gaule morcelée. Au Ve siècle, la Gaule est divisée en plusieurs royaumes barbares : Entre la Loire et l'Espagne, se trouve le Royaume Wisigothique de Gaule (419-507). Dans la vallée du Rhône, les Alpes et le Jura, les Burgondes ont établi leur royaume : la Sapaudia (443-534). Les Francs s'installent à partir de 486 en Allemagne (jusqu'à la Hesse actuelle), Belgique et Pays-Bas. Une partie de la Provence est occupée par les Ostrogoths, qui tiennent l'Italie (489-552). Le dernier bastion romain en Gaule est l'espace situé entre Seine et Loire : la Normandie, l'île de France et une partie du Bassin parisien. La plupart de ces royaumes sont éphémères, du moins en Gaule. A la fin du Ve siècle et au début du VIe, les Francs, menés par Clovis puis ses descendants, vont reconquérir la Gaule et soumettre les différents peuples barbares.
► 420 Les Francs envahissent en masse le Nord de la Gaule.
► 421 - 8 février Constance III est nommé empereur par Honorius.
► 421 - 2 septembre mort de Constance III.
► 423 Honorius chasse Galla Placidia de Ravenne.
► 423 - 15 août Mort d'Honorius. A la mort d'Honorius, un usurpateur, le séna-teur italien Jean, prend l'empire à Ravenne (20 novembre).
► 423 Théodose II refuse de nommer un successeur à Honorius gouverner l'Occident.
► 423 Boniface Ier soutient Galla Placida et menace de bloquer les transports de blé venant d'Afrique. Boniface Ier, 42e pape (419–422). À la mort du pape Zosime, le 26 décembre 418, le parti des diacres élit pour lui succéder l'archidiacre Eulalien, le 27 décembre. Or, le 28, les prêtres choisissent l'un des leurs, qui devient Boniface Ier. Il en résulte que, le 29 décembre les deux hommes sont sacrés chacun de leur côté.
► 423 La cour de Ravenne nomme Jean empereur d'Occident.
► 423 Jean envoie Aetius lever une armée chez les Huns. Aetius (né en 390), qui a passé une partie de sa jeunesse comme otage chez les Wisigoths et les Huns, se rallie à sa cause et va recruter une armée chez les Huns. Quand il revient avec une forte armée, Jean a déjà succombé aux attaques de Galla Placidia, fille de Théodose Ier, soutenue par son neveu Théodose II (mai 425).
Flavius Aetius (parfois francisé en Aétius) est un général romain qui obtint les titres de "Patrice" en 433 et de "maître de la Milice" pour les Gaules par Galla Placidia, la mère de l'empereur romain Valentinien III. On a dit de lui qu'il fut "le Dernier des Romains" en raison de ses victoires contre les barbares et de l'époque à laquelle il vécut, peu avant que le dernier empereur d'Occident ne soit déposé. Il repoussa les Francs orientaux au-delà du Rhin, vainquit les bagaudes d'Armorique, battit les Francs saliens de Clodion à Helesmes.
Ce dernier chef barbare conclut un traité avec le général en 428. Ce traité (foedus) faisait d'eux des "fédérés" combattant pour Rome, et les autorisait à s'installer dans l'Empire, en l'occurrence près du fisc impérial de Tournai. Il s'agissait là des origines du futur royaume franc de Clovis Ier. Aetius battit également les Burgondes de Gunthar qui étaient entrés en Gaule et les força - ou plutôt négocia leur installation en Sapaudia (la future Savoie, précisément les territoires entre Alpes et Jura).
Enfin, il chargea le roi des Alains qui étaient établis sur la Loire, Goar, de surveiller les Armoricains. Ainsi, il contribua par sa politique à dessiner certains des traits marquants du territoire français au haut Moyen Âge. Mais la notoriété d'Aetius est surtout due à ce que l'Historiographie a fâcheusement nommé la "bataille des Champs catalauniques".
Cette bataille se déroula en réalité au lieu-dit campus mauriacus près de Troyes et marqua la fin de l'invasion des Huns, menés par Attila, en Gaule. Aetius y commanda la coalition romano-barbare aux côtés du roi wisigoth Théodoric Ier et de Burgondes, d'Alains, de Saxons et de Francs qui étaient ses alliés. Triomphant, il fut finalement victime des jalousies que ses victoires lui avaient apportées à Rome. Il mourut, en effet, assassiné sur l'ordre de Valentinien III en 454. Théodoric Ier (? - 451) - roi des Wisigoths (418-451) Véritable fondateur de la monarchie Wisigothique, il établit sa capitale à Toulouse. Il fit trois fois la guerre au Romains, de 425 à 436, mais ne put réussir à s'emparer d'Arles, ni de Narbonne. Il mourut au coté d'Aetius, en combattant Attila à la bataille des Champs Catalauniques.
► 423 Aetius gouverneur de la Gaule restée sous la domination de Rome.
► 424 - 23 octobre Valentinien III est nommé César par Théodose II.
► 425 - 9 juillet Valentinien III annule les actes pris par Jean.
► 425 - 23 octobre Valentinien III est nommé Auguste sous la régence de sa mère Galla Placidia.
► 425 VALENTINIEN III (425 à 455) (Placidius Valentianus)
► 425 Valentinien III (2 juillet 419, Ravenne - 16 mars 455, Rome) fut un empereur romain (de 425 à 455). Il fut le seul fils de Constance III et de Galla Placidia, fille du grand Théodose Ier. Il fut nommé César le 23 octobre 424 à Constantinople, et après une courte guerre en Italie, il fut sacré empereur de l'Empire romain d'Occident à Rome le 23 octobre 425. Il avait seulement six ans lorsqu'il eut reçut le titre d'Auguste, c'est donc sa mère qui a régné avec Aetius jusqu'en 433. Son règne fut marqué par l'éclatement de l'Empire romain d'Occident, la conquête de la province de l'Afrique par les Vandales en 439, l'abandon de l'Angleterre en 446, la perte d'une partie des territoires d'Espagne et de la Gaule, où les peuples barbares s'installèrent et enfin les ravages fait en Sicile et sur les côtes orientales de la mer Méditerranée par les flottes de Genséric.
Il y eut quand même la victoire d'Aetius sur Attila en 451 près de Châlons et les campagnes successives contre les Wisigoths dans le Sud de la Gaule en 426, 429 et 436, enfin, des envahisseurs venant du Rhin et du Danube furent repoussés de 428 à 431. L'impôt est devenu de plus en plus plus intolérable pour les provinces pendant que la puissance de Rome diminuait ce qui a fait que leur fidélité a été sérieusement altérée.
Ravenne était la résidence habituelle de Valentinien mais il s'est sauvé de Rome à l'approche d'Attila, qui, après avoir ravagé le Nord de l'Italie, est mort l'année suivante (453). En 454, le fils d'Aetius devait se marier avec la fille de l'empereur, mais il fut tué sous les ordre de Valentinien. Le 16 mars de l'année suivante, l'empereur fut lui-même assassiné par deux des palpeurs barbares d'Aetius. D'une part, il n'avait pas la capacité de régner sur l'Empire dans un tel moment de crise, d'autre, il n'a jamais été indulgent envers ses victimes.
► 425 Capture de Jean par les soldats de Théodose II à Ravenne.
► 425 mai Exécution de Jean à Aquilée.
► 425 mai Aetius arrive à Ravenne à la tête d'une amée qu'il congédie.
► 425 - 23 octobre Valentinien III est nommé Auguste sous la régence de sa mère Galla Placidia.
► 425 Félix est nommé commandant des armées et Aetius maître de la milice en Gaule.
► 425 à 450 - Mausolée de Galla Placidia à Ravenne: le plus ancien ensemble de mosaïques. Galla Placidia est une impératrice romaine née en 390. Elle est la fille de Théodose Ier et la demi-soeur des empereurs Arcadius et Honorius. Le Mausolée de Galla Placidia, à Ravenne, en Italie, est un célèbre monument d'époque et de style byzantins. Plus que par son architecture, ce monument est mondialement connu par ses somptueuses mosaïques, les plus anciennes de la ville. Elles marquent la transition entre l'art paléochrétien et l'art byzantin.
► 428 CLODION (428-455), roi des francs.
► 428 Avènement de Clodion. Clodion, dit "le Chevelu" (? - 448), fils de Pharamond, était chef des Francs saliens, donc deuxième roi de France de la première dynastie, celle des Mérovingiens.
► 428 Clodion, roi des francs s'empare de Cambrai et atteint la Somme avant d'être battu par Aetius.
► 428 L'hérésiarque Nestorius patriarche de Constantinople (428-431). Nestorius ne veut voir dans le Christ qu'un homme en qui le Verbe de Dieu à résidé. Marie n'est pas mère de Dieu (Théotokos), mais mère du Christ (Christotokos). L'évêque de Rome Célestin condamne la doctrine nestorienne. Le patriarche d'Alexandrie Cyrille fait aussitôt rédiger par un concile égyptien une mise en demeure qu'il transmet à Nestorius.
Nestorius ou Nestorios (né vers 381-mort en 451) fut patriarche de Constantinople du 10 avril 428 au 11 juillet 431. Nestoriens, on appelle nestoriens les chrétiens adeptes du nestorianisme, une des formes historiquement les plus influentes du christianisme dans le monde durant toute la fin de l'Antiquité et du Moyen Âge à partir de ses bases à l'ouest de l'empire perse. Cyrille d'Alexandrie (376-444) devient évêque d'Alexandrie en 412 et est un docteur de l'Église.
Patriarche d'Alexandrie en 412, il déploya un grand zèle contre l'hérésie, ferma les églises des Novatiens et chassa les Juifs d'Alexandrie. Ces mesures énergiques l'engagèrent dans de vifs démêlés avec Oreste, préfet d'Égypte, et furent l'occasion de scènes sanglantes (415), dans lesquelles périt Hypatie. S. Cyrille combattit également Nestorius et contribua à le faire condamner par le concile d'Éphèse, 431. Il est le grand défenseur de "Marie, Mère de Dieu" en particulier lors du concile d'Éphèse en 431. Il mourut en 444, méritant le titre de Défenseur de l'Église, que lui décerna Saint Célestin.
► 429 Raids de Genséric en Afrique depuis l'Espagne. Genséric (v. 389/399 à 477) ou Geiseric était le roi des Vandales lors de leur conquête de l'Afrique en 429-439.
► 430 juin Genséric met le siège devant Hippone. Hippone, en latin Hippo Regius, est le nom antique de la ville d'Annaba se trouvant au Nord-Est de l'Algérie. Fondée par les Phéniciens, elle devint l'une des principales cités de l'Afrique romaine. Saint Augustin était l'évêque de la ville entre 396 et 430. Hippone est ensuite prise par les Vandales en 431 au terme d'un siège de 18 mois. La ville devient alors leur capitale de 431 à 539, avant de redevenir romaine entre 534 et 698. Elle est alors prise par les Arabes.
► 430 - 28 août Mort de Saint Augustin au cours du siège d'Hippone (jusqu'en juillet 431).
► 430 à 486 - naissance et mort de Sidoine Apollinaire, premier auteur national. Sidoine naquit à Lyon, vers l'an 430, d'une illustre famille arverne des Gaules, où son aïeul et son père furent préfets du prétoire. Il étudia les lettres sous les maîtres les plus habiles, et devint lui-même un des hommes de son temps les plus célèbres dans l'éloquence et la poésie.
Gendre de l'empereur Avitus, arverne comme lui (il avait épousé sa fille Papianilla en 452), il l'accompagna à Rome et prononça son panégyrique devant le Sénat. Revenu à Lyon après la chute d'Avitus, il y fut capturé par le nouvel empereur Majorien en 457. En raison de sa réputation, celui-ci le traita avec grand respect, et Sidoine prononça son panégyrique en retour, ce qui lui valut d'avoir une statue de bronze élévée sur le Forum et le titre de comte.
En 467, l'empereur Anthémius le récompensa d'un panégyrique composé en son honneur en le nommant préfet urbain de Rome, et par la suite l'éleva à la dignité de patricien et de sénateur. Pour des raisons plus politiques que religieuses, il fut appelé à succéder à Eparchius sur le siège épiscopal d'Arvernum, aujourd'hui Clermont en 471. Lors de la prise de la ville par les Goths en 474, il fut emprisonné car il avait pris une part importante dans la défense de la ville. Il fut restauré dans ses fonctions par Euric, roi des Goths, et gouverna son évêché jusqu'à sa mort. Ses poèmes et ses lettres nous fournissent un témoignage unique et intéressant sur l'Auvergne du Ve siècle.
► 431 Premier concile oecuménique qui se tient à Éphèse; il condamne le nestorianisme comme une hérésie; il définit Marie comme étant vraiment la "Mère de Dieu". Après son succès sur Nestorius au concile d'Éphèse, le patriarche d'Alexandrie Cyrille est accueilli triomphalement en Égypte, et Alexandrie est considérée pendant un temps comme la capitale de la chrétienté d'Orient. Un grand nombre des partisans de Nestorius se réfugient en Perse, et Nestorius meurt dans le désert de Libye en 440.
Le concile d'Éphèse est ouvert le 22 juin 431 par le patriarche Cyrille d'Alexandrie et rassemble près de 200 personnes. Les lettres de convocation sont adressés à tous les évêques métropolitains de l'Empire d'Orient et à très peu d'évêques occidentaux pour la Pentecôte 431. Cyrille n'attend pas les retardataires, pourtant nombreux et souvent favorables à Nestorius. La décision de condamner ce dernier est prise en une journée.
À l'inverse des précédents conciles dont les questions théologiques portaient principalement sur l'unicité de Dieu, le concile d'Éphèse marque un tournant en s'interrogeant sur la nature du Christ. Ainsi, le nestorianisme est le centre du débat. Nestorius, niant la tradition de l'unicité de la nature du Christ, s'oppose à la désignation de Marie en tant que "mère de Dieu". Pour lui, elle est au mieux "mère du Christ". Marie serait donc la mère d'un homme dans lequel le Verbe s'est incarné, c'est-à-dire que Dieu serait venu "visiter".
Or, si la religion chrétienne a pu s'implanter si rapidement en Asie mineure, c'est que le culte de Marie, très vivant, a pu être identifié au culte d'Artémis, principale déesse de l'ancienne religion. Remettre en cause cette importance de Marie, revient à affaiblir la position de la nouvelle religion notamment en Ionie. C'est la raison pour laquelle le concile se déroule à Éphèse, dans la première église dédiée à la Vierge.
Mais derrière ces questions théologiques se cache une rivalité entre les deux patriarcats : celui d'Alexandrie et celui de Constantinople. L'empereur lui-même, Théodose II, intervient pour séparer les protagonistes et ordonner l'emprisonnement de Nestorius et de Cyrille. D'autres divisions s'opérent à la suite de ce concile. Jean d'Antioche condamne Cyrille qui répond en excommuniant ce-même Jean. Il faut attendre 2 ans pour qu'un compromis soit trouvé. Le concile d'Éphèse apparaît alors comme un symbole d'union entre deux courants.
► 432 Évangélisation de l'Irlande par Saint-Patrick. Saint Patrick (ou Patrice) est un saint catholique fêté le 17 mars. Il est à la fois l'évangélisateur de l'Irlande et le fondateur du christianisme irlandais. Saint Patrick, qui était britto-romain, de son nom païen de naissance Maewyn Succat, serait né aux environs de 389 en Bretagne insulaire dans la région qui correspond à l'actuel le Pays de Galles, ultime refuge celtique des bretons insulaires invaincus par l'occupant germanique, à Bannaven Taberniae de parents britto-romains : Calpurnius et Conchessa. Son père, bien que diacre, n'était pas considéré comme un homme très religieux, sa situation aisée provenant de la collecte de taxes.
En 405, saint Patrick est enlevé par des pirates écossais qui le vendent comme esclave. Durant ses six années de captivité, il est berger pour le compte d'un chef de clan irlandais. Peu religieux avant sa capture, il rencontre Dieu et devient un chrétien dévôt. En 409, il parvient à s'échapper après que Dieu lui dit, dans un de ses rêves, de rejoindre le rivage et de s'embarquer sur un bateau. Il rejoint les côtes anglaises et devient prêtre. Il gagne ensuite les îles de Lérins, près de Cannes en France, et s'installe au monastère de Saint-Honorat où il se consacre à des études théologiques pendant deux années.
En 411, il retourne en Irlande qu'il commence à évangéliser. La légende raconte que c'est à ce moment-là qu'il chasse tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du peuple irlandais : les serpents représentent l'"antique ennemi", c'est-à-dire Satan, rendu responsable de l'ignorance du Dieu véritable. Encore selon la tradition, saint Patrick introduit également le concept de Trinité dans le pays en se servant du trèfle pour l'expliquer. Il est ordonné évêque et prend le nom de Patricius (Patrice ou Patrick en latin). Après de longues années d'évangélisation, il se retire à Downpatrick où il meurt le 17 mars 461. Il y est enterré aux côtés de sainte Brigitte et de saint Columcille, tous deux également patrons de l'Irlande.
► 434 Aetius s'arroge le titre de commandant des armées.
► 434 Les Huns (des Mongols) atteignent l'Europe. Emmenés par Attila, ils vont conquérir une grande partie du continent. Les Huns sont un peuple asiatique turco-mongol, probablement de langue turque, ou à tout le moins altaïque. mené par Attila est considéré comme étant l'extension occidentale des Huns. L'établissement du premier État hun a été un des premiers aspects bien documentés de la culture de la migration à dos de cheval.
Ces tribus nomades surpassèrent leurs rivaux dans la maîtrise du cheval, grâce à la promptitude et la mobilité étonnante de leurs montures, ainsi qu'au talent des cavaliers, initiés dès le plus jeune âge. Cet avantage, couplé à l'arc court qui pouvait être utilisé depuis le dos de la monture, fut crucial dans les nombreuses batailles que livrèrent les Huns. Attila fut le roi des Huns - une peuplade originaire des steppes qui s'était établie dans la plaine danubienne - et régna selon l'historiographie romaine de 434 à 453.
► 435 - 11 février Traité avec Genséric lui accordant Maurétanie et Numidie.
► 435 - Victoire d'Aetius sur Gundicaire, roi des Burgondes à Gundaha.
► 435 - L'invasion des Vandales. Les Vandales envahissent l'ancienne région de Mauritanie. Ils occuperont Carthage, la capitale romaine d'Afrique, quatre ans plus tard. En 533, les Vandales seront chassés par l'armée byzantine, envoyée pour conquérir le continent africain.
► 436 Défaite des Burgondes face aux troupes d'Attila.
► 437 octobre Valentinien III épouse Licinia Eudoxia, fille de Théodose II à Constantinople.
► 438 - 15 février Promulgation du Codex de Théodose rassemblant toutes les lois.
► 439 Prise de Carthage par les Vandales ; l'Afrique du nord passe sous leur contrôle.
► 439 Avitus est nommé préfet du prétoire des Gaules. Avitus était un noble gaulois d'Auvergne qui devint empereur romain d'Occident (455 - 456).
► 443 Aetius transfert les Burgondes de la rive gauche du Rhin pour les installer entre Genève et Grenoble.
► 448 Le chef Franc Mérovée est élevé sur le pavois (est reconnu pour chef par toutes les tribus franques occupant le même territoire dans la Gaule). De lui sortira la Première race des rois de France.
► 449 Les Jutes, les Angles et les Saxons commencent la conquête de la Grande-Bretagne.
► 450 - 27 novembre Mort de Galla Placidia, mère de l'empereur.
► 451 - 7 avril Attila met à sac la ville de Metz. Attila, à la tête des Huns, poursuit dans la Gaule qu'il envahit ses sujets Wisigoths qui ont fui l'Ukraine sans son accord et qui ont atteint l'Aquitaine, royaume fondé par Théodoric Ier, roi des Wisigoths, et l'Espagne.
► 451 - 14 juin Aetius allié aux Wisigoths délivre Orléans.
► 451 - 21 juin Aetius bat les Huns près de Troyes qui quittent la Gaule en direction de l'Italie.
► 451 Mort de Clodion Mérovée lui succède.
► 451 MÉROVÉE (451-456)
► 451 Les Huns, conduits par Attila, envahissent la Gaule, et se répandent jusque dans la région de Lutèce, dont ils s'éloignent devant l'attitude résolue de ses habitants, encouragés par sainte Geneviève. Peu après ils sont battus près de Châlons-sur-Marne par les forces réunies du général romain Aetius et des chefs francs, Mérovée et Théodoric.
Attila vaincu, passe avec ses hordes en Italie. Alors qu'Attila menace la ville, Sainte Geneviève exhorte les Parisiens à ne pas quitter la ville et à résister aux Huns. Ceux-ci, aidés par les fortifications de la ville, résistent et font de la religieuse la patronne de la ville. Ses prières auraient contribuée à repousser les Huns. Sainte Geneviève est aussi responsable de l'érection de la première église abbatiale de Saint-Denis, sur le lieu supposé du tombeau du premier évêque de Paris.
Sainte Geneviève, de père franc et de mère gallo-romaine, elle se voue très jeune à Dieu et est très vite remarquée par saint Germain d'Auxerre et saint Loup de Troyes, qui passent par Nanterre en 429, à l'occasion de leur voyage vers la Grande-Bretagne. Elle mène une vie consacrée et ascétique, probablement dès ses seize ans. Selon la tradition, en 451, grâce à sa force de caractère, Geneviève convainc les habitants de Paris de ne pas abandonner leur cité aux Huns et elle détourne la colère d'Attila par ses prières, et accessoirement grâce aux solides murailles de la cité.
Une autre hypothèse à ce sujet prétend qu'elle aurait averti l'envahisseur d'une épidémie de choléra sévissant dans la région. Enfin, par ses liens avec les Francs, intégrés au dispositif romain, elle aurait pu savoir qu'Attila voulait s'attaquer d'abord aux Wisigoths en Aquitaine, et ne voulait sans doute pas perdre du temps devant Paris.
► 451 Invasion de la Gaule par Attila. Bataille dite des "Champs catalauni-ques" remportée par Aetius sur Attila. Les Huns d'Attila sont battus aux champs Catalauniques près de Troyes par une armée romano-barbare. C'est le premier échec militaire d'Attila, surnommé "le Fléau de Dieu". L'Empire des Huns s'étend de la Hongrie à l'Ukraine et de la Pologne à la Serbie. Vêtus de peaux de martres, les joues tailladées pour empêcher la barbe de pousser, ses guerriers sèment la terreur dans toute l'Europe.
La défaite en Gaule, n'abattra pas la puissance d'Attila : c'est sa mort, en 453, qui provoquera la désagrégation de son Empire. La bataille des champs Catalauniques, en 451 après J.-C., rassembla les forces coalisées composées de Gallo-romains et de peuples fédérés menées par le patrice Aetius, contre les troupes de Huns emmenées par Attila. Elle fut appelée ainsi parce que les chroniqueurs grecs un siècle plus tard situaient le lieu de cette bataille aux environs de Châlons-en-Champagne (Duro Catalaunum à l'époque gallo-romaine).
Aujourd'hui encore, à proximité de "la Grande Romanie", antique voie romaine entre Reims et Toul, reconvertie en chemin départemental rectiligne, on peut rencontrer un terrain bordé de fossés (vestiges d'un antique relais militaire romain ou d'une enceinte celte ?) appelé "le camp d'Attila". Aetius eut l'occasion, comme otage dans sa jeunesse, de côtoyer le peuple Hun et avait à plusieurs reprises enrôlé des Huns comme troupes auxiliaires.
Il est dès lors vraisemblable que cette bonne connaissance des us et coutumes, notamment militaires, du peuple nomade lui servit utilement dans le commandement de la bataille. La victoire romaine permit, très temporairement, de maintenir la présence de l'Empire et interdit toute implantation des Huns en Gaule. Elle y conforta, en revanche, la présence des peuples barbares fédérés. La bataille des Champs Catalauniques marque l'avancée occidentale extrême des Huns établis en Pannonie (actuelles les plaines hongroises).
► 451 - 8 octobre : Ouverture du concile de Chalcédoine où siègent des représentants du pape. Le concile proclame qu'il existe deux natures en Jésus-Christ ; une nature divine et une nature humaine, qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. La doctrine monophysite est condamnée. Les patriarches de Rome et de Constantinople sont placés à égalité, interdiction de la simonie, reconnaissance du monachisme… Le patriarche d'Alexandrie Dioscore est déposé et exilé. Sa condamnation attise les luttes religieuses et oppose les monophysites d'Alexandrie, d'antioche et d'aksoum aux Grecs orthodoxes de Constantinople, appelés les melkites (de melk :roi).
Le concile de Chalcédoine est le quatrième concile oecuménique et a eu lieu dans l'église Sainte-Euphémie de la ville éponyme en 451. Convoqué par l'empereur byzantin Marcien et son épouse l'impératrice Pulchérie il réunit à partir du 8 octobre 451 entre cinq et six cents évêques. Dans la continuité des conciles précédents, il s'intéresse à divers problèmes christologiques et condamne en particulier le monophysisme d'Eutychès et Dioscore sur la base de la lettre du pape Léon Ier intitulé Tome à Flavien de Constantinople (nom du patriarche de Constantinople, destinataire de la lettre du pape).
C'est durant ce concile qu'est redéfinie la notion de personne : a) comme le principe de différenciation relationnelle au sein du mystère d'un Dieu à la fois un et trine, b) comme le principe d'unité et d'identité, dans le cas des deux natures, dans la personne unique du Christ. Cependant le pape saint Léon Ier le Grand refuse d'accepter le 28e canon du concile, qui en attribuant à la ville de Constantinople le titre de "Nouvelle Rome", remet en question la primauté du siège apostolique de Rome.
► 452 juillet Trêve entre Valentinien III et Attila qui quitte l'Italie en contrepartie d'un tribut annuel. Le pape Léon Ier supplie le roi des Huns et ses troupes de renoncer à envahir Rome. Attila, qui a déjà ravagé la Gaule mais a subi une terrible défaite aux champs calauniques (Champagne) en juin, accepte et retourne dans ses steppes. Il mourra peu après sur les bords du Danube et l'empire des Huns s'évanouira.
Léon Ier, Saint Léon Ier le Grand, pape de 440 à 461, et docteur de l'Église. Ses origines sont mal connues. Né en Toscane ou à Rome entre 390 et 400, fils d'un dénommé Quintianus, il est archidiacre de Rome sous le pontificat de Célestin Ier (422/432) puis de Sixte III (432/440) dont il est l'homme de confiance. À la mort de ce dernier, le 19 août 440, Léon est en Gaule à la demande de la cour de Ravenne afin d'arbitrer un conflit entre le patrice Aetius et le préfet du prétoire Albinus. Sa réputation et son influence sont si grandes qu'il est élu par le peuple romain pendant son absence en Gaule. Il rentre à Rome en septembre pour être sacré le 29 septembre. Il eut pour conseiller saint Pierre Chrysologue.
► 453 mort d'Attila en Hongrie.
► 454 - 21 septembre Assassinat d'Aetius par Valentinien III à Rome.
► 455 - 16 mars Assassinat de Valentinien III par des officiers d'Aetius.
► 455 PÉTRONE MAXIME (455) (Flavius Anicius Petronius Maximus)
► 455 Petronius Anicius Maximius dit Pétrone Maxime (né en ?, mort en 455). Empereur romain d'occident en 455. Sénateur très en vue de l'Empire, il se révolte contre Valentinien III qui a violé sa femme, le fait assassiner et se fait proclamer Empereur par ses partisans. Pétrone Maxime sera massacré par la foule, le 2 juin 455, lorsqu'il tenta de s'échapper de Rome envahie par les Vandales de Genséric.
► 455 - 7 mars Pétrone Maxime est nommé empereur par l'aristocratie italienne.
► 455 Pétrone Maxime nomme Avitus maître de la milice des Gaules.
► 455 Pétrone Maxime épouse la veuve de Valentinien III.
► 455 - 31 mai Pétrone Maxime meurt au cours de violentes révoltes à Rome.
► 455 - 2 juin Genséric s'empare de Rome et la pille (jusqu'au 16). Les Vandales et leur chef Genséric débarquent à Rome et pillent la ville, sans massacre ni incendie, selon l'accord passé avec le pape Léon Ier. Mais ils emportent avec eux un énorme butin et des milliers de prisonniers. Les invasions barbares provoqueront la chute de l'Empire romain d'Occident. Genséric conquerra les îles de la Méditerranée occidentale et l'Afrique du Nord, puis établira sa capitale à Carthage. Il fondera ainsi un véritable empire, que ses descendants ne sauront pas conserver.
► 455 AVITUS (455 à 456) (Marcus Maecilius Flavius Eparchius Avitus)
►455 Eparchius Avitus était un noble gaulois d'Auvergne qui devint empereur romain d'Occident (455 - 456). Avitus avait été préfet du prétoire des Gaules et avait en 439, conclu une paix avec les Wisigoths. Par ses bonnes relations à la cour wisigothique il avait aidé à la coalition autour d'Aetius contre Attila. Établi maître de la milice (Magister militum) par l'empereur Pétrone Maxime, il fut envoyé en mission diplomatique auprès de son ancien élève, Théodoric II, roi des Wisigoths et se trouvait à Toulouse lorsque Genséric envahit Rome, mettant fin au règne de Pétrone Maxime.
Théodoric profita de l'occasion pour lui proposer la pourpre qu'il accepta après l'accord d'une réunion de sénateurs gallo-romains. Le 9 juillet 455, à Arles, il était proclamé empereur et entrait à Rome en septembre. Les Italiens ne le reconnurent pas réellement et lorsque sa campagne contre les Vandales échoua et qu'ils firent le blocus de Rome, sa situation devint difficile. Les difficultés financières l'amenèrent à renvoyer ses gardes du corps goths ; pour payer leur départ il dut même faire fondre des statues de bronze pour frapper de la monnaie.
Ricimer, qu'il avait amené au pouvoir, et Majorien, profitèrent de ces difficultés pour fomenter un coup d'État. Avitus parvint à se réfugier à Arles. Ses appels à l'aide à Théodoric ne reçurent aucune réponse, celui-ci étant en Espagne à affronter les Suèves. Il rassembla les forces qu'il parvint à réunir et retourna en Italie. Il fut défait à la bataille de Placientia (Plaisance).
Capturé il fut épargné et autorisé à devenir évêque de Piacenza le 17 ou 18 octobre 456. Craignant toujours pour sa vie il chercha refuge en Gaule mais périt en route. Sa fille, Papianelle, épousa Sidoine Appolinaire, issu d'une famille sénatoriale du Lyonnais, qui fut préfet urbain sous Anthémius et plus tard évêque d'Auvergne. Les poèmes et lettres de ce dernier sont les principales sources sur le règne d'Avitus. Le fils d'Avitus, Ecdicius, devint une personnalité politique en Gaule - préfet des Gaules - et en Italie plusieurs décennies plus tard.
► 455 juillet Avitus est nommé empereur par la noblesse gauloise et Théodoric II à Toulouse. Théodoric II est roi des Wisigoths, fils du roi Théodoric Ier et frère et successeur du roi Thorismond, après l'avoir fait assassiner, en 453. Il porte les frontières du royaume wisigothique presque jusqu'à la Loire (il avait vaincu le roi des Suèves, Réchiaire) et commence la conquête de l'Espagne, terminée par son frère et successeur Euric. Il meurt égorgé par ce-dernier, en 466, qui lui reprochait d'être trop romanisé. Il a aussi élevé Avitus sur le trône d'Occident et obtenu la Narbonnaise de Ricimer après avoir combattu Majorien.
► 455 - 9 juillet Avitus reçoit les insignes impériaux à Arles.
► 456 Victoire de Ricimer (général romain) contre la flotte vandale au large de la Corse.
► 456 septembre Majorien et Ricimer maître de la milice, lancent un coup d'état contre Avitus. Majorien, empereur d'occident de 457 à 461. Ricimer, fils d'un Suève, Ricimer est par sa mère petit-fils du roi Wisigoth Wallia. Il commande les forces armées d'Italie, une victoire en Corse sur une flotte vandale le rend populaire. De 456 à 472, date de sa mort, sa carrière comme patrice illustre l'impasse de la politique de germanisation totale des armées romaines : pendant 16 ans il contrôle ce qui reste d'empire en Occident, mais son origine barbare lui interdit l'accession au titre impérial et l'oppose aux autres barbares Goths et Burgondes.
Et son opportunisme pour maintenir son pouvoir l'amène à faire et défaire les empereurs. Il soutien l'ascension de Majorien en 456, se brouille avec lui en 461. Il impose Libius Severus en 461, et profite à sa mort en 465 d'un interrègne de deux ans en attendant l'arrivée Anthémius, nommé par l'empereur d'Orient. Anthémius reconnait l'importance de Ricimer en lui donnant sa fille en mariage. En 472, Ricimer proclame Olybrius contre Anthémius, assiège Anthémius dans Rome et le tue. Ricimer décéde peu après, de mort naturelle, ayant totalement dévalué le titre impérial.
► 456 - 17 octobre Avitus battu à Plaisance est déposé par Ricimer, maître de la milice. Plaisance, est une ville d'Italie.
► 456 Exécution d'Avitus après s'être échappée.
► 456 Mort de Mérovée, son fils Childéric lui succède. Childéric Ier (vers 436 - 481, Tournai), roi des Francs Saliens en 456. Certainement le fils de Mérovée, il épousa Basine de Thuringe et eut pour fils Clovis.
► 456 CHILDÉRIC Ier (456-481)
► 456 Childéric Ier. Les origines de Childéric ne sont pas certaines on le suppose fils de Mérové (Mére-wig, guerrier de la mer) et peut être petit fils de Chlodion (Clodion le chevelu) tous deux chefs des Francs ou tout au moins de tribus franques. Roi des Francs Saliens, il mène son peuple jusqu'à la Somme et la Loire. Il contribue à protéger Angers des pirates anglo-saxons. Il collabore fréquemment avec Aegidius, lieutenant d'Aetius (général romain) puis avec Syagrius (fils d'Aegidius mort en 464). Bien que païen, il montre une grande bienveillance à l'égard des évêques ce qui montrera le chemin à son fils Clovis Ier. Il donne sa soeur en mariage au roi Wisigoth.
► 456 Avènement de Childéric Ier.
► 456 Childéric Ier succède à Mérovée en qualité de chef ou roi des Francs; ses compagnons l'exilent en Thuringe à cause de ses débauches, et offrent le pouvoir au général romain Aegidius, envoyé par Rome comme maître de milice, mais ils ne tardent pas à se lasser d'obéir à un étranger, et ils rappellent leur roi. Il eut pour épouse Basine. La Thuringe au centre de l'Allemagne.
► 456 Léon Ier empereur d'Orient se considère comme empereur d'Occident. Léon Ier, dit "le grand" est empereur d'Orient de 457 à 474. Son règne est dominé par ses interventions, souvent malheureuses, dans les affaires de l'empire romain d'Occident, dont il se proclame souverain en 461. Il impose en 467 Anthémius sur le trône d'Occident mais celui-ci est tué en 472 par Ricimer.
► 456 Révoltes en Auvergne et en Narbonnaise suite à la mort d'Avitus.
► 456 MAJORIEN (456 à 461) (Julius Valerius Maiorianus)
► 457 - 27 février Léon Ier empereur d'Orient fait Ricimier patrice et Majorien maître de la milice.
► 457 - 1er avril Les armées proclament Majorien empereur d'Occident près de Ravenne.
► 457 - 28 décembre Majorien prend le titre d'Auguste.
► 457 Aegidius restaure l'autorité de l'empire en Gaule. Aegidius, général romain.
► 458 Installation des Burgondes près de Lyon.
► 461 - 2 août Majorien est capturé à Tortone par Ricimier.
► 461 - 7 août Ricimer fait exécuter Majorien.
► 461 SÉVÈRE III (461 à 465) (Libius Severus)
► 461 Libius Severus Nommé empereur en novembre 461 par le patrice Ricimer, il n'est pas reconnu par l'empereur d'Orient, ni par les romains de Dalmatie ou de Gaule, qui font presque sécession. Tout le pouvoir est exercé par Ricimer. Il meurt en novembre 465, après un règne si inexistant que aucun successeur immédiat ne lui est nommé.
► 461 - 19 novembre Ricmier porte Libius Sévère à la tête de l'Empire.
► 461 Théodoric II, roi des Wisigoths s'empare de Narbonne.
► 465 Naissance de Clovis, fils de Childéric Ier. Clovis fut roi des Francs de 481 à 511 et considéré anachroniquement comme le premier roi catholique officiel de France.
► 465 - 14 novembre Mort de Sévère III à Rome probablement empoisonné.
► 465 ANTHÉMIUS (465 à 472) (Procopius Athemius)
► 465 Procopius Anthémius (420 - 11 juillet 472) était un empereur romain d'Occident du 12 avril 467 au 11 juillet 472. C'est l'un des "empereurs d'ombre" du Ve siècle, il était certainement le dernier ayant les capacités nécessaires pour ce poste. Anthémius essaya de résoudre les deux défis militaires principaux, faisant face aux restes de l'Empire romain d'Occident: l'expension des Wisigoths d'Euric, dont le domaine s'étend de part et d'autre des Pyrénées; et les Vandales de Genséric, qui contrôlent l'Afrique du Nord.
Anthémius est d'une famille illustre : il descendrait de Procope, cousin de l'empereur Julien. Plus sûrement, son grand-père fut préfet du prétoire entre 408 et 414 et son père général sous Théodose II, et Anthémius a épousé Aelia Marcia Euphemia, fille de l'empereur d'Orient Marcien. Anthémius est général de l'empereur d'Orient Léon Ier et mène campagne en 466-467 en Pannonie contre les Ostrogoths. A cette date, la place d'empereur d'Occident était vacante, et l'Italie dirigée par le patrice Ricimer en lutte contre les Vandales.
Léon Ier profita des circonstances et tenta de récupérer l'Italie en accordant le titre de César à Anthémius, qui dirigea son armée vers l'Italie. A son passage, le gouverneur de Dalmatie Marcellinus, devenu quasi indépendant de Ravenne, lui fit allégeance. A son arrivée en Italie, Anthémius est acclamé empereur par ses troupes le 12 avril 467 et s'allie avec Ricimer en lui donnant sa fille Alypia en mariage. Anthémius reçu également en Gaule l'appui de Riothamus et de son armée de Bretons dans une alliance contre Euric.
Cependant, Euric pu vaincre non seulement l'armée de Riothamus et les forces romaines dans le Berry, mais aussi annexer des villes gauloises qui étaient restées romaines. En 468, une campagne contre les Vandales de Genséric est entamée coordonnant une flotte venue d'Orient dirigée par Basiliscus et les troupes d'Occident. La campagne contre Genséric se termina en fiasco, le général Marcellinus fut assassiné en Sicile.
En 470, à la suite de toutes ces malchances, Anthémius tomba gravement malade. A ces échecs, s'ajoutent les conflits de tempérament entre le colérique Anthémius, traité de "sale gre" et l'ambitieux Ricimer, traité de "Gète vêtu de fourrure", ainsi que l'impopularité d'Anthémius auprès des milieux romains, qui l'accusaient de sympathie païenne.
Le chef de l'armée, Ricimer, perdit patience, appelant 6000 hommes qui avaient été enrôlés pour la guerre contre les Vandales, et commença une opposition armée à partir de Milan contre Anthémius qui se trouvait à Rome. Ricimer proclama un empereur concurrent Olybrius. Ce conflit finit cinq mois plus tard par la conquête de Rome par Ricimer en juillet 472 après deux mois de siège, la capture d'Anthémius déguisé en mendiant, puis son exécution.
► 467 Anthémius, fils de Procope est nommé César par Léon Ier Empereur d'Orient.
► 467 - 21 avril Anthémius est proclamé empereur par ses troupes.
► 467 novembre-décembre Mariage de Alypia, fille d'Anthémius avec Ricimer.
► 468 août Les armées d'Anthémius et Léon partent en Afrique pour com-battre Genséric.
► 468 La flotte des empereurs est détruite au promontoire de Mercure.
► 468 Les armées romaines quittent l'Afrique.
► 470 Ricimer en désaccord avec Anthémius quitte Rome pour Milan.
► 471 Défaite de l'armée d'Anthémius par Euric. Euric (415 - 484), frère et successeur de Théodoric II, fut roi des Wisigoths, de 466 à 484. Il fit de Toulouse sa capitale. C'est sous son règne que le royaume wisigoth connut sa plus grande extension, incluant la péninsule ibérique après sa victoire sur les Suèves ainsi que le sud de la Gaule après la prise d'Arles en 476 (ou 480). Auteur du code d'Euric, première codification de la loi wisigothe, il décéda de mort naturelle à Arles en 484. Son fils Alaric II lui succéda.
► 472 avril Ricimer nomme Olybrius, époux de Galla Placida la jeune fille de Valentinien III. Olybrius, empereur romain d'Orient en 472
► 472 Ricimer assiège Anthémius à Rome.
► 472 Prise de Rome après 2 mois de siège.
► 472 - 11 juillet Capture et exécution d'Anthémius.
► 472 OLYBRIUS (472) (Anicius Olybrius)
► 472 Anicius Olybrius Descendant d'une riche famille sénatoriale, Olybrius épouse Galla Placidia la jeune, fille de l'empereur Valentinien III. En 455, lors du second sac de Rome par les Vandales, Olybrius est emmené par Genséric comme otage avec la veuve de Valentinien III et ses deux filles. Cette captivité ne fut probablement pas très pénible, car Genséric sut apprécier les qualités d'Olybrius, au point qu'il le libéra en 462. Olybrius et son épouse s'installèrent à Constantinople.
En 465, à la mort de l'empereur d'Occident Libius Severus, Genséric et l'empereur d'Orient Léon Ier envisagent de le nommer empereur ; finalement Léon Ier lui préféra son général Anthémius. En 472, le patrice Ricimer entre en conflit ouvert avec l'empereur Anthémius. Contre lui, il appelle Olybrius, qui bénéficie d'une certaine légitimité comme ancien gendre de Valentinien III, et dispose de l'appui de la classe sénatoriale et du roi des Vandales Genséric.
Olybrius débarque en Italie et est proclamé empereur devant Rome assiégée en avril 472. Mais une fois liquidé Anthémius, Ricimer, qui commandait l'armée d'Italie, décède en août 472. Olybrius le remplace par son neveu, le jeune prince burgonde Gondebaud, avec le titre de patrice. Ce choix pouvait apporter à Olybrius le soutien supplémentaire des Burgondes.
Cependant le pouvoir d'Olybrius ne dépasse pas l'Italie, et l'empereur d'Orient Léon Ier ne le reconnaît pas, puisqu'il a détroné son protégé Anthémius. Mais Olybrius n'a pas le temps de régner: il décède à son tour en novembre 472, de mort naturelle. Gondebaud reste seul maître d'Italie, mais son origine barbare lui interdit le titre impérial. Il attendra quatre mois avant de trouver le successeur d'Olybrius: ce sera Glycérius.
► 472 Ricimer nomme Olybrius empereur d'Occident.
► 472 19 août Ricimer meurt d'une hémorragie.
► 472 - 2 novembre Mort d'Olybrius.
► 472 GLYCÉRIUS (472 à 474) (Flavius Glycerius)
► 472 Flavius Glycérius (? - 480) (empereur de mars 473 à juin 474): chef de la garde personnelle de Gondebaud, il fut proclamé empereur à Ravenne par celui-ci. Lorsqu'un groupe d'Ostrogoths pénétra en Italie, Glycérius n'avait aucune force à leur opposer. Il les paya pour qu'ils partent en Gaule, où ils se mêlèrent aux Wisigoths. L'empereur byzantin Léon Ier refusa cependant de le reconnaître et nomma à son tour Julius Nepos, qui débarqua en début 474 à Ravenne avec une petite armée.
Glycérius prit la fuite vers Rome, mais le Sénat Romain refusa de le soutenir et lui ferma les portes de la ville. Lorsque Julius Nepos parvint à Rome, Glycérius se rendit sans combattre. Il fut tonsuré et reçut en compensation l'évêché de Salone en Dalmatie, où il mourut en 480. Il est identifié avec l'évêque Glycérius qui commendita l'assassinat de Julius Nepos en 480 près de Salone.
► 473 - 5 mars Glycérius est nommé empereur d'Occident par Gondebaud, neveu de Ricimer. Gondebaud (né avant 460, mort en 516) fut roi des Burgondes (territoire des Alpes à la Loire et du Rhin supérieur à la Provence) de 480 à sa mort.
► 474 Zénon nomme Julius Nepos César et lui ordonne de capturer Glycérius. Zénon Ier est un empereur d'Orient, né vers 430 à Rosoumblada dans le sud est de l'Asie Mineure, qui gouverne l'empire de 474 à 491.
► 474 Arrivée des troupes de Zénon pour lutter contre Glycérius.
► 474 Glycérius quitte Ravenne en direction de Rome qui lui refuse l'entrée.
► 474 Capture de Glycérius à Porto, Julius Nepos le nomme évêque de Salonne.
► 474 JULIUS NEPOS (474 à 475) (Flavius Julius Nepos)
► 474 Flavius Julius Nepos (450 - 480) (empereur de juin 474 à août 475) fils de Nepotianus et neveu par alliance de l'impératrice Aelia Verina, épouse de Léon Ier l'empereur d'Orient. Nepos gouverne la Dalmatie à Salone, lorsque en 476 l'empereur d'Orient Zénon le nomme César avec mission de renverser Glycérius, considéré comme illégitime par Zénon. Nepos débarque à Ravenne, poursuit et capture Glycérius au voisinage de Rome.
Comme le font souvent les soldats menés au succès, son armée le proclame Empereur d'Occident le 24 juin 474. Mais Nepos manque d'appui en Occident, et est mal vu des Romains qui n'apprécient pas ce grec étranger. En Gaule, Euric, roi des Wisigoths poursuit son expansion par la conquête de l'Auvergne. En 475, Nepos doit conclure un traité par lequel il reconnaît l'autorité d'Euric sur l'Espagne et sur la Gaule jusqu'au Rhône et à la Loire. Nepos donne ordre à son général Oreste de revenir de Gaule en Italie.
Oreste en profite pour renverser Nepos le 28 août 476. Nepos ne peut attendre aucun secours de Constantinople, en proie aux révolutions de palais de 475 et 476 ; il rembarque précipitamment et retourne en Dalmatie. En 477, après la destitution de Romulus Augustule, Nepos sollicite l'aide de Zénon pour récupérer son trône à Ravenne, mais Zénon aux prises avec les Ostrogoths ne peut rien pour lui. Nepos meurt assassiné le 9 mai 480 près de Salone, à l'instigation de l'évêque Glycérius qui se venge de sa destitution. Julius Nepos est le dernier empereur romain d'occident à avoir été reconnu par l'Empire romain d'Orient.
► 474 - 24 juin Julius Nepos est acclamé empereur par ses troupes.
► 475 Euric s'empare de l'Auvergne.
► 475 Traité de Paix avec Euric lui accordant l'Espagne et une partie de la Gaule.
► 475 - 28 août Oreste renverse Julius Nepos qui s'enfuit. Oreste, malgré son nom grec, était un Hun. Il fut un très proche collaborateur d'Attila (vraisemblablement son secrétaire), et par la suite, il prit la tête des troupes barbares confédérées qui "protégeaient" (en réalité, occupaient) l'Italie. En 475, il déposa l'empereur régnant Julius Nepos et plaça sur le trône son fils, Romulus Augustule. Tout indique en fait qu'il règna effectivement à sa place ; il s'aliéna notamment une partie des troupes qui l'appuyaient jusqu'alors en refusant de céder à leurs exigences de butin. Il fut tué en 476 durant le siège de Pavie, en faisant face à la sécession du chef barbare Odoacre.
► 475 ROMULUS AUGUSTULE (475 à 476)
► 475 Romulus Augustule (461 ? - ???) fut le dernier représentant de l'Empire romain. Fils du chef Hun Oreste, qui fut secrétaire d'Attila puis général au service de l'empereur d'Occident Julius Nepos. En 475, Oreste chassa Nepos, mais au lieu de s'installer sur le trône, il tira probablement la leçon des conflits précédents entre empereurs et chef de l'armée : il plaça son jeune fils sur le trône sous le nom de Romulus Augustus, gardant le contrôle de l'armée et donc le pouvoir réel.
La jeunesse de Romulus (il était adolescent) lui valurent le sobriquet d'Augustulus, "petit Auguste". En 476, un officier de la garde, Odoacre, barbare et fils de l'ex roi des Hérules, réclama pour ses soldats le tiers des terres d'Italie. Oreste refusa, provoquant une révolte. Il s'enferma dans Pavie, puis à Plaisance, où il fut fait prisonnier et décapité le 28 août 476. Odoacre déposa Romulus le 4 septembre 476 et l'envoya en exil au cap Mysène, où il finit ses jours avec une riche pension. Aucun empereur romain ne fut proclamé en Occident après Romulus.
► 475 - 29 octobre Oreste, fait proclamer son fils, Romulus Augustule empereur par ses troupes.
► 475 à 526 - naissance et mort de Boèce. Homme d'État, philosophe, mathématicien. Ce chrétien, helléniste d'éducation, obtint la faveur de Théodoric qui le nomma consul, en 510 et 522; il essaya de créer dans la cour du roi barbare, un centre de culture intellectuelle. Il a laissé des traductions de 'l'Isagoge' de Porphyre, de certaines oeuvres d'Aristote, probablement de 'l'Organon' qu'on perdit et qu'on retrouva seulement au XIIe siècle; il publia des 'Commentaires' sur ces ouvrages, des traités personnels sur le syllogisme et autres sujets logiques et des écrits théologiques. Ayant encouru la disgrâce de Théodoric, il fut jeté en prison où il écrivit son traité célèbre: De consolatione philosophioe dont le titre indique bien le sujet: "Boèce dans son infortune cherche le bonheur; la philosophie le console en lui apprenant où et comment il le trouvera". Boèce fut exécuté entre 524 et 526.
► 476 Odoacre réclame des terres en Italie à Oreste qui refuse. Odoacre (Odovacar), né en Pannonie vers 435, est le fils d'Ederon, chef des Hérules alliés aux Huns et ministre d'Attila. Il est l'auteur principal de la chute finale de l'Empire romain d'Occident en déposant le dernier empereur fantoche d'Occident, Romulus Augustule, et en renvoyant les insignes impériaux à Byzance.
Soutenus par ses Hérules et les mercenaires barbares d'Italie qu'il masse surtout dans le nord du pays, il gouverne la péninsule avec le titre de patrice à partir de l'an 476. A la mort de Julius Nepos en 480, il occupe la Dalmatie mais à partir de 488, il doit lutter contre les Ostrogoths et leurs alliés du roi Théodoric, envoyé par Byzance dans le but de le chasser d'Italie. Il est battu à trois reprises par Théodoric, soutenu par les Wisigoths de son gendre, le roi Alaric II ; à Aquilée en 489, à Vérone, puis sur les bords de l'Adda en 490. Obligé de se replier dans Ravenne, sa capitale, il résiste trois ans alors qu'il est assiégé. Théodoric finit par lui proposer un marché et Odoacre accepte de capituler en mars 493. Quinze jours plus tard, il est assassiné en plein banquet par le roi ostrogoth lui-même.
► 476 - 23 août Odoacre est proclamé roi d'Italie par ses troupes.
►476 août Odoacre s'empare de Pavie; Oreste s'enfuieà Plaisance. Pavie est une commune italienne située sur les rives du Tessin près de son confluent avec le Pô. Plaisance, est une ville italienne, chef-lieu de la province de Plaisance, située sur la rive droite du Pô, en Émilie-Romagne.
► 476 - 28 août Odoacre capture et exécute Oreste à Plaisance.
► 476 - 4 septembre Prise de Ravenne, capture de Romulus Augustule qui abdique. Le 4 septembre 476 est une date symbolique retenue comme la chute de l'Occident romain. Chute de l'Empire romain d'Occident, le roi Odoacre, chef germain des Hérules, occupe Rome mettant fin à l'Empire romain d'Occident. Il dépose le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule, qui est exilé en Campanie, et renvoie les insignes impériaux à Byzance, pour que Zénon le reconnaisse comme patrice.
Zénon le renvoie à l'empereur légitime d'Occident, Julius Nepos, alors réfugié en Dalmatie. Odoacre refuse et les choses en restent là. En apparence, Odoacre gouverne au nom du seul empereur, celui d'Orient. En fait, l'Empire d'Occident a cessé d'exister. Fin de la Pax romana. L'empire romain se disloque. Les hordes barbares fondent sur l'empire. Trois siècles de carnages vont suivre. L'armée d'Italie est depuis longtemps composée de Barbares (Rugiens, Hérules, Skires, Turcilinges).
Ils demandent, par extension à l'Italie du système de la tercia, le tiers des terres de la péninsule, à l'exemple des autres provinces. Le patrice Oreste refuse. La révolte, attisée par Odoacre, un Skire chef de l'armée romaine d'Italie, éclate. Oreste s'enferme dans Pavie, qui est prise. Il s'enfuit à Plaisance. Découvert, il a la tête tranchée. Odoacre respecte les traditions romaines, maintient la vie politique dans le cadre des coutumes italiennes et recherche l'appui de la classe sénatoriale. Bien qu'arien, il conserve de bonnes relations avec le clergé catholique. Odoacre, prince de la dynastie torcilingue [ou turcilinge ?!?], est le fils du roi skire Edika, ancien vassal d'Attila.
► 476 Un chef Hérule, Odoacre, s'empare de Rome, et dépose le dernier empereur, Romulus Augustule. Cet événement met fin à l'empire romain d'Occident (dont la Gaule était une province). Cependant l'autorité romaine continuera quelques années encore à s'exercer dans quelques parties de la Gaule.
► 476 Odoacre, qui s'est emparé de Rome, dépose le dernier empereur Romulus Augustule et renvoie les insignes du pouvoir à Byzance. Six siècles de domination sur la Gaule s'achèvent. Les royaumes barbares qui se mettent en place, avec les Francs au nord, les Burgondes le long de la Saône et du Rhône, les Wisigoths au sud, renversent les hiérarchies que la paix romaine avait établies. "Maintenant, en effet, qu'ont été abolis les degrés des dignités grâce auxquelles on avait l'habitude de distinguer les grands des humbles, le seul signe de noblesse sera désormais la connaissance des lettres", écrit en ces temps l'évêque de Clermont Sidoine Apollinaire à l'un de ses amis.
► 476 Fin de l'Empire romain d'Occident.
► 476 Conventionnellement, ici finit l'Antiquité et commence le Moyen Âge. En fait, la Romanité ne connaît pas de discontinuité dans la partie orientale de l'Empire. Seul l'Empire romain d'occident a disparu, remplacé par des royaumes barbares qui disparaîtront à leur tour. Des siècles de guerres vont suivre, avant que se dégagent de nouvelles forces : royaumes francs, sédentarisation des peuples germaniques et territoires islamiques (en Occident, voir Al-Andalus; pour la province d'Afrique : Ifriqiya). L'unité du monde romain, la Pax Romana deviennent des mythes qui inspireront longtemps le monde occidental, attendant que survienne une forme de résurgence. La date symbolique de 476 a eut un retentissement considérable pour la civilisation occidentale qui se réclame de la culture latine.
Les voyages de l'Air du TEMPS - EUROPE
| PAYS | VILLES |
| ALLEMAGNE |
Berlin |
|
Bonn |
|
| Dresden (Sachsen) | |
| Frankfurt | |
| Höst (Nordrhein-Westfalen) | |
| Götingen (Berlin) | |
| Hamburg | |
| Nurember (Bayern) | |
31 - De 476 à 530
► 476 MOYEN ÂGE
► 476 Le Moyen Âge occidental est la période de l'Histoire située entre l'Antiquité et la Renaissance. Traditionnellement, on fait commencer le Moyen Âge en 476, à la déposition du dernier empereur romain d'Occident par un chef barbare et il s'achève en 1453, avec la prise de Constantinople et la chute de l'Empire romain d'Orient, ou en 1492, date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et de la fin de la Reconquista en Espagne. Le Moyen Âge est traditionnellement subdivisé entre Haut Moyen Âge et Bas Moyen Âge.
► 476 Le début du Moyen Âge est marqué par des guerres civiles entre les 4 principales tribus barbares présentes en Gaule qui tentent chacune d'étendre leur territoire : les francs dans l'actuelle Belgique, les wisigoths en Aquitaine, les burgondes dans l'actuelle Bourgogne, les alamans dans l'actuelle Alsace, Suisse et sud de l'Allemagne.
A la mort de son père, Clovis, roi des francs, hérite d'un modeste territoire en Belgique. Son baptême à la religion catholique va lui permettre d'être accepté par les gallo-romains et il va progressivement étendre son territoire aux détriments des autres tribus franques, des derniers romains, des Alamans et des Wisigoths. Avec Clovis, fondateur de la 1ère monarchie française, la Gaule devient mérovingienne et tous les habitants du royaume deviennent "Francs" : la Gaule devient le "regnum francorum", ancêtre de la France.
A sa mort, ses fils continuent l'extension de son royaume mais des guerres civiles dues au partage des richesses entre les héritiers vont affaiblir la dynastie. Le roi Dagobert réalisera en 632 la dernière unification de la dynastie des Mérovingiens : la population reconquiert des terres abandonnées, peuple de nouvelles villes et surtout bénéficie de la croissance générée par l'ouverture de nouveaux marchés (mer du nord et monde oriental).
A la fin du règne de Dagobert, le pouvoir est progressivement contrôlé par de riches familles aristocratiques franques qui, via leur rôle de "Maire du Palais" (sorte de 1er Ministre), vont tenir les rênes de l'état. Les rois mérovingiens perdent donc le pouvoir et sont qualifiés de "rois fainéants". Pépin le Bref, Maire du Palais d'Austrasie et de Neustrie, va ainsi déposer sous le couvert de la papauté le dernier roi mérovingien en 751 : il deviendra ainsi le 1er roi de la dynastie des Carolingiens.
► 476 Le Moyen Âge occidental est l'époque de l'Histoire située entre l'Antiquité et l'Époque moderne, donc grossièrement entre 500 et 1500 après Jésus Christ. Elle s'étend donc sur une période de 1000 ans. Traditionnellement, on fait commencer le Moyen Âge à la déposition du dernier empereur romain d'Occident Romulus Augustule (* vers 460 – † après 511) par Odoacre en 476. Cependant, beaucoup d'historiens contemporains font perdurer l'Antiquité au-delà de cette date traditionnelle.
Il est à noter que tout événement unique ne peut jouer qu'un rôle symbolique dans un changement d'époque, qui en fait est un processus. Certains historiens retiennent aujourd'hui la mort de Clovis Ier au 27 novembre 511 comme date conventionnelle de la fin de l'Antiquité, d'autres retiennent la date de son baptême, soit le 25 décembre 496, par l'évêque de Reims, Saint Rémi. Ainsi, ils font commencer le Moyen Âge symboliquement avec la mort de Sainte Geneviève le 3 janvier 512.
La fin du Moyen Âge est généralement située vers 1500 ; plusieurs dates symboliques ont été proposées par les historiens : 1492 qui marque la fin de la Reconquista espagnole, avec le 2 janvier la reprise de Grenade) qui voit Christophe Colomb débarquer en Amérique le 12 octobre, et la France et l'Angleterre signer le traité d'Étaples – qui prépara les Guerres d'Italie menées par la France – le 3 novembre ; 1453, au cours de laquelle Constantinople, l'ancienne Byzance, capitale de l'Empire Romain d'Orient, tombe aux mains des Ottomans, et qui voit la fin de la guerre de cent ans, avec la victoire française sur l'Angleterre (bataille de Castillon).
En histoire de France, on utilise souvent 1483, date de la mort de Louis XI. Vers 1440 a lieu l'invention des caractères mobiles de Gutenberg et vers 1450, la mise au point de la première presse. En 1517 a lieu le début de la réforme du protestantisme conduite par l'allemand Martin Luther (elle sera reprise plus tard par le français Jean Calvin). Plus généralement, les grandes découvertes marquent le début de ce qu'on peut déjà appeler la mondialisation (accroissement des échanges entre différents pays distants, permis par de nouvelles inventions et découvertes…). Les limites exactes du Moyen Âge font encore l'objet de débats entre historiens.
► 476 La philosophie médiévale est la philosophie qui s'est développée dans l'Occident chrétien (Europe de l'ouest actuelle) pendant le Moyen Âge. Le Moyen Âge, qui s'étend de la chute de l'empire romain à la Renaissance, est aussi appelé période médiévale. Les lettrés du Moyen Âge ont posé les fondements intellectuels de la chrétienté (l'occident en particulier), soit par l'héritage direct des auteurs latins, soit par des échanges avec la civilisation islamique, qui ont permis la transmission des oeuvres d'Aristote. La culpabilisation des hébreux par le christianisme médiéval entraîne une mise à l'écart de la pensée de la philosophie juive, stigmatisée par une angoisse de la Cabale. L'occident développe donc sa pensée propre.
► 476 Science du Moyen Âge, dans le haut Moyen Âge, les sciences se structurent autour des arts libéraux, dont la partie scientifique est constitués par le quadrivium, défini par Boèce au VIe siècle. Bède le Vénérable le reprit (avec le comput), puis Alcuin, principal conseiller de Charlemagne, l'introduisit dans les écoles de l'empire carolingien. Après les invasions viking, arabes, et hongroises, l'occident médiéval (latin) s'approprie ensuite l'héritage grec et arabe.
Vers l'an mil, Gerbert d'Aurillac (qui deviendra le pape Sylvestre II) rapporte d'Espagne le système décimal avec son zéro et réintroduit le quadrivium dans les écoles d'occident. Au XIIe siècle, de 1120 à 1190 environ, un travail systématique de traduction des oeuvres des scientifiques et philosophes grecs et arabes est effectué à Tolède et dans quatre villes en Italie (Rome, Pise, Venise, Palerme, voir par exemple Al Idrisi dans cette dernière ville), s'appuyant aussi sur les écrits philosophiques grecs (Platon, Aristote), eux aussi transmis par les arabo-musulmans (sauf Platon qui n'avait pas été perdu).
La diffusion progressive de ces connaissances au XIIe siècle dans tout l'occident aboutit à leur intégration par Albert le Grand dans les universités alors en création : Bologne, Paris (Sorbonne), Oxford, Salamanque, etc.), avec les disciplines du droit. Au XIIIe siècle, la théologie de Thomas d'Aquin, à l'université de Paris, s'appuie sur les écrits d'Aristote qui vont longtemps faire autorité en matière de méthode scientifique et philosophique (on ne faisait pas vraiment la différence entre ces deux domaines).
Paris acquiert un grand prestige pour son université très réputée, et devient une sorte de capitale de l'occident. On note à cette époque certaines critiques sur les livres de physique d'Aristote (de la part de Roger Bacon notamment), qui cependant ne portent en aucune manière sur la méthode philosophique. La grand peste qui ravage l'occident (1347-1351, qui se répète ensuite par vagues successives) puis la guerre de Cent Ans en France interrompent cette Renaissance, qui néanmoins reprend assez vite en Italie et à Avignon.
Le Moyen Âge tardif annonce déjà, aux XIVe et XVe siècles, la Renaissance, et apporte encore beaucoup de connaissances en géographie et cartographie, disciplines où l'occident avait accumulé un grand retard. Pierre d'Ailly, au tournant des XIVe et XVe siècles écrit l'Imago mundi (1410), qui servira à un certain Christophe Colomb, et Fra Mauro alimente en connaissances cartographiques les premiers navigateurs portugais au milieu du XVe siècle. Ils préparèrent les grandes découvertes par les navigateurs européens de la Renaissance.
► 476 Dès le IIIe siècle, les invasions se multiplient, surtout au Ve, ce qui entraîne la chute de l'Empire Romain ; régions perdues : celles qui correspondent à la Grande Bretagne, à la Yougoslavie, à l'Afrique du Nord. Les conséquences sont importantes sur toute la Romania. Certaines régions se détachent entièrement du latin : soit parce que les parlers antérieurs resurgissent dans les régions mal romanisées : retour du Basque (langue pré-indo-européenne), des parlers celtiques en Armorique (résistance au latin, et arrivée de celtes de Britannia, chassés par des envahisseurs germaniques, les saxons) ; soit parce que les envahisseurs germaniques dominent entièrement certaines régions : à l'Est, les Alamans (invasions Alémaniques), ce qui donnera l'Alsacien ; au Nord (rive gauche du Rhin, région actuellement flamingante), domination du francique (langue des anciens Francs ; et non la francisque, qui est une hache de guerre chez les Francs !).
Dès le IIIe siècle, c'est l'arrivée des Francs, venus de régions allant du Rhin à la Mer du Nord (ils sont peut-être originaires des pays de la Baltique). Après 2 expéditions dévastatrices en Gaule, ils reconnaissent la suzeraineté romaine (après une campagne de l'empereur Maximien), et fournissent aux romains des soldats (mercenaires) et des colons. Ils prennent de plus en plus d'importance à mesure que l'Empire Romain s'affaiblit, à la fois sur le plan militaire et dans l'occupation des terres.
Ils s'installent et s'assimilent, par des mariages, par la sédentarisation terrienne, par l'adoption de la religion chrétienne (en 496, baptême de Clovis) ; ils constituent 20% de la population, et dominent la moitié Nord du pays, au Nord de la Loire. Ils se fondront dans la population gallo-romaine, beaucoup plus nombreuse, qui adoptera leur nom. Au Sud de la Loire, c'est une région romaine depuis longtemps : la Narbonnaise est une province romaine dès 120 avant JC. Cette région est occupée peu de temps par les Wisigoths et les Burgondes, ce qui a peu d'influence sur la langue. => On aboutit ainsi à une évolution divergente entre le Nord et le Sud ; au VIIIe siècle, on obtient : Au Nord de la Loire, un mélange du "latin" (ou plutôt roman) et du francique, ce qui donne la langue d'Oïl (oil = oui).
Le latin n'est plus compris par le peuple. En 813, le Concile de Tours ordonne au clergé de prêcher en langue courante là où c'est nécessaire, car on a constaté que les clercs, formés aux nouvelles études latines, ne se font pas comprendre des fidèles. En 842, les Serments de Strasbourg (prêtés par les fils de Louis le Pieux et leurs armées) sont rédigés en langue courante. On rappellera que Charlemagne, peu avant l'an 800, a fondé l'École du Palais, toute latine (avec l'aide du savant religieux Alcuin, auteur de traités sur le dogme trinitaire) ; on réenseigne en latin aux moines, la langue courante est exclue des écoles pour 1000 ans.
Cette période (environ 750 à 850) est appelée la Renaissance carolingienne. Elle sera suivie d'une période de décadence, avec les secondes invasions, celles des Normands. Après le VIe siècle, la Gaule du Nord est appelée France. [au VIe siècle : néologisme Francia = le pays des Francs = les régions rhénanes ; puis, la France, c'est l'empire de Charlemagne, roi des Francs ; puis, les divers royaumes : Francia Orientalis / Media / Occidentalis ; création du duché de France, entre Seine et Loire > Ile-de-France]. Au Sud de la Loire, c'est la langue d'Oc, proche du latin (Bourgogne, Savoie, Dauphiné).
Au milieu, une zone intermédiaire, où les deux se mélangent, ce qui donne le Franco-Provençal. Francique, historiquement le terme francique désigne la langue des Francs ou des régions peuplées par les Francs. Aujourd'hui, par extension, francique désigne certaines langues ou dialectes germaniques parlés en Allemagne, en France et au Luxembourg. Historiquement les premiers Francs bien avant Charlemagne parlaient une langue rattachée au groupe linguistique dit bas-allemand, groupe d'origines du néerlandais entre autres.
Ce francique-là, bas-allemand, n'avait sans doute pas de forme écrite. En outre, ces Francs ne constituaient pas un peuple bien précis, par conséquent il devait y avoir plusieurs variantes linguistiques. Sous Charlemagne, les Francs s'étaient davantage répandus en Europe et les variantes linguistiques avaient déjà pris le pas sur ce qu'on allait appeler le bas-allemand (Niederdeutsch), le moyen-allemand (Mitteldeutsch) et l'allemand supérieur (Oberdeutsch).
Dans les Serments de Strasbourg, datant de 842, peu après la mort de Charlemagne, le texte en theodisca lingua est rédigé dans un francique rhénan de l'époque, déjà rattaché au moyen-allemand sous-groupe du haut-allemand (Hochdeutsch). Ainsi le francique rhénan était la langue maternelle de Charlemagne, parce que cet empereur Franc avait vécu sur les terres rhénanes, et non parce que depuis l'origine les Francs auraient parlé le francique rhénan. Par conséquent, déjà à l'époque carolingienne, le terme francique est une notion historique qui ne correspond pas à un groupe linguistique germanique unique, ni même à une zone géographique distincte.
► 476 à 1453 - Art Byzantin. L'art byzantin s'est développé dans l'empire romain d'Orient entre 476 et la chute de Constantinople en 1453. Byzance, colonie grecque fondée au VIIe siècle avant J-C, est devenue Constantinople, capitale de l'empire romain d'Orient, en 330, sous le règne de l'empereur Constantin. L'empire byzantin durera plus de mille ans, jusqu'en 1453, année où les turcs donnent l'assaut à Constantinople et tuent le dernier empereur, Constantin XII.
Byzance a transmis à l'Occident sa brillante civilisation, héritage enrichi de l'Antiquité. L'art byzantin a acquis sa spécificité, mélange de caractéristiques grecques et orientales, au VIe siècle. Alors que les édifices romains ne faisaient usage que de droites et d'angles vifs, étant globalement des parallélépipèdes rectangles, les églises byzantines ont été construites tout en rondeur, avec des cercles et des coupoles, préfigurant l'art carolingien puis roman. La mosaïque est devenue une spécificité byzantine.
► 480 à 547 - naissance et mort de Saint Benoît de Nursie. Père des moines. Patron de l'Europe, naquit dans une petite ville des montagnes de l'Ombrie, d'une des plus illustres familles de ce pays. Le Pape saint Grégoire assure que le nom de Benoît lui fut providentiellement donné comme gage des bénédictions célestes dont il devait être comblé. Craignant la contagion du monde, il résolut, à l'âge de quatorze ans, de s'enfuir dans un désert pour s'abandonner entièrement au service de Dieu.
Il parvint au désert de Subiaco, à quarante milles de Rome, sans savoir comment il y subsisterait; mais Dieu y pourvut par le moyen d'un pieux moine nommé Romain, qui se chargea de lui faire parvenir sa frugale provision de chaque jour. Le jeune solitaire excita bientôt par sa vertu la rage de Satan; celui-ci apparut sous la forme d'un merle et l'obséda d'une si terrible tentation de la chair, que Benoît fut un instant porté à abandonner sa retraite; mais, la grâce prenant le dessus, il chassa le démon d'un signe de la Croix et alla se rouler nu sur un buisson d'épines, tout près de sa grotte sauvage.
Le sang qu'il versa affaiblit son corps et guérit son âme pour toujours. Le buisson s'est changé en un rosier qu'on voit encore aujourd'hui: de ce buisson, de ce rosier est sorti l'arbre immense de l'Ordre bénédictin, qui a couvert le monde. Les combats de Benoît n'étaient point finis. Des moines du voisinage l'avaient choisi pour maître malgré lui; bientôt ils cherchèrent à se débarrasser de lui par le poison; le saint bénit la coupe, qui se brisa, à la grande confusion des coupables. Cependant il était dans l'ordre de la Providence que Benoît devînt le Père d'un grand peuple de moines, et il ne put se soustraire à cette mission; de nombreux monastères se fondèrent sous sa direction, se multiplièrent bientôt par toute l'Europe et devinrent une pépinière inépuisable d'évêques, de papes et de saints.
► 481 Mort de Childéric Ier, son fils Clovis lui succède.
► 481 Clovis (fils de Childéric Ier et de Basine) succède à Childéric Ier. - A ce moment, six peuples différents dominent sur la Gaule: les Francs en Belgique (et Nord de la France actuelle), les Alamans entre les Vosges et le Rhin, les Burgondes dans les vallées du Rhône et de la Saône, les Wisigoths entre la Loire et les Pyrénées, les Armoricains en Bretagne, Anjou et Maine; enfin, ce qu'il reste des Romains, dans les vallées de la Marne et de l'Oise.
► 481 CLOVIS Ier (481-511) - Roi des Francs.
► 481 Clovis Ier. Suivant les scribes de l'époque, le prénom Clovis qui dans sa forme moderne est équivalent à Louis peut se lire Chlodovic, Chlodovicus, Chlodovech, Chlodewig. Il épouse en 493 Clotilde nièce du roi des Burgondes Gondebaud. Ce dernier est monté sur le trône après avoir tué l'ancien roi, son frère, le père de Clotilde, il a aussi noyé sa mère et décapité ses deux frères, sa soeur est entrée au couvent et Clotilde s'est réfugiée à Genève.
Gondebaud n'ose pas refuser la main de Clotilde au puissant Clovis, cependant il se méfie de Clovis et de ses ambitions. Clotilde est chrétienne elle fera baptiser ses enfants. Roi des Francs, païen, contrairement aux autres peuplades qui avait épousé l'hérésie Arienne, sa conversion au catholicisme en 496 lui permit d'obtenir l'aide de l'épiscopat. Il détruit le royaume Romain de Syagrius (486) qui avait pour capitale Soisson.
Syagrius vaincu s'enfuit et trouve refuge chez le roi des Wisigoths Alaric II mais ceux-ci craignant Clovis lui livrent Syagrius qui le fait décapiter. Clovis s'empare ainsi de tout le pays entre la Somme et la Loire. Il soumet les Alamans, victoire de Tolbiac (496), réduit les Burgondes, victoire de Dijon (500). Après sa victoire sur les Wisigoths à Vouillé en 507, il étend le royaume des Francs (Saliens et Ripuaires) jusqu'à la Garonne et devient maître de toute la Gaule. Les Wisigoths ne conservent plus que la Septimanie (bande côtière autour du golfe du lion) et doivent se retirer en Espagne où il établissent leur capitale à Barcelone d'abord puis à Tolède.
C'est, l'intervention de Théodoric le grand roi des Ostrogoths qui l'empêchera d'atteindre la Méditerranée. Clovis avait beaucoup de respect pour Théodoric, il nommera son premier fils Thierry, autre forme de Théodoric en son honneur et lui donnera sa soeur en mariage. Son épouse catholique Clotilde l'aurait converti au cours de la bataille contre les Alamans.
A Noël 498 il est baptisé à Reims par Saint Rémi ("Courbe la tête avec humilité, Sicambre; adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré") ainsi que sa soeur Alboflède et 3000 de ses guerriers qui le suivront dans sa démarche. (Les Sicambres sont des peuples germaniques qui se sont fondus dans les Francs au IIIe siècle). Il parviendra à faire l'unité en réunissant Francs Saliens et Ripuaires et en éliminant tous ceux qui pouvaient contester sa suprématie: la famille de Sigibert (Sighebert) chef des Francs de la région de Cologne, Chararic chef salien rival et son fils, Ragnachar chef des Francs de Cambrai ainsi que son frère Righomer etc.
A sa mort, en 511, son royaume considéré à l'époque comme une propriété privée est partagé entre ses 4 fils. La première conversion d'un roi barbare est d'importance pour l'église. La Gaule d'alors est essentiellement païenne et les peuples germaniques ont épousé la religion catholique arienne qualifiée d'hérésie. Qu'un jeune roi conquérant se range sous la bannière de l'église catholique ne peut que l'aider à propager sa doctrine.
Pour Clovis l'opération ne sera pas sans bénéfice, il se fait d'un coup des alliés dans tous les camps, tous les catholiques en terre ennemie sont autant de ses partisans ce qui, sans nul doute, l'aidera dans ses conquêtes futures. Entre 508 et 511 Clovis édicte le "Pactus Legis Salicae" ou loi salique c'est un ensemble de 64 articles de loi qui doivent éviter les vengeances et les vendettas entre familles.
Sainte Geneviève née à Nanterre en 422, sur les conseils de Saint Germain l'Auxerrois se consacra à Dieu, l'histoire dit qu'elle protégea Paris des invasions des Huns par ses prières. Suivant ses conseils, Clovis fit bâtir l'Église Saint Pierre Saint Paul qui s'appellera plus tard Sainte Geneviève (reconstruite, c'est maintenant le Panthéon). Cette Sainte y fut inhumée (3 janvier 513) elle est la patronne de Paris. Clovis sera inhumé sur la Montagne Sainte Geneviève.
► 481 Avènement de Clovis, qui devient roi des Francs.
► 481 reconquête de la ville de Soissons, sous la coupe des Romains de Syagrius.
► 481 La Gaule romaine connaît d'abord une période de prospérité et de stabilité. Mais, dès la fin du siècle des Antonins (192), la vie sociale commence à se disloquer. Cette tendance s'accentue à partir du IIIe siècle avec les incursions des Germains: du IIIe au IVe siècle ils déferlent sur le pays qu'ils se partagent en plusieurs royaumes, wisigoth, burgonde, alaman, franc rhénan et franc salien (tribu franque), tandis que les Gallo-Romains sont cantonnés dans le bassin parisien et la Bretagne.
Menés par Clovis, l'un de ces peuples germaniques, les Francs Saliens, occupe le royaume gallo-romain en 486, bat les Wisigoths en 507 et absorbe le royaume des Burgondes, en 534. Il se produit alors un fait linguistique assez rare: contrairement à ce qui s'est passé lors de la colonisation latine, c'est la langue dominée, le latin, qui demeure la langue officielle. Les raisons de son maintien sont religieuses et peut-être politiques: pour se concilier les évêques dans la lutte qu'il voulait entreprendre contre les Wisigoths, de religion arienne ou par conviction personnelle, Clovis se convertit au christianisme, religion officielle des Romains depuis 312.
Ce faisant, les Francs obtiennent l'appui des Gallo-Romains, mais ils acceptent aussi le latin comme langue religieuse. Des raisons culturelles expliquent aussi l'adoption du latin. La vieille civilisation latine est supérieure à la civilisation dominante et, malgré les troubles de l'époque, elle se maintient encore: dans les royaumes des Burgondes et des Wisigoths, l'administration romaine subsiste; chez les Francs, les Gallo-Romains conservent leurs biens; au IVe et au Ve siècles, malgré les invasions, il y a encore des écoles et des bibliothèques où l'on continue à lire et à étudier en latin.
Ayant adopté la culture et la religion romaine les Francs calquent leur administration sur celle des vaincus et rédigent leurs lois en latin. Pendant une longue période il s'établit dans les zones conquises une sorte de bilinguisme, pour les Francs comme pour certains Gallo-Romains. Les Francs ont transmis une partie de leur lexique à la langue qu'ils ont adoptée (le latin). On compte plus de 400 mots d'origine francique dans le vocabulaire français.
Ainsi, la coexistence de deux aristocraties, gallo-romaine et franque, explique le caractère bilingue de la terminologie guerrière et administrative: épée est gallo-roman, mais brand, qui signifiait "épée" et sur lequel est fondé le verbe brandir, est francique; roi, duc, comte sont gallo-roman, mais marquis, baron, chambellan sont franciques. Le reste du lexique d'origine franque concerne la vie rurale - les Francs étaient davantage agriculteurs et chasseurs que citadins: gerbe, blé, jardin, haie, etc. D'autres mots dépeignent les sentiments ou le caractère: orgueil, honte, honnir, hardi...
Le bilinguisme entraîna surtout la forte évolution phonétique qui fait la spécificité du français par rapport aux autres langues romanes: réduction du mot, évolution des voyelles, disparition de certaines consonnes intervocaliques. Par exemple un mot latin comme sudare devient suer en français, mais reste sudar en espagnol. Les Gaulois sont responsables du changement de prononciation de la lettre u, et les Francs ont supprimé le d intervocalique et transformé en e le a accentué du latin.
La zone de colonisation franque - c'est-à-dire la France du Nord, où les Francs émigrent en nombre important - correspond au français d'oil, tandis que le français d'oc a beaucoup moins évolué. Pendant les deux siècles qui suivent, la civilisation latine s'étiole: le royaume est divisé entre les fils des rois mérovingiens, déchiré par les luttes intestines. Ce morcellement territorial favorise la formation de nombreux dialectes.
L'Église perd son rôle conservateur de la civilisation et de la langue: évêques et moines maintiennent des écoles qui forment les religieux, mais on n'y apprend guère que quelques prières et formules liturgiques. Certes il existe encore des lettrés, mais ils emploient volontiers un latin proche du peuple qu'ils appellent la langue "simple", "humble", "inculte". Selon le spécialiste du latin tardif Michel Banniard, le public de langue d'oil comprend ce latin simplifié et populaire, déjà très différent de sa langue parlée, jusqu'aux années 750-780; le public de langue d'oc garde cette compétence plus longtemps.
► 484 Le pape Félix III refuse l'édit impérial Henotikon qu'il considère comme hérétique et accuse Acace, le patriarche de Constantinople d'en être le véritable auteur. Un schisme sépare les Églises de Rome et de Constantinople. Félix III est un aristocrate romain, veuf et père de famille (il a deux enfants), fils d'un prêtre et bisaïeul du futur saint Grégoire le Grand. Il est élu pape à la succession de Simplice le 13 mars 483.
C'est la rupture avec Constantinople qui occupe surtout son pontificat. En effet l'empereur Zénon Ier, sous l'influence du patriarche de Constantinople Acace (ou Acacius), a tenté d'apaiser le conflit monophysite en publiant un texte, l'Henotikon (ou "acte d'union"), supposé trouver un compromis entre monophysisme et catholicisme. Mais Félix III y décèle une trop forte influence du monophysisme et lance l'anathème (484) contre Acace (contre l'empereur cela comportait sans doute plus de risque). Le patriarche réagit en rayant le nom de l'évêque de Rome des diptyques liturgiques, ce qui revient à l'excommunier.
Le monophysisme est une doctrine christologique apparue au Ve siècle dans les écoles théologiques de l'empire byzantin. Cette doctrine tente de résoudre les contradictions de la foi nicéenne concernant la nature du Christ. La doctrine chrétienne s'est construite à l'origine autour du symbole de Nicée, c'est-à-dire la reconnaissance de la consubstantialité du Père et du Fils, tout comme de la nature humaine du Christ. Les monophysites, en revanche, affirment que le Fils n'a qu'une seule nature et qu'elle est divine, cette dernière ayant absorbé sa nature humaine. Ils rejettent la nature humaine du Christ. En cela le monophysisme s'oppose au nestorianisme.
► 486 Clovis bat à Soissons Syagrius, le dernier représentant du pouvoir romain en Gaule. Cet événement marque la fin de la domination romaine en Gaule. Bataille de Soissons, bataille de Soissons contre Syagrius. Syagrius s'intitulait "roi des Romains" et semblait maintenir l'illusion d'une permanence de l'empire romain entre la Meuse et la Loire. La victoire de Soissons permit au royaume de Clovis d'embrasser tout le nord de la Gaule.
À la fin de la bataille, il fit égorger Syagrius avant de s'installer dans la résidence de ce dernier, à Soissons : instauration du domaine royal de Soissons. C'est également lors de cette bataille, qu'eut lieu – selon Grégoire de Tours – l'épisode anecdotique du vase de Soissons, où, contre la loi militaire du partage, le roi demanda de soustraire du butin un vase précieux pour le rendre à l'église de Reims, à la demande de l'évêque de cette dernière cité. L'épilogue de l'histoire eut lieu, quant à lui, le 1er mars 487.
Syagrius (-430/-486), général romain qui contrôlait une bonne partie de la Gaule (entre la Somme et la Loire), avant d'être vaincu par Clovis à la bataille de Soissons en 486. Il trouva refuge chez Alaric II qui le livra au roi Franc l'année suivante. Celui-ci le fit assassiner. Vase de Soissons, L'épisode légendaire du vase de Soissons nous est parvenu par Grégoire de Tours (dans son Historia Francorum). Il aurait eu lieu peu de temps après une bataille ayant opposé en 481 Clovis Ier, roi des Francs saliens, à Syagrius, "roi des Romains" (selon Grégoire de Tours, il s'agissait en fait d'un aristocrate à la tête d'une coalition de troupes romaines résistant aux Francs) pour la conquête de la ville de Soissons, alors sous la coupe des Romains de Syagrius.
La légende raconte qu'au milieu du butin arraché à Syagrius on découvrit un vase (probablement en argent) dont l'évêque de Reims demanda la restitution auprès de Clovis. Toutefois les coutumes franques voulaient que les parts du butin fussent tirées au sort. Le tirage fait, Clovis n'obtint pas le vase mais afin de préserver ses bonnes relations avec le clergé, celui-ci tenta néanmoins de le récupérer ; prétextant un passe-droit, il l'exigea du guerrier désigné par le sort.
Le soldat frappa le vase d'un coup de sa francisque en disant : "tu n'auras rien que ce que le sort t'attribuera vraiment". Selon la légende le vase fut brisé, mais selon d'autres sources il fut simplement cabossé. Quelque temps après, Clovis, passant ses guerriers en revue, reconnut le soldat insolent. Prétextant que sa tenue et ses armes laissassent à désirer, il les lui prit et les jetta à terre. Le soldat se baissa alors pour les récupérer et Clovis lui brisa le crâne, disant : "Ainsi as-tu fait au vase de Soissons !"
► 486 La fusion entre gallo-romains et barbares. Il semble qu'elle se soit faite facilement et progressivement, et ce pour plusieurs raisons : Déjà, avant les invasions, Romains et Barbares avaient été en contact : un certain nombre de Germains servaient comme mercenaires dans l'armée romaine. Quelques-uns s'étaient installés à l'intérieur des frontières de l'Empire, Rome leur ayant octroyé des terres et accordé un statut de fédérés.
Ces peuples avaient donc eu l'occasion de connaître les us et coutumes des Romains. Certains avaient même appris le latin. De plus, bien que les invasions aient laissé des souvenirs terribles, comme en témoignent les écrits de l'époque, les barbares étaient beaucoup moins nombreux que les gallo-romains et il leur fut facile de se fondre dans la population. Enfin, un des grands facteurs d'unification fut la conversion des Francs au christianisme, religion qui gagne toute la Gaule.
► 490 à 580 - naissance et mort de Cassiodore. Homme politique et érudit latin. Préfet du prétoire sous Théodoric, il voulut faire la somme des connaissance religieuses et profanes dans son encyclopédie, les 'Institutions des lettres divines et séculières', précis des sept arts libéraux, à la base de l'enseignement au Moyen Âge, privilégiant une pédagogie de la pensée sur une rhétorique de la mémoire. Il rapporte le grand nombre de statues à Rome et admet que les arts doivent être motivés par le gain possible d'argent.
► 490 Mort de Sidoine Apollinaire.
► 491 Campagne de Clovis contre les Thuringiens. Les Thuringiens: un peuple germain installé près de la Saale. La Saale est une rivière d'Allemagne. Elle est le plus grand affluent de l'Elbe sur le territoire allemand.
► 493 - 25 février : Après plus de 2 ans de siège de Ravenne, Théodoric le Grand persuade Odoacre qui dirige l'empire d'Occident de se rendre et de partager le pouvoir avec lui.
► 493 - 15 mars : Pendant le banquet qui scelle cet accord, Théodoric assassine Odoacre. La légende dit que au cours du banquet dix mille Hérules et dix mille Goths étaient placés l'un à côté de l'autre. A un signal de Théodoric, avec une parfaite simultanéité, les dix mille Goths plantèrent leurs poignards dans le coeur de leurs voisins de gauche. Ainsi, en un instant, l'armée - et la nation - hérule disparut de l'Histoire au bénéfice des Goths et de Théodoric qui va devenir "le Grand". Théodoric le Grand, le chef des Ostrogoths est maintenant roi d'Italie.
► 493 Clovis épouse Clotilde; elle prépare par ses exhortations sa conversion au christianisme.
► 496 Clovis fait la promesse de se faire baptiser et gagne la bataille face aux Alamans à Tolbiac.
► 496 Clovis marche contre les Alamans dans le but d'arrêter leurs invasions. Il les bat à Tolbiac. A la suite de cette victoire, il embrasse avec ses compagnons le christianisme, et est baptisé par saint Rémi, évêque de Reims, avec 3 000 de ses guerriers. Bataille de Tolbiac. A l'issue de l'épisode légendaire du "vase de Soissons", Clovis choisit avec intelligence de ne pas poursuivre aussitôt sa conquête vers le sud, mais d'affermir ses positions à l'est.
Luttes sanglantes, mais mal connues, pour soumettre les autres tribus franques et les Thuringiens, pour contenir la poussée des Alamans. Ces derniers sont vaincus et dispersés en 496 (ou 506) à la bataille dite de Tolbiac (aujourd'hui Zülpich) et la partie rhénane de leur royaume passe sous protectorat franc. Après cette victoire, il est convenu de situer le baptême de Clovis, avec 3 000 de ses guerriers, par saint Remi, évêque de Reims. Cette conversion place Clovis, le barbare païen, dans l'ordre religieux du côté de ses sujets gallo-romains.
Tolbiac est une ville de l'ancienne Gaule, aujourd'hui dénommée Zulpich, près de Cologne. On appelle victoire de Tolbiac, la victoire emportée par Clovis Ier, roi des Francs, sur les Alamans en 496, sur un point non déterminé du cours moyen du Rhin. En remerciement pour cette victoire, Clovis, qui avait épousé une chrétienne catholique du nom de Clotilde, se convertit à la foi de Nicée avec ses soldats. Ce fut l'évêque de Reims Remi qui baptisa Clovis.
► 498 - 25 décembre Baptême de Clovis à Reims. A la suite de sa victoire à Tolbiac contre les Alamans, Clovis et trois mille de ses guerriers sont baptisés à Reims par saint Rémi. Saint Remi évêque de Reims, apôtre des Francs (vers 437-13 janvier 533) est considéré comme le convertisseur officiel par baptême de la France au christianisme en baptisant collectivement Clovis, le premier roi mérovingien chrétien de France à Noël 496 avec 3000 guerriers et nobles francs. Ce qui est un des événements clef de l'histoire européenne catholique. La cathédrale de Reims devient alors la cathédrale ou seront sacrés tous les rois et empereurs de France.
► 500 Clovis marche contre les Burgondes et bat, près de Dijon, à l'Ouche, leur chef Gondebaud, qui est dès lors obligé de lui payer tribut.
► 502 Prise de Verdun par les troupes de Clovis.
► 507 Alaric II, roi des Wisigoths, qui était Arien, persécutait les évêques d'Aquitaine. Ceux-ci implorèrent la protection de Clovis, qui marcha contre le roi Wisigoth, le battit à Vouillé, près de Poitiers, et le tua de sa propre main. Cette victoire étendit la domination de Clovis jusqu'aux Pyrénées. Bataille de Vouillé, au printemps 507, l'armée franque franchit la Loire en direction de Poitiers sous le commandement de Clovis et de son fils aîné Thierry.
L'armée des Wisigoths marche au nord pour limiter leur progression en espérant que les Ostrogoths les appuieraient : la rencontre a lieu dans la plaine de Vouillé près de Poitiers. Un terrible corps à corps commence, jusqu'à ce que le roi Alaric II soit tué par Clovis en personne. Comme pour la bataille de Tolbiac contre les Alamans, cette mort marque la débandade des Wisigoths qui furent massacrés par les Francs.
Cette victoire ouvre pour Clovis la route du midi : il conquiert Toulouse, ancienne capitale des Wisigoths, Narbonne, l'Aquitaine, la Gascogne, le Languedoc et le Limousin. Victoire de Vouillé. Converti et baptisé, Clovis peut exploiter le mouvement d'opinion en sa faveur et sa campagne décisive contre les Wisigoths va apparaître comme une croisade pour la Chrétienté. Plus que la neutralité du royaume des Burgondes, il obtient la participation de quelques contingents de soldats ainsi que celle de troupes rhénanes.
Fort d'une puissante armée, et après une étape à Tours où il se met sous la protection de saint Martin, il attaque le royaume wisigoth. A Vouillé, près de Poitiers, il met en déroute l'armée du roi Alaric II. Alaric meurt dans la bataille (507). Son peuple reflue vers l'Espagne, laissant les villes de Bordeaux et de Toulouse aux mains de Clovis, qui s'empare bientôt de toutes les régions situées entre la Loire et les Pyrénées (à l'exception du bas Languedoc, sous protectorat ostrogoth). Revenu à Tours, Clovis y fait une entrée triomphale, à la manière d'un général romain, reçoit les insignes royaux par l'empereur d'Orient, Anastase. Son pouvoir est désormais légitimé.
► 508 Clovis entre sans combat dans Toulouse alors capitale des Wisigoths.
► 509 Clovis fait assassiner Sigebert, roi des Francs rhénans par son propre fils Chlodéric et récupère son royaume.
► 510 Publication de la loi salique. Après la liquidation de ses frères d'armes lui garantissant les pleins pouvoirs, Clovis souhaite donner à son royaume une base législative solide afin de se positionner en refondateur de l'état de droit. C'est ainsi qu'il fait rédiger entre 508 et 510 un ensemble de lois (dites Lois Saliques car Clovis était un franc salien) à partir du Bréviaire du wisigoth Alaric et d'anciennes lois germaniques.
Elle consiste essentiellement à régler:* l'égalité entre tous les citoyens, qu'ils soient gallo-romains ou germains, * la liberté de mariage, * les problèmes de procédure concernant les personnes et les biens: en particulier, elle essaie de supprimer la coutume du "droit de vengeance" dans les familles en codifiant, par compensation financière, le dédommagement de la parenté en cas de meurtre ou blessure d'un des siens, * les droits de succession pour les biens fonciers (terres): ceux-ci ne peuvent échoir qu'aux hommes. Les femmes peuvent hériter des autres biens mais pas des propriétés terriennes, ce qui les exclue des partages des royaumes. La loi Salique est le premier code de loi à avoir été rédigé en France : si le code Napoléon n'en garde que peu de trace, la législation médiévale en fut largement imprégnée.
► 511 - 27 novembre Mort de Clovis. On l'enterre dans la basilique des Saints-Apôtres à Paris. Sa femme Clotilde se retire dans un monastère à Tours. - Partage de son royaume entre ses quatre fils: Thierry régnera à Metz sur l'Austrasie - l'est; Clodomir à Orléans; Childebert à Paris; Clotaire à Soissons (Neustrie - l'ouest). Austrasie, durant la période mérovingienne, l'Austrasie désignait un territoire franc couvrant le Nord-Est de la France actuelle, des bassins de la Meuse et de la Moselle, jusqu'aux bassins moyen et inférieur du Rhin. La capitale en fut d'abord Reims, puis Metz. Ce royaume est apparu au décès de Clovis (511), lorsque le territoire de celui-ci fut partagé entre ses fils. Berceau de la dynastie carolingienne, l'Austrasie disparut avec le dernier roi mérovingien (751), et fut intégrée dans le grand royaume franc que réunirent Pépin le Bref et Charlemagne.
La Neustrie était un royaume de l'époque mérovingienne. Ce territoire couvre la région Nord-Ouest de la France actuelle, et a pour capitale Soissons. La Neustrie est créée à la mort de Clotaire Ier (561), lorsque ses fils se partagent le Regnum Francorum. Néanmoins, le terme de Neustrie (dérivé de Niuster "le plus récent") semble n'être apparu qu'un siècle plus tard. Le triomphe de Clotaire II en 613 fut celui de la Neustrie, à laquelle fut annexée l'Aquitaine. Mais après la mort de Clotaire III, la Neustrie reçut un roi imposé par les Austrasiens et l'Aquitaine se trouva de ce fait indépendante en 670; Ébroïn ne releva la Neustrie que pour peu de temps, car il fut vaincu en 687 à Testry, village de Picardie à 13 km au sud de Péronne, par Pépin duc d'Austrasie. Elle ne fut à partir de ce moment qu'un état vassal de l'Autrasie que dirigeait la maison d'Héristal. Cependant la distinction de Neustrie, Austrasie, Bourgogne subsista, bien que s'effaçant, après le traité de Verdun en 843, le nom de Neustrie ne désigna plus que l'ouest de la Basse Neustrie. Enfin celle-ci perdit son nom pour prendre celui de Northmannie ou Normandie, lorsqu'elle eut été cédée au Normand Rollon en 912.
► 511 THIERRY, CLODOMIR, CHILDEBERT et CLOTAIRE (515-524) - (Thierry Ier roi de Metz (futur Austrasie) - Clodomir roi d'Orléans - Childebert Ier roi de Paris - Clotaire Ier roi de Neustrie)
► 511 Thierry Ier. Aîné des fils de Clovis Ier il reçoit à la mort de son père en 511 une partie de son royaume avec comme capitale Reims. Il doit 4 ans après le début de son règne faire face à une incursion des Vikings danois qui pénètrent par l'embouchure de la Meuse, la remontent et commencent à piller l'Austrasie. Il envoie une armée commandée par son jeune fils Théodebert qui taillera en pièce les Danois. Théodebert tuera de sa main leur chef Clochilaïe. Thierry réprime une révolte en Arvernes (Auvergne) en la ravageant mais ne se joint pas à ses frères qui tentent la conquête de la Bourgogne. Il soumet la Thuringe en exécutant son roi Hermanfred, il la réunit à son royaume. Thierry meurt en 534 son fils Théodebert lui succèdera.
► 511 Clodomir. Second des fils de Clovis Ier, il reçoit à la mort de son père en 511 une partie de son royaume avec comme capitale Orléans. Le roi des Burgondes, Gondebaud meurt en 516, son fils Sigismond lui succède. Les trois fils de Clovis, Clodomir, Childebert et Clotaire décident d'attaquer la Bourgogne. Leur mère, Clotilde, ne les en dissuadera pas, Gondebaud (oncle de Clotilde) ayant assassiné ses parents et ses frères. Clodomir fera subir à Sigismond et sa famille le même sort que celui que Gondebaud avait fait subir aux parents de Clotilde sa mère.
Le frère de Sigismond, Godemar, réussit à repousser les Francs. Clodomir reprendra plus tard la lutte et sera tué dans la bataille et sa tête sera promenée au bout d'un pic. Ses deux fils Théobald et Gontaire qui avaient trouvé refuge chez leur grand mère Clotilde sont tués par leurs oncles Childebert Ier et Clotaire Ier qui se partagent son domaine. Le troisième fils parvient à se sauver et deviendra saint Cloud. Clotilde se réfugiera dans la prière le reste de ses jours. Longtemps après Clotaire épousera sa veuve Gundiuque.
► 511 Childebert Ier. Troisième des fils de Clovis Ier il reçoit à la mort de son père en 511 une partie de son royaume avec comme capitale Paris. Il participe avec son frère Clotaire Ier à l'assassinat des deux fils de son frère défunt, Clodomir, et s'empare de Chartres et d'Orléans en 524. Avec son frère Clotaire Ier et le fils de son frère Thierry Ier, Théodebert Ier il soumet les Burgondes, victoire d'Autun contre Gondemar, frère de Gondebaud assassin des parents de leur mère, en 534, et s'empare d'une partie de leur royaume.
Il lutte également contre les Wisigoths il vainc leur chef Amalric II en 531. Outre Paris, il détient alors Lyon, Arles et Orléans qui joueront pendant son règne le rôle de métropoles religieuses du royaume Mérovingien. Il s'y tiendra de 533 à 558 quatre conciles dont trois furent fréquentés par des évêques venus de tout le royaume. Childebert fonde, à Lyon, en 542, le premier hospice ou maison de charité connu en France. La consigne avait été donnée en 325 au concile de Nicée (ville de Turquie actuellement Iznik). Il fonde aux portes de Paris l'église Saint-Vincent qui deviendra par la suite Saint-Germain des prés. Il meurt en 558 sans descendant mâle, son royaume sera rattaché à celui de son frère Clotaire.
► 511 Clotaire Ier. Quatrième fils de Clovis Ier il reçoit à la mort de son père en 511 une partie de son royaume avec comme capitale Soissons. Il participe avec ses frères à la lutte contre les Burgondes et soumet la Thuringe en 531. Il assassinera les deux enfants de Clodomir à la mort de celui-ci dont il prendra une partie du royaume en 524. A la mort de son petit neveu Théodebald fils de Théodebert roi de Reims et petit-fils de Thierry Ier, il s'empare de son royaume (555). Il en fait de même à la mort de Childebert (558) et devient le seul maître des états Francs. Son fils Chramme s'étant révolté et ayant convaincu à sa cause le comte de basse Bretagne, Conobre il le fait périr ainsi que sa femme et ses filles. L'unité des états Francs ne durera pas longtemps car à sa mort en 561 son royaume sera à nouveau partagé entre ses fils. Le partage de son royaume verra apparaître trois entités, l'Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne.
► 511 Le concile d'Orléans réserve au roi franc la nomination des clercs. Concile des Gaules à Orléans réuni par Clovis afin de régler le sort de l'Aquitaine nouvellement conquise. Le roi impose lui même aux participants les mesures à prendre.
► 512 Écriture arabe. Apparue avant l'islam, l'écriture arabe se propagera en profitant de la dispersion de la religion musulmane. Elle descend selon toute évidence de l'écriture araméenne, bien qu'il n'y ait aucune certitude sur sa création. Les premières traces remontent en 512 après JC, et la tradition musulmane veut qu'un membre de la famille de Mahomet l'ait inventée. Écriture araméenne, le nom d'araméen désigne plusieurs langues et dialectes sémitiques proches appartenant à la famille des langues afro-asiatiques.
Au VIe siècle av. J.-C., l'araméen était la langue administrative de l'empire persan. Du IIIe siècle av. J.-C. jusqu'à 650 ap. J.-C., c'était la principale langue écrite du Proche-Orient. Elle a donné son nom à l'alphabet araméen avec lequel elle était écrite. L'araméen pouvait servir de lingua franca. On estime que Jésus a prêché en araméen, parce que les textes de l'Évangile (qui sont écrits en grec) citent une phrase en araméen célèbre, Eli, Eli, lama sabachthani ? ("Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?").
L'araméen était également la langue employée par les rabbins qui ont participé à l'écriture du Talmud dit "de Babylone" car on retrouve un très grand nombre d'expressions idiomatiques araméennes dans les textes de Mishna et de Gémara. L'Araméen était la langue usuelle de la Palestine du temps de Jésus et le resta dans toute la région puisque le prophète Mani préchait en araméen "comme Jésus". L'histoire de l'alphabet arabe montre que cet abjad ne s'est pas écrit depuis les origines tel qu'on le lit actuellement. On considère que l'alphabet arabe est un dérivé de l'alphabet araméen dans sa variante nabatéenne ou bien syriaque, lui-même descendant du phénicien (alphabet qui, entre autres, donne naissance à l'alphabet hébreu, à l'alphabet grec et, partant, au cyrillique, aux lettres latines, etc.).
► 515 Les troupes de Thierry repoussent les armées danoises après avoir tué leur roi.
► 523 Les quatre fils de Clovis concluent une alliance pour faire ensemble la conquête de la Bourgogne.
► 523 Les fils de Clovis battent Sigismond. Sigismond, roi des Burgondes (516-524). Fils et successeur du roi Gondebaud, il chassa les Wisigoths d'Auvergne, mais fut vaincu par les Francs. Il fonda en 515 le monastère de Saint-Maurice d'Agaune (Valais, Suisse).
► 524 Dans la conquête de la Bourgogne, Clodomir, roi d'Orléans, est tué au combat de Véséronce. Ses frères Childebert et Clotaire font assassiner ses enfants (dont un leur échappe et deviendra moine sous le nom de saint Cloud), afin de se partager leur héritage.
► 524 Clotaire épouse Gontheuque, veuve de Clodomir.
► 524 THIERRY, CHILDEBERT et CLOTAIRE (524-534) - (Thierry Ier roi de Metz (futur Austrasie) - Childebert Ier roi de Paris - Clotaire Ier roi de Neustrie)
► 525 Denys le Petit calcule l'Anno Domini. Denys le Petit, ou Dionysius Exiguus, (environ 470 - environ 540) est un moine connu pour avoir calculé l'Anno Domini utilisée comme ère par le calendrier grégorien, surnommé le Petit à cause de sa taille. Il est originaire de la province romaine de Scythie mineure (correspondant à l'actuelle région de Dobroudja entre le nord-est de la Bulgarie et le sud-est de la Roumanie et serait d'ascendance arménienne.
Il vient à Rome vers 500, y est fait abbé d'un monastère, s'acquiert une grande réputation par ses ouvrages sur la discipline ecclésiastique et la chronologie, et meurt en 540. À cette époque, il était coutumier de compter les années en utilisant le début du règne de l'empereur Dioclétien, connu pour avoir déclenché la dernière persécution de chrétiens dans l'Empire romain. Il introduit l'usage de compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ, qu'il place à l'année 753 de Rome (4 ans trop tard, paraît-il).
Il trouve une période de 532 ans qui commence à l'année même de l'incarnation, et qu'on appela, d'après son nom, période dionysienne. Anno Domini, ou plus exactement Anno Domini Nostri Jesu Christi, signifie littéralement An du Seigneur, An de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce terme évoque l'année supposée de la naissance de Jésus-Christ telle qu'elle fut évaluée au VIe siècle. Décrétée an 1, cette année inaugure l'ère conventionnelle, système de datation compris – sinon approuvé – par toutes les organisations mondiales.
Cette datation a été calculée en se basant sur le Liber de Paschate de Dionysius Exiguus, Denis le Petit, publié vers 525; il avait été chargé par le chancelier papal Bonofacius de concevoir une méthode pour prévoir la date de Pâques selon la "Règle Alexandrine". Jusque là, la date de naissance de Jésus, reposait sur l'indication de l'évangéliste Luc : Jésus avait 30 ans en l'an 15 de Tibère. Clément d'Alexandrie faisait coïncider cette datation avec la 28ème année suivant la prise d'Alexandrie par Auguste, Hippolyte de Rome et l'historien Orose avec l'année 752 ab urbe condita, Eusèbe de Césarée avec la 42ème année d'Auguste.
Or Denys le Petit prit pour départ le 25 Mars de l'année suivante, 753 ab urbe condita, parce qu'elle offrait une coïncidence avec la Nouvelle Lune de Printemps. En effet, cette année là - qui correspondait à L'an 1 avant l'ère chrétienne, soit l'an 0 sur l'échelle des astronomes - la nouvelle lune de printemps se produisit le 24 mars à 11h28. Les années proches n'offraient pas cette coïncidence. Ab Urbe condita, ce qui signifie "à partir de la fondation de la Ville (de Rome, le mot Urbs prend ici une majuscule)". Elle était utilisée par les anciens romains comme origine de la datation des années. Cette fondation est placée en l'an 753 av. J.-C., le 21 avril.
► 527 1er août : Début du règne de Justinien Ier le Grand, seul empereur byzantin (fin en 565). Justinien Ier, (né le 11 mai 483 en Illyrie - mort en 565), fut empereur byzantin de 527 à 565. Il est l'un des plus importants dirigeants de l'Antiquité tardive. Que ce soit au niveau législatif, de l'expansion des frontières de l'empire ou de la politique religieuse, il laisse une oeuvre et une vision impérissables.
Empire byzantin, en 395, à la mort de Théodose Ier, l'Empire romain est partagé en deux parties : l'Empire romain d'Occident qui disparaît en 476, et l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin qui durera jusqu'en 1453. Au cours de ces mille ans, les Byzantins se considérèrent "Romains", et ils appelèrent leur empire "l'Empire romain". Un certain nombre de lois et coutumes fut conservé des Romains ainsi que certains aspects culturels comme l'architecture. Ce fut aussi un empire chrétien qui, entre autres, aura défini certains dogmes du christianisme. L'Église officielle fut l'Église chrétienne universelle jusqu'au Grand Schisme d'Orient de 1054, ensuite cette partie de l'Église prit le nom d'Église orthodoxe.
Leur religion, leur langue, et leur culture étaient essentiellement grecques plutôt que romaines. Les Perses et les Arabes appelèrent les Byzantins "Romains", mais les Européens les appelèrent toujours "Grecs", et leur Empire "Imperium Graecorum", "Graecia", ou aussi "Terra Graecorum". Alors que l'Europe est en plain féodalisme, l'Empire byzantin est à son zénith autour de Constantinople. De 527 à 565, l'empereur Justinien rend à son empire unité et grandeur. Il domine la Méditérannée, fait rédiger le code Justinien. Avec Basile II, Byzance devient le plus grand centre commercial et intellectuel du monde.
► 529 Saint Benoît fonde l'ordre des Bénédictins. Ordre Bénédictin, l'Ordre de Saint Benoît (O.S.B), plus connu sous le nom d'Ordre Bénédictin, a été fondé en 529 par Saint Benoît de Nursie (480-547). Si l'on excepte l'introduction de la laus perennis en 515 à l'Abbaye de Saint-Maurice d'Agaune, c'est le plus ancien d'Occident ; ses membres prononcent les voeux solennels qui les lient pour leur existence au monastère choisi et qui leur imposent la Règle.
Habits monastiques : tunique noire et scapulaire noir à capuchon. Une ceinture noire autour de la tunique. Port de la coule noire pour les profès à vie lors des offices et messes. Bénédictins. Religieux qui suivent la règle de saint Benoît de Nursie (480-547), fondateur de l'abbaye du Mont-Cassin. Sa vie est connue par le récit qu'en fit le pape Grégoire le Grand dans ses Dialogues. Les Bénédictins sont de grands missionnaires ; ils entreprennent notamment en 597 la conversion de l'Angleterre au catholicisme. Le monastère constitue un microcosme autonome où l'on cultive la terre, copie les manuscrits, étudie la théologie et les sciences.
► 530 à 611 - naissance et mort de Venance Fortunat. Poète et évêque. Troubadour de la région de Ravenne, en Italie, rimant sur tout, rimant sur rien, mais toujours attablé aux meilleures tables. Guéri d'une maladie des yeux après des prières à saint Martin, il voulut partir en pèlerinage au tombeau du saint évêque, choisissant des détours par Metz et l'Austrasie. Mais ses chansons n'obtinrent qu'un demi-succès dans le pays de Brunehaut (reine d'Austrasie). De Tours, il se rend à Poitiers. Et c'est là qu'il se convertit et, ordonné prêtre, devient aumônier du monastère de sainte Radegonde. Il continua de rimer pour la vie des saints. Ses hymnes, qui sont parmi les merveilles de la littérature religieuse latine : le "Pange lingua" et le "Vexilla Regis", sont encore dans la liturgie romaine.. Sa poésie y exprime toute sa vie spirituelle et sa méditation intérieure. Choisi comme évêque de Poitiers, il meurt quelques années plus tard.
► 530 Saint Brendan part pour une quète de sept ans à la recherche du jardin d'Eden. Saint Brendan de Clonfert ou Bréanainn de Clonfert (né vers 484 à Ciarraight Luachra dans le comté de Kerry, mort en 577 à Enachduin ou Annaghdown/Annadown), surnommé le Navigateur, est l'un de ces saints moines irlandais du Haut Moyen Âge dont la légende a occulté l'histoire. Brendan (aussi orthographié Brandan) se prépare à la vie monastique à l'abbaye de Llancarvan. Parti pour une quète de sept ans à la recherche du jardin d'Eden, il s'aventure sur l'océan Atlantique avec une petite embarcation (peut-être un curragh) et plusieurs moines, probablement vers 530.
Il revient en Irlande en affirmant avoir découvert une île qu'il assimile au Paradis ; le récit rapidement propagé de ses aventures attire de nombreux pèlerins à Aldfert, le village d'où il avait prit son départ. En 1976, l'Irlandais Tim Severin construit une barque en peaux de bêtes tendues et en atteignant Terre-Neuve par les îles Féroé et l'Islande, prouve que le voyage de Brendan a pu lui faire découvrir l'Amérique avant les Vikings et Christophe Colomb.
32 - De 531 à 680 - Pépin de Herstal devient maire du palais d'Austrasie
► 531 Victoire à Tolbiac de Thierry et Clotaire contre Hermanfried, roi de Thuringe qui se tue.
► 531 Révolte en Auvergne.
► 532 Clotaire et Childebert attaquent la Bourgogne et s'emparent d'Autun. Les Francs attaquent la Bourgogne : Childebert Ier et Clotaire Ier décident de marcher ensemble une nouvelle fois sur le petit royaume burgonde et écrasent les derniers défenseurs à la bataille d'Autun.
► 532 - 11 janvier La sédition de Nika à Constantinople. L'Hippodrome, où se déroulent régulièrement les courses de chars, voit deux factions s'affronter en son sein. D'un côté, ceux que l'on surnomme les "Bleus", issus de l'aristocratie, et de l'autre, les "Verts", partisans de la démocratie. Les deux profitent souvent de l'événement pour montrer leur désaccord sur le gouvernement de l'Empire. Au cours de l'une des ces courses, les Verts s'opposent au préfet actuel, Jean de Cappadoce.
Les manifestations violentes éclatent et Cappadoce ordonne qu'on s'empare de quelques hommes pour en faire des otages. Toutefois, par erreur, un Bleu est arrêté, puis exécuté deux jours plus tard. La faction bleue se joint alors aux émeutes, qui redoublent de violence. Durant trois jours, la ville sera ravagée avec pour bruit de fond les cris "Nika ! Nika !", signifiant "Victoire !". Les émeutiers seront finalement massacrés par l'empereur Justinien. La sédition Nika (victoire en grec) à cause de son cri de ralliement est un soulèvement populaire à Constantinople qui fait vaciller le trône de l'empereur Justinien Ier en 532.
► 532 à 537 Construction de l'église Sainte-Sophie à Constantinople. La basilique Sainte-Sophie, un bijou d'architecture byzantine du début de l'ère byzantine. Elle fut érigée en 532, puis détruite à deux reprises par des incendies. rebâtie sur les cendres de la basilique, Sainte-Sophie fut inaugurée après moins de 6 années de chantier le 26 décembre 537 par l'empereur Justinien, qui la consacra à la sagesse divine (Hagia Sophia en grec).
Pour habiller les murs et dresser les colonnes, Justinien fit venir des provinces de l'Empire une grande variété de marbres : marbre blanc de Marmara, marbre vert de l'île d'Eubée, marbre rose des carrières de Synnada et marbre jaune d'Afrique.
► 532 - 18 janvier L'empereur Justinien réprime la sédition de Nika. Depuis trois jours, la cité est ravagée par la révolte des factions bleue et verte qui tentent de donner le pouvoir à Hypatios, neveu d'Anastase Ier. Soutenu par son épouse, Théodora et par Bélisaire, commandant de l'armée, Justinien décide de résister et de réprimer les insurgés. Plus de 30 000 hommes sont tués dans l'Hippodrome. Quant à Hypatios, il sera mis à mort le lendemain. Bélisaire né vers l'an 500 aux confins de l'Illyrie et de la Thrace, fut un général de grande valeur. Soutien fidèle de l'empereur Justinien, il maintint l'intégrité de l'empire romain d'Orient et reconquit l'Occident.
► 533 Conquête byzantine de la Tunisie. Le général Bélisaire s'empare de Carthage et chasse les Vandales. Ces derniers occupaient le territoire depuis 439. La région connaîtra une grande instabilité provoquée par une politique fiscale démesurée.
► 534 Mort de Thierry, son fils Théodebert lui succède.
►534 THÉODEBERT, CHILDEBERT et CLOTAIRE (534-548) - (Théodebert Ier roi d'Austrasie - Childebert Ier roi de Paris - Clotaire Ier roi de Neustrie)
► 534 Théodebert Ier. Petit fils de Clovis Ier, il succède à son père, Thierry Ier à la mort de celui-ci en 534, comme roi de Reims. Avec ses oncles, il soumet définitivement le royaume des Burgondes. L'Empereur d'Orient disputait aux Ostrogoths la possession de l'Italie, les deux partis firent appel à Théodebert. Celui-ci, accordant son appui aux deux partis il les mit d'accord en "en croquant l'un et l'autre (La Fontaine)". Cependant et afin que la morale soit sauve, les troupes franques furent décimées par les maladies ce qui aura une répercussion importante sur la proportion de Germains en Gaule. C'est à compter de cette date que les Gallo-Romains furent admis (ou contraints) à porter les armes et à combattre dans les armées franques.
Quelques années plus tard, il se fait céder la Provence par le roi des Ostrogoths Vitigès. L'abandon de la Provence par les Ostrogoths laisse les Alamans isolés, Théodebert les soumet et annexe leur territoire. Il parvient à soumettre à son control un amalgame de peuples (Lombards, Thuringiens, Alamans, Vètes, Hérules) qui à la demande de Justinien avaient fait mouvement vers l'Italie. Cet amalgame devait constituer le peuple Bavarois. Il se servira de ce territoire comme tête de pont pour conquérir l'Italie du nord en 539. Élevé par des conseillers romains il a probablement souhaité devenir Empereur d'Occident mais il a échoué. A sa mort son fils Théodebald lui succède.
► 534 Partage du royaume Burgonde entre Théodebert, Childebert et Clotaire.
► 536 Alliance de Théodebert, Childebert et Clotaire avec les Ostrogoths et Justinien empereur romain d'orient. Les Ostrogoths étaient un peuple germanique. Ils jouèrent un rôle considérable dans les événements de la fin de l'empire romain. Les Goths formaient une tribu unie jusqu'au IIIe siècle, date à laquelle ils se seraient scindés en deux branches : les Ostrogoths et les Wisigoths. Leur histoire écrite commence avec leur indépendance de l'empire des Huns après la mort d'Attila. Alliés à leurs anciens vassaux et rivaux, les Gépides, les Ostrogoths menés par Théodimir écrasèrent les forces hunniques commandées par les fils d'Attila lors de la bataille de Nedao en 454.
Les Ostrogoths entrèrent en relation avec l'Empire et s'installèrent en Pannonie. Pendant la majeure partie de la seconde moitié du Ve siècle, les Ostrogoths jouèrent en Europe du Sud-Est un rôle équivalent à celui que jouèrent les Wisigoths au siècle précédent. Ils furent présents dans toutes les relations d'amitié et d'hostilités imaginables avec la puissance romaine orientale, et cela jusqu'à ce que, comme les Wisigoths l'avaient fait avant eux, ils ne passent d'Orient en Occident.
► 536 - 10 décembre Le général byzantin Bélisaire prend Rome aux Ostrogoths au nom de l'empereur romain d'Orient, Justinien. Le roi ostrogoth Vitigès s'y opposera et souhaitera reconquérir la ville, mais Bélisaire le vaincra en 540. Finalement, Rome sera reconquise par le roi goth Totila en décembre 546. Vitigès (? - 540) était le roi des Ostrogoths de 536 à 540. Il a hérité du trône de l'Italie au milieu de la guerre gothique, alors que Bélisaire s'était emparé de la Sicile l'année précédente et était alors dans le sud de l'Italie à la tête des forces de Justinien, l'empereur oriental.
► 537 Conquête de la Provence sous domination Ostrogoth. Ayant assuré ses arrières en concédant la Provence, aux mains des Ostrogoths depuis 508, aux Francs, Vitigès se déplace vers Rome et en fait le siège. Mais il doit se retirer et se retrancher dans Ravenne. Des Byzantins débarquent à Gênes, enlèvent Milan, Novare, Côme et Bergame, rejoignent l'armée de l'Adriatique et encerclent Ravenne.
► 537 Annexion du royaume des Burgondes (Bourgogne et Provence) et de la Thuringe. Les Francs contrôlent maintenant l'ensemble de la Gaule, hormis la Bretagne et le Languedoc.
► 539 Victoire de Théodebert à Pavie contre les Ostrogoths et à Ravenne contre les Romains.
► 540 à 594 - naissance et mort de Saint Grégoire. Pape Grégoire Ier. Il est une des figures majeures de l'Histoire de l'Église. Né dans une famille patricienne de Rome, il est préfet de la ville ; mais il ressent l'appel à la vie monastique : il fonde un couvent qu'il rejoint à 35 ans, abandonnant charge et honneurs. Le pape Pélage II l'ordonne diacre et l'envoie comme légat à Constantinople en 579.
A la mort du pape, il est choisi pour lui succéder. Il se dévoue sans compter pendant l'épidémie de peste qui a emporté son prédécesseur, puis se consacre à la réorganisation de l'Église, seule force capable de faire face à la disparition de l'empire romain. Il fait la paix avec les Lombards, envoie plusieurs moines de son abbaye en Angleterre, d'où ils propageront la règle de Saint Benoît dans toute l'Europe. Il est aussi à la base d'un mouvement de renouveau liturgique qui est à la base du chant grégorien.
Enfin ses nombreux écrits font autorité et lui valent le titre de docteur de l'Église. Le chant grégorien est le chant liturgique officiel de l'église catholique romaine, qui remonte au moyen âge. Parce qu'il est indissociable du latin, il est aujourd'hui marginalisé dans cet usage liturgique. Il reste cependant utilisé, régulièrement dans certaines communautés religieuses ou traditionnelles, et à titre plus exceptionnel dans les cérémonies particulièrement solennelles. Chant grégorien. Le chant grégorien, appelé également "plain-chant", est à la fois le premier répertoire occidental et le premier exemple de musique métissée, dont les règles ont été établies sous le pontificat de Grégoire Ier (590-604).
Le grégorien est une musique où l'unisson est roi (une seule ligne mélodique), une musique dite monophonique. Le rythme en est libre et directement élaboré à partir du texte latin mis en musique. Le plain-chant est presque toujours interprété a capella (sans accompagnement instrumental), parfois doublé à l'orgue. C'est un chant choral, où la voix se fond dans la communauté priant. Les textes religieux mis en musique sont d'ailleurs d'une importance fondamentale pour l'élaboration de la musique. La notation, enfin, est assurée par un système un peu semblable à notre système actuel.
► 542 Échec de l'expédition de Clotaire et Childéric contre les Wisigoths en Espagne.
► 542 Constantinople est ravagée par la peste. La capitale de l'empire romain d'Orient est touchée par une épidémie de peste dévastatrice. Particulièrement longue et affectant tout l'Empire byzantin, elle atteindra Rome en 589. On la surnommera plus tard la "peste de Justinien", selon le nom de l'empereur d'Orient qui dut y faire face. Plusieurs centaines de milliers de Constantinopolitains périront.
► 543 Grande épidémie de peste bubonique.
► 547 mort de Saint Benoît.
► 548 Mort de Théodebert, roi d'Austrasie. Son fils Théodebald lui succède.
548 THÉODEBALD, CHILDEBERT et CLOTAIRE (548-555) - (Théodebald Ier roi d'Austrasie - Childebert Ier roi de Paris - Clotaire Ier roi de Neustrie)
► 548 Théodebald l. succède à son père Théodebert Ier et devient roi de Reims en 548, il a 13 ans. Il abandonne l'Italie du nord. De santé fragile, il ne joue pas un grand rôle et meurt à 20 ans sans descendant. Son royaume est réuni à celui de Clotaire Ier dernier fils vivant de Clovis Ier.
► 550 'La Getica', de l'historien goth Jordanès, mentionne les Finnois (Scretefennae, les "Finnois qui glissent") et établit que les Danes, venus de Scanie, ont expulsé définitivement les Hérules du Danemark. Jordanès ou Jornandès est un historien du VIe siècle, écrivant en latin. D'origine ostrogothique mais converti à l'arianisme, on sait peu de choses sur lui. Il est un temps notaire d'un prince inconnu, puis, plus tard, il devient peut-être évêque de Crotone en Calabre.
Il séjourne à Constantinople en 551, accompagnant le pape Vigile, et à Ravenne, capitale de l'Italie ostrogothique, puis capitale de l'Exarchat de Ravenne à l'époque byzantine. Témoin des violentes “guerres gothiques”, qui finissent par provoquer la défaite définitive des Ostrogoths, ses compatriotes, et leur extermination dans les années 550. Il retraça l'histoire des goths, les tentatives de sédentarisation dans les diverses terres traversées depuis leur migration de la Baltique (terres de Gothie en Europe orientale) ; ses écrits permettent de connaître mieux la période de l'empire hunnique et les guerres de succession qui s'ensuivirent.
► 553 Victoire des Byzantins contre les Francs.
► 555 Mort de Théodebald sans héritier, Clotaire épouse sa veuve et annexe le royaume.
► 555 CHILDEBERT et CLOTAIRE (555-558) - (Childebert Ier roi de Paris - Clotaire Ier roi de Neustrie)
► 555 Soumission de la Bavière par Clotaire.
► 555 Clotaire donne le gouvernement de l'Auvergne à Chramne, son fils. Chramne, fils de Clotaire lui donne bien du fil à retordre : poussé par son oncle Childebert, il complote deux fois de suite contre son père ; Clotaire lui accorde une première fois son pardon, mais Chramne récidive en 560. Cette fois, Clotaire est bien décidé d'en finir. Chramne se réfugie auprès du comte de Bretagne Conobre (ou Conomor le Maudit), mais les troupes du comte ne peuvent résister à l'armée de Clotaire : lors de la bataille du Relec, Conobre est vaincu et tué ; Chramne, lui, est capturé et étranglé, puis Clotaire ordonne qu'on l'enferme, avec toute sa famille, dans une cabane à laquelle on met le feu.
► 556 Soumission de la Saxe par Clotaire. La Saxe est aujourd'hui l'un des 16 Länder composant l'Allemagne.
► 558Mort de Childebert, roi de Paris. Héritant de ses trois frères, Clotaire réunit toute la monarchie.
► 558 CLOTAIRE Ier (558-561) - (Clotaire Ier roi des Francs)
► 558 Clotaire rassemble l'héritage de Clovis.
► 559 Révolte de Chramne qui se réfugie en Bretagne.
► 559 Nouvelle épidémie de Peste.
► 560 Clotaire s'empare de Chramne et l'exécute avec sa femme et ses enfants.
► 561 Mort de Clotaire et partage par tirage au sort de la monarchie, entre ses quatre fils: Caribert (Paris), Gontran (Orléans), Sigebert (Metz) et Chilpéric (Soissons).
►561CARIBERT, GONTRAN, SIGEBERT, CHILPÉRIC Ier et FRÉDÉGONDE (561-567) - (Caribert Ier roi de Paris - Gontran Ier roi de Bourgogne - Sigebert Ier roi d'Austrasie - Chilpéric Ier roi de Neustrie)
► 561 Caribert. Fils aimé de Clotaire Ier, il devient roi de l'ouest de la Gaule avec Paris comme capitale en 561. Excommunié pour bigamie (Mirefleur, Teutegilde étaient deux soeurs servantes d'Ingeberge), il meurt en 567 sans descendant mâle. Son royaume est partagé entre ses frères.
► 561 Gontran. Second fils de Clotaire Ier, il devient roi d'Orléans et de Bourgogne en 561. Il essaye de freiner les hostilités entre ses frères Sigebert Ier et Chilpéric Ier sans toutefois parvenir à éviter la guerre qui éclate en 570. Il mène des campagnes contre les Bretons, les Basques et les Wisigoths. Pour montrer l'importance des Romains du Rhône il établit sa cour à Châlon dont il fait sa capitale aussi bien politique que religieuse.
Sans héritier mâle, il adopte son neveu Childebert II roi d'Austrasie qui devient son successeur en vertu du traité d'Andelot en 587. C'est en 590 qu'arrive d'Irlande le moine Colomban qui va bouleverser les rapports entre les monastères et les évêques. Il se rend à la cour de Gontran qui le reçoit bien et l'autorise à s'installer dans une forteresse ruinée à Annegray dans les Vosges. Plusieurs autres suivront, il restera 30 ans en Bourgogne, s'attirant l'animosité des évêques qu'il tenait à l'écart des ses monastères. Bienfaiteur des églises et des abbayes, il est béatifié.
► 561 Sigebert Ier. Troisième fils de Clotaire Ier, il devient roi de Reims et d'Austrasie en 561. Il épouse en 566 Brunehaut fille du roi des Wisigoths Athanagil. Jaloux, son frère et rival Chilpéric Ier roi de Neustrie épouse Galswinthe soeur de Brunehaut mais la laisse assassiner par sa maîtresse Frédégonde. Ce crime entraîne une lutte acharnée entre Brunehaut et Frédégonde et la guerre entre les deux frères. Alors que Sigebert est vainqueur, que Chilpéric est enfermé dans Tournai et que les Neustriens (sujets de Chilpéric) s'apprêtent à reconnaître Sigebert comme souverain, Frédégonde le fait assassiner et retourne la situation (575). Son fils Childebert II âgé de 5 ans lui succède sous la tutelle de Brunehaut.
► 561 Chilpéric Ier. Quatrième fils de Clotaire Ier, il devient roi de Soisson et de Neustrie en 561. Personnage contrasté, lettré, ami des spectacles mais aussi débauché et sans scrupule. Il répudie Audovère son épouse sous l'emprise de Frédégonde suivante d'Audovère. Jaloux du mariage de son frère Sigibert avec Brunehaut il épouse la soeur de celle-ci, Galswinthe. Il la laisse étrangler par Frédégonde et épouse cette dernière.
Une guerre sans merci s'engage entre Brunehaut et Frédégonde (et les deux frères). Alors que Sigebert est vainqueur, Frédégonde sauve la situation en le faisant assassiner. Brunehaut est prisonnière à Rouen, son fils est sauvé par un fidèle qui l'emmène en Austrasie où il sera désigné roi. Brunehaut parviendra à se faire libérer en séduisant le fils de la première femme de Chilpéric, Mérovée, ce qui ne lui sera pas pardonné par Frédégonde elle le convaincra au suicide et fera tuer Saint Prétextat évêque de la ville qui avait célébré le mariage.
La famine, la peste et le feu de Saint Antoine s'abattirent sur le royaume. Deux enfants de Frédégonde furent atteints par cette dernière maladie. Le couple royal y vit une vengeance de dieu pour toutes ses mauvaises actions. Pour se faire pardonner, ils brûlèrent le registre des impôts qui pesaient lourdement sur le peuple malgré cela, les enfants périrent. Chilpéric mourra assassiné en 584. Le fils de Frédégonde, Clotaire II, qui n'a que quelques mois lui succède sous la tutelle de Frédégonde.
► 561 Chilpéric est chassé de Paris par ses trois frères.
► 562 Attaque des Avars contre les Thuringes. Les Avars sont un peuple proto-mongol de cavaliers nomades. les Francs de Charlemagne et de son fils Pépin d'Italie, décidés d'en finir avec ces païens, et les combattent violemment et sans relâche avec leurs troupes franques, bavaroises et lombardes. Leur camp retranché, le Ring avar, est pris en 795 avec un trésor considérable, fruit de plusieurs siècles de pillage pur et simple. Les Avars sont exterminés, ceux qui se soumettent sont convertis de gré mais bien souvent de force, et les derniers rebelles sont vaincus en 805.
► 566 Sigebert épouse Brunehaut, fille d'Athanagild, roi des Wisigoths d'Espagne, née en 534. Brunehaut ou Brunehilde, née en Espagne à Mérida vers 534 et morte exécutée en 613 à Renève (France) est une princesse wisigothe devenu reine des Francs. Fille d'Athanagild, roi des Wisigoths, elle épouse Sigebert Ier, roi franc mérovingien d'Austrasie, en 566. Athanagild est un roi wisigoth d'Espagne de l'an 554 à sa mort en 567.
► 567 mars Mariage de Chilpéric avec Galswinthe, fille d'Athanagild, roi des Wisigoths. Galswinthe, née à Tolède vers 540, morte à Soissons (?) en 568 (?), fut reine des Francs en Neustrie. Fille d'Athanagild, roi des Wisigoths, elle épouse le roi mérovingien de Soissons Chilpéric Ier en 567. Elle lui apporte en dot de nombreux trésors (en monnaie et en objets précieux) et une alliance avec le roi wisigoth; ce mariage offre aussi à Chilpéric une certaine tranquillité dans ses possessions d'Aquitaine.
► 567 Mort de Caribert, causée par ses excès de toute sorte. ses trois frères se partagent son royaume et décident de gouverner conjointement Paris.
► 568GONTRAN, SIGEBERT, CHILPÉRIC Ier et FRÉDÉGONDE (568-575) - (Gontran Ier roi de Bourgogne - Sigebert Ier roi d'Austrasie - Chilpéric Ier roi de Neustrie)
► 568 Raids lombards contre le sud-est de la Gaule. Les Lombards de Pannonie (20 000 hommes), conduits par leur roi Alboin, ébranlés par les Avars, rejoint par des Gépides, Sarmates, Thuringes, Saxons et Bavarois marchent sur le Frioul (1er avril), prennent Aquilée (20 mai) et occupent la Vénétie (sauf les îles où s'est réfugiée la population). Ils attaquent la Provence mais sont rejetés par les Francs.
Encombrés par la présence des familles et des bagages, ils avancent lentement. Aux côtés des guerriers, un peuple entier se déplace (200 à 300 000 personnes). Les Lombards occupent une grande partie de l'Italie. La résistance byzantine est très faible, car l'effort principal se porte en Orient et dans les Balkans. Seule les villes résistent. La population, accablé d'impôt et victime d'un système de spoliation discutable, voit arriver les Lombards avec une neutralité bienveillante.
► 568 Mort de Galswinthe, que la concubine de Chilpéric, Frédégonde, fait étrangler pour prendre sa place. Frédégonde ou Frénégonde, la première femme de Chilpéric Ier, alors roi de Neustrie. Elle séduisit et épousa ce dernier, non sans lui avoir fait d'abord répudier Audevère, puis lui avoir fait assassiner Galswinthe, sa seconde épouse. Elle suscita et commanda alors de nombreux meurtres, tant dans le camp des ennemis de son époux (tel celui du roi Sigebert Ier), que dans les rangs neustriens, parmi les rivaux de son fils, Clotaire II, auquel elle voulait assurer le trône.
► 568 Guerre entre les héritiers de Clotaire, Neustrie contre Austrasie (568-719) et Brunehaut contre Frédégonde.
► 568 Commencement de la lutte, qui durera près d'un siècle et demi, entre les Francs de l'est ou Ripuaires, du royaume d'Austrasie, et les Francs de l'ouest, du royaume de Neustrie.
► 570 à 632 - naissance et mort de Mahomet. Prophète arabe. Mahomet (Mohammed) naît orphelin de père. Sa mère ne pouvant subvenir à ses besoins, il est mis en nourrice auprès d'une tribu bédouine. Mahomet sera ensuite élevé par son grand-père paternel puis par son oncle, riche marchand mecquois et chef de clan. Mahomet opte pour le commerce environnant et devient caravanier. Ses voyages successifs l'amèneront à rencontrer sa future épouse Khadidja, une riche veuve.
Ils auront ensemble quatre filles, véritable drame pour les mecquois. Ils adoptent donc le cousin de Mahomet, Ali. Ne pratiquant pas la polygamie, Mahomet subit la moquerie des habitants. Mais Mahomet préfère se recueillir sur le mont Hira. Ses méditations se concrétisent par une révélation de l'ange Gabriel. Il doit vulgariser un message monothéiste. Les Mecquois se soumettront à un dieu unique: Allah, Mahomet serait son prophète, les riches marchands distribueront leur fortune aux pauvres...
L'ensemble des révélations est retranscrit et compose le Coran. Mais face aux hostilités des notables, Mahomet doit fuir. Son exil volontaire marque l'Hégire. Arrivé à Médine, il est reconnu comme le médiateur et établit un code de vie. Victoires et défaites se succéderont avant qu'il ne puisse retourner à la Mecque. Les bédouins sont des nomades de culture arabe vivant dans des régions désertiques du Moyen-Orient où ils élèvent des chèvres et des chameaux.
► 571 Victoire contre les Lombards à Chamousses, près d'Embrun. Embrun est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
► 571 Nouvelle épidémie de Peste.
► 572 Victoire contre les Saxons à Estoublon. Estoublon est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
► 573 Début de la guerre entre Sigebert et Chilpéric.
► 575 Défaite de Chilpéric face à Sigebert à Vitry. Vitry-en-Artois est un chef-lieu de canton du nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais.
► 575 Assassinat de Sigebert, roi d'Austrasie sur ordre de Frédégonde, sa veuve Brunehaut gouverne à sa place, en attendant que leur fils Childebert II soit en état de régner.
► 575 GONTRAN, CHILDEBERT II, CHILPÉRIC Ier et FRÉDÉGONDE (575-584) - (Gontran Ier roi de Bourgogne - Childebert II roi d'Austrasie - Chilpéric Ier roi de Neustrie)
► 575 Childebert II. Fils de Sigebert Ier et de Brunehaut, il hérite du trône à 5 ans, sa mère étant prisonnière de Chilpéric, c'est le maire du Palais Gogon qui assurera sa tutelle. C'est la première fois qu'un maire du palais qui assure une fonction de domestique, de haut rang il est vrai, sera érigé au rang politique (ça ne s'arrête pas là). Adopté par son oncle Gontran roi de Bourgogne, il lui succède en 592 en vertu du traité d'Andelot (587) réunissant ainsi L'Austrasie, la Bourgogne et les régions de Paris et d'Orléans.
Il meurt 3 ans après peut être empoisonné par sa femme. Son royaume est partagé entre ses deux fils Théodebert II et Thierry II. Maire du palais, à l'origine intendant général (chargé de diriger les services politiques et domestiques de la maison du roi), le maire du palais apparaît, dès le milieu du VIIe siècle, comme le personnage principal de l'État. C'est lui, de fait, qui exerce la réalité du pouvoir.
► 575 Frédégonde épouse Mérovée fils de Chilpéric Ier.
► 575 Grégoire de Tours écrit 'Histoire des francs'. Grégoire de Tours – Georgius Florentius Gregorius c'est-à-dire Georges Florent Grégoire – (né à Riom, près de Clermont v. 538 – † à Tours v. 594), fut évêque de Tours, historien de l'Église, des Francs et de l'Auvergne. 'L'Histoire des Francs', l'oeuvre majeure de Grégoire de Tours a survécu à travers plusieurs manuscrits du Moyen Âge, dans des versions plus ou moins altérées par rapport à l'original.
Elle est communément nommée Histoire des Francs. En réalité, il s'agit d'une "Histoire ecclésiastique", originellement intitulée Dix Livres d'Histoire, qui a pour vocation de dresser l'histoire de l'Église universelle dans une perspective chrétienne, eschatologique, depuis la genèse du monde jusqu'au règne des rois francs, en 572. S'y ajoute un ensemble de récits de vies de saints gaulois, réunis sous le nom de Livre(s) des miracles et composés après 570.
Évidemment, le récit pris dans son ensemble possède un caractère édifiant. Il fait la part belle à la Gaule mérovingienne que connaît Grégoire : cinq des dix livres et le Livre des miracles concernent le temps de l'auteur. Ce dernier en brosse un portrait plutôt sombre, mettant l'accent sur les conséquences désastreuses du comportement de certains rois par opposition au comportement de leurs aïeux chrétiens, à commencer par Clovis.
► 577 Alliance de Gontran et Childebert II. Gontran, roi de Bourgogne, n'ayant pas d'héritier, adopte son neveu Childebert, roi d'Austrasie.
► 578 Mort de Mérovée.
► 578 Les Bretons s'emparent de Vannes. Bretons insulaires (anciens Bretons, habitants de l'île de Bretagne, ou Grande-Bretagne). Le nom Bretons (en latin Britanni) désigne d'abord les habitants de l'île de Bretagne (en latin Britannia), ou plus exactement habitant la partie de l'île limitée au nord par la rivière Clyde. Les Bretons, c'est-à-dire les anciens habitants de Grande-Bretagne, comprenaient à l'époque située immédiatement avant la conquête romaine de nombreux peuples et tribus dont le caractère celtique est avéré, notamment dans le sud de l'île et à l'embouchure de la Tamise.
À partir du milieu du Ve siècle, de nouveaux envahisseurs germaniques, les Anglo-Saxons repoussèrent progressivement les Bretons du sud et de l'est vers l'ouest de l'île de Bretagne tandis que les Irlandais effectuaient des raids sur la côte ouest de la Bretagne (c'est d'ailleurs à cette occassion que saint Patrick qui était breton fut capturé). Ils finirent par fonder de véritables principautés sur les côtes galloises et écossaises. Si les premières furent finalement écrasées, les secondes donnèrent naissance à l'Écosse par la fusion du Dal Radia avec les royaumes britonniques du nord.
Durant cette période sur laquelle les sources fiables font défaut (ce sont les "âges sombres" ou Dark Ages de l'historiographie anglaise), des populations celtes peu romanisées établirent de nombreux "royaumes celtiques" dans l'île, notamment dans le pays de Galles et d'autres migrèrent en Irlande. De même, là se trouve probablement la cause première d'une émigration en masse de Bretons vers la péninsule armoricaine, celle-ci prenant alors le nom de Bretagne.
Âge sombre en Grande-Bretagne, l'expression désigne la période où l'île de Bretagne fut laissée sans souverain central, à compter du départ des Romains. C'était l'époque du doute et de la perte progressive de l'unité des Celtes britanniques, celle des incursions des violentes tribus du nord, les Pictes et les Scots, que les murs romains d'Hadrien et de Constantin ne retenaient plus ; enfin, celle de l'arrivée successive des Angles, Saxons sur les terres de l'Est, ainsi que des Vikings à York.
Dans le monde anglo-saxon, cette définition prévaut ainsi (Dark Age), et est à l'origine de deux lignes de légendes : * la matière de Bretagne, d'origine celtique, fondée sur Historia Regum Britanniae, qui fait d'Arthur l'héritier de Vortigern et de Brutus, aïeul mythique des celtes britanniques ; * la légende anglo-saxonne, basée sur Historia ecclesiastica gentis Anglorum de Bède le Vénérable.
► 579 Les Bretons s'emparent de Rennes et de Nantes.
► 579 Révoltes suite à une augmentation des impôts par Chilpéric.
► 581 Rupture de l'alliance entre Gontran et Childebert II qui se rapproche de Chilpéric.
► 581 Échec de l'expédition envoyée par Chilpéric contre les Basques. Le Peuple Basque est sûrement le plus ancien d'Europe. Les anthropologues s'accordent à dire que les Basques d'aujourd'hui sont les descendants directs de l'homme de Cro-Magnon. Son ancienneté remonterait donc à 50 000 ans environ. C'est à des gens qui parlaient l'euskara qu'on doit les peintures de Lascaux et d'Altamira.
Le basque est la seule langue non indo-européenne connue en Occident. La toponymie prouve que le basque a été parlé sur un territoire qui va au moins de l'Èbre à la Garonne et au val d'Aran. L'arrivée des Celtes n'a pas déplacé la population basque. Les implantations gauloises sont assez faibles en Aquitaine et au Pays Basque, alors que leur présence est massive au nord et à l'ouest du pays. Les romains n'ont jamais conquis le Pays Basque.
La présence romaine est pourtant importante dans la vallée de l'Èbre et en Gascogne. Pline, Strabon, Ptolémée, Jules César... fournissent les premiers témoignages écrits sur les coutumes et sur les différentes tribus qui composent ce peuple. Les Basques fournissent des troupes d'élite à la légion romaine, en particulier des cohortes de cavalerie.
Les peuples germains qui envahissent toute l'Europe n'arrivent pas à asservir le Peuple Basque. Les Goths, Les Wisigoths et les Francs tentent sans relâche de l'envahir, en vain. Les musulmans traversent le pays pour aller combattre les Francs, mais ils ne l'occupent pas. La vallée de l'Èbre et Pampelune changent plusieurs fois de mains, mais à chaque occasion, les montagnards redescendent sur le plat pour récupérer les territoires perdus.
► 581 Début de la dynastie Sui de Chine (fin en 618), avec le règne de Sui Wendi, premier empereur chinois de la dynastie Sui (fin en 604). Yang Jian, un militaire, usurpe le trône des Zhou du Nord et crée la dynastie des Sui (581-618) en Chine du Nord, avant de réunifier la Chine en 589 à la chute de la dynastie Chen. La dynastie Sui fut de courte durée et éphémère (581 - 618). Elle n'apporta pas le soulagement espéré par la population, et les lettrés confucéens n'hésitèrent pas à la comparer à la dynastie Qin car Wendi, le fondateur, ne leur accordait guère d'importance. C'est cependant sous cette dynastie que fut construit le « Grand Canal » ainsi que de nouvelles routes pour favoriser l'essor du commerce. Des tronçons de la grande muraille furent également rebâtis.
► 583 Restauration de l'alliance entre Gontran et Childebert II.
► 584 Expédition victorieuse de Childebert II en Lombardie.
► 584 Chilpéric, roi de Soissons, meurt assassiné par ordre de sa femme Frédégonde, qui prend le pouvoir, et gouverne jusqu'à ce que leur fils Clotaire II soit en état de régner. Gondowald (bâtard de Clotaire Ier) revendique le trône. Clotaire II, dit le Jeune, (584 - 18 octobre 629) fut : roi des Francs de 613 à 629, roi de Neustrie de 584 à 613. Il est le fils de Chilpéric Ier et Frédégonde. Il épousa Adaltrude, Bertrude (avec qui il eut Dagobert Ier) et Sichildis (en 618). Il est le père entre autres de Dagobert Ier.
► 584 GONTRAN, CHILDEBERT II et FRÉDÉGONDE (584-593) - (Gontran Ier roi de Bourgogne - Childebert II roi d'Austrasie - Frédégonde gouverne la Neustrie)
► 585 Expédition de Childebert II en Italie.
► 585 Gondowald soulève le sud de la Gaule et s'empare d'Angoulême, Toulouse et Bordeaux.
► 585 Gontran désigne Childebert II comme unique héritier.
► 585 Mort de Gondowald dans Comminges où il s'était réfugié, et incendie de la ville par les troupes de Gontran et Childebert.
► 585 Gontran attaque les Wisigoth de Septimanie et s'empare de Carcassonne. Septimanie est le nom que portait la région Languedoc-Roussillon.
► 585 L'Église catholique commence à percevoir un impôt de 10%, la dîme. Le concile de Mâcon menace d'excommunication ceux qui ne s'acquitteraient pas de la Dîme. La dîme, redevance religieuse prélevée à l'origine sur tous les bénéfices, y compris commerciaux et artisanaux, mais portant pratiquement uniquement sur les fruits de la terre et sur les troupeaux. Elle est prélevée sur toutes les terres, quels que soient le rang et la religion de leurs possesseurs. En règle générale, les bois, les prés et les produits des étangs ne sont pas sujets à la dîme. Celui qui perçoit les dîmes d'une paroisse s'appelle le décimateur.
► 587 - 28 novembre Traité d'Andelot, entre Gontran, roi d'Orléans et Childebert II, fils de Sigebert, roi de Metz. Ce traité est relatif à la possession des fiefs par les leudes (à l'époque mérovingienne, les leudes forment les cadres supérieurs de l'aristocratie); Gontran et Childebert y renouvellent leur alliance, et se font donation de leurs royaumes au dernier survivant. Le traité d'Andelot entre Gontran Ier roi de Bourgogne et d'Orléans et son neveu Childebert II roi d'Austrasie, fut ratifié le 28 novembre 587. C'est l'un des épisode de la lutte entre Frédégonde et Brunehaut. Il stipule que le dernier vivant recevra le domaine de l'autre.
► 587 Échec de l'expédition envoyée par Gontran contre les Basques.
► 588 Nouvelle expédition de Childebert II en Italie.
► 589 Nouvelle expédition de Gontran contre les Wisigoths qui s'empare de nouveau de Carcassonne.
► 590 Échec de l'expédition de Childebert II en Italie.
► 590 Fondation du monastère de Luxeuil par saint Colomban, début du monachisme irlandais et apparition de la règle bénédictine qui va le supplanter. Le monastère de Luxeuil fut fondé vers 590 par saint Colomban et le roi d'Austrasie Sigebert. Ce monastère permit la renaissance de Luxovium, ville thermale romaine, aujourd'hui Luxeuil-les-Bains, chef-lieu de canton de la Haute-Saône. Colomban, né en 543 et mort le 21 novembre 615 en Lombardie, fut un moine irlandais qui sillonna l'Europe pour évangéliser les populations campagnardes.
► 590 à 659 - naissance et mort de Le bon saint Éloi, orfèvre à la cour du roi Clotaire II dont il sera ensuite le trésorier, deviendra le principal conseiller du roi Dagobert lorsque ce dernier succèdera à son père, Clotaire II, en 629. Éloi, devenu prêtre puis évêque de Noyon après du second souverain, consacre sa vie à secourir les pauvres et à racheter les esclaves.
► 591 Traité de Paix entre Chidebert II et Agilulf, roi des Lombards. Agilulf (ou Agilulphe ou encore Agholphe) futur roi lombard d'Italie. Fils du duc lombard de Turin Ansvald, il est proclamé roi à Milan en mai 591, succèdant au roi Authari dont il épouse la veuve selon la coutume lombarde, la reine catholique Théodelinde. Son long règne fut marqué par une trêve avec la Papauté en 598, mettant provisoirement fin à 30 années de terreur lombarde. Il consolide son pouvoir et la domination lombarde dans son royaume, entretient de bons rapports avec les Francs.
► 593 Mort de Gontran, conformément au traité d'Andelot, Childebert II hérite du Royaume.
► 593 CHILDEBERT II et FRÉDÉGONDE (593-596) - (Childebert II roi d'Austrasie et de Bourgogne - Frédégonde gouverne la Neustrie)
► 596 Victoires de Frédégonde à Driossy et à Latofao sur les Austrasiens.
► 596 Mort de Childebert II, partage du royaume entre ses deux fils Théodebert (11 ans) et Thierry (9 ans).
► 596 THÉODEBERT, THIERRY II et FRÉDÉGONDE (596-597) - (Théodebert roi d'Austrasie - Thierry II roi de Bourgogne - Frédégonde gouverne la Neustrie)
► 596 Théodebert II. Petit Fils de Sigebert Ier et de Brunehaut, et fils de Childebert II. Il reçoit l'Austrasie à la mort de son père en 596. Il a 9 ans, c'est sa grand mère, Brunehaut qui a l'autorité, il s'en délivre en 599 en la chassant, elle se réfugie chez son second petit fils Thierry II. Avec son frère Thierry II ils reprennent la lutte contre le fils de Frédégonde roi de Neustrie. Ils parviennent à s'emparer d'une grande partie de ses territoires en 600-604. Les deux frères se font la guerre, Théodebert est vaincu à Toul et à Tolbiac en 612, il est enfermé dans un monastère. Sa grand mère Brunehaut le fait assassiner ainsi que son fils Mérovée. Son royaume est récupéré par son frère Thierry II.
► 596 Thierry II. Petit Fils de Sigebert Ier et de Brunehaut, et fils de Childebert II. Il reçoit la Bourgogne à la mort de son père en 595, il a 8 ans. Sa grand mère, Brunehaut qui a été chassée par Théodebert en 599 assure sa tutelle. Avec son frère Théodebert II ils reprennent la lutte contre le fils de Frédégonde, Clotaire II roi de Neustrie. Ils parviennent à s'emparer d'une grande partie de ses territoires en 600-604. Poussé par Brunehaut il fait la guerre à son frère Théodebert qui est vaincu à Toul et à Tolbiac en 612, il est enfermé dans un monastère. Sa grand mère Brunehaut le fait assassiner ainsi que son fils Mérovée. Thierry II annexe l'Austrasie.
►597 Mort de Frédégonde, son fils Clotaire II lui succède.
► 597 THÉODEBERT, THIERRY II et CLOTAIRE II (597-600) - (Théodebert roi d'Austrasie - Thierry II roi de Bourgogne - Clotaire II roi de Neustrie)
► 597 Clotaire II. Fils de Chilpéric Ier et de Frédégonde, il n'a que quelques mois lorsque son père est assassiné. Sa mère assure la régence jusqu'à sa mort en 597. Elle défend la Neustrie contre Théodebert II et Thierry II, mais Clotaire II est battu en 604 et perd presque tout son territoire. Pourtant ses vainqueurs meurent en 612 et 613, il capture Brunehaut et Sigebert II (il a 12 ans) fils de Thierry II et les fait exécuter. Il s'empare de leurs territoires et réunit le royaume des Francs.
► 597 En Angleterre, début de l'évangélisation des peuples Angles et Saxons par Augustin, dit Augustin de Cantorbéry, et ses moines, depuis leur premier lieu d'installation dans la ville de Cantorbéry, capitale du Kent. Cet évêché deviendra le premier et le plus important siège épiscopal du pays. Augustin, débarqué à Pâques à l'embouchure de la Tamise, obtient la conversion du roi Ethelred de Kent, chef de la confédération anglo-saxonne.
Augustin revient en Arles pour y recevoir la consécration épiscopale qui lui permettra de diriger la nouvelle Église d'Angleterre. Ethelred lui fait don de l'emplacement actuel de la cathédrale de Cantorbéry. Saint Augustin de Cantorbéry est un moine bénédictin du VIIe siècle. Il est envoyé en Angleterre avec 40 moines par le pape Grégoire le Grand dans le but d'amener ce pays à la foi catholique. Sur place, il convertit très vite le roi Anglo-Saxon du Kent, Ethelbert, qui l'installe à Cantorbéry ; mais il ne sait pas s'attirer la faveur des peuples celtes, en lutte avec les récents envahisseurs anglo-saxons. Mort en 604, canonisé, il est considéré comme le fondateur de l'Église d'Angleterre.
► 599 Nouvelle épidémie de Peste.
► 600 et 604 - Victoires des Austrasiens sur les Neustriens, à Dormeilles et à Étampes. Étampes est une commune française, située dans le département de l'Essonne et la région Île-de-France.
► 600 Défaite de Clotaire II face à Théodebert et Thierry II, perdant ainsi une partie de ses possessions.
► 600 Isidore de Séville écrit 'De Etymologia' (Les Étymologies). Isidore de Séville, né entre 560 et 570 à Carthagène et mort le 4 avril 636, fut évêque métropolitain de Séville, capitale du royaume wisigothique, entre 601 et 636. Il vient d'une famille influente (son frère, Léandre, ami du pape Grégoire le Grand le précède à l'épiscopat de Séville) qui contribue largement à convertir les Wisigoths, majoritairement ariens, au christianisme nicéen.
► 601 Brunehaut, veuve de Childebert est expulsé d'Austrasie par les grands du royaume avec l'assertiment de son fils Théodert. Elle se réfugie alors en Bourgogne chez Thierry II, son second fils.
► 602 Expédition de Théodebert et Thierry II contre les Basques.
► 602 - 27 novembre L'empereur Byzantin Maurice est décapité. A Chalcédoine en Asie Mineure, l'empereur d'Orient Maurice et ses six fils son assassinés suite à une mutinerie de l'armée mécontentée par la réduction des soldes. Le centurion Phocas, ordonne leur mise à mort après avoir été proclamé empereur.
► 605 Assassinat de Protade, maire du Palais de Bourgogne par les grands du royaume de Bourgogne lors d'une entrevue avec les grands du royaume d'Austrasie. Protade (? - 605), fut maire du palais de Bourgogne de 603 à 605.
► 605 Nouvelle épidémie de Peste.
► 610 - 3 octobre : Début du règne d'Héraclius Ier, empereur byzantin (fin en 641). Héraclius le Jeune, fils de l'exarque de Carthage, renverse Phocas qui est massacré par la foule. Héraclius fonde une nouvelle dynastie. Les règles de succession au trône sont modifiées : Héraclius cesse de choisir un César, comme le prévoyait le système tétrarchique de Dioclétien, pour associer au trône ses fils Constantin et Héraclonas. Héraclius prend le premier le titre de Basileus. Héraclius Ier ou Hérakleios (né vers 575, règne de 610 à 641) fut un empereur de l'empire romain d'orient et le fondateur de la dynastie des Héraclides.
► 610 Entrevue de Selz, marquant le début de la guerre entre Théodebert et Thierry II.
► 611 Le général perse Charbaraz occupe Antioche, puis Damas (612).
► 611 Incursions des Alamans près d'Avenches.
► 611 Défaite de Théodebert à Toul par les armées de Thierry II.
► 612 Défaite de Théodebert allié aux Germains par les armées de Thierry II qui le fait exécuter avec son fils.
► 612THIERRY II et CLOTAIRE II (612-613) - (Thierry II roi d'Austrasie - Clotaire II roi de Neustrie)
► 613 Mort de Thierry II, Brunehaut tente de faire nommer l'aîné, Sigebert II, mais les grand du royaume préfèrent Clotaire II. Sigebert II, fils naturel de Thierry II, il est livré par le maire du palais à Clotaire II de crainte qu'il gouverne sous la tutelle de son arrière grand mère Brunehaut. Clotaire II, fils de Frédégonde, ennemie jurée de Brunehaut, le fait mettre à mort et annexe la Bourgogne et l'Austrasie à la Neustrie réalisant ainsi l'unité du monde Franc.
► 613 CLOTAIRE II (613-629) - (Clotaire II roi des Francs)
► 613 Clotaire II. Fils de Chilpéric Ier et de Frédégonde, il n'a que quelques mois lorsque son père est assassiné. Sa mère assure la régence jusqu'à sa mort en 597. Elle défend la Neustrie contre Théodebert II et Thierry II, mais Clotaire II est battu en 604 et perd presque tout son territoire. Pourtant ses vainqueurs meurent en 612 et 613, il capture Brunehaut et Sigebert II (il a 12 ans) fils de Thierry II et les fait exécuter. Il s'empare de leurs territoires et réunit le royaume des Francs.
Pour obtenir leur assentiment, il lui fallu composer avec la noblesse. Il réunit à Paris une assemblée des Grands et un concile qui aboutissent à l'Édit de Clotaire, édit de paix, (614). Le roi s'engage à choisir les comtes (fonctionnaires royaux) parmi les propriétaires terriens (abandon du pouvoir à la noblesse terrienne). Les composantes du royaume, l'Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne gardent une certaine indépendance sous la domination du maire du palais qui est à la tête de l'administration. Ils deviennent de fait chefs de la noblesse. Son règne est une période de prospérité.
On voit l'émergeance d'une aristocratie terrienne. Clotaire II nomme à la tête de chaque territoire, Austrasie, Neustrie, Bourgogne un maire du palais. Il prend comme monétaire (l'homme qui fait frapper la monnaie royale) un excellent orfèvre, Éloi, (qui deviendra évêque de Noyon et Saint Éloi) qui essaie de remettre en ordre les finances publiques et comme référendaire (l'homme qui vérifie que les écrits au nom du roi peuvent être signés et scellés, actuellement le garde des sceaux) et chargé de missions importantes, Ouen évêque de Rouen (futur Saint Ouen).
La cour de Clotaire II est une pépinière à responsable, les jeunes de la noblesse et des grandes familles sont envoyés à la cour, ils sont intégrés à la maison royale où ils sont élevés comme les enfants du roi. Ils s'y faisaient connaître du roi et nouaient un réseau d'amitiés ce qui leur permettait d'obtenir des fonction importantes et d'accroître la fortune familiale. Le roi pouvait ainsi placer ces jeunes aux postes importants tout en étant certain de leur fidélité. Ces postes pouvaient être aussi bien civiles -comte- que religieux -évêque-.
► 613 Clotaire II fait exécuter Sigebert II et Brunehaut.
► 613 Mort de Brunehaut. - Les Austrasiens, de nouveau vaincus par les Neustriens de Clotaire II, fils de Chilpéric et de Frédégonde, la lui livrent et il la fait périr ignominieusement. Clotaire II réunit toute la monarchie. L'empire des Francs s'étend alors du Weser à la Garonne, comprenant les royaumes d'Austrasie, Bourgogne et Neustrie, qui ont chacun leur administration particulière.
► 613 Nouvelle unité politique sous Clotaire II et Dagobert (613-639). Saint Éloi et saint Ouen ministres. Saint Éloi (Eligius en latin) (v. 588 - 1er décembre 660), évêque de Noyon, orfèvre et monnayeur, il eut une fonction de ministre des finances auprès de Dagobert Ier. Né à Cadillac près de Limoges en Limousin vers 588, l'orfèvre Éloi devint monétaire de Clotaire II, puis trésorier de Dagobert Ier avant d'être élu évêque de Noyon en 641. Fondateur de monastères à Solignac et à Paris, il accueillit sainte Godeberthe comme moniale à Noyon. Il mourut le 1er décembre 660.
Il est aussi considéré comme le fondateur de l'abbaye du mont Saint-Éloi située à l'ouest d'Arras. Saint Ouen (609 à Sancy près de Soissons - 686 à Clichy) vécut à la cour de Clotaire II et de Dagobert Ier, qui lui confia la garde du sceau, et fut étroitement lié avec saint Éloi dont il écrivit la vie. Il ne fut tonsuré qu'à l'âge de 30 ans, et fut un an après sacré évêque de Rouen en 640. Il administra son diocèse avec sagesse, et mourut près de Paris, à Clichy, au lieu où fut depuis bâtie la ville de Saint-Ouen. Son corps fut transporté à Rouen et inhumé dans l'église qui a reçu son nom.
► 614 - 5 mai Les Perses s'emparent de la "Vraie Croix". Les Perses de l'empereur Chosroès II prennent Jérusalem, centre de pèlerinage chrétien, et s'emparent de la relique de la "Vraie Croix". 35 000 habitants seront vendus comme esclaves et les églises seront détruites. En 630, l'empereur byzantin Héraclius Ier, vainqueur des Perses à Ninive en 627, ramènera la Vraie Croix à Jérusalem. La ville tombera aux mains des musulmans en 638.
► 614 - 10 octobre Concile de Paris. (liberté des élections épiscopales, privilèges du for ecclésiastique, inviolabilité des biens de l'Église).
► 614 - 18 octobre Édit de Clotaire sur la liberté des élections épiscopales. Édit de Clotaire II sur l'administration publique, qui reconnaît l'hérédité des maires du Palais et décide que tous les hauts fonctionnaires doivent être originaires du territoire administré. Clotaire tente de rétablir l'ordre et l'équité dans son royaume. Cet édit, par ailleurs : * proclame la liberté des élections épiscopales. * précise qu'en l'absence du roi, l'évêque peut condamner un juge coupable. * intervient contre les abus des comtes qui cherchent à établir de nouveaux tonlieux à leur profit.
► 615 - Clotaire II confirme en faveur des leudes l'inamovibilité de leurs fiefs, et aux évêques l'élection par les fidèles et le droit d'être jugés par leurs égaux.
► 618 à 907 - Chine - Dynastie des Tang, treizième dynastie chinoise, les Tang ont régné de 618 à 907. Au lendemain d'une longue division entre le Nord et le Sud, cette dynastie fait retrouver à l'empire une taille et une unité qu'il avait perdu après les Han. Il brilla par son extension territoriale, sa civilisation pleine de vigueur et son large rayonnement.
► 622 - 15 juin : Le prophète Mahomet quitte la ville de La Mecque dont les habitants voulaient l'assassiner. La Mecque ou La Mekke est une ville de l'ouest de l'Arabie saoudite, située dans le désert du Hedjaz, à 80 km de la mer Rouge.
► 622 - 23 juin : Pacte d'Aqaba : les musulmans prêtent un serment de fidélité et d'obéissance à Mahomet. Aqaba ou Akaba est une ville côtière de 62773 habitants (1994) à l'extrémité sud de la Jordanie. Aqaba occupe une position stratégique pour la Jordanie car c'est le seul port du pays. La ville est mitoyenne d'Eilat, en Israël et un poste-frontière permettant de se rendre en Israël. Aqaba et Eilat sont à la pointe nord du Golfe d'Aqaba.
► 622 - 16 juillet : Fuite de Mahomet à Yathrib (Médine) : début de l'Hégire (exil). C'est l'Hégire, date de la fuite de Mahomet de La Mecque à Médine, Arabie saoudite, qui marque le point de départ du calendrier musulman, le point zéro de l'Islam. Hégire, le mot hégire signifie en arabe "émigration" ; le sens de "rupture de liens" est parfois rencontré.
Il désigne la journée du 16 juillet 622 où se produit le départ des quelques premiers compagnons de Mahomet de La Mecque vers l'oasis de Yathrib, ancien nom de Médine. Médine est une ville d'Arabie saoudite située dans le Hedjaz, à 594 mètres d'altitude. C'est là que vint s'installer Mahomet, le prophète de l'Islam, après qu'il eut reçu, selon le Coran, l'ordre de Dieu de quitter La Mecque. La Mecque ou La Mekke est une ville de l'Ouest de l'Arabie saoudite, située dans le désert du Hedjaz, non loin de la mer Rouge.
► 622 Haut Moyen Âge (622-987). La fin de l'Antiquité. Du IIIe au VIIe siècle de notre ère, l'empire romain est assailli par les Barbares d'Europe orientale. Il connaît de profondes transformations sociales, culturelles, techniques et politiques qui ne sont pas toutes négatives. D'où le nom d'Antiquité tardive que des historiens comme Henri-Irénée Marrou ou Jacques Le Goff donnent aujourd'hui à cette période. L'avènement d'Héraclius (610) et l'Hégire (622) marquent la fin véritable de l'empire romain et de l'Antiquité.
C'est l'époque où la partie orientale de l'empire romain, autour de Constantinople, se transforme en empire grec ou byzantin. Héraclius et ses successeurs renoncent à une illusoire reconquête de l'Occident. Ils concentrent leurs efforts dans la lutte contre les envahisseurs venus d'Orient : Arabes, Turcs,... C'est aussi l'époque où l'Europe occidentale, dominée par les rois barbares, entre dans la période la plus noire de son histoire. En Gaule et sur le Rhin, les rois mérovingiens qui succèdent à Clovis et Dagobert s'avèrent si insignifiants que la postérité les qualifiera de rois fainéants.
La péninsule arabe et l'Orient romain et persan sont bouleversés par l'expansion militaire de l'islam. En quelques décennies, la religion de Mahomet se répand des Pyrénées aux portes de la Chine. Cet événement majeur coupe en deux moitiés rivales le monde méditerranéen qu'avaient unifié les Romains. La ruine du commerce maritime accélère la décadence du réseau urbain hérité de Rome. En Occident, les centres de pouvoir se transfèrent du Midi vers le bassin rhénan, berceau de Charles Martel, Pépin le Bref et Charlemagne.
Il faut attendre les croisades, un demi-millénaire plus tard, pour que l'Occident rétablisse des liens réguliers avec l'Orient. À l'autre extrémité de l'Eurasie, la Chine se relève d'une longue décadence grâce à un nouvel empereur, Li Che-min, plus connu sous le nom de T'ai Tsong le Grand. Il fonde la dynastie des T'ang et rompt avec le passé. Depuis le XVIIe siècle, les historiens appellent faute de mieux Moyen Âge la longue période de l'Histoire occidentale qui court de la fin de l'Antiquité à la découverte de l'Amérique (1492). Le haut Moyen Âge désigne les siècles les plus obscurs de cette période.
Il débouche sur la division de l'ancien empire romain entre trois empires très différents : - l'empire byzantin, resté très proche du modèle antique, - l'empire arabo-musulman, en rupture avec le passé chrétien de l'Occident, - l'empire de Charlemagne, vague réminiscence de l'empire romain, marqué par ses racines germaniques et coupé de l'Orient antique du fait de l'invasion arabe. Le haut Moyen Âge se clôt aux alentours de l'An Mil avec l'émergence des États modernes et l'épanouissement en Europe d'une civilisation originale, la nôtre.
La tradition qui désigne l'année 476 comme marquant la fin de l'Antiquité n'a aucune signification historique en-dehors de l'Europe occidentale (l'année 476 se signale seulement par la déposition à Ravenne, en Italie, d'un enfant-empereur sans pouvoir). Cette tradition trouve son origine dans la volonté des historiens français du XIXe siècle de faire remonter les origines de leur pays à Clovis, roi des Francs et fondateur de la dynastie mérovingienne, qui vécut à cette époque (vers 465-511).
► 623 Dagobert, fils de Clotaire II devient roi d'Austrasie.
► 627 - 12 décembre Victoire d'Héraclius sur les Perses. L'empereur byzantin Héraclius écrase l'armée perse du souverain Chosroès devant Ninive en Mésopotamie. Il contraint les Perses sassanides à rendre l'Égypte à l'empire byzantin et entre triomphalement dans la capitale sassanide, Ctésiphon. Héraclius ramènera la relique de la vraie croix, volée par les Perses en 614, à Jérusalem.
► 629 - 18 octobre Mort de Clotaire II, son fils Dagobert prend la tête du royaume.
► 629 DAGOBERT Ier (629-639) - (Dagobert Ier roi des Francs)
► 629 Dagobert Ier. Fils aîné de Clotaire II et de Bertrude en conformité avec la coutume de l'aristocratie austrasienne, dominée par le maire du palais Pépin de Landen et l'évêque de Metz Arnoul, il fut nommé roi d'Austrasie en 623 (Clotaire ne mourra qu'en 629). Son nom Dagobert vient de Daghe-bert qui veut dire Guerrier Illustre. Il fait de Paris sa capitale et s'y installe. A la mort de son père, il reçoit la Neustrie et la Bourgogne mais doit concéder à son frère Caribert II l'Aquitaine sorte d'avant poste destiné à protéger le royaume contre les Basques réputés "peuple mauvais entre tous" qu'il récupèrera en 632 à la mort de son frère.
Suivant la règle il doit concéder l'Austrasie à son fils Sigebert qui a 3 ans et par précaution il attribua la Bourgogne et la Neustrie à son second fils Clovis II. Dagobert Ier est un des rares Mérovingiens à accéder au pouvoir à l'âge adulte. Pendant les 10 années de son règne il a joui d'un pouvoir absolu. Il fera reconnaître son pouvoir par les Saxons, les Basques et les Bretons et intervient dans les affaires wisigothiques. Il conclu en 631 un accord de paix avec l'empereur byzantin Héraclius. Dagobert conserve les hommes de confiance de son père comme Éloi et Ouen.
C'est sous son règne que s'unissent les deux familles de Pépin, maire du palais d'Austrasie et d'Arnoul évêque de Metz qui seront à l'origine de la dynastie des Carolingiens. Il crée de grands monastères dans les faubourgs de Paris, Saint-Germain-des-prés, Saint-Denis. L'abbaye de Saint-Denis devient le centre de la religion royale et il inaugurera le rôle de nécropole royale de la basilique qu'elle conservera jusqu'à la révolution.
La cour de Dagobert comme de Clotaire II son père, est une pépinière à responsable, les jeunes de la noblesse et des grandes familles sont envoyés à la cour, ils sont intégrés à la maison royale où ils sont élevés comme les enfants du roi. Ils s'y faisaient connaître du roi et nouaient un réseau d'amitiés ce qui leur permettait d'obtenir des fonction importantes et d'accroître la fortune familiale. Le roi pouvait ainsi placer ces jeunes aux postes importants tout en étant certain de leur fidélité. Ces postes pouvaient être aussi bien civiles -comte- que religieux -évêque- Il sera le dernier Mérovingien à régner pleinement par lui même.
► 629 Caribert II. Fils de Clotaire II et de Bertrude. A la mort de leur père, en 629 son frère Dagobert Ier lui constitue un royaume en Aquitaine. Il y règne pendant 3 ans et meurt ainsi que sa descendance.
► 629 à 639 - Règne de Dagobert, pendant lequel eurent lieu des expédit-ions heureuses contre les Saxons et les Bretons, et qui fut marqué par une véritable prospérité à l'intérieur. Dagobert eut pour ministres le célèbre saint Éloi, orfèvre, évêque de Noyon, saint Ouen, évêque de Rouen et Pépin de Landen qui fut la tige des Carolingiens. Fondation du duché d'Aquitaine en faveur de Caribert, frère de Dagobert. Pépin de Landen (vers 580-vers 640) fut maire du palais d'Austrasie sous trois rois mérovingiens mais Dagobert Ier lui retira le poste en 629. Il le reprit à la mort du roi en 639. Par sa fille Begga (620–695), il fut l'ancêtre des Pépinides qui donna naissance à la dynastie carolingienne.
► 629 Fondation de l'Abbaye de Saint-Denis, qui fut par la suite le lieu de sépulture des rois de France. Abbaye de Saint-Denis, célèbre abbaye construite au VIIème siécle, par le roi mérovingien, Dagobert Ier, qui la fit élever à l'endroit où, d'après la tradition, furent inhumés Saint Denis, le premier évêque de Paris, et ses deux compagnons, le prêtre Rusticus et le diacre Eleuthère, après avoir été décapités à Montmartre. L'abbaye est célèbre au point de vue historique.
Non seulement elle contient les tombeaux des anciens rois de France (on y remarque surtout les mausolées de Louis XII, d'Anne de Bretagne, de François Ier et de Henri II), mais elle fût associée aux grands évènements de l'histoire de France; C'est là que les rois allaient prendre l'oriflamme avant de partir en guerre. Saint Denis, Denis de Paris, Denis (Dionysius), venu d'Italie vers 250 ou 270 après J.-C. avec six compagnons pour évangéliser la France, aurait été le premier évêque de Paris (Lutèce), l'apôtre des Gaules.
► 629 Quelle est la situation de la France en ce début de VIIe siècle ? L'âge d'or de la paix romaine n'est plus qu'un souvenir. Venues de l'est au début du Ve siècle, des populations barbares ont franchi le Rhin. Non pas sur la forme d'une éruption brutale, en masse, mais par infiltrations successives. Progressivement, ces Germains ont envahi tout le territoire et précipité la fin de la civilisation gallo-romaine. Parmi les envahisseurs, les Francs. Issu de ce peuple, un homme d'exception s'est rapidement distingué. Païen, il s'est converti au catholicisme ; petit chef Franc, il s'est fait élire roi.
C'est Clovis, fondateur de la dynastie mérovingienne (du nom de son ancêtre plus ou moins légendaire Mérovée). On peut considérer Clovis comme le premier roi de l'Histoire de France. Dernier roi de cette lignée, Dagobert (603-639) est certainement le plus remarquable. Deux siècles seulement séparent l'avènement et la fin de la première dynastie royale en Gaule. Avec ses luttes civiles, ses heures de gloire et son déclin. Depuis Clovis, une lente fusion s'est opérée entre les populations gallo-romaines et franques, fusion qui a donné un nouveau visage à la Gaule.
Mais les souverains qui se succèdent n'ont pas les qualités pour s'élever à la notion d'État et de bien public. La loi germanique de partage du royaume entre héritiers a fortement contribué à le morceler. Les rivalités des princes, déchirés par des luttes fratricides sanglantes pour l'accession au trône, ont considérablement miné l'autorité monarchique. A la veille de l'avènement du roi Dagobert, la Gaule est affaiblie, la démographie en régression, l'agriculture en sommeil, le trésor royal dilapidé. Dagobert va redresser la situation.
Ce grand roi, administrateur né, va non seulement donner un coup de frein à la décadence mérovingienne mais susciter un véritable regain économique et culturel. A la suite de hasards dynastiques, le roi a réuni sous sa seule autorité une grande partie de la Gaule et de la Germanie. Du Danube à l'Atlantique, à l'exception de l'Armorique et de la Septimanie (Bas Languedoc), il est maître d'un vaste territoire qui comprend quatre entités : l'Austrasie à l'est, la Neustrie et l'Aquitaine à l'ouest, la Bourgogne au centre et jusqu'à la Méditerranée.
Unifiée, la Gaule n'en a pas moins des particularismes régionaux très affirmés. Dans le domaine linguistique notamment. De part et d'autre d'une ligne de partage qui serait la Loire, deux espaces géographiques s'opposent. Au nord, les parlers germaniques l'ont finalement emporté. Au sud, les parlers romans, héritiers du latin, ont survécu. Entre les mondes méditerranéens et les mondes germaniques, la Gaule au temps de Dagobert trouve un nouveau souffle et une paix relative. L'Église est le ciment de cet État, constitué d'une grande diversité de populations.
Entre paganisme, arianisme et foi catholique, le christianisme a triomphé. Doté par le roi et les grands du royaume qui, en lui accordant domaines et abbayes lui apportent la fortune, le clergé poursuit sa mission pastorale et évangélisatrice. La Gaule vit dans la ferveur religieuse. Tous les actes quotidiens sont empreints de religiosité. Mais certains restes de rites païens qui pourraient contaminer les pratiques chrétiennes sont fermement combattus. Éloi, évêque de Noyon, met en garde ses ouailles : "Que nul chrétien ne croie au bûcher superstitieux...
Que nul n'ose faire des cérémonies lustrales, ni enchanter les plantes, ni faire passer les bêtes par des arbres percés de part en part". Cependant, la tradition germanique a la vie dure dans les masses rurales. Pour échapper aux maux physiques et moraux qui les accablent, hommes et femmes portent des amulettes et des talismans d'origine animale ou végétale : défenses de sanglier, canines d'ours, coquillages, morceaux de résines et d'ambre. Évêques et abbés ne refusent pas de protéger et d'entretenir les paysans ou les citadins qui s'adressent à eux.
Mais l'Église encourage vivement les fidèles à vénérer les reliques et les tombeaux des saints pour s'assurer leur protection et y trouver le salut de leur âme. Qui mieux que les saints pouvaient être les intercesseurs efficaces entre Ciel et Terre ? Ainsi, les pèlerinages se multiplient au VIIe siècle. De nombreux pèlerins n'hésitent pas à faire le voyage jusqu'à Rome, ce qui contribue à resserrer les liens entre la Gaule et la papauté. A l'intérieur ou hors les murs des villes, églises et basiliques s'élèvent en toutes régions. Parlant de Lyon, l'évêque Avit remarque : "Cette ville est plus efficacement défendue par ses basiliques que par ses remparts".
Paris compte dix églises sur sa rive droite et quatre sur sa rive gauche. En plus de sa mission spirituelle, le haut clergé exerce un rôle temporel. L'abbaye ou le monastère est un véritable centre d'exploitation agricole qu'il faut gérer et enrichir. Aux moines qui instruisent les clercs on doit également le défrichement de nombreuses régions. Saint-Denis ou Fleury-en-Loire deviennent des pôles importants de développement économique. Les évêques doivent remplir également une fonction administrative. Ce sont des fonctionnaires, des agents du pouvoir royal au même titre que les comtes.
Qu'il soit laïc ou ecclésiastique, le personnel dirigeant du royaume sort généralement de l'aristocratie. Indistinctement le roi emploie l'aristocratie sénatoriale d'origine gallo-romaine, ou l'aristocratie franque composée des amis du prince qui se sont distingués jadis au combat et qui ont reçu des terres au moment du partage selon la tradition germanique. Le roi attire à la cour les fils de bonne famille de tous les coins du royaume. Sans règle précise de recrutement, les jeunes aristocrates viennent au palais (d'où leur nom de palatin), où l'on s'occupe de leur éducation en même temps que de celle des princes pour qui ils seront des compagnons (leudes) et plus tard des serviteurs dévoués aux futurs rois.
Mais la cour a une réputation de débauche. Éloignées de leurs enfants, les mères s'inquiètent et écrivent de pieux conseils à leur progéniture : "Choisis avec soin tes compagnons, aime et crains Dieu, garde avant tout la chasteté". A la cour, école de cadres, ils apprennent à être fonctionnaire ou soldat. Ceux qui sont distingués par le souverain pourront diriger la chancellerie et le trésor royal (chambellan), les écuries (connétable) ou l'ensemble de tous les services (maire du palais). Chargé de coordonner les activités des services domestiques et civils de la cour, le maire du palais va devenir un véritable premier ministre, et son pouvoir grandissant ira jusqu'à se substituer à l'autorité du roi.
Pour se faire respecter et lever les armées, le roi doit avoir un trésor important. Dans la "chambre" du trésor, l'or s'entasse sous tous ses aspects : monnaies, bijoux, vaisselles, lingots. Le souverain est fier de montrer à un invité de marque ses richesses, cadeaux de l'empereur de Byzance ou biens confisqués aux vaincus. Le produit des amendes, les levées d'impôts directs ou indirects sont un apport non négligeable au trésor royal. Le roi n'a pas de capitale fixe. Avec son entourage il se déplace de domaine en domaine, quittant l'un pour l'autre quand les ressources sont épuisées.
Mais ce nomadisme permet au roi d'inspecter son royaume, de recevoir les doléances de ses sujets qui en appellent au tribunal royal, de surveiller les comtes qu'il a nommés dans les provinces et qu'il peut révoquer en cas d'abus. Dans son fief, le comte détient tous les pouvoirs : administratif, financier (levée des impôts), judiciaire et militaire (levée des armées). Tout homme libre est un soldat en puissance qui doit être prêt à prendre les armes au service des grands. Juge équitable ou tyran, le comte a une autorité absolue sur la population rurale ou urbaine. Rare est celui qui n'en abuse pas, oubliant que son devoir, édicté par son suzerain, est d'être “particulièrement le défenseur de la veuve et de l'orphelin” avant de “châtier les larrons et malfaiteurs impitoyablement”.
La pitié n'est pas la qualité première des Francs. Au sein de la famille, le père était également un maître absolu ayant droit de vie et de mort sur ses enfants et pratiquant la vengeance privée (faida). Pour la faute d'un membre de la famille ou d'un voisin, on exigeait le "prix du sang". Afin de diminuer les excès, une nouvelle législation royale établit des amendes (wergeld) en manière de dédommagement. Proportionnel à la gravité du délit ou à l'échelon social de la victime, le wergeld est minutieusement tarifé : "Quiconque aura blessé quelqu'un de sorte que le sang coule, devra payer 15 sous d'or.
S'il est sorti trois esquilles, 30 sous d'or. Si le cerveau a été mis à découvert, 45 sous d'or". Tuer un noble franc coûte 600 sous d'or, un aristocrate gallo-romain, 300 seulement. Le monde rural n'a guère évolué au temps de Dagobert. La Gaule ne compte pas plus de cinq à six millions d'habitants. Les guerres liées aux invasions des siècles précédents mais aussi les famines, la tuberculose, les épidémies de peste et la mortalité infantile expliquent cette régression démographique. Dans les campagnes, les sols s'épuisent à donner de maigres récoltes. L'arrivée des Barbares n'a pas modifié les méthodes d'exploitation agricole.
L'araire reste l'outil médiocre du paysan. Il n'est pas rare de voir une femme attelée, faute d'un animal de trait. Une classe de petits propriétaires cultive directement ses terres. A côté de ces petites exploitations familiales ou manses (du latin manéo, demeure), les aristocrates mettent en valeur d'immenses propriétés, villae, qu'ils ont occupées par la force ou reçues de la générosité des rois. La main-d'oeuvre étant rare, ces grands propriétaires terriens font non seulement appel aux serfs mais aussi à des contingents d'esclaves. Ce sont des débiteurs insolvables ou des prisonniers que l'on a ramené d'expéditions militaires “attachés deux à deux comme on le faisait pour les chiens”.
Les grands domaines sont organisés sur le même modèle. Le seigneur des lieux, dominus, vit dans sa maison fortifiée, parfois richement décorée de mosaïques, entourée de thermes, d'une chapelle privée et prolongée par une cour fermée (pouvant atteindre 600 m²) où prennent place les bâtiments agricoles et les ateliers. Entre les villae, la forêt, qui a progressé au détriment des terres cultivées, couvre de très vastes étendues. Ces forêts peuvent former de véritables frontières naturelles entre les différentes parties du royaume. Refuge des hors-la-loi ou des ermites, elles ne sont pas laissées à l'abandon. Grands chasseurs, les rois y ont aménagé des réserves.
Eux seuls et l'entourage princier ont le droit de chasser les bêtes fauves : ours, sangliers, aurochs. Pour les paysans, la forêt est une source essentielle à l'alimentation (viande, baies, miel) et un lieu de pacage pour les troupeaux. Pour les citadins, le bois sert à alimenter les fours des "industries" du verre, de la poterie ou du métal. La vie économique reprend un certain élan. On commerce avec la monnaie sortie des ateliers royaux de monnayage et à l'effigie du souverain : sou, tiers de sou ou trientes. Hommes et marchandises circulent mieux sur le réseau ancien des routes gallo-romaines qui a été amélioré.
Les syri, marchands syriens et juifs de langue grecque, sont les intermédiaires actifs du grand commerce. Narbonne, Marseille, Bordeaux restent en liaison avec le Levant d'où provient du poivre, des soieries, des épices, des esclaves, des pièces d'or de Byzance. Des bateaux chargés de blé en vrac, de céramiques, de marbre pyrénéen voyagent jusqu'aux ports d'Espagne ou de Constantinople. Tout au long des routes marchandes, les villes repliées sur elles-mêmes à l'abri de leurs remparts au temps des invasions, s'ouvrent à nouveau vers l'extérieur. A la croisée des chemins et des trafics, des bourgs (vici) se sont partout implantés.
Des marchés assurent la circulation des produits agricoles, des foires animent et relancent les échanges. Des hospices routiers jalonnent les voies de pèlerinage et la qualité de leur administration témoigne du rôle important des moniales qui les dirigent. Presque entièrement réservée aux nobles dames ou princesses de l'entourage du roi, l'instruction des femmes s'est peu à peu développée. Les femmes lisent et écrivent, sont copistes dans les monastères ou auteurs de poèmes. Un nouveau courant poétique est né, stimulé en particulier par les femmes mais aussi par les évêques.
L'un des plus fameux, Loi, évêque de Noyon, orfèvre de métier, a contribué à la renommée de l'orfèvrerie mérovingienne et notamment du damasquinage. Au contact des lettrés ecclésiastiques mais aussi des aristocrates gallo-romains, la haute société franque a été gagnée par l'écrit (actes de vente ou de donation, brevets de nomination, testaments, édits royaux). Cependant les monastères restent le refuge des études au VIIe siècle et les principaux foyers de la vie culturelle. D'Irlande ou d'Italie des moines y viennent, apportant avec eux leur propre culture, échangeant idées et manuscrits, suscitant des embellissements dans l'architecture religieuse, provoquant un renouveau de la vie artistique et intellectuelle.
Cet éclat retrouvé au temps de Dagobert va être de courte durée. Après son règne, ceux que l'on nomme les "rois fainéants" seront entièrement livrés à la tutelle des maires du palais qui exerceront le pouvoir effectif. Ces rois enfants dont la plupart sont morts avant d'atteindre la majorité, vont précipiter la fin de la dynastie mérovingienne et permettre à un maire du palais, plus brillant que les autres, Charles Martel, de donner naissance à une nouvelle dynastie : les Carolingiens.
► 630 Les tribus croates arrivent en Illyrie. Selon la légende, sept tribus croates en provenance de la Haute Vistule (au sud de l'actuelle Pologne) traversent les Carpates pour s'installer au bord de l'Adriatique. Ils intègrent alors l'Empire Byzantin dirigé à cette époque par Héraclius pour lutter contre les Avars. C'est alors que le peuple d'origine Perse va s'installer sur les terres de l'actuelle Croatie. Mais la situation des Croates entre la zone d'influence romaine, les invasions avars et l'Empire Byzantin reste floue pendant le VIIe siècle. A la fois sous influence romaine et byzantine, les Croates seront les premiers slaves convertis au christianisme.
► 630 Victoire de Caribert contre les Basques. Caribert II, roi d'Aquitaine à partir de 629. Il est le demi-frère de Dagobert Ier. Il devient roi d'Aquitaine en 629 avec un royaume, concédé par Dagobert après un début difficile, qui comprend plusieurs comtés du Sud-Ouest menacés par les incursions des Basques. Il a Toulouse comme capitale. Son fils Childéric lui survivra - certains accuseront cependant Dagobert de l'avoir fait tuer - et reconstituera une principauté aquitaine autour de Toulouse.
► 631 Paix perpétuelle entre Dagobert et Héraclius. Héraclius Ier (né vers 575, règne de 610 à 641) fut un empereur de l'empire romain d'orient et le fondateur de la dynastie des Héraclides. Les Héraclides sont les soixante fils d'Héraclès, par extension ses descendants qui conquièrent le Péloponnèse, au sens restreint, les fils d'Hyllos, fils du héros et de Déjanire.
► 632 Mort de Caribert, Dagobert récupère l'Aquitaine.
► 632 Guerre entre les Slaves de Samo et Dagobert. Samo, un franc, fut roi de Bohême vers 623 à 658. Le règne de Samo est un moment identifié comme initiateur dans l'histoire de la Tchéquie, l'histoire de la Slovaquie et l'histoire de la Slovénie. Le Royaume de Samo (623-658), les Slaves établis sur les territoires des actuelles Moravie, Slovaquie et Autriche, en particulier, souffrirent au VIIe siècle de la domination des Avars sur la région et de la proximité des Francs à l'ouest : en 623, ils se révoltèrent et élirent un commerçant franc nommé Samo comme leur chef. Ce quasi-État disparut à la mort de ce dernier, vers 658, non sans avoir compris depuis les annés 630 la Bohême et la Lusatie.
► 632 L'alliance entre Dagobert et les Lombards n'empêche pas sa défaite face au Slaves.
► 632 mort du prophète Mahomet à Médine. Abou Bakr devient le premier calife de l'Islam. Abou Bakr, Abû Bakr “as-Siddîq” ben Abî Quhâfa, Abou Bakr, Abû Bakr ou Aboubéker était le beau-père de Mohammed (père d'Aïcha). Né à La Mecque vers 573, mort à Médine en 634, il fut le premier calife de l'islam, de 632 à 634.
► 632 La conquête arabe. Après avoir reçu la révélation, Mahomet donne aux Arabes une religion commune, l'islam, et leur impose l'unité politique en même temps que l'unité religieuse. Aussitôt après la mort du Prophète, les Arabes se font conquérants. En moins de dix ans (634-643), ils conquièrent la Syrie sur l'Empire byzantin, la Chaldée et de l'Assyrie sur l'Empire perse, l'Égypte, autre province byzantine, et enfin la Perse elle-même.
Arabes, l'identité arabe peut se définir de plusieurs façons : * Définition par l'identité ethnique : est arabe une personne qui se considère elle-même comme arabe (au regard de l'origine ethnique) et qui est reconnue en tant que tel par les autres. * Définition linguistique : est arabe une personne dont la langue maternelle est l'arabe (ou l'une de ses variantes). Cette définition inclut plus de 280 millions de personnes à travers le monde. La langue arabe appartient à la famille des langues sémitiques. * Définition généalogique : est arabe une personne qui établit que figurent parmi ses ancêtres des habitants de la Péninsule arabique. * Définition politique : est arabe une personne citoyenne d'un pays où la langue arabe est langue officielle ou nationale, ou pays membre de la Ligue arabe, ou pays faisant partie de ce qui est défini comme le monde arabe.
Cette définition recouvre environ 300 millions de personnes, mais exclut la diaspora. Avant le début de la conquête musulmane, les tribus arabes étaient donc essentiellement nomades, à l'exception notable de quelques régions où les Arabes avaient développé des civilisations urbaines, comme au sud de la péninsule arabique, en Mésopotamie, sur le territoire araméen, où ils avaient créé autant de petits royaumes (Palmyre, Pétra, etc.). Après la conquête de la péninsule arabique par l'Islam, les Arabes ont conquis aux VIIe et VIIIe siècles les régions voisines du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord.
Après leur conversion à l'islam, les Berbères conquirent l'Espagne où ils se sont maintenus près de huit siècles. Ils ont également occupé une petite partie du Sud de la France où ils se sont maintenus un siècle. La Sicile fut également conquise pour près de 250 ans et à peu près tous ses habitants se convertirent à l'islam jusqu'à ce que les armées chrétiennes et normandes ne récupèrent l'île, fondant le royaume de Sicile. Après avoir fondé Al-Andalus, les "maures" ont été repoussés de la péninsule ibérique lors de la Reconquista. Le Proche-Orient et l'Afrique du Nord demeurent aujourd'hui majoritairement peuplés d'arabes.
► 634 Sous la pression des Austrasiens, Dagobert nomme son fils Sigebert III (2 ans) roi d'Austrasie. Sigebert III, également connu sous le nom de saint Sigisbert, roi d'Austrasie, (631- 1er février 656), est le fils aîné de Dagobert Ier.
► 635 Naissance de Clovis II, fils de Dagobert. Clovis II, né en 633 ou 634 et mort en 657, il était le fils de Dagobert Ier et de Nanthilde. Il fut : * roi de Neustrie et roi de Burgondie de 638 à 657 ; * roi d'Austrasie de 656 à 657, et roi unique des Francs. Monté sur le trône, à l'âge de trois ans, c'est sa mère qui assure la régence, sous l'influence du maire du palais. Son règne s'est donc en partie déroulé sous l'influence des maires du palais de Neustrie – Ega et Erchinoald (ou Archambaud).
► 636 20 août : L'armée byzantine est écrasée par les Arabes à la bataille de Yarmouk. Byzance perd la Syrie, occupée par les musulmans jusqu'aux Monts Taurus. Les succès arabes sont favorisés par la négligence du basileus qui a refusé de payer ses mercenaires des marches syriennes, et par l'affaiblissement de l'empire perse qui vient d'être envahie par les Byzantins. La population de la Syrie comprend de nombreux éléments arabes qui se mêlent à l'armée d'occupation et se convertissent. Le pays est divisé en quatre djund dans lesquels les tribus participent à la vie économique. Les gouverneurs décident pour maintenir la stabilité du pays de limiter l'immigration aux clans apparentés aux tribus déjà présentes.
► 637 Le roi de Perse Yazdgard III tente de reprendre Al-Hira. Le général arabe Abu'Obayd traverse l'Euphrate à sa rencontre mais est écrasé sous les pattes d'un éléphant. Al-Mothanna regroupe les forces des musulmans, vainc les Perses devant Al-Hira puis retraverse le fleuve vers Ctésiphon. Le Perse Roustan tient bon et les Arabes doivent se regrouper au sud de Al-Hira. Renforcés par les troupes de Syrie, ils livrent une bataille décisive de trois jours à Al-Qadisiyya au printemps. Roustan, défait, meurt. Les Arabes prennent Ctésiphon (Mada'in) puis sont victorieux à Jaloula. Yazdgard III s'enfuit dans le Zagros.
► 638 Février : Conquête de Jérusalem par Omar disciple du prophète Mahomet. Les Juifs de Palestine désertent le pays après la conquête de Jérusalem. Création d'un lieu de prière musulman sur le mont du Temple à Jérusalem (Aelia). Omar, Umar Ier, Umar ben Al-Khattab ben Nafîl ou Abû Hafs “al-Fârûq” Umar ben Al-Khattab (vers 581-644) compagnon du prophète Mahomet il devint le second calife de l'Islam en succédant à Abou Bakr en 634. Il fait partie du clan Banu Ad de la tribu Quraych.
► 639 - 19 janvier Mort de Dagobert Ier. Dagobert Ier décède d'une colique à l'âge de trente-six ans après avoir lancé à ses chiens (qu'il préférait aux hommes) : "Il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte". Il est inhumé à Saint-Denis. Son fils, Clovis II, devient roi de Neustrie et de Bourgogne. L'Austrasie reste à Sigebert III, son frère.
► 639 SIGEBERT III et CLOVIS II (639-656) - (Sigebert III roi d'Austrasie - Clovis II roi de Neustrie, de Bourgogne)
► 639 Sigebert III. Nommé dès l'âge de 3 ans roi d'Austrasie par son père Dagobert Ier, il le reste à la mort de celui-ci en 639 il n'a que 8 ans. Il règne sous la tutelle de Pépin de Landen maire du palais de 639 à 640 date de sa mort puis son fils Grimoald qui lui succèdera. En 643 (il a 12 ans) il adopte le fils de Grimoald, Childebert, mais en 652 il aura un fils Dagobert II. Grimoald exilera le fils de Sigebert au profit de son fils, mais il seront éliminés par les grands de Neustrie en 662.
► 639 Clovis II. Il succède à son père Dagobert Ier en 639 il a 4 ans, le royaume avait été partagé entre lui et son frère Sigebert du vivant de leur père. Il devient roi de Neustrie et de Bourgogne sous la tutelle de sa mère Nantechilde et des maires du palais successivement Aega et Erchinoald (aristocrates neustriens). Il épouse en 651 Bathilde (future sainte Bathilde). Son fils Clotaire III né l'année suivante, lui succèdera à sa mort en 657.
► 639 Pépin de Landen, maire du palais en Austrasie, s'empare du pouvoir, le successeur de Dagobert, Sigebert III, étant encore mineur. Grimoald, fils de Pépin de Landen, lui succède et, à la mort de Sigebert III, tente de faire couronner son propre fils, mais il est assassiné par les Francs fidèles à la famille de Dagobert. Dagobert laissait deux fils: Sigebert III et Clovis II qui furent les premiers rois fainéants, ainsi surnommés parce qu'ils laissaient le gouvernement aux mains des maires du palais. Clovis Il épousa sainte Bathilde.
Ces deux princes moururent en 656. Clovis II laissait trois fils: Clotaire III, Childéric II, Thierry III. Rois fainéants, l'appellation de "rois fainéants" a été attribué après coup aux rois francs mérovingiens à partir de 639, fin du règne de Dagobert Ier. Cette fin de dynastie, marquée par des règnes très courts, de souverains souvent très jeunes - conséquences de nombreuses querelles de succession - amena une période d'instabilité politique où le pouvoir fut détourné par l'aristocratie, et notamment par les maires de Palais, dont notamment Charles Martel et Pépin le Bref, qui finira par fonder sa propre dynastie, celle des carolingiens, avec la naissance de son fils Charles (futur Charlemagne). Le brillant et rapide renouveau du royaume français qu'apportera Charlemagne fit paraître, par contraste, la fin de règne des mérovingiens comme une période trouble de l'histoire de France.
► 639 Début du "règne des maires du palais", Pépin de Landen en Austrasie et Aega en Neustrie.
► 640 Mort de Pépin de Landen, Otton lui succède.
► 641 Erchinoald remplace Aega à la tête du palais de Neustrie. Erchinoald, maire du palais de Neustrie de 641 à 658. Il succèda à Aega comme maire du palais. Il offrit au roi Clovis II, Bathilde, une anglo-saxonne achetée, esclave, à York. Le roi l'épousa ce qui renforça la position d'Erchinoald.
► 641 Rodolphe, duc de Thuringe proclame l'indépendance de son duché.
► 641 Défaite de Sigebert face à Rodolphe.
► 642 Les Arabes font la conquête de l'Égypte et fondent la nouvelle capitale, Fostat (Le Caire).
► 642 Victoire des arabes musulmans sur l'empire sassanide à la bataille de Nahavand. Cette bataille marque la fin de l'empire Sassamide. La bataille de Nahavand a eu lieu en 642 entre les arabes musulmans et l'empire sassanide. Les arabes furent victorieux, ce qui conduisit à la destruction de l'Empire sassanide et à la dispersion de l'Islam en Perse.
► 643 Grimoald, fils de Pépin de Landen devient maire du palais d'Austrasie après l'assassinat d'Otton. Grimoald Ier (616-†v.662), fils de Pépin de Landen dit le Vieux et Itta, maire du palais d'Austrasie (643-v.662). Assassiné à Paris. Avec la mort de Pépin de Landen en 640, Grimoald, devient le chef du lignage pépinnide. À cette époque, Radulf, duc de Thuringe, s'est rebellé contre Sigebert III. Grimoald participe à l'expédition mené contre ce dernier, expédition qui se solde par un échec.
Grimoald sauva la vie du roi et devient son ami. Puis, faisant éliminer le maire du palais en fonction, Otton, par un complice, il devient à son tour maire du palais d'Austrasie. Grimoald convainc le roi, qui n'avait pas d'enfant, d'adopter son fils baptisé Childebert. À la mort de Sigebert, son fils monte sur le trône mais ils ne tardent pas à être tous deux éliminés vers 662 par les Neustriens menés par le roi Clovis II et son maire du palais Erchinoald qui avaient des vues sur l'Austrasie.
► 651 Écriture du Coran. Première recension écrite du Coran à Médine sous la direction de Zayd. Des recensions concurrentes auraient existés, notamment le récit de Ubayy, un autre secrétaire de Mahomet, dont la recension est à l'honneur à Damas, celle d'Ibn Masud, compagnon du prophète opposé à l'opération d'unification et celle d'Ali (chiites). Le Coran est un livre, sacré selon les musulmans orthodoxes, qui regrouperait les paroles divines transmises au prophète Mahomet par l'archange Gabriel. Les croyants de l'islam le considèrent généralement comme incréé.
Cette Révélation faite à Mahomet s'est déroulée sur une période de vingt-trois ans. Le Coran est le livre le plus sacré des musulmans, les autres livres sacrés dans l'islam étant les Évangiles, les Psaumes, la Torah et les Feuillets d'Abraham, et est le premier livre à avoir été écrit en langue arabe, qu'il a contribué à fixer. Il regroupe les paroles divines qui, selon la croyance musulmane, ont été transmises au prophète Mahomet fragmentairement par l'archange Gabriel par voie auditive durant une période de vingt-trois ans. Il est parfois également appelé kitâb (livre) ou dhikr (rappel). Les musulmans le considèrent comme la parole incréée de Dieu (Allah) adressée à l'intention de toute l'Humanité.
► 654 Fondation de l'abbaye de Jumièges. L'abbaye de Jumièges (Seine-Maritime) fut fondée par Saint Philibert, fils d'un comte franc de Gascogne. Saint Philibert (Filibert) (VIIe siècle) a fondé les monastères de Jumièges et Noirmoutier. Il imposait jeûne, flagellation et pénitence. Il avait quitté la cour du roi Dagobert pour se faire moine d'abord à Rebais dans la Brie française. Plus tard il fonda un monastère à Jumièges près de Rouen.
Quand il apprit que Ébroïn, le maire du palais, avait fait assassiner Saint Léger d'Autun, il alla reprocher son crime au maire de Neustrie. Ébroïn chargea Saint Ouen de le faire disparaître. L'évêque de Rouen obéit, le fit emprisonner, mais la captivité fut douce et dura peu, car Ébroïn fut assassiné à son tour. Saint Philibert remercia Saint Ouen de son hospitalité, l'assura de sa parfaite amitié et prit le chemin du monastère de Noirmoutier. Mort à Noirmoutier le 20 août 685, à l'âge de 70 ans, son corps a été déposé dans un sarcophage.
► 656 Mort de Sigebert III, Grimoald après avoir exilé Dagobert II, fils de Sigebert III en Irlande, place son propre fils, Childebert l'Adopté sur le trône. Childebert l'Adopté (?-†662), fils de Grimoald Ier, maire du palais d'Austrasie (656-v.662). Adopté par le roi d'Austrasie Sigebert III, il fut lui-même roi d'Austrasie de 656 à 662.
► 656 CHILDEBERT l'Adopté et CLOVIS II (656-657) - (Childebert l'Adopté roi d'Austrasie, Clovis II roi de Neustrie, de Bourgogne)
► 656 Childebert l'Adopté. Fils de Grimoald maire du palais d'Austrasie, il avait été adopté par Sigebert III qui avait 12 ans à cette époque (643) et régnait sous la tutelle de Grimoald. En 652 Sigebert eut un fils Dagobert II qui aurait du régner lorsque son père est mort en 656 mais Grimoald exila Dagobert II (il n'avait que 4 ans à la mort de son père) et plaça son propre fils Childebert sur le trône d'Austrasie. Une fois de plus les grands de Neustrie interviennent en 662 et mettent à mort Grimoald et son fils. Ils mettront sur le trône Childéric II, deuxième fils de Clovis II.
► 656 Ébroïn est nommé maire du palais de Neustrie.
► 656 Juin : Ali ibn Abi Talib succède à Uthman, calife à Médine (656-661). Uthman (Othman) voit sa politique de collaboration avec les peuples vaincu pour l'administration de l'Empire contestée en Égypte et en Syrie par les partisans d'Ali. Il est assassiné le 17 juin par le frère d'Aïsha (fille d'Abu Bakr et femme préférée du Prophète). Ali s'impose à Médine comme son successeur. Il obtient rapidement le soutient des trois grandes villes musulmanes (Basra, Kûfa et Fustât). Mais il est soupçonné d'avoir commandité le crime d'Uthman.
Ali ibn Abi Talib est le fils d'Abû Tâlib, oncle du prophète Mahomet, qui l'a élevé et protégé comme son propre fils, après la mort de son grand-père Abd Al-Mottalib. Il est né vers 600 à la Mecque, dix ans avant le début de la mission prophétique de Mahomet. À l'âge de six ans, il quitta la maison de son père pour se mettre sous la protection du prophète. Il a été à la fois le cousin, le frère spirituel, le disciple et le gendre de Mahomet en épousant sa fille Fâtima née de sa première épouse Khadija en 622.
Il a été le quatrième calife "orthodoxe" de l'islam (656-661). Alî a été le premier et le père de tous les imâms. Il fut le père de Hasan et de Hussein. Uthman ben Affan est le troisième calife de l'islam (644-656), successeur d'Abû Bakr et d'Omar. Selon la tradition, il est le premier mecquois converti à l'islam. Il s'est converti avant l'hégire et il a participé au premier exil des musulmans en Abyssinie en 620. Ses relations avec Mahomet sont excellentes.
► 656 Décembre : Bataille du chameau en Arabie. Muawiya, allié d'Aïcha et leurs partisans (Talha et Zoubayr, de la Mecque) se soulèvent contre Ali mais sont battus à la bataille du Chameau où Aïcha est faite prisonnière. La bataille du chameau est une des batailles entre les premiers musulmans, opposant le clan des quraychites majoritaires à La Mecque aux fidèles d'Ali. Elle a lieu en décembre 656 près de Bassora. À l'issue de cette bataille, Ali est vivant et les deux chefs de l'insurrection morts. Mais personne n'est vraiment vainqueur, le côté légendaire du récit de cette bataille laisse entendre que Dieu a soutenu Aïcha qui en sort confortée dans ses prétentions et son soutien à la famille Omeyyade.
Aïcha, fille d'Abou Bakr, née à La Mecque vers 614, morte à Médine en 678, fut la troisième épouse de Mahomet. Muawiya Ier, est né en 603. Il est le fils de l'un des plus farouches adversaires du prophète Mohammed : Abû Sufyân ibn Harb. Il est le premier ommeyyade à porter le titre de calife en 661. Il prend ce titre à Ali à la suite d'une médiation entre Ali et lui après la bataille de Siffin. Il meurt en 680, son fils Yazid Ier lui succéde. Les Omeyyades ou Umayyades sont une dynastie de califes qui gouvernèrent le monde musulman de 661 à 750, établissant leur capitale à Damas. Ils tiennent leur nom d'un de leurs ancêtres, Omayya, grand-oncle de Mahomet.
Ils appartenaient à la tribu des Quraychites, tribu dominante à La Mecque au temps du prophète Mohammed. Après s'être opposés à celui-ci, ils l'avaient rejoint au dernier moment. Les Omeyyades étaient liés avec le troisième calife, Uthman. Quand celui-ci fut assassiné par des opposants qui portèrent au pouvoir Ali, cousin et gendre de Mohammed, tous ceux qui étaient liés à Uthman crièrent vengeance, notamment l'Omeyyade Muawiya, qui était alors gouverneur de Syrie. À la suite de quelques combats, Ali fut écarté du pouvoir en Syrie par un arbitrage, et Muawiya fut proclamé calife par les Syriens en 661. Ali ayant été assassiné par les Kharidjites, ses anciens partisans, plus rien ne s'opposa ensuite au règne des califes omeyyades.
► 657 Mort de Clovis II, son fils aîné Clotaire lui succède sous la régence de sa mère Bathilde.
► 657 CHILDEBERT l'Adopté et CLOTAIRE III (657-662) - (Childebert l'Adopté roi d'Austrasie, Clotaire III roi de Neustrie, de Bourgogne)
► 657 Clotaire III. Fils aimé de Clovis II, il n'a que 5 ans lorsque son père meurt. Il devient roi de Neustrie et de Bourgogne et règne sous la tutelle de sa mère Bathilde. Ébroïn, qui est fait maire du palais en 658 prend de fait le pouvoir.
► 657 à 670 - Règne de Clotaire III en Neustrie. - Ébroïn, maire du palais, gouverne à partir de 659, jusqu'en 681; à la mort de Clotaire, il fait élire pour lui succéder Thierry III, dont l'autorité reste précaire jusqu'en 673.
► 657 Fondation de l'abbaye de Corbie (fondée par la reine régente Bathilde). Corbie, ville située à 15 km d'Amiens, dans le département de la Somme (80). Bathilde, ou Batilde ou encore Bathylle, est née vers 626 et morte le 30 janvier 680, à Chelles, est une reine des Francs, épouse de Clovis II.
► 660 Mort de saint Éloi.
► 660 11 février Naissance de l'Empire du Japon. Après avoir vaincu le royaume Yamato, le prince Jimmu Tennô monte sur le trône du Japon et fonde l'empire japonais. Jimmu Tennô est, selon la légende, un descendant de la déesse solaire Amaterasu Omikami, divinité majeure du culte shintô. Tous les souverains de l'histoire japonaise se réclament de Jimmu Tennô.
► 660 à 740 - naissance et mort de Saint André de Crète, évêque dans l'île de Lesbos. André naquit dans une famille arabe chrétienne de Damas. La ville est sous domination musulmane depuis une trentaine d'années. Est-ce cette enfance dans une communauté d'autant plus fervente qu'elle est minoritaire, qui lui donne le goût de l'absolu ? A 15 ans, il entend l'appel : "Quitte ton pays et la maison de ton père". Le voilà à Jérusalem, moine au Saint Sépulcre.
Au bout de dix ans de vie monastique, il a suffisament manifesté sa valeur pour être envoyé, avec deux autres moines, à Constantinople afin de représenter le patriarche de Jérusalem auprès de l'empereur byzantin. Il s'agit de défendre la légitimité du 6ème concile oecuménique qui reconnaît deux volontés (humaine et divine) dans le Christ. Demeuré à Constantinople, André dirige l'orphelinat de la ville pendant quelque temps. Vers 700, on le nomme évêque de Gortyne en Crète. Il entreprend d'instruire ses fidèles par sa prédication où s'exprime son amour pour la Mère de Dieu.
Il s'occupe aussi des enfants (souvenir de l'orphelinat de Constantinople). Durant la crise iconoclaste, il prend la défense des Saintes Images comme son compatriote saint Jean Damascène. André est surtout connu pour son oeuvre liturgique. Il crée la forme du Canon, grande hymne de la liturgie byzantine et compose "le Grand Canon", chanté en Carême dans les églises de rite byzantin: on dit que ce Canon pénitentiel aurait pour origine le repentir d'un acte personnel de lâcheté à Constantinople.
► 662 Assassinat de Grimoald et de Childebert l'Adopté, Clotaire III reste seul roi.
► 662 Childéric II, frère de Clotaire III est nommé roi d'Austrasie.
► 662 CLOTAIRE III (662-673) et CHILDÉRIC II (663-673) - (Clotaire III roi de Neustrie, de Bourgogne - Childéric II roi d'Austrasie)
► 662 Childéric II. Deuxième fils de Clovis II, il est placé sur le trône d'Austrasie après l'élimination de Childebert l'adopté et de son père Grimoald par les grands de Neustrie. Il n'a que 9 ans et règne sous la tutelle de sa tante, la femme de Sigebert III, Himnechilde. Il chasse le roi de Neustrie, son frère Thierry III et réunit tout les états francs sous son pouvoir, mais assure les nobles que chaque régions gardera une certaine autonomie et que notamment il ne nommerait pas dans chacune des régions des dirigeants d'autres régions. Il ne tint pas sa parole et voulu regrouper les deux régions sous l'autorité d'un seul maire du palais Wulfoald. Une fois de plus les grands de Neustrie interviennent, il est exécuté en 675 en forêt de Lognes ainsi que sa jeune femme enceinte.
► 662 à 673 - Règne de Childéric II sur l'Austrasie et la Bourgogne. - Seul roi en 673, il eut pour conseiller saint Léger. Il périt assassiné en 673 par un de ses leudes (Bodilon). Saint Léger (616-678) Évêque d'Autun. A la mort de Clovis II, il fut le conseiller de la régente, sainte Bathilde, jusqu'au sacre de son fils. Nommé évêque d'Autun en 659, il s'attacha à réformer la discipline ecclésiale et donna à toutes les abbayes de son diocèse l'ordre de suivre la règle de Saint Benoît.
Il fit preuve de grandes qualités d'administrateur, tout en défendant l'autonomie de la Bourgogne. À la mort de Clotaire III, fils de Bathilde, Ébroïn, le maire du palais, décida de donner la couronne de Neustrie à Thierry III, le frère de Clotaire III, sans consulter les aristocrates burgondes. Ceux-ci, mécontents, se révoltèrent sous la conduite de Léger et firent appel à Childéric II, roi d'Austrasie. Thierry fut confié aux moines de Saint-Denis, Ébroïn exilé au monastère de Luxeuil. Le parti burgonde l'ayant emporté, saint Léger devint un temps conseiller du roi Childéric II, avant de tomber à son tour en disgrâce et d'être envoyé au monastère de Luxeuil, où il retrouva son éternel adversaire, Ébroïn.
À la mort de Childéric en 675, l'évêque d'Autun et l'ancien maire du palais quittèrent Luxeuil et rejoignirent leurs partisans. Léger fit sortir Thierry III de Saint-Denis et lui donna la couronne de Neustrie. Ébroïn, soutenu par les Austrasiens, s'empara du trésor royal et assiégea Autun. Voyant que la ville allait tomber aux mains de l'ennemi, Léger se rendit. Ébroïn lui fit crever les yeux, arracher les lèvres et la langue, avant de l'exposer sur la place publique. Léger se retira ensuite à l'abbaye de Fécamp d'où Ébroïn le fit sortir pour le juger à nouveau. Accusé du meurtre de Childéric II, Léger fut livré au comte Chrodobert qui le fit décapiter dans la forêt de Sarcing, près d'Arras. Au lendemain de sa mort, il fut considéré comme un martyr.
► 670 Okba ibn Nafi édifie Kairouan. L'émir Okba Ibn Nafi fonde la cité de Kairouan. Quelques années plus tôt, les Arabes avaient déjà profité de l'instabilité régnante sous les Byzantins pour occuper les terres. Cette édification marque plus concrètement leur domination et provoquera de fortes révoltes berbères. Les combats aboutiront malgré tout à la prise arabe de Carthage en 695.
► 670 à 1300 - Art de l'Islam. Art islamique, le terme art islamique désigne la production artistique ayant eu lieu depuis l'hégire (622 de l'ère chrétienne) jusqu'au XIxe siècle dans un territoire s'étendant de l'Espagne jusqu'à l'Inde, et habité par des populations de culture islamique. L'art islamique présente une certaine unité stylistique, due aux déplacement des artistes, des commerçants, des commanditaires et des oeuvres. L'emploi d'une écriture commune dans tout le monde islamique, et la mise en valeur particulière de la calligraphie renforce cette idée d'unité.
Toutefois, la grande diversité des formes et des décors, selon les pays et les époques, amène souvent à parler plus d'arts de l'Islam que d'un art islamique. L'architecture crée des bâtiments aux fonctions très spécifiques à ces régions, comme des mosquées et des madrasas, celles-ci prenant des formes très variées. S'il n'existe quasiment pas d'art de la sculpture, le travail des objets de métal, d'ivoire ou de céramique atteint fréquemment une grande perfection technique. Il faut aussi souligner la présence d'une peinture et d'une enluminure présentes dans les livres sacrés et profanes.
L'art islamique n'est pas un art proprement religieux : l'Islam est ici considéré avec une majuscule, comme une civilisation et non comme une religion. Contrairement à une idée reçue, il y existe des représentations humaines, animales, et même du Prophète : celles-ci ne sont bannies que dans les lieux ou ouvrages religieux (mosquées, madrasas, Corans), en dépit de quelques exceptions.
► 673 Mort de Clotaire III.
► 673 CHILDÉRIC II (673-675) - (Childéric II roi d'Austrasie occupe la Neustrie)
► 673 Ébroïn, maire du palais de Neustrie, porte Thierry III sur le trône, provoquant la colère des grands du royaume. A la mort de Clotaire III, Ébroïn, qui craint l'intervention des Grands, fait monter sur le trône de Neustrie Thierry III, troisième fils de Clovis II et Bathilde, et contraint cette dernière à se retirer dans un couvent. Childéric II, désigné par les Grands, envahit la Neustrie. Ébroïn sera vaincu et interné à Luxeuil par Childéric et une coalition dirigée par Wulfoald et saint Léger. Childéric devient seul roi des Francs. L'autorité des Grands prend un caractère héréditaire. La mairie du palais est supprimée en Neustrie et en Bourgogne.
► 673 Thierry III est emprisonné à l'abbaye de Saint-Denis, Saint Léger et Ébroïn au Monastère de Luxeuil.
► 674 Les Arabes assiègent Constantinople. Régnant dans la lignée des Héraclides, l'empereur Constantin IV Pogonat doit faire face aux attaques des Arabes, lesquels se sont lancés dans la conquête de l'Orient au nom de l'islam. Ayant déjà repris la Syrie, la Mésopotamie, l'Arménie et l'Égypte, ils atteignent les murs de Constantinople. Durant quatre ans, les Arabes assiègeront la ville, dont la détermination à résister ne faiblira pas. Constantinople possède, de plus, une arme inégalable : le feu grégeois. Mélange inflammable même sur l'eau, elle lui permettra finalement de mettre ses ennemis en déroute. Mais ces derniers ne s'en tiendront pas là, puisqu'ils assiègeront une nouvelle fois la ville en 717.
► 675 Assassinat de Childéric II par Bodilon dans la forêt de Chelles. Le roi Childéric II se débarrasse de saint Léger qui est enfermé à Luxeuil, ce qui provoque son assassinat par Bodilon : Childéric et sa femme Bilichilde, enceinte, sont égorgés lors d'une chasse dans la forêt de Bondy, à l'est de Paris, par les nobles révoltés. Ses partisans quittent la Neustrie pour l'Austrasie.
► 675 Évasion de Léger et Ébroïn du monastère de Luxeuil et ils rétablissent Thierry sur le trône.
► 675 THIERRY III (675-676) - (Thierry III roi de Neustrie)
► 675 Thierry III. Nous arrivons dans une période très troublée annonçant la fin de la dynastie Mérovingienne, depuis Childebert II, la moyenne de la durée de vie des rois mérovingiens qui était jusqu'alors de 46 ans tombe à 28 et l'âge d'accession au trône passe de 18 ans à 9 ans et demi. Il devient évident qu'ils ne vont plus être que des jouets dans les mains de régents plus ou moins officiels. On peut voir que Clotaire II et Dagobert Ier font figure d'exception puisqu'ils ont vécu 45 et 35 ans et ont eu un règne personnel. Les maires des Palais deviennent souvent les vrais rois, certains en feront un usage discret d'autres auront beaucoup moins de scrupules.
En 658 Ébroïn devient maire du palais de Neustrie pendant le règne de Clotaire III, il gouverne en ses lieux et places ce qui n'est pas du goût de l'aristocratie neustrienne, lorsque Clotaire meurt en 673 Ébroïn place sur le trône le troisième fils de Clovis II, Thierry III. Les grands de Neustrie et Childéric II second fils de Clovis II qui a été mis à la tête de l'Austrasie renversent Thierry III le relègue au monastère de Saint Denis et Ébroïn est enfermé au monastère de Luxeuil. Childéric II devient roi des Francs. En 675 Childéric II meurt, il est remplacé sur le trône d'Austrasie par Dagobert II mais en Neustrie, Clovis III, dont la filiation avec Clotaire III est très incertaine est placé sur le trône. Il n'y restera qu'une année.
Ébroïn redevenu puissant réintègre Thierry III sur le trône de Neustrie et de Bourgogne sous sa tutelle évidemment. En Austrasie Dagobert II retrouvé a été replacé sur le trône en 676 mais il meurt en 679. A cette date Thierry III devient roi des Francs mais l'année suivante Pépin de Herstal s'empare de la mairie d'Austrasie. La guerre entre Neustrie et Austrasie est déclenchée, Ébroïn remporte une victoire contre Pépin en 680 mais elle n'est pas décisive. En 683 Ébroïn est assassiné. En 687 Thierry est écrasé par Pépin à Tertry. Pépin de Herstal devient le maître du royaume franc mais laisse Thierry sur le trône. Il mourra en 691
► 675 Clovis III. Lorsque Childéric II meurt en 675, le maire du palais Ébroïn, installe sur le trône d'Austrasie, un soit disant fils de Clotaire III, Clovis III mais la filiation avec Clotaire était plus que douteuse. Il n'y restera qu'un an et disparaîtra.
► 675 Avènement de Thierry III qui réunit toute la monarchie franque, et règne sous la tutelle d'Ébroïn.
► 675 Thierry III accède à la tête du royaume Franc.
► 676 Dagobert II est rappelé par les Austrasiens.
► 676 THIERRY III et DAGOBERT II (676-679) - (Thierry III roi de Neustrie - Dagobert II roi d'Austrasie)
► 676 Dagobert II. Lorsque son père, Sigebert III meurt, le maire du palais Grimoald qui avait fait adopté son fils Chidebert par le roi, fait disparaître Dagobert qui avait 4 ans afin de mettre son fils sur le trône. Dagobert est envoyé, à l'insu de sa mère, qui le croira mort, à Poitiers chez l'évêque Didon puis il sera recueilli par l'évêque d'York Wilfrid (futur saint) et mis dans le monastère irlandais de Slane.
Childebert et son père Grimoald sont assassinés par les grands de Neustrie en 662. Le royaume est attribué à Childeric II, second fils de Clovis II en 673, Clotaire III roi de Neustrie et de Bourgogne meurt, Childéric II devient roi des Francs mais meurt à son tour en 675; Les grands d'Austrasie ont appris que Dagobert II n'est pas mort, ils le font chercher et l'installe sur le trône d'Austrasie (676) pendant que Thierry III est mis sur le trône de Neustrie et de Bourgogne. Dagobert II est assassiné 3 ans plus tard. Pépin de Herstal dit Pépin le jeune prend le pouvoir.
► 678 Saint Léger est capturé après le siège d'Autun par les armées d'Ébroïn. Ébroïn quitte l'abbaye de Luxeuil, tue Leudesius, met en sécurité le jeune Thierry III. Tout le personnel du palais de Neustrie est transformé. l'évêque d'Autun saint Léger est torturé, aveuglé, déposé et assassiné par Ébroïn. Ses partisans se réfugient en Aquitaine.
► 679 Défaite de l'armée austrasienne devant celle de Thierry III et Ébroïn.
► 679 décembre Assassinat de Dagobert II.
► 679 THIERRY III (679-690) (Thierry III roi des Francs (en fait unique-ment de Neustrie), l'Austrasie étant aux mains de Pépin de Herstal)
► 680 à 687 - Ébroïn est assassiné après sa victoire à Latofao, sur le maire du palais d'Austrasie, Pépin de Herstal (petit-fils de Pépin de Landen). Les Neustriens commandés par Berthaire, successeur d'Ébroïn, sont définitivement battus à Testry par Pépin de Herstal; Berthaire y perd la vie (687). - Pépin de Herstal gouverne seul. Pépin de Herstal, Pépin II de Herstal ou Pépin le Jeune est maire du palais d'Austrasie. Il est le fils d'Ansegisèle (lui-même fils de Saint Arnoul) et de Begga, fille de Pépin de Landen.
► 680 Pépin de Herstal devient maire du palais d'Austrasie.
► 680 Assassinat d'Ébroïn par Waratton, il le remplace en tant que maire du palais. Waratton, maire du palais de Neustrie (680). Déposé un temps par son fils.
► 680 Fondation du chiisme par les Alides. Alides est le nom donné aux descendants d'Ali, et plus spécialement aux Imams. Le chiisme qui regroupe environ 10% des musulmans constitue l'une des trois principales branches de l'islam avec le sunnisme et le kharijisme. Le terme "chiisme" vient de l'expression arabe chiat Ali, qui signifie "les partisans d'Ali". Ali ibn Abu Talib était le beau-fils du prophète Mahomet et le quatrième calife de la nouvelle communauté islamique (umma) après la mort de Mahomet.
Les sunnites le vénèrent également comme le dernier des "quatre califes vertueux". Ainsi que tous les groupes islamiques, les chiites actuels considèrent leur forme d'islam comme la plus pure représentation de la religion originelle de Mahomet. Les premiers chiites étaient en désaccord avec les principes politiques de la nouvelle religion et notamment avec le mode de succession au califat. Ils étaient simplement liés par le soutien qu'ils apportaient à Ali en sa qualité de dirigeant de la communauté islamique.
Après l'assassinat d'Ali en 661, certains chiites ont considéré ses différents fils comme ses successeurs de droit au titre de calife : les descendants d'Ali sont devenus rivaux imités par leurs adeptes chiites qui se sont divisés en fonction de leur choix. Par la suite, les chiites ont commencé à développer des croyances religieuses différentes qui les ont séparés des autres musulmans. Les sunnites et les chiites diffèrent en plusieurs domaines. Leur moindre désaccord concerne la loi et les rituels, et leurs plus grandes divergences concernent leur manière de concevoir l'autorité légitime, la théologie et le génie de leur culture.
Les sunnites reconnaissent comme légitimes les trois premiers khalifes Abou Bekr, Omar et Osman, tandis que les chiites les regardent comme des usurpateurs et ne font commencer le khalifat qu'avec Ali, fils d'Abou-Taleb, gendre du Prophète dont il avait épousé la fille Fatimah. Ils acceptent la Sunna comme complément du Coran et comme le seul commentaire qu'on en doive donner; les chiites, au contraire, considèrent la Sunna comme peu importante et croient que l'on peut commenter le texte du livre sacré avec les moyens que l'humain peut puiser dans son intelligence.
Sunnisme, courant majoritaire de l'islam. L'autre principale tradition musulmane est le chiisme, considéré par les sunnites comme plus ou moins hérétique. Les sunnites sont ainsi appelés du fait de l'importance qu'ils accordent à la Sunna, l'ensemble des paroles et des actions du prophète Mahomet que tous les croyants doivent s'efforcer d'imiter. La Sunna et le Coran sont considérés comme les deux sources principales de la loi islamique. Les chiites soulignent aussi l'importance de la Sunna, à la différence qu'ils y incluent les paroles et les actions de leurs imams.
Les sunnites ayant été les premiers à établir la primauté de la Sunna, il est fort probable qu'ils se soient fait appeler les "gens de la Sunna" pour se distinguer des autres groupes musulmans, et cela avant même que les chiites aient développé leur propre système juridique. Selon la loi sunnite traditionnelle, l'idée existait déjà du vivant de Mahomet de consulter et suivre l'exemple du Prophète en cas de doute sur une question religieuse ou juridique. Les injonctions du Coran appelant à "obéir à Allah (Dieu) et à son Prophète" sont fréquemment citées pour justifier cette idée.
D'après cette théorie, les compagnons du Prophète, lorsque celui-ci était encore en vie, s'attachaient particulièrement à se rappeler ses paroles et ses gestes et ils les transmirent après sa mort à la génération suivante, qui la passa à son tour à la suivante, et ainsi de suite. Les anecdotes individuelles par lesquelles étaient transmises les paroles ou les actions du Prophète furent appelées hadiths. Après la mort du Prophète, lorsqu'une question religieuse ou juridique venait à se poser, il était d'usage parmi les hommes pieux d'examiner le Coran et la Sunna pour y trouver une réponse.
De cette façon, l'autorité du Prophète se perpétuait même après sa disparition. La sunna. Dans le Coran, le terme sunna est employé pour désigner la « loi immuable » de Dieu sous l'expression sunna Allah qui signifie « règles de Dieu ». La sunna, selon le Coran, englobe les règles ou « lois » de Dieu qui ont été prescrites à tous les prophètes, y compris le prophète de l'Islam, Mahomet. Ces récits, appelés hadiths, sont au nombre de plusieurs (dizaines de) milliers qui ont fait l'objet de nombreuses compilations. Les sunnites se revendiquent de la sunna, ce que leur contestent les chiites.